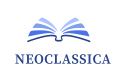L’Indispensable sur la communauté et l’individu. Prépas scientifiques français-philosophie. Concours 2025-2026, Paris, Ellipses, mai 2024, 232 pages, 16 €. ISBN : 9782340087576. Disponible en version numérique : 13,99 €. ISBN : 9782340089235.
Retrouvez ces informations sur le site des éditions Ellipses. Vous y trouverez également un extrait et la table des matières.
Deux autres ouvrages sont publiés aux éditions Ellipses sur le nouveau thème : L’Intégrale, qui approfondit les enjeux du programme, et Le thème en 21 dissertations, qui permet de s’entraîner efficacement à cet exercice qui peut faire une réelle différence aux concours.
Je vous propose ici un extrait du chapitre sur les deux pièces d’Eschyle au programme (© Ellipses), rédigé par Christine Vulliard et moi-même.
L’individu roi et ses rapports à la communauté
Les deux rois de nos pièces sont bien caractérisés comme individus avec des marques personnelles et des personnalités individualisées. Étéocle apparaît comme un homme autoritaire, assez violent puisqu’il ira même jusqu’à menacer de mort les contrevenants à ses ordres (« quiconque n’entendra pas mon ordre, homme, femme – ou tout autre –, verra un arrêt de mort tôt délibéré sur lui, et n’échappera pas, j’en réponds, aux pierres meurtrières du peuple », p. 148), misogyne (il appelle les femmes « intolérables créatures », « fléau », ibid.), sourd aux sentiments ou aux propos des autres. Il peut faire preuve d’hybris (c’est-à-dire de démesure) en se fiant totalement à ses propres décisions et en s’aveuglant quelque peu, puisqu’il semble surpris que son adversaire à la septième porte soit Polynice, oubliant de toute évidence l’Érinys* familiale. Pélasgos, quant à lui, est un homme à l’écoute, fier de ses origines (il a donné son nom à son peuple), capable de pitié, un homme qui doute et réfléchit à ce qui représente la meilleure voie pour sa cité, cruellement partagé entre le respect des lois de l’hospitalité et la peur de voir sa cité détruite par une guerre avec les Égyptiades (les 50 fils d’Égyptos). En outre, il manifeste tout au long de la pièce son respect pour la communauté des femmes, réitéré juste avant sa sortie de scène (p. 84).
En conséquence, les deux individus, en tant que rois, présentent un rapport très différent à la communauté que constitue leur cité et dont ils sont l’expression. Étéocle estime incarner sa cité donc il prend ses décisions seul et les impose à la communauté, aux guerriers comme aux femmes. Dès l’ouverture de la pièce, il définit sa fonction de chef et annonce des mesures déjà prises, sans consulter les citoyens qui doivent se contenter d’obéir. C’est un chef à la tête de son peuple, qu’il veut guider tel un pilote (la comparaison revient plusieurs fois et elle est particulièrement courante dans le domaine de la pensée politique antique). Il se voit comme tel : « Peuple de Cadmos, il doit dire ce que l’heure exige, le chef qui, tout à sa besogne, au gouvernail de la cité, tient la barre en main, sans laisser dormir ses paupières. Car, en cas de succès, aux dieux tout le mérite ! » (p. 143). Et il est vu comme tel par le messager : « Allons, bon pilote, à la barre ! » (p. 145). Alors même que les assaillants ont procédé à un tirage au sort, on le voit aussi choisir seul les guerriers qu’il mettra à chaque porte : « Moi, aux sept issues de nos remparts, pour tenir tête à l’ennemi, j’irai placer six guerriers de grande allure – et moi septième » (p. 152). En vérité, c’est bien lui qui va sauver sa cité comme en témoignent sa bonne analyse des forces en présence (avec l’évocation des boucliers) et son choix final. Lors de l’agôn*, durant lequel les femmes défendent leur position, Étéocle leur impose sa volonté car il est conscient que l’ordre intérieur est nécessaire à l’ordre extérieur (p. 148) : il se veut le garant des deux. Même s’il est conscient de l’état d’esprit de son peuple (prompt à critiquer les chefs), il a avant tout le souci de sa cité, quitte à se montrer tyrannique, et, lors de cet agôn* et avant sa sortie de scène, il laisse entrevoir ses sentiments profonds sous sa détermination apparente : en se précipitant vers le fratricide, il sait que ce sera sa propre perte mais que, par sa mort, il va satisfaire les dieux et permettre le salut de sa ville. Ainsi l’individu accepte de se sacrifier pour la communauté alors que Laïos, qui préféra avoir une descendance dont il savait qu’elle causerait la perte de sa cité, Polynice, qui attaque sa cité natale, et même Œdipe, qui maudit ses fils en condamnant ainsi Thèbes à une guerre fratricide (p. 166-167), ont sacrifié leur cité à leurs passions.
Pélasgos, pour sa part, se révèle vraiment être l’expression de sa communauté, à laquelle il demande son avis sans décider seul : même si, de toute évidence il influence le vote (et le reconnaît : « je vais convoquer les gens de ce pays, pour disposer en ta faveur l’opinion populaire », p. 69), ne fût-ce qu’en donnant aux Danaïdes des conseils pour bien mettre en évidence leur statut de suppliantes et susciter la pitié de tous (p. 68), il ignore ce que va décider le peuple mais il entend « disposer en [faveur des Danaïdes] l’opinion populaire » (p. 69), expression de la communauté qu’il gouverne et qui rendra finalement un « décret décisif » « d’une voix unanime » (p. 72)[1]. Il n’est pas un roi tout-puissant, bien que son entrée en scène soit impressionnante (voyez son arrivée sur son char, avec une escorte armée, et le discours où il présente l’étendue de sa puissance, p. 59-60). D’une certaine façon, il incarne une vision démocratique idéale de l’autorité, ce qu’atteste son dialogue avec le chœur des Danaïdes : «si la souillure est pour Argos, pour la cité entière, que le peuple s’occupe d’en découvrir le remède. Pour moi, je ne saurais te faire de promesse, avant d’avoir communiqué les faits à tous les Argiens » (p. 64) ou « quel que soit mon pouvoir, je ne saurais rien faire sans le peuple » (p. 65). Il se distingue en étant un roi pour qui la souveraineté comprend aussi la protection des faibles, au point qu’à la fin de la pièce il se propose même comme « répondant » (un étranger qui s’installait en Grèce devait avoir un citoyen comme garant, un prostatès) en même temps que tous les citoyens qui ont voté pour la protection des Danaïdes.
[1] Cette décision collective est rapprochée, par métaphore, d’un « clou assez fermement planté et enfoncé pour que rien ne l’ébranle jamais » (p. 83).