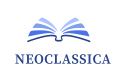Cette page concerne les CPGE littéraires.
FRANÇAIS
Une très longue liste de sujets proposés à l’épreuve commune de français de l’ENS Ulm est disponible sur cette page.
Vous trouverez au début de la fin de la page susmentionnée les œuvres exclues de l’épreuve commune d’explication de texte français hors programme.
PHILOSOPHIE
Une très longue liste de sujets proposés à l’épreuve commune de philosophie de l’ENS Ulm est disponible sur cette page. Vous pouvez aussi vous amuser à aller voir les sujets de leçons de l’Agrégation externe de Philosophie !
HISTOIRE
Des listes de sujets proposés à l’épreuve commune d’histoire contemporaine de l’ENS Ulm de Paris sont disponibles sur cette page.
Des listes de sujets proposés depuis 2000 à l’épreuve à option d’histoire ancienne de l’ENS Ulm de Paris sont disponibles sur cette page.
ANGLAIS
Retrouvez sur cette page les modalités de tirage, la méthode, les conseils de langue et les auteurs tombés pour l’épreuve commune d’anglais à l’ENS Ulm de Paris.
LATIN
Je vous propose ici quelques textes d’oraux afin que vous puissiez vous entraîner et voir le format des épreuves. Vous trouvez aussi des exemples et des listes de références sur les sites officiels des ENS.
ENS LSH de Lyon (non-spécialistes)
Plusieurs exemples de sujets donnés aux non spécialistes des différentes séries littéraires (A/L) sont disponibles sur le site de l’ENS de Lyon. En voici près de cent :
Les passages donnés aux spécialistes de Lettres classiques dans le cadre de leur épreuve sur programme sont précisés dans les rapports de jury.
Retrouvez ici les sujets de la session 2023 (spécialistes et non spécialistes) [Références seules].
Voici les références pour les textes de 2022, de 2024 et de 2025.
ENS Ulm de Paris (non-spécialistes et spécialistes)
Le temps de préparation est désormais d’1h 30 pour 30 min de passage (20 min de prestation et 10 min de reprise/discussion). Le dictionnaire n’est pas autorisé (pour l’instant mais une réforme est en cours).
Les rapports de jury présentent chaque année au moins un billet donné à quelqu’un lors de la session concerné.
Les textes proposés ci-dessous ont été donnés comme oraux de préparation aux concours. Ils sont accompagnés du vocabulaire que j’estime pouvoir figurer sur un billet de khôlle, voire d’oral de concours. Cela dit, je suis assez généreux et le vocabulaire spécifique appris durant l’année en fonction du programme de culture antique conditionne évidemment les mots que fournissent les professeurs ou les jurys.
Retrouvez quelques khôlles sur les animaux sur cette page.
Mots à bien connaître :
(2022) imperator ; pro ; in suivi de l’accusatif ; fero ; ingens ; fari ; legatio ; patior (sous la forme passus) ; fieri ; Hercule ; peior ; quoniam ; quisque ; uis ; diuus ; turba ; quicumque ; munus ; reor ; seruilis ; cras ; intus adverbial ; propter ; malle ; munus ; fur ; decus ; pauci ; circiter ; pro suivi de l’ablatif ; uereor (sous la forme uerita) ; probitas ; tandem ; nondum ; tener ; dubito ; cunctor.
Exemples de sujets donnés à l’oral d’Ulm :
Non-spécialistes
Augustin, Confessions IX, 9, 19
Catulle 42; 64, 71-93
César, Guerre des Gaules IV, 6-7; VI, 11-12
Guerre civile I, 72; III, 9, 2-7; III, 87
Cicéron, Pour Archias 4-5; 18-19
Philippiques 2, 23, 57-58; 2, 27, 66-67
Tusculanes 1, 103-104; 5, 58-60; 5, 64-66; 5, 113-114
De la divination I, 48-49; 1, 77-78; II, 23
Lettres familières XIV, 4, 1-3
Lettres à Atticus IX, 10, 1-3
Brutus 254-257; 313-315
De l’orateur I, 1-3; I, 14-16
Pour Sestius 96-97
Sur la loi agraire 2, 8-9
République VI, 10-11; VI, 13-16; VI, 22-23
Des devoirs III, 94-95
Aulu-Gelle, Nuits attiques I, 23; IX, 3 ; XIX, 12, 7-10
Histoire Auguste, Sévère Alexandre 29-30
Horace, Epîtres I, 2, 1-26
Tite-Live I, 13, 1-6; 1, 24, 4-9 ; V, 40, 4-10; XXVII, 13, 2-8; XXXII, 8, 9-16; XXXIV, 2-3 ; XLII, 3
Lucrèce III, 59-77; III, 884-903 ; V, 958-981 ; V, 1-21
Ovide, Métamorphoses I, 283-303; 1, 642-663 ; II, 35-52
Fastes II, 429-448; III, 1-22
Amours II, 10, 1-20
Pétrone, Satyricon 29; 48-49; 89-90
Plaute, Aululaire 40-60
Stichus 155-180
Ménechmes 77-98
Pline l’Ancien XXXV, 8-9
Pline le Jeune, Lettres I, 16, 1-5 : II, 18 : 11, 20, 1-6; III, 18, 1-5
Panégyrique de Trajan 7, 3-7; 31, 2-6; 45, 3-6
Properce I, 4, 9-32; II, 12, 1-24 ; 11, 19, 1-26
Quintilien I, 1, 4-7; III, 7, 10-13
Salluste, Catilina 6; 18; 51
Jugurtha 95-96
Histoires II, 47, 6-12
Sénèque, A Lucilius 21, 2-5 : 56, 3-5; 95, 29-33; 122, 15-17
Questions naturelles II, 42-44; II, 45-46; III, pr, f. 5-7
Des bienfaits I, 5, 2-6; I, 6-7
De la brièvete de la vie IX, 1-3
Troyennes 19-37
Sénèque le Père, Suasoires VI, 17
Suétone, Tibère 70; Claude 10; Titus 2-3
Tacite, Annales I, 61, 1-14 ; II, 71 ; III, 53-54 ; XIII, 3 ; XVI, 1-3
Dialogue des orateurs 12, 1-5
Térence, Eunuque 241-263
Heautontimoroumenos 96-118; 1024-1044
Tibulle I, 1, 41-60; 1, 1, 57-78; 1, 4, 33-56; 1, 6, 15-34 ; 1, 10, 29-48
Virgile, Bucoliques V, 20-39
Enéide I, 522-543; II, 707-729; II, 730-751; II, 771-791; III, 564-587; III, 588-610
Apulée, Métamorphoses, IV, 28-29
Aulu-Gelle, Nuits Attiques, 1, 10; VI, 18, 1-9 ; IX, 11, 4-8
Augustin, Cité de Dieu, 3, 19
– Confessions, I, 13, 20-21
Catulle, 8 ; 34 ; 64, 132-153
César, B. C., III, 103.5-104.3
– B. G., IV, 5-6
Cicéron, Ad Atticum, I, 17, 5-6 ; VIII, 11, 1-2
- Ad Familiares, IV, 13, 2-3
Brutus, 53-55
De Finibus, II, 63-65
De Officis, I, 103-104
De oratore, III, 126-128
De Signis, 51-52 ; 74-75 ; 86-87 ; 106-107 ; 107-108 - Pro Caelio, 33-34
Pro Sexto Roscio Amerino, 23-25 ; 27-28 - Tusculanes, I, 97 ; III, 2
Florus, Abrégé d’Histoire romaine, II, 8, 6-14
Histoire Auguste, Hadrien, 13
Horace, Epítres, II, 1, 108-131
Hygin, Fables, 274, 10-13
Lactance, Institutions divines, V, 8, 6-10
Lucrèce, DRN, II, 352-370; II, 865-885 ; IV, 1058-1078
Macrobe, Saturnales, VII, 2, 3-7
Ovide, Ars Amatoria, 1, 109-130 ; III, 469-486 ; III, 749-768
— Fastes, II, 491-512
– Métamorphoses, II, 847-868 ; VII, 9-28 ; XI, 592-612
Pétrone, Satyricon, 49-50 ; 123 ; 209-232
Phèdre, Fables, IV, 25
Plaute, Amphitryon, 341-360
Plaute Pseudolus, 74-93
Pline le Jeune, Epist, IV, 8 ; IV, 13, 3-6 ; V, 8, 8-13 ; VI, 20, 3-8 ; VI, 21
– Panégyrique de Trajan, 54, 3-7 ; 85
Quinte-Curce, Histoires, VIII, 14, 41-46
Quintilien, I. O., II, 2, 4-8
Salluste, C. C., 14 ; 15.1-16.4 ; 31.5-32.1 ; 32.3-34.1 ; 61
Salluste, B. I., 64, 1-5
Sénèque, Cons. ad Helviam, XVIII, 1-6
- Cons. ad Marciam, XI, 1-3
De Beneficiis, V, 24
De constantia Sapientis, V, 6-7
De Tranquillitate, XVII, 4-6 - Epist. ad Luc., 53, 1-4 ; 76, 30-32
Suétone, Auguste, 28 ; César, 84, 2-7 ; Domitien, 17, 1-5 ; Galba, 1-2 ; Tibère, 68 ; Titus, 8, 1-6;9
Tacite, Agricola, 46
– Annales, I, 6 ; XIII, 16, 1-4 ; XIV, 20
Térence, Adelphes, 48-67 ; 88-108
Tibulle, Elégies, I, 10, 1-22
Tite-Live, 1, 16, 2-8 ; I, 31, 1-6; 1, 34, 7-12 ; 1, 35, 1-6 ; II, 40, 5-10 ; XXI, 14.1-15.2 ; XXV, 3, 8-13 ; XXVI, 10, 3-8
Valère Maxime, II, 2, 2-3
Virgile, Enéide, II, 162-182; I1, 274-294 ; II, 318-338 ; 11, 348-369 ; III, 655-674 ; VIII, 432-
453; VIII, 478-498 ; IX, 1-22 ; IX, 477-497; X, 633-652
– Géorgiques, IV, 345-367
Spécialistes
Calpurius Siculus, Bucoliques, I, 33-54
Catulle, 61, 191-235
Catulle, 64, 215-237
Catulle, 64, 387-408
Cicéron, Orator, 69-71
Pro Flacco, 7, 15-17
Horace, Satires, I, 6, 65-88
Lucain, I, 125 -143
Lucrèce, DRN, II, 312-332
Manilius, Astronomica, III, 1-23
Martial, Épigrammes, V, 37
Ovide. Ars Amatoria, I, 135-156; II, 123-142.
Amores, III, 2, 1-20.
Plaute, Amphitryon, 592-616
Pline le Jeune, Lettres, I, 20, 1 – 5 ; V, 8, 8-13
Properce, III, 16, 13-30
Salluste, Guerre de Jugurtha , VII, 6-8,2
Sénèque, Lettres à Lucilius, 15, 2-5
Silius Italicus, Punica, I, 144-164
Suétone, Othon, 5; 8.
Tacite, Annales, I, 1 – 2, 1.
Tertullien, Apologétique, II, 6 – 7
Tite-Live, I, 39 ; XXI, 19, 6 – 11 ; XXV, 24, 11 – 25, 2
Velleius Paterculus, Histoire romaine, II, 107
Virgile, Énéide, II, 232 – 253 ; II, 506 – 525 ; I1, 535 – 557 ; II, 705 – 725; VII, 323 – 342
Auteurs tombant aux oraux de latin (à l’ENS Ulm de Paris) :
Pour les non spécialistes
| Les plus fréquents | Apulée Augustin Catulle César Cicéron Horace Lucrèce Ovide Plaute Properce Salluste Sénèque Tacite Tite Live Virgile |
| Très fréquents | Juvénal Lucain Quinte Curce |
| Fréquents | Silius Italicus Stace Suétone Térence |
| Moins fréquents | Aulu-Gelle Claudien Pétrone Pline l’Ancien Quintilien Tibulle Valère Maxime Velléius Paterculus |
Pour les spécialistes
| Les plus fréquents | Cicéron Lucrèce Ovide Plaute Sénèque Tacite Virgile |
| Très fréquents | Horace |
| Fréquents | Apulée Lucain Suétone Tite Live |
| Moins fréquents | Catulle César Juvénal Pétrone Pline le Jeune Properce Salluste Térence |
Les auteurs non mentionnés dans les tableaux sont vraiment peu fréquents. Nous en proposons cependant une liste pour vous donner des idées de textes : Ammien Marcellin, Boèce, Calpurnius Siculus, Columelle, Corippe, Cornélius Népos, Florus, Fronton, Lactance, Martial, Minutius Félix, Perse, Pseudo-Sénèque, Rutilius Namatianus, Sulpice Sévère, Tertullien, Vitruve. Cette liste n’est pas exhaustive.
L’oral de latin (extrait de Méthod’ Latin)
PRÉPARATION
• Prendre la peine de lire le titre, les indications, les notes et les vocabulaire fournis par le jury !
• Bien savoir gérer son temps de préparation
• Pour les épreuves sans dictionnaire, tenter de comprendre les mots a priori inconnus grâce à l’étymologie, à la formation des mots ou à des rapprochements avec le français (ou avec une autre langue)
• Essayer de ne pas réduire le temps dévolu au commentaire à peau de chagrin, le cas échéant
INTRODUCTION
• La rendre concise et frappante
• Ne pas en faire trop sur l’auteur (ne pas donner de biographie détaillée)
• Caractériser le texte (poésie/prose ; genre ; auteur ; œuvre ; énonciation)
• Contextualiser le texte et, le cas échéant, présenter les personnages et leurs rapports
• Donner les éléments essentiels qui montrent d’emblée que vous avez compris l’intérêt et les enjeux du texte
• Ne pas se contenter de reprendre le chapeau introductif s’il en a un
LECTURE
• Lire de manière fluide
• Autant que faire se peut, faire entendre les groupes de mots qui vont ensemble
• Bien lire les y qui se prononcent comme des u français
• Mettre le ton si nécessaire (discours, dialogue théâtral…) et être expressif
• Ne pas oublier les élisions en poésie
Aujourd’hui, on préconise la prononciation restituée. Quoi qu’il en soit, tenez-vous-en à la prononciation que vous avez choisie.
TRADUCTION
• Reprendre le texte par groupes de mots
• Traduire précisément (vocabulaire, temps, structures…)
• Ne changer l’ordre de la phrase que si cela est nécessaire
• Le cas échéant, proposer rapidement une traduction littérale – c’est un des avantages de l’oral – puis une traduction en bon français, notamment pour les passages très délicats ou impossibles à rendre immédiatement en français
• Privilégier l’exactitude à l’élégance, sans pour autant se priver de cette dernière
COMMENTAIRE
• Dès l’introduction du commentaire, donner les éléments clefs du texte, son intérêt, ses enjeux
• Annoncer clairement si vous allez faire un commentaire linéaire ou composé (selon les modalités de l’épreuve, qu’il faut évidemment connaître sur le bout des doigts)
• Énoncer clairement et posément l’axe de lecture que sera suivi et y rattacher les remarques tout au long du commentaire
• Proposer clairement soit les parties de commentaire pour un commentaire composé soit une structure précise du texte (ses grands mouvements) pour un commentaire linéaire
• S’appuyer systématiquement sur des segments du texte ou sur un élément d’histoire ou de culture latines
• Connaître les figures de style, les notions de métrique et le vocabulaire grammatical* (natures, fonctions, propositions…)
• Faire des remarques d’ordre stylistique et grammatical
• Toujours les relier à une interprétation possible
• Étudier l’ensemble du texte à part égale
• Conclure rapidement en reprenant l’axe de lecture
• Soigner les dernières minutes, qui sont la dernière impression que vous laissez
REPRISE
• Rester concentré : l’épreuve n’est pas finie !
• Rester ouvert : la reprise est censée faire gagner des points
• Être réactif
• Prendre son temps mais ne pas hésiter à dire que l’on ne sait pas : il vaut mieux passer au point suivant pour tenter de gagner des points plutôt que de perdre du temps et de laisser un grand silence
• Reprendre le segment que le jury signale comme incorrect et proposer une nouvelle traduction sans attendre qu’on le demande
Il faut trouver un équilibre : on a le droit de rester sur ses positions, pour tel ou tel point de commentaire, si on argumente bien en s’appuyant précisément sur le texte, mais il faut être capable de reconnaître ses erreurs et de proposer une autre traduction ou idée.
EXPRESSION ET ATTITUDE
• Ne pas oublier de dire « bonjour Madame/Monsieur » et « au revoir »
• Parler dans un français correct
• Parler clairement et distinctement
• Éviter de ponctuer votre prestation des insupportables « euuuh » qu’on entend trop souvent
• Parler avec un débit correct et intelligible pour l’auditoire
• Regarder le jury et ne pas avoir toujours les yeux fixés sur ses notes
• Ne pas exagérer ses gestes lorsqu’on parle
• Bien gérer le temps imparti
• Donc avoir une montre et la regarder régulièrement !
• Savoir maîtriser son stress avant et pendant l’épreuve ainsi que devant le jury
• Ne pas oublier de sourire de temps en temps !
*À cet égard, vous pouvez vous rapporter aux Terminologies grammaticales présentes ici.
GREC ANCIEN
ENS Ulm de Paris
Conclusion, éculée et bonasse (du rapport du jury 2016) : le ‘petit grec’ épargnera bien des misères à tout le monde.
Extraits du rapport de jury de 2021 [La méthode est détaillée dans ces pages et on y trouve des exemples de billets donnés au concours. Si le jury prend la peine de donner ces indications lexicales, c’est qu’il attend à coup sûr que les candidat•es connaissent ces mots !]
Nous reproduisons, à titre indicatif, la liste de mots proposée dans les rapports précédents, enrichie de l’expérience de cette session. Cette boîte à outils ne saurait être exhaustive et nous renvoyons, pour ce qui est du vocabulaire attique courant, aux fameuses « pages jaunes » du manuel de grec de J. Métayer et d’A. Lebeau et, pour tout ce qui touche aux hellénismes, aux pages fondamentales de la Syntaxe grecque de M. Bizos (p. 242-256). Rappelons aussi que la morphologie verbale est la pierre de touche de la maîtrise de la langue grecque.
- Substantifs : αἴσθησις, ἀπάτη, ἀρχή dans ses différents sens, βία (à ne pas confondre avec βίος), γνώμη (« opinion » mais aussi « décision »), δαπάνη, εἰσφορά, ἐνιαυτός, ἐπιστήμη, εὔνοια, ἡλικία, ἡσυχία, κάλλος (trop souvent confondu avec l’adjectif et son comparatif), κέρδος, κόσμος (« ordre », « univers », mais aussi « parure », « ornement »), κρίσις, μειράκιον, μεταβολή, ναός, νέμεσις, νόστος, οἰκέτης, πλεονεξία, πόθος, πόνος, πολιτεία, πολυπραγμοσύνη et son antonyme ἀπραγμοσύνη (ainsi que les adjectifs πολυπράγμων et ἀπράγμων), le pluriel πράγματα au sens de « difficultés, ennuis », πρεσβεία, στόμα, συγγνώμη, συμφορά, τεκμήριον, τρυφή, ὑπερβολή, φήμη, φόρος, φθόνος, ὥρα.
- Verbes : ἀγανακτέω-ῶ, αἰδέομαι-οῦμαι, αἱρέω-ῶ, αἴρω, αἰσχύνομαι, ἁλίσκομαι (avec son aoriste à voyelle longue ἑάλων), ἀμύνομαι, ἀναγκάζω, ἀναλίσκω, ἀξιόω-ῶ, ἀπατάω-ῶ, ἀπειλέω-ῶ, ἀπέχομαι, ἀποκρίνομαι, ἀπολαύω, ἀποστερέω-ῶ, ἅπτομαι, ἀρέσκω, ἀτιμάζω, ἀφαιρέω-ῶ et ἐξαιρέω-ῶ, ἀφικνέομαι-οῦμαι, βαίνω (aoriste ἔβην), βάλλω, le poétique βλώσκω (et son aoriste 2 ἔμολον), βούλομαι (très souvent confondu avec βουλεύω), δέω et δέομαι, διαλέγομαι, διαφέρω (dans ses deux sens : « être différent de » et « être supérieur à »), διδάσκω, δοκέω-ῶ (et ses différents sens et constructions), δυσχεραίνω, ἐάω-ῶ (connaître le participe ἐῶν, ῶντος, l’aoriste εἴασα, l’impératif aoriste actif ἔασον, l’infinitif, enfin, ἐᾶν, à bien distinguer d’ἐάν), εἰκάζω, ἐξετάζω, ἐπιδείκνυμι, ἐπιτιμάω-ῶ, ἐργάζομαι, ἐσθίω, ἑστιάω-ῶ, εὐδοκιμέω-ῶ, ζηλόω-ῶ, ζημιόω-ῶ, ζητέω-ῶ, ἥδομαι (et son aoriste ἥσθην), νικάω-ῶ et son passif ἡττάομαι-ῶμαι, les principaux composés de ἵστημι et de ἵημι, κακῶς ἀκούω et son antonyme εὖ ἀκούω (qui servent de passif à κακῶς et εὖ λέγω), καταγιγνώσκω, καταστρέφομαι, καταφρονέω-ῶ, κατορθόω-ῶ, κομίζω, κοσμέω-ῶ, κτάομαι-ῶμαι, λοιδορέω-ῶ, μανθάνω (et son aoriste ἔμαθον), μέλλω (+ infinitif dans son sens usuel de « être sur le point de », mais aussi au sens de « tarder »), οἰκέω-ῶ et ses composés, οἰμώζω, οἰκτίρω, οἴχομαι + participe, ὁμολογέω-ῶ, ὀνίνημι et ὠφελέω-ῶ (tours actifs et passifs), ὀφείλω (y compris dans l’expression du regret), ὁράω-ῶ (imparfait ἑώρων), ὀργίζομαι, παίω et son passif πλήττομαι (ainsi que ἐκπλήττω), παραινέω-ῶ, παρέρχομαι, παρέχω, πειράομαι-ῶμαι, πορίζω, προδίδωμι, προσέχω, πωλέω-ῶ et ὠνέομαι- οῦμαι (et ἐπριάμην), σπουδάζω, στυγέω-ῶ, συμβαίνει (et son aoriste συνέβη), συμφέρω (et l’expression usuelle τὸ συμφέρον), τιμωρέομαι-οῦμαι, τολμάω-ῶ, τυγχάνω dans ses deux emplois principaux en prose classique (+ génitif : « obtenir » ; + participe : « se trouver par hasard »), ὑβρίζω, ὑπακούω, ὑπισχνέομαι-οῦμαι, ὑποκρίνομαι, φείδομαι, les trois sens principaux de φεύγω, φρονέω-ῶ (construit avec un adverbe ou un accusatif d’objet interne), χαρίζομαι, χωρέω-ῶ et ses composés, ψέγω.
- Formes de verbes usuels à bien connaître : αἱρέω-ῶ (aoriste εἷλον, infinitif aoriste ἑλεῖν, participe ἑλών, όντος), ἁλίσκομαι (aoriste ἑάλων), ἀπαντάω-ῶ, ἀπόλλυμι, βοηθέω-ῶ, δίδωμι, εἰμί, εἶμι et ἵημι, ἕπομαι, ἐράω-ῶ (trop souvent confondu avec ἐρωτάω-ῶ), ἔρχομαι, ἐρωτάω-ῶ (rappelons qu’ἠρόμην sert d’aoriste à ἐρωτάω-ῶ et qu’il convient de bien repérer le participe et l’infinitif correspondants : ἐρόμενος, ἐρέσθαι), ἔχω (et ses deux futurs : ἕξω et σχήσω), ἡττάομαι-ῶμαι (passif de νικάω-ῶ), λέγω (et, en composition, ἀγορεύω), μέλω, οἶδα (dont les formes ne doivent pas être confondues avec celles d’ὁράω-ῶ), ὁράω-ῶ (imparfait : ἑώρων, aoriste : εἶδον, parfait : ἑόρακα), πάσχω, πείθω, προσέχω, προσήκω, σκοπέω-ῶ (dont le futur et l’aoriste sont empruntés à *σκέπτομαι).
- Expressions et hellénismes : λόγον ποιεῖσθαι, εὖ ποιεῖν, εὖ πράττειν, πράγματα παρέχειν, ἔχω + adverbe (y compris interrogatifs, comme πῶς) = εἰμί + adjectif, sens de χαῖρε à l’impératif, ποιοῦμαι περὶ πολλοῦ / πλείονος / οὐδενός / ὀλίγου.
- Adjectifs : ἄσμενος, δειλός, δεινός, ἔνοχος, κύριος, οἰκεῖος, ὅσιος, πένης, πιστός (actif, passif), σαφής, φαῦλος, les comparatifs du type ἡδίων, ἄλλος précédé de l’article (ὁ ἄλλος, « le reste de », d’où le tour ἄλλως τε καί, sous ses différentes déclinaisons).
- Les adverbes σχεδόν, εἰκότως, ὅμως sont mal connus, ἀδεῶς ignoré, de même que ὀπίσω ou ὄπισθεν et ἔμπροσθεν, ainsi que le couple ἐμποδών / ἐκποδών.
- Les conjonctions de subordination : ἐπειδή doit être distingué de l’adverbe ἔπειτα, ὁπότε de πώποτε ; il faut connaître la différence entre ἵνα + subjonctif et ἵνα + indicatif, bien relier ἐπειδὴ et τάχιστα dans la locution ἐπειδὴ τάχιστα (les deux termes ne sont pas toujours accolés), et identifier ἐξ ὅτου. Ne pas confondre ὥστε et ὥσπερ, ἤν et ἐπειδάν ; et reconnaître dans certains ἄν l’équivalent de ἐάν.
- Les prépositions πρό, ὑπέρ, ἕνεκα, ἄνευ et χωρίς ne sont pas toujours bien comprises ni construites. Les sens de περί, de διά et de μετά sont mal distingués. On ajoutera à cette rubrique la préposition ὡς + accusatif de personne, une des acceptions d’un mot dont les constructions sont multiples et souvent mal connues.
- Les deux formes d’expression de la conséquence sont parfois confondues (ὥστε + indicatif : conséquence présentée comme réelle / ὥστε + infinitif : conséquence présentée comme logique). Le sens que prend οὕτως en corrélation avec ὥστε (« si… que », « tant… que ») est aussi souvent éludé : on ne saurait traduire οὕτως… ὥστε en corrélation par « ainsi… si bien que » ; le sens intensif et explicatif de οὕτως en tête de phrase n’est pas reconnu.
- Il arrive que des candidats, qui connaissent bien le sens d’un tour précis, aient du mal à repérer les expressions parallèles. Il convient de se rappeler, par exemple, que l’expression μέγα φρονεῖν, en général connue des candidats, est un cas particulier du tour φρονεῖν + adverbe, où le verbe φρονεῖν, « nourrir tels ou tels sentiments », a besoin d’être précisé (ταὐτὰ φρονεῖν, κακῶς φρονεῖν, etc.). La même remarque vaut pour le verbe ἀκούειν : les expressions εὖ, καλῶς, κακῶς ἀκούειν sont en général bien traduites, mais les candidats ne retrouvent plus le tour si l’adverbe est plus précis (αἰσχρῶς ἀκούειν) ou s’il est au comparatif (ἄμεινον ἀκούειν). Il en va de même pour le tour « actif » correspondant : εὖ λέγειν. Ajoutons à cette liste les expressions εὖ ποιεῖν τινα et son « passif » εὖ πάσχειν avec toutes leurs variations, εὖ πράττειν / κακῶς πράττειν, διατιθέναι τινά + adverbe et son « passif » διακεῖσθαι + adverbe.
- Enfin, nous réaffirmons avec force la valeur discriminante des esprits et des accents. Les candidats confondent parfois l’adjectif au neutre pluriel ἄλλα avec la conjonction de coordination ἀλλά, les formes d’impératif (φίλει, εὐφήμει) avec des formes d’indicatif (φιλεῖ, εὐφημεῖ). Il arrive que πειθώ (la persuasion) soit analysé comme l’indicatif présent du verbe « persuader » (πείθω), que l’adverbe οὔτοι (« non certes », « en vérité non ») soit traduit comme s’il s’agissait du pronom-adjectif démonstratif οὗτοι ou encore que, dans les crases courantes ἅνθρωπος ou ἁνήρ, l’article soit ignoré.
Confusions fréquentes, toutes catégories confondues :
αἱρέω-ῶ / αἴρω
ἀπαντᾷ / ἅπαντα
ἀπέωσα /ἀπέσωσα
βία / βίος
βοάω-ῶ / βοηθέω-ῶ
βουλεύω / βούλομαι
δεινός / δειλός
διοικέω-ῶ / διώκω
formes de δοκέω-ῶ / formes de δίδωμι
ἐᾶν / ἐάν
εἰς / εἷς
ἐπειδή / ἔπειτα
ἐρῶ (futur contracte de λέγω) / ἐράω-ῶ
ἐράω-ῶ / ἐρωτάω-ῶ
ἕψομαι (futur de ἕπομαι) / ὄψομαι (futur de ὁραω-ῶ)
ἥν (pronom relatif) / ἤν (conjonction de subordination)
κάλλος / καλός / καλλίων
κἄν (= καὶ ἐάν) / κἀν (καὶ ἐν)
οἶδα / εἶδον (et εἰδώς / ἰδών, etc.)
ὅ τι / ὅτι
οὐδέ / οὔτε
ὀφείλω / ὠφελέω-ῶ
πείσομαι (futur de πάσχω) / πείσομαι (futur du moyen πείθομαι) πολέμιος / πόλεμος
προσέχω / προσήκω
σαφής / σοφός
τις / τίς
χρῄζω / χρή
χρῆναι / χρῆσθαι
ὥσπερ / ὥστε
Auteurs tombant aux oraux de grec ancien (sur 10 ans) :
Très fréquents
Andocide
Antiphon
Aristophane
Démosthène
Dinarque
Diodore de Sicile
Eschine
Eschyle
Euripide
Hérodote
Hypéride
Isocrate
Lysias
Pausanias
Platon
Plutarque
Sophocle
Théophraste
Thucydide
Xénophon
Fréquents
Dion de Pruse
Galien
Lucien de Samosate
Ménandre
Peu fréquents
Achille Tatius
Aelius Aristide
Aelius Théon
Anonyme de Jamblique
Antiphane
Antisthène
Appien
Aristote
Arrien
Athanase
Athénée
Athénion
Basile de Césarée
Denys d’Halicarnasse
Dion Cassius
Dion de Pruse, dit Chrysostome
Élien
Épicharme
Épicratès
Épictète
Flavius Josèphe
Gorgias
Hésiode
Hippocrate
Isée
Longus
Lycurgue
Nicolas de Damas
Phoïnikidès
Polybe
Synésios
Timoclès
Xénophon d’Athènes
Xénophon d’Éphèse
Exemples de textes donnés au concours :
Aristophane, Les Acharniens, v. 676-691 (de Οἱ γέροντες οἱ παλαιοί… à … τοῦτ’ ὀφλὼν ἀπέρχομαι).
—, L’Assemblée des femmes, v. 169-189 (de Ἄπερρε καὶ σύ… à… εὖ γε ταυταγὶ λέγεις).
—, Lysistrata, v. 507-522 (de Ἡμεῖς τὸν μὲν πρότερον πόλεμον… à … ὑμῖν ὑποθέσθαι ;).
Aristote, Rhétorique, 1390a4-20 (de Καὶ δυσέλπιδες… à … οἱ δὲ δί ἀσθένειαν).
Démosthène, Contre Midias, 104-105 (de κατέπτηχε μέντοι… à … παρὰ τὴν ἡμετέραν ἀμέλειαν).
—, Sur la couronne, 206-208 (de εἰ μὲν τοίνυν… à … τοὺς κρατήσαντας μόνους).
—, Sur les forfaitures de l’ambassade, 64-66 (de ὃν μὲν τοίνυν τρόπον… à… διὰ τούτους).
Diodore de Sicile, Bibliothèque historique, XVII, 51 (de ὁ μὲν προφητεύων ἀνήρ… à … διὰ παντὸς ἀνίκητον).
Dion de Pruse, Discours Troyen (Ilion n’a pas été prise), 11, 22-23 (de Τούτοις δὲ ἐπέθηκε τὸν κολοφῶνα… à … ἢ τῷ τἀληθῆ λέγειν).
Eschine, Contre Timarque, 4-6.
Euripide, Électre, v. 905-927 (de λέγ’ εἴ τι χρῄζεις… à … ἄνδρα δυσσεϐῆ κεκτημένη).
—, Les Suppliantes, v. 1094-1108 (de Εἶεν· τί δὴ χρή… à … ὥστε μὴ θανεῖν).
—, Les Troyennes, v. 975-997 (de οὐ παιδιαῖσι… à …ταῖς σαῖς ἐγκαθυϐρίζειν τρυφαῖς).
Hérodote, Enquêtes (ou Histoires), VI, 129.
—, VI, 61 (de Ἐοῦσαν γάρ μιν τὸ εἶδος φλαύρην… à… μεταπεσεῖν τὸ εἶδος).
—, III, 22 (de Λαϐὼν δὲ τὸ εἷμα… à… ἔτεα ὀλίγα ζώουσι).
Isocrate, Évagoras, 21-23 (de Οὕτω δὲ καὶ τῶν πραγμάτων καθεστώτων… à … ἀλλ’ ἕκαστον αὐτῶν εἰς ὑπερϐολήν).
Lucien, Comment il faut écrire l’histoire, 62-63 (de Ὁρᾷς τὸν Κνίδιον ἐκεῖνον ἀρχιτέκτονα… à … στάθμη ἱστορίας δικαίας).
Lucien, Contre l’inculte qui achète de nombreux livres, 3 (de Τί οὖν ;… à … πρὸς τὰ βιϐλία συνουσίας).
—, Dialogues des morts, 4 (21) (jusqu’ à ἔλεγκος ἀκριϐής).
—, La Double Accusation, I, 1.
Lysias, Contre Andocide, 8-11.
Philostrate, Sur les héros, 43, 12-15.
Platon, Lachès, 182d-183b (de καὶ δὴ καὶ τὸ ὁπλιτικὸν τοῦτο… à … πρὸς τὰ τοῦ πολέμου).
—, Protagoras, 309a-d (de Τί οὖν τὰ νῦν… à … ἀκούσας).
—, Théétète, 150b4-150d (de μέγιστον δὲ τοῦτ’ ἔνι… à … αἴτιος).
Sophocle, Ajax, v. 1226-1245 (de σὲ δὴ τὰ δεινά… à … οἱ λελειμμένοι).
—, Les Trachiniennes, v. 1046-1063 (de Ὦ πολλὰ δή… à … φασγάνου δίχα).
—, Œdipe Roi, v. 444-462 (de Ἄπειμι τοίνυν… à … μηδὲν φρονεῖν).
Xénophon, Cyropédie, 6, 2, 26-29.
Quelques extraits tirés d’Homère pour s’entraîner (tous viennent du chant XI de l’Odyssée) :
Cette partie de l’épreuve disparaît malheureusement à partir de la session 2024 !
Pour la grammaire homérique, voir aussi cette page.
Ulysse retrouve l’un de ses compagnons aux enfers.
Πρώτη δὲ ψυχὴ Ἐλπήνορος ἦλθεν ἑταίρου·
οὐ γάρ πω ἐτέθαπτο ὑπὸ χθονὸς εὐρυοδείης·
σῶμα γὰρ ἐν Κίρκης μεγάρῳ κατελείπομεν ἡμεῖς
ἄκλαυτον καὶ ἄθαπτον, ἐπεὶ πόνος ἄλλος ἔπειγε.
Τὸν μὲν ἐγὼ δάκρυσα ἰδὼν ἐλέησά τε θυμῷ,
καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδων… (51-56)
C’est l’âme de Tirésias qui parle.
« Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ,
τίπτ᾽ αὖτ᾽, ὦ δύστηνε, λιπὼν φάος ἠελίοιο
ἤλυθες, ὄφρα ἴδῃ νέκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον ;
ἀλλ᾽ ἀποχάζεο βόθρου, ἄπισχε δὲ φάσγανον ὀξύ,
αἵματος ὄφρα πίω καί τοι νημερτέα εἴπω. » (92-95)
La parole est à Ulysse, qui décrit les différentes âmes qu’il rencontre.
Καὶ Λήδην εἶδον, τὴν Τυνδαρέου παράκοιτιν,
ἥ ῥ᾽ ὑπὸ Τυνδαρέῳ κρατερόφρονε γείνατο παῖδε,
Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα,
τοὺς ἄμφω ζωοὺς κατέχει φυσίζοος αἶα·
οἳ καὶ νέρθεν γῆς τιμὴν πρὸς Ζηνὸς ἔχοντες
ἄλλοτε μὲν ζώουσ᾽ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε
τεθνᾶσιν· τιμὴν δὲ λελόγχασιν ἶσα θεοῖσι. (298-304)
Voici venir l’âme d’Achille.
Ἦλθε δ᾽ ἐπὶ ψυχὴ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
καὶ Πατροκλῆος καὶ ἀμύμονος Ἀντιλόχοιο
Αἴαντός θ᾽, ὃς ἄριστος ἔην εἶδός τε δέμας τε
τῶν ἄλλων Δαναῶν μετ᾽ ἀμύμονα Πηλεΐωνα.
Ἔγνω δὲ ψυχή με ποδώκεος Αἰακίδαο
καί ῥ᾽ ὀλοφυρομένη ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·
« Διογενὲς Λαερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσεῦ,
σχέτλιε, τίπτ᾽ ἔτι μεῖζον ἐνὶ φρεσὶ μήσεαι ἔργον ;
πῶς ἔτλης Ἄϊδόσδε κατελθέμεν, ἔνθα τε νεκροὶ
ἀφραδέες ναίουσι, βροτῶν εἴδωλα καμόντων ; » (467-475)
ENS LSH de Lyon
Épreuve orale pour les non-spécialistes
Ces textes peuvent servir de khôlles. Ils ont été récupérés dans les rapports de jury 2012-2022.
Retrouvez ici les sujets de la session 2023 (spécialistes et non spécialistes). [Références seules]
Exemples de textes donnés au concours :
Aristophane, Les Acharniens, v. 37-47.
—, Lysistrata, v. 99-112
—, Les Nuées, v. 1420-1429.
—, Les Oiseaux, v. 112-122 ; v. 466-476
—, Les Thesmophories, v. 389-400.
Aristote, Constitution d’Athènes, 5, 1-3.
Basile de Césarée, Aux jeunes gens, 7, 22-25 ; 9, 112-118.
Démosthène, Contre Aristocrate, 196-197.
Eschine, Contre Timarque, 9-10.
Eschyle, Les Suppliantes, v. 277-290.
Euripide, Alceste, v. 152-166 ; v. 183-195
—, Électre, v. 1062-1073 ; v. 54-67.
—, Hécube, v. 798- 812.
—, Hippolyte, v. 9-22.
—, Les Phéniciennes, v. 1437-1453.
—, Les Troyennes, v. 18-31.
Hésiode, Théogonie, v. 1-24 ; v. 69-92 ; v. 109-137 ; v. 213-239 ; v. 639-662.
Isocrate, Contre les sophistes, 3-4.
—, Éloge d’Hélène, 16- 17.
—, Évagoras, 22-23 ; 71-72.
—, Panégyrique, 103-105.
Jean Chrysostome, Sur la vaine gloire et l’éducation des enfants, 31-33 ; 73.
Longus, Pastorales, I, 13, 1-3 ; I, 14, 1-3.
Lucien, Dialogue des morts, 16, 1-2.
—, Dialogues des hétaïres, 10, 3.
—, Éloge de la mouche, 6 – 7, 4.
—, Histoires vraies, I, 34 ; II, 30.
Lysias, Contre Andocide, 51-52 ; 53.
—, Contre Simon, 6-8.
—, Oraison funèbre, 4-5 ; 25-26.
Platon, Gorgias, 456d-457a ; 457a-c.
—, Minos, 318c-d.
—, Phédon, 107c
—, Phèdre, 229c-e ; 274e-275a.
Plutarque, De l’éducation des enfants, 3a-b.
—, Vie d’Antoine, 43, 3-6 ; 71, 6-8 ; 82, 3-5.
—, Vie de Lycurgue, 14, 3-5 ; 15, 1-3.
Sophocle, Antigone, v. 449-460 ; v. 728-737.
—, Œdipe à Colone, v. 14-25.
—, Œdipe Roi, v. 22-34 ; v. 380-389.
Xénophon, Anabase, II, 6, 17-20 ; III, 1, 38-40.
—, Cyropédie, I 2, 2-4 ; I, 4, 3-4 ; I, 4, 25-26 ; I, 6, 7-9.
—, Économique, 5, 18-19 ; 7, 22-23 ; 9, 3-5 ; 9, 14-15 ; 21, 2-4.
—, Helléniques, II, 2, 3-4.