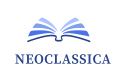Généralités
AELM
[RJ-2022]
Il convient de rappeler que l’exposé de grammaire nécessite rigueur, clarté et précision : la prise en compte des occurrences du passage, une catégorisation et un classement de ces occurrences au sein d’une réponse organisée selon des critères de préférence morphosyntaxiques, une présentation de la notion soumise à l’étude, enfin, qui motive le plan choisi pour le traitement de la question.
1. Attendus
Commençons par rappeler la finalité de l’épreuve : il s’agit pour les candidats de manifester leur maîtrise des catégories analytiques fondamentales de la grammaire française en proposant un exposé organisé à partir d’une question posée sur le texte donné à l’explication (ou sur un extrait de celui-ci) et des occurrences qu’il présente (ou que l’extrait présente), et de toutes celles-ci (toutes les occurrences du texte doivent être relevées et prises en compte dans leur spécificité). Ainsi, il ne s’agit pas d’une « explication » de grammaire (terme employé par certains candidats pour désigner l’épreuve), mais d’un exposé structuré en fonction de la question posée, comportant un nombre de parties dépendant de cette question ainsi que des occurrences offertes par le texte.
L’épreuve évalue la capacité du candidat à lire un texte de manière fine, en en comprenant les structures linguistiques. La compréhension des structures morphosyntaxiques d’un texte constitue en effet le premier niveau de lecture et de déchiffrement de ce dernier. Elle est nécessaire à sa véritable compréhension de détail et cela qu’il s’agisse des textes d’ancien régime ou des textes de siècles plus récents : de nombreuses erreurs d’interprétation, voire des contresens sur le texte de Sartre auraient ainsi pu être évités, en prêtant une attention plus grande aux structures syntaxiques et aux questions énonciatives. Bien souvent, l’ironie ou tout au moins la polyphonie des énoncés n’a pas été perçue.
Une telle aptitude à une lecture attentive aux structures linguistiques, qui repose sur une maîtrise des catégories fondamentales de la grammaire, est attendue de toute personne se destinant à l’enseignement dans le second degré — rappelons que l’étude de la langue a une place centrale dans les enseignements du collège et que les programmes du lycée accordent désormais une place spécifique à la grammaire, intégrée depuis 2020 à l’Épreuve Anticipée de Français (EAF) du baccalauréat sous forme d’une question portant sur un point de langue du texte soumis à l’explication.
Quelle que soit la question donnée, l’attendu principal de l’interrogation de grammaire est une description morphosyntaxique, la plus scrupuleuse et précise possible. Ainsi, même si la question posée implique d’autres aspects importants, comme c’est le cas pour les questions engageant aussi une piste d’analyse pragmatique (cf. modalités d’énonciation, l’interrogation, l’expression de l’injonction, la négation, etc.), ou sémantico-référentielle (les pronoms par exemple), le candidat doit s’appliquer à proposer en premier lieu une analyse morphosyntaxique. Par exemple, pour l’interrogation, est attendue une description de la syntaxe propre à l’interrogation, de même que, dans le cas de l’interrogation partielle, une analyse grammaticale (nature et fonction) des mots interrogatifs.
Afin de mener à bien cette analyse, la mobilisation de tests d’identification morphosyntaxiques, appuyés sur les manipulations linguistiques fondamentales (substitution, insertion, déplacement, suppression) est souhaitable : elle permet d’aider le candidat à fonder et argumenter son analyse et à mettre en valeur sa capacité à la réflexion linguistique.
2. Écueils
Compte tenu des attentes posées, on comprendra qu’une prestation dénuée de description ne peut être satisfaisante : ainsi, pour la question du COD, si aucun test n’est donné, si aucune nature des unités ayant cette fonction dans les énoncés que comporte l’extrait n’est précisée, il est évident que les attendus de l’épreuve ne sont pas satisfaits et qu’un tel exposé est voué à la note la plus basse. Ce ne fut heureusement pas le cas le plus fréquent. Une description insuffisante, soit insuffisamment précise, se limitant à un classement non analytique des occurrences, soit omettant des occurrences, a plus souvent été constatée. Si, le cas échéant, l’entretien permet de préciser cette dernière (c’est d’ailleurs une des fonctions principales de l’entretien que de permettre au candidat de corriger ou de compléter ses analyses), on notera toutefois que l’imprécision cache parfois une incapacité à analyser les occurrences omises. Cette incapacité que l’entretien révèle est souvent due à des connaissances insuffisantes ou trop fragiles.
Enfin, des erreurs grossières dans l’analyse morphosyntaxique se glissent parfois dans des exposés par ailleurs convenables. Elles manifestent au mieux une réflexion insuffisante du candidat lors de l’analyse, au pire, une incapacité à mobiliser des connaissances en vue de l’analyse ; la mobilisation des tests, parce qu’elle contraint à pousser plus avant la logique analytique, constitue la meilleure arme pour les combattre.
On l’aura compris : il importe au premier chef de disposer de connaissances maîtrisées. Pour le dire en d’autres termes, le candidat ou la candidate doit être capable de définir toutes les notions qu’il ou elle emploie.
AELC
[RJ-2021]
L’explication littéraire d’un texte postérieur à 1500, associée à une épreuve de grammaire, peut prendre deux formes: soit l’étude synthétique, portant sur tout ou partie de l’extrait, d’une notion grammaticale ou d’un fait de langue ; soit, dans une démarche plus analytique, la présentation de « toutes les remarques syntaxiques » utiles et nécessaires à l’éclaircissement grammatical d’un segment du passage.
Pour traiter l’explication de texte et la question de grammaire, les candidats disposent de 2h30 de préparation, au terme desquelles ils présentent un exposé de 45 minutes suivi de 15 minutes de questions, portant sur les deux volets de l’épreuve. Afin de permettre un réel examen de la question proposée, le jury recommande généralement 30 minutes de préparation et 15 minutes de présentation orale.
« Saisir » le sujet
Assurément, comme dans tous les concours et dans toutes les épreuves, certains sujets peuvent donner l’impression d’être « plus difficiles », « plus longs » que d’autres. La notion de difficulté est tributaire de nombreuses variables, mais ce n’est pas la longueur qui, en elle-même, doit effrayer les candidats. En effet, lorsqu’un sujet a de nombreuses occurrences, ce qui est presque inévitable avec certaines catégories grammaticales (ainsi les pronoms ou les déterminants), toutes les occurrences ne présentent pas le même degré d’intérêt : savoir sélectionner les occurrences qui seront analysées plus en détail fait partie des compétences attendues.
Telle étude sur les pronoms a précisément été proposée pour inviter à explorer plus particulièrement deux ou trois occurrences remarquables (présence de on ; d’un il non référentiel, d’un nous à la référence ambiguë) ; dans un tel cas, il est inutile de s’interroger sur une série identique de il dont la référence est transparente, et il vaut mieux consacrer son temps de préparation, comme son temps d’exposé oral, à l’étude des occurrences véritablement intéressantes.
Des sujets manifestement synthétiques comme « Les temps verbaux » n’appellent pas une analyse pointilliste de chaque occurrence, mais une présentation fortement problématisée permettant de mettre en lumière le fonctionnement énonciatif et grammatical du passage.
On le voit : s’emparer activement du sujet, c’est déjà amorcer une réflexion proprement grammaticale. D’un point de vue méthodologique, les candidats doivent commencer par s’interroger : pourquoi ce sujet a-t-il été choisi ? Sur quel type de difficulté permet-il de réfléchir ? Quelles sont les occurrences qui ont pu sembler particulièrement intéressantes à étudier ?
L’introduction
L’exposé commence par une introduction, qui présente de manière problématisée les éléments définitoires essentiels du sujet proposé. Elle expose les critères d’identification des formes étudiées et annonce un classement, si possible en le justifiant. Cette définition n’est pas un point d’aboutissement mais bien un point de départ : elle pose question, et pourra être mise à l’épreuve du corpus étudié, questionnée et éventuellement retravaillée à sa lumière (voir plus loin). Attention aux automatismes réducteurs qui risquent de limiter ou de gauchir d’emblée la réflexion : le pronom n’est pas toujours « mis pour le nom », l’adverbe n’est pas toujours invariable, etc.
Le relevé et le classement des occurrences
L’exposé s’appuie sur un relevé exhaustif des occurrences dans l’extrait proposé (il se peut que l’extrait proposé pour la grammaire ne corresponde qu’à une partie du passage étudié en littérature). Comme indiqué plus haut, si les occurrences sont particulièrement nombreuses, c’est que certaines sont similaires (même fonction, même nature…) et peuvent dès lors être abordées conjointement : c’est alors l’occasion de manifester son esprit de synthèse et de prendre de la hauteur, en y repérant une situation-type. Si au contraire les occurrences sont peu nombreuses, il s’agit d’approfondir les analyses, et peut-être d’identifier un ou plusieurs cas particulièrement intéressants ou remarquables (voir plus loin). Pour certains sujets, l’absence du fait de langue considéré est significative et doit être étudiée, ainsi l’absence de déterminant.
Rappelons que dans un texte dramatique, il ne faut pas oublier d’étudier les occurrences présentes dans les didascalies. Il est dommage, par exemple, qu’étudiant dans un extrait du Balcon les compléments verbaux, la candidate oublie une occurrence remarquable de possession dite inaliénable (« (Il lui retrousse les lèvres.) »).
Lors de l’exposé devant le jury, les occurrences ne sont pas présentées linéairement, mais sous la forme d’un classement. Il est parfois possible d’adopter le principe suivant : s’il s’agit de relever une catégorie (par exemple, l’adjectif qualificatif), on classe selon la fonction syntaxique ; s’il s’agit de relever les occurrences occupant une même fonction (par exemple, la fonction sujet), on classe selon la catégorie grammaticale. Cependant, d’autres types de classements sont parfaitement recevables, voire préférables, lorsqu’ils mettent plus clairement en évidence la pertinence ou le fonctionnement de la notion à étudier. Le plan doit donc faire l’objet d’une réflexion avisée, car un plan inadéquat entravera inévitablement la réflexion.
Ayant à traiter des adjectifs qualificatifs dans un extrait de Mauprat, une candidate a par exemple proposé un plan exclusivement sémantique, reposant sur une dichotomie maladroitement articulée entre « subjectivité » et « objectivité » ; elle s’est ainsi privée de donner toute leur place aux analyses morphologiques et syntaxiques qui étaient évidemment attendues.
De même, une question sur les temps de l’indicatif a donné lieu à un classement peu probant : 1. Les verbes du 1er groupe 2. Les verbes du 2e groupe 3. Les verbes du 3e groupe. Si un tel classement permettait certes de rendre compte de l’ensemble des occurrences à étudier, il était à la fois peu pertinent (en ce qu’il ne permettait pas vraiment de s’interroger sur les « temps »), et peu opératoire (il a donné lieu à un exposé beaucoup trop long, la candidate étant conduite à répéter très souvent les mêmes informations). Un classement par tiroirs verbaux (I. L’indicatif présent ; II. L’indicatif imparfait ; III. L’indicatif futur, etc.) aurait du moins permis de réfléchir sur les « temps », mais sans faire véritablement apparaître une problématique cohérente. Il aurait donc mieux valu regrouper les occurrences selon qu’elles relevaient de tel ou tel niveau énonciatif (I. Les temps du Discours ; II. Les temps du Récit), ce qui aurait permis de présenter une réflexion cohérente et structurée sur les temps verbaux de l’extrait, et par ailleurs d’éclairer puissamment son analyse littéraire. Dans d’autres cas (par exemple dans un texte relevant entièrement de l’énonciation de Discours), la distinction entre temps simples et temps composés pourra s’avérer plus opératoire.
Bien entendu, le plan doit en outre s’adapter finement au corpus étudié, le classement étant organisé en fonction des occurrences relevées. Traiter des attributs dans un texte de Boileau comportant 14 occurrences d’attribut du sujet et une seule occurrence d’attribut de l’objet pouvait inciter à choisir un classement non par fonction, mais par nature, selon que l’attribut est I. un nom ou un groupe nominal ; II. un adjectif ou un groupe adjectival ; III. un groupe prépositionnel.
L’analyse des occurrences
Chaque occurrence doit donner lieu à une analyse au moins minimale, respectant les principes suivants :
- l’identification peut s’appuyer sur les tests de base : suppression/déplacement/pronominalisation, etc. Toutefois, on ne confondra pas les critères d’identification des occurrences et les critères de classement ;
- il faut essayer de ne laisser de côté aucune dimension importante du sujet : tel exposé sur les subordonnées dans l’Heptaméron, tout à fait solide par ailleurs, a par exemple négligé totalement la question des modes verbaux dans les subordonnées ;
- il est important de distinguer le contexte recteur et le contexte régi, et n’oublier ni l’un ni l’autre ; par exemple, dans le cas d’une étude de l’adjectif, il faut d’une part spécifier la fonction adjectivale et le terme recteur, d’autre part identifier les possibles expansions adjectivales ;
- il est nécessaire de respecter l’empan des groupes fonctionnels ; ainsi, dans cette même étude, analyser le segment « les vivres de Guyenne estoient aussi bons que ceux de Paris » implique de relever toute la structure corrélative aussi bons que ceux de Paris et pas seulement l’adverbe intensif aussi.
On se gardera de postuler sans vérification, pour contourner une difficulté d’analyse, l’existence d’une expression proverbiale ou d’une locution figée. Pendant le temps de préparation, des usuels sont à disposition, qu’il ne faut pas hésiter à consulter : si la séquence est figée/proverbiale, elle sera enregistrée dans les dictionnaires.
Certaines occurrences, parfois présentées comme « problématiques » méritent une attention particulière. Il n’est pas toujours optimal de les présenter d’un bloc en fin de parcours ; bien souvent, elles gagneraient à être insérées à tel ou tel moment de la réflexion, pour interroger les limites de tel type d’emploi par exemple.
Le plus souvent, le caractère « problématique » tient surtout aux limites de la définition initiale exposée en introduction, certaines occurrences se pliant malaisément à l’application des critères d’identification, en particulier fondés sur les tests de base: effacement, permutation, commutation, déplacement, expansion / réduction, modification du type de phrase, modification de la forme de phrase (procédés d’emphase, négation, modification de la diathèse…). Il s’agit alors de montrer
- ce qui justifie qu’on évoque telle occurrence : à quels critères d’identification souscrit-elle ? quels tests fonctionnent ?
- ce qui, aussi, pose problème : à quels critères d’identification ne souscrit-elle pas ? quels tests ne fonctionnent pas ?
Dans de pareils cas, c’est moins la résolution (ou la réduction) définitive du cas « problématique » qui importe, que l’éclairage qu’il jette sur la notion ou la catégorie étudiée, et la manière dont il incite à faire retour sur la définition initiale exposée en introduction, que ce soit pour l’assouplir (si les critères étaient trop rigides) ou pour la compléter (s’il convient d’introduire de nouveaux critères). D’où la proposition de recourir, plutôt qu’à la désignation de «cas problématiques», à l’appellation «cas remarquables» (puisque ces occurrences imposent des analyses – ou « remarques » – supplémentaires par rapport aux autres), « cas- limites » (puisqu’ils peuvent inviter à questionner les limites d’une catégorie) ; ou « cas intéressants » (puisque ces occurrences, invitant à faire retour sur les outils descriptifs habituels et les définitions prototypiques, présentent un intérêt heuristique).
La conclusion
La conclusion n’a pas à être longue et peut à la rigueur être omise, mais elle peut aussi être l’occasion, précieuse, de souligner les spécificités de l’extrait au regard du sujet proposé : retour critique sur la définition initiale au regard des « cas intéressants » étudiés ; absence ou au contraire surreprésentation remarquable d’une des formes de la notion ou de la catégorie, ouvrant éventuellement sur une remarque stylistique faisant le lien avec l’analyse littéraire ; et/ou remarques diachroniques s’il s’agit d’un texte ancien : même si l’exposé reste globalement synchronique, traiter de l’absence d’article, de la négation ou des formes en -ant dans un texte du XVIe ou du XVIIe siècle engage à mettre en lumière un état de langue différent de l’état actuel.
L’entretien
L’entretien peut être l’occasion de compléter l’exposé, de rectifier certaines erreurs ou d’approfondir certaines analyses. Si par mégarde une ou deux occurrences ont été oubliées pendant l’exposé, l’entretien pourra notamment porter sur ces oublis ; dans ce cas, il sera préférable de ne pas se contenter de relever l’occurrence, mais de procéder immédiatement à son examen.
Quoi qu’il en soit, le candidate est invité à faire montre de son aptitude à la réflexion et au dialogue, en sachant prendre le temps de la réflexion (et éventuellement de la réflexion à voix haute), s’ouvrir éventuellement à d’autres hypothèses, corriger au besoin avec honnêteté et netteté une proposition erronée. Il doit s’efforcer de rester pleinement attentif tout au long de la discussion, et de formuler des réponses claires et précises manifestant à la fois des connaissances solides et un intérêt pour le questionnement de la langue – qualités qui seront essentielles dans sa pratique pédagogique.
AEGr
Le format est différent des deux autres Agrégations de Lettres
Après l’explication littéraire, le candidat répond à des questions de grammaire. Il s’agit le plus souvent de questions ponctuelles qui portent sur des identifications morphologiques, des analyses syntaxiques ou lexicales sans difficulté particulière, des points de versification ou d’histoire de la langue : sont ainsi vérifiées la solidité des connaissances grammaticales et les capacités de réaction et d’improvisation du futur enseignant. Le candidat peut prendre un court temps de réflexion avant de répondre aux questions ou même faire part de ses hésitations. En cas d’erreur, un échange avec le jury permet de rectifier son analyse. On renvoie à la même bibliographie que pour les autres épreuves de linguistique. [RJ-2022]
L’explication d’un texte de littérature française tiré du programme est suivie, avant l’entretien, d’une série de questions de grammaire française improvisées, étendues sur une dizaine de minutes. Les questions posées peuvent aborder tous les niveaux de l’analyse grammaticale, la morphosyntaxe et la sémantique demeurant néanmoins les niveaux privilégiés. Ces questions sont naturellement destinées à vérifier les connaissances des candidats et ne visent aucunement à les piéger. L’ordre des questions peut n’être pas anodin, les premières visant à vérifier les capacités d’analyse élémentaire (nature et fonction, types de phrase, par exemple), les suivantes à témoigner de la capacité du candidat à prendre du recul, voire à proposer des analyses alternatives lorsque celles-ci existent. En somme, le jury souhaite apprécier la réactivité des candidats, la solidité de leurs connaissances et l’aptitude à raisonner linguistiquement. [RJ-2020]
Conseils bibliographiques du jury
Les plus importants :
GARDES-TAMINES Joëlle, La Grammaire, Paris, Armand Colin, « Cursus », 1988, t. 2 « Syntaxe », 2010.
C. NARJOUX, Le Grevisse de l’étudiant. Grammaire graduelle du français (Capes et agrégation Lettres), Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, 2018, 1re édition, 768 p.
Nombre de candidat·es apprécient cet ouvrage pour préparer les questions de grammaire. Les autres ouvrages Grevisse sont aussi très utiles.
M. RIEGEL, J.-Chr. PELLAT, R. RIOUL, Grammaire méthodique du français, Paris, PUF, 2018, 7e édition, 1110 p.
C’est l’ouvrage de « référence », même s’il n’est pas parfait.
*
D’autres outils :
DELAUNAY Bénédicte et LAURENT Nicolas, La Grammaire pour tous [2012], Paris, Hatier, coll. « Bescherelle », 2019.
GREVISSE Maurice, Le Bon Usage – grammaire française, 12ème édition refondue par André Goosse, Paris, Duculot, 1988.
MAINGUENEAU Dominique, Précis de grammaire pour les concours. Capes et agrégation de Lettres, Paris, A. Colin, 2015.
MERCIER-LECA Florence, Trente-cinq questions de grammaire, Paris, A. Colin, coll. « Cursus », 2010.
SIOUFFI Gilles et VAN RAEMDONCK Dan, Cent fiches pour comprendre les notions de grammaire, Paris, Bréal, 2007.
SOUTET Olivier, La Syntaxe du français, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 1989.
*
En ce qui concerne des cas particuliers à la langue de la Renaissance et à la langue classique (diachronie), vous pouvez consulter :
FOURNIER, Nathalie, Grammaire du français classique, Paris, Belin, 2002.
LARDON Sabine et THOMINE Marie-Claire, Grammaire du français de la Renaissance. Etude morphosyntaxique, Paris, Classiques Garnier, 2009.
*
Enfin, sur des points sujets à discussion, il existe des grammaires critiques là encore consultables très ponctuellement :
LE GOFFIC Pierre, Grammaire de la phrase française, Paris, Hachette, « Hachette « Supérieur », 1993.
WILMET Marc, Grammaire critique du français, Paris Duculot, Hachette « Supérieur », 2003.
Grammaire du français. Terminologie grammaticale : il s’agit du document officiel de référence de l’Éducation nationale. La présente édition date de 2021 et est disponible en ligne à l’adresse suivante. Attention toutefois à certains choix de théorisation qui ont suscité des critiques. L’ancienne version de cette terminologie se trouve ici.
*
Encore quelques références :
Jean-Claude Milner, François Regnault, Dire le vers [1987], Verdier, 2008
Jean-Michel Gouvard, La Versification, Presses universitaires de France, 1999
Jacques Dürrenmatt, Stylistique de la poésie, Belin, 2005
Anne Herschberg Pierrot, Stylistique de la prose, Belin, 1993
Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, 3 tomes [1977], Belin, 1996
PELLAT, Jean-Christophe et Stéphanie FONVIELLE, Le Grevisse de l’enseignant – grammaire de référence, Paris, Magnard, 2016.
Erreurs à éviter
et diverses remarques des jurys
[AELM-2022]
Parmi les erreurs d’identification et confusions relevées cette année, on notera :
– pour les propositions subordonnées relatives adjectives, la confusion entre les niveaux d’analyse sémantique et syntaxique : ainsi, la distinction entre relatives déterminative et explicative est d’ordre sémantique. Ce niveau d’analyse se substitue dans la majorité des analyses à une analyse de type syntaxique, laquelle s’intéresse à la fonction des subordonnées dans la phrase (pour les relatives adjectives, les fonctions possibles d’épithète, apposition – ou épithète détachée –, et attribut) ;
– plus grave encore, la confusion entre les différentes catégories de subordonnées et/ou leur classement selon des critères non homogènes (par exemple, un classement qui distingue les «relatives», « complétives » et « circonstancielles » confond ou rabat le type de subordonnée sur sa fonction;
– en ce qui concerne les mots introducteurs des subordonnées, leur analyse est parfois incohérente en regard du type de subordonnée identifié — une conjonctive complétive introduite par un pronom relatif, par exemple ;
– on est souvent qualifié de pronom impersonnel : rappelons qu’il s’agit d’un pronom indéfini ou pronom personnel indéfini, qui peut admettre différents types d’emplois selon les contextes, parmi lesquels on peut opposer un emploi générique à un emploi comme substitut de pronom personnel (emploi parfois dit d’énallage de personne) ;
– mais est invariablement désigné comme un adversatif alors qu’il a parfois une valeur de connecteur argumentatif : on se référera aux analyses de Jean-Claude Anscombre et d’Oswald Ducrot, qui établissent une claire distinction entre les deux emplois de mais en français (voir Anscombre et Ducrot, « Deux mais en français ? », Lingua, n° 43, 1977).
On sera également attentif au sens de certaines notions, souvent employées à mauvais escient :
– le terme de co-référence est souvent mal employé : la notion ne peut engager que la mise en relation de deux GN ou substituts de GN, en relation de co-référence totale (on pourra alors parler plus aisément d’identité référentielle) ou partielle selon les cas. En aucun cas un GN ne peut être co-référent à un adjectif : rappelons que ce dernier n’a pas d’aptitude référentielle, dénotant une propriété applicable à un GN qui en est syntaxiquement le support et auquel, sémantiquement, cette propriété s’applique. De manière plus globale, la notion même de référence n’est pas maîtrisée ;
– on remarque une nouvelle fois la mobilisation abusive de la dénomination de « présentatif » pour c’est : le terme de « présentatif » est en effet parfois utilisé comme un étiquetage morphologique. Pourtant, cette désignation ne correspond qu’à un emploi particulier de c’est, lorsque ce dernier régit un GN ou un équivalent de GN et « quand [ce] ne représente explicitement aucun élément du contexte » (Le Goffic, op. cit., p. 142) ;
– concernant enfin la catégorie des compléments circonstanciels et sa frontière avec celle des compléments essentiels: la notion de compléments circonstanciels internes au prédicats (dits « prédicatifs » ou « intra-prédicatifs ») est souvent très mal appréhendée : les critères pour distinguer les uns des autres sont au mieux, flous, au pire, erronés, lorsque la catégorie n’est pas tout bonnement omise. Une telle omission entraîne une impossibilité d’analyse d’un certain nombre d’occurrences, rabattues soit sur la catégorie des compléments de phrase, soit sur celle du complément d’objet indirect (voir Le Goffic, op. cit., p. 457-458).
Certains candidats ont pu manifester des connaissances pointues sur telle ou telle question, tout en se révélant démunis devant une analyse catégorielle de base. Il conviendra donc de s’assurer que les fondamentaux sont acquis avant de s’engager dans des analyses complexes pas toujours maîtrisées.
[AELC-2021]
Certains outils ou notions obsolètes tendent à entraver la réflexion ; les candidats gagneraient à actualiser leurs connaissances (voir les conseils bibliographiques ci-dessous) afin de se donner les moyens de déployer une véritable réflexion grammaticale. Deux exemples :
– le classement des verbes en 1er/2e et 3e groupe, s’il a quelques mérites pour l’apprentissage de la morphologie verbale, est peu adapté à des études syntaxiques de corpus : on peut lui préférer le classement en verbes à 0 compléments, 1 complément, 2 compléments, etc…
– le recours à des notions telles que « sujet réel » / « sujet logique » est assez périlleux, et conduit à des considérations sémantico-pragmatiques souvent contestables (ces notions offrant en outre une définition très labile de ce qu’est un sujet en grammaire). On leur préférera avantageusement la distinction entre sujet, agent et contrôleur.
De même, les « analyses » s’engageant sur des considérations du type « verbe élidé », « élément sous- entendu » sont souvent peu rigoureuses : il est toujours périlleux de commenter ce qui pourrait être plutôt que d’étudier ce qui est effectivement…
Deux lacunes, récurrentes, ont gêné plusieurs candidats :
– la notion de prédicat n’est presque jamais convoquée, même pour traiter la question de l’attribut ;
– les valeurs aspectuelles ne sont presque jamais mentionnées pour les temps de l’indicatif, le nom même d’aspect semblant souvent complètement ignoré.
Les remarques nécessaires
[AELC-2021]
Un sujet sur 10 environ invite à analyser un segment du passage ; c’est alors au candidat d’identifier et de présenter les faits de langue qui lui paraissent significatifs. L’exposé peut se présenter en deux parties :
- dans un premier temps, des remarques macrostructurales, portant sur la syntaxe de tout le segment : nombre, identification et articulation des phrases, des propositions et/ou des groupes fonctionnels ;
- dans un second temps, des remarques microstructurales, portant sur des faits de langue sélectionnés et organisés en fonction de leur intérêt et de leur importance. Il ne s’agit pas de viser une inatteignable exhaustivité, mais de manifester, au cours d’un exposé clair et structuré, sa maîtrise de diverses questions grammaticales et sa capacité à identifier et à analyser les cas remarquables ou atypiques. Si des difficultés sont repérées, il vaut mieux les affronter, quitte à tester successivement, aussi méthodiquement que possible, différentes hypothèses, plutôt que de les ignorer en commentant uniquement tel ou tel phénomène adjacent, plus banal et plus « facile ».
Les sujets possibles
[AELC-2021]
- La question de synthèseIl s’agit alors d’étudier une notion grammaticale ou un fait de langue à partir d’un relevé classé d’occurrences.Les sujets possiblesOutre les sujets du type « Faites toutes les remarques nécessaires sur [un segment du passage] », cinq types de sujets peuvent se présenter, qu’on se contentera de rappeler ici brièvement, puisqu’ils ont déjà été évoqués dans les rapports antérieurs :
- – une classe de mots ou une fonction syntaxique, par exemple «Les pronoms personnels», « L’attribut » ;
- – un couple (plus rarement un trio) de morphème(s) ou de mot(s), par exemple « Que », « Être et avoir » ;
- – un couple (plus rarement un trio) de notions, par exemple « Indicatif et subjonctif » ;
- – une notion transversale, par exemple « La négation » ;
- – une notion relevant de la linguistique de l’énonciation ou de l’organisation communicationnelle, par exemple « Modalités d’énonciation et types de phrases ».
Sujets donnés
Session 2025
AELM
AELC
AEGr
AELM
Remarques nécessaires (un sujet sur dix environ)
Classes de mots et groupes de mots
Les déterminants
Déterminant et absence de déterminant
Les adjectifs / l’adjectif
Participe et adjectif
Les pronoms
Les pronoms compléments
Les démonstratifs
Démonstratifs et possessifs
Verbes pronominaux et constructions pronominales
Adjectif et groupe adjectival
La construction du GN
Infinitif, participe et adjectif verbal
Les adverbes
Adverbes et conjonctions de subordination
Les adverbes à l’exception des adverbes de négation
Les groupes prépositionnels
Préposition et groupe prépositionnel
Expansions du N et expansions détachées du GN
Les indéfinis
La morphosyntaxe du GN
Le GN et ses expansions
Fonctions syntaxiques
Sujet et absence de sujet
Attribut et apposition
L’attribut
Compléments d’objets et attributs
Les compléments circonstanciels
Autour du verbe et du groupe verbal
Auxiliaires et semi-auxiliaires
L’infinitif
Les emplois de l’infinitif
La transitivité verbale
Les constructions du verbe
Les constructions de l’infinitif
Les constructions du verbe être
Être et avoir
Être, avoir, savoir, pouvoir
Les formes non personnelles du verbe
Les modes non-personnels du verbe
Infinitif, participe et adjectif verbal
Les modes verbaux
La syntaxe de l’infinitif
La syntaxe du subjonctif
Le subjonctif
Valeurs des temps et des modes verbaux
Verbe et complémentation verbale
Les formes en -ant
Les emplois de l’indicatif et du subjonctif
Syntaxe de la phrase, types et formes de phrase
L’interrogation
Interrogation et exclamation
Interrogation et injonction
La négation / la syntaxe de la négation
Les modalités d’énonciation
Les relatives
Les subordonnées
Les subordonnées avec justification du mode
La subordination
Types et formes de phrases
Études transversales
Anaphore et deixis
Le mot si
Le mot de
Le mot que
Les mots en qu-
Qui et que
Référence et expressions référentielles
La variation en degré
AELC
1. Questions sur des classes grammaticales
Les déterminants (et l’absence de déterminant)
La détermination
L’absence de déterminant
L’article et l’absence d’article
Les démonstratifs (déterminants et pronoms)
Le nom et le groupe nominal
Les expansions du nom
Les adjectifs
Les adjectifs qualificatifs
Les pronoms
Les pronoms personnels
Les pronoms autres que les pronoms personnels
Les adverbes
2. Questions sur des fonctions syntaxiques ou des groupes fonctionnels
La fonction sujet
Les compléments du verbe
Compléments du verbe et compléments de phrase
Les constructions verbales
Les compléments circonstanciels
Les compléments indirects
Les compléments du nom
L’attribut
Les groupes (ou syntagmes) prépositionnels
3. Questions sur le verbe
- Questions sur l’emploi de certaines formes
Les modes non personnels du verbe
L’infinitif
Les séquences verbe + infinitif
Le participe
Participe présent et gérondif
Les formes en -ant
Les emplois du verbe être
- Questions sur les modalités verbales
Temps et modes du verbe
Les temps de l’indicatif
Le subjonctif et le conditionnel
Le présent
4. Questions sur la phrase
- Questions sur les modalités ou les formes de phrases
Les types de phrase
Types et formes de phrase
Les formes de phrase
L’interrogation
Interrogation et exclamation
La négation
L’emphase : dislocation et extraction
- Questions sur les groupes et les propositions
Les propositions subordonnées
Les propositions subordonnées circonstancielles
Les propositions subordonnées complétives
La proposition subordonnée relative
Les groupes en position détachée dans la phrase
Juxtaposition et coordination
5. Autres questions
Le morphème que
Le morphème de
Discours direct et style indirect libre
Le discours rapporté
Les plans d’énonciation (discours et récit)
AEGr
Sur L’Astrée d’Honoré d’Urfé
– pp. 180-181, « Et parce qu’Alcippe avait une si haute opinion…lui avait fait tenir tels propos ».
1. L’emploi du subjonctif dans « si vous voulez donc…. demeurer ensemble » (p. 181) ;
2. Analyser « si vous voulez donc que nous continuons de vivre » (p. 181) ; 3. Analyser
« soy-mesme » dans la première phrase de l’extrait ; 4. Analyser les formes « recoignoissiez »
et « voy » (p. 180).
– pp. 237-238, « Ils se résolurent un jour…. se transforme en la chose aimée ».
1. Étudier les propositions relatives du début de l’extrait jusqu’à « inondant » ; 2. Analyser la
tournure « alloient inondant » ; 3. Faire les remarques nécessaires sur « Le Druyde en
sousriant les vint retirer leur disant qu’ils creussent pour certain n’estre point aimés ».
– p. 250, « Non Celadon…comme une ».
1. Analyser et commenter le mot toute dans « Elle trouva toute seule dans le jardin » ; 2. Le mot
« que » dans le passage ; 3. Analyser la proposition « Leonide l’oyant souspirer » ;
4. Lexicologie et création lexicale : « rigoureusement » ; 5. À partir de la forme « s’en douloir »,
donner les différents types de verbes pronominaux.
Sur Le débat de Folie et d’Amour de Louise Labé
– pp. 88-90, « je la plains… celui de la personne qu’il aime ».
1. Analyser le morphème « que » dans la réplique d’Amour « la première chose ….en choses
insensibles » (p. 89) ; 2. Analyser « si » dans « si est-il bien contre nature, que ceux qui ont
reçu tou mauvais traitement de toi… » (p. 88) ; 3. Faire les remarques nécessaires sur « Cest
pource que les Dieux et hommes, bien avisés, craignent que ne leur fasse pis. » (p. 88) ;
4. Analyser les infinitifs dans « la richesse te fera jouir des Dames qui son avares : mais aimer
non. » (p. 89)
Sur Élégie III, de Louise Labé
– pp. 170-172, v. 27-64.
1. Commenter les constructions « plus fort », « plus docte que sage » et donner les variantes
possibles (v. 35 et 54) ; 2. Analyser les trois formes en –ant du passage (v. 44 et 46) ;
3. Donner la nature et la fonction des compléments circonstanciels du passage (v. 57-58) ;
4. Donner la nature et la fonction du groupe « d’ire » (v. 59) ; 5. Donner le type de phrase
(points de vue morphosyntaxique et pragmatique) (v. 47-48).
Sur l’Histoire d’une Grecque moderne de l’abbé Prévost
– pp. 250-251, « il se passa encore plus de huit jours…ma foiblesse ».
1. Analyser les subordonnées dans la première phrase de l’extrait ; 2. Justifier l’emploi du
subjonctif dans cette même phrase ; 3. Faire les remarques nécessaires sur « ce qui pouvait
me faire trouver Téophé plus coupable ».
Sur Écrits sur l’art de Baudelaire
– pp. 207-208, « Elle retombera sur son Nicole…celui de Théophé ».
1. Étudier le mot « que ».
– p. 221 « Il serait temps… un jour sur sept. ».
1. Analyser la phrase complexe.
Sur Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute
– p. 28, du début jusqu’à « … on le revoit plus ».
1. La complémentation verbale.
– p. 46.
1. Analyser les relatives.
– p. 46, à partir de « H2 : Oui, peur….trop bien ».
1. Analyser la construction « se savoir » ; 2. Analyser « l’avoir entendu dire ».
– pp. 45-47, « Qu’est-ce que ça peut bien te faire… cette chance ».
1. Analyser le mot « où » et la proposition « où vous vous débattez » ; 2. Conjuguer « tu
crains » à la même personne et à tous les temps de l’indicatif et du subjonctif ; 3. À partir de la
phrase « La vie ne vaut pas la peine d’être vécue », donner les temps de l’infinitif à toutes les
voix ; 4. Commenter la forme « en » dans « Je n’en suis pas un » ; 5. Commenter la
construction (type et forme de phrase) « Je veux savoir d’où ça te vient, ce détachement ».
Sur Le Silence de Nathalie Sarraute
– pp. 31-32, « On entend un faible rire….n’oubliez pas ça ».
1. Commenter la construction « c’est Jean-Pierre qui vient de rire » ; 2. Commenter les phrases
« Non ». « De l’empereur de Chine ». « De la reine de Saba ». « Du shah de Perse » ;
3. Donner la nature et la fonction de la proposition « Regardez dans quel état vous avez mis
notre pauvre ami » ; 4. Lexilocogie : les noms « shah », « roi », « reine », « empereur »
(étymologie et sémantique).
AELM
Classes de mots :
Article et absence d’article
Les déterminants
Déterminant et absence de déterminant
Les adjectifs/ L’adjectif
Adjectifs et participes
Les pronoms
L’emploi des pronoms démonstratifs
Morphosyntaxe des pronoms personnels
Démonstratifs et possessifs
Les adverbes/ Les adverbes, à l’exception des adverbes de négation/ Syntaxe de l’adverbe
Adverbes et prépositions
Groupes de mots :
Les groupes nominaux
Les expansions du nom
Les déterminants du nom
Les modifieurs du nom et du groupe nominal
Les groupes prépositionnels/ Les syntagmes prépositionnels
Les groupes prépositionnels introduits par de
Fonctions syntaxiques :
Syntaxe du sujet
L’attribut
Attributs et compléments d’objet direct
Attribut et apposition
Le complément d’objet
Les compléments essentiels du verbe
Les compléments circonstanciels
Autour du verbe et du groupe verbal :
Le groupe verbal
La construction des verbes
Les constituants essentiels du groupe verbal
Verbes pronominaux et constructions pronominales
Être et avoir / Les constructions de être et de avoir
Les emplois de être et de faire
L’infinitif/ Syntaxe de l’infinitif
Infinitif, participe et adjectif verbal
Les participes
Les formes en -ant
Formes en -ant et participes passés
Le participe passé
Les modes impersonnels / les modes non personnels / Les formes non personnelles du verbe
Les modes personnels
L’emploi des temps de l’indicatif /la valeur des temps de l’indicatif
Auxiliaires et semi-auxiliaires
Auxiliaires, semi-auxiliaires et verbes supports
Les périphrases verbales
Syntaxe de la phrase, types et formes de phrase :
Les constructions détachées
La subordination
Les subordonnées/ Les propositions subordonnées
Les propositions subordonnées relatives
Relatifs et relatives
Les propositions subordonnées circonstancielles
La variation en degré
Types et formes de phrases
Les types de phrases
L’interrogation
Mots interrogatifs et syntaxe de l’interrogation
Interrogation et exclamation / Les modalités interrogative et exclamative
Exclamation et injonction
La négation
Les modalités de la phrase excepté l’assertion
Études transversales :
Le mot de
Le mot que/ Les emplois de que
Que et qui
Si et que
Tout, quelque, bien
L’expression de la comparaison
La deuxième personne du singulier
La syntaxe des noms désignant des parties du corps
AELC
Catégories grammaticales et syntagmes
Les adjectifs
Les adjectifs qualificatifs
Les adverbes
Les démonstratifs
Les déterminants
L’absence de déterminant
L’article et l’absence de déterminant
Les déterminants et l’absence de déterminant
Les pronoms
Le pronom on
Les pronoms personnels
Les indéfinis (pronoms et déterminants)
Les groupes prépositionnels
Les expansions du nom
Verbe et constructions verbales
La fonction sujet
Les compléments du verbe
Les compléments indirects
Le verbe être
Être et avoir
Les constructions verbales
Les constructions attributives
Les temps de l’indicatif
Le subjonctif et le conditionnel
Les modes non personnels du verbe
L’infinitif
Les formes en -ant
Les participes passés
Propositions et constructions de la phrase
L’ordre des mots
Les modes de construction de la phrase complexe
Juxtaposition et coordination
La subordination
Les propositions subordonnées
Les propositions subordonnées relatives
Types et formes de phrase
Le passif
L’expression de la négation
Les types de phrase
Types et formes de phrase
Les modalités de phrase
Interrogation et exclamation
Exclamation, injonction, interrogation
Cohésion textuelle
Les anaphores grammaticales
Mots et couples de mots
Le morphème que
Que et qui
Remarques
Faites les remarques nécessaires sur l’extrait allant de […] à […].
Faites les remarques syntaxiques nécessaires sur l’extrait allant de […] à […].
AEGr
Extraits de Jean de Léry : le mot que ; analyse des subordonnées dans une phrase complexe ; les valeurs du subjonctif.
Extraits de L’Hermite : les déterminants ; l’ordre des mots dans une phrase ; l’expression de la concession.
Extraits de Diderot : les valeurs des tiroirs verbaux ; les pronoms
Extraits de Proust : le démonstratif ; les formes en – ant ; les emplois de l’infinitif ; l’adverbe pesamment (analyse morphologique et histoire).
Session 2022
Remarques nécessaires (un sujet sur dix environ)
Classes de mots et groupes de mots
Le syntagme nominal
Les déterminants
Les déterminants et l’absence de déterminant
L’article et l’absence d’article
Les pronoms / Les pronoms personnels
L’adjectif
Adjectif et groupe adjectival
Adjectifs, participes et formes en -ant
Participes et formes en -ant
Adjectifs et formes en -ant
Participe et groupe participial
Les modifieurs du nom et du GN
Les démonstratifs
Démonstratifs et possessifs
Les expansions du nom
La détermination nominale
L’adverbe / L’adverbe, à l’exception des adverbes de négation
Les prépositions / Les groupes prépositionnels / Les syntagmes prépositionnels / Préposition et syntagme prépositionnel / Les constructions prépositionnelles
Adverbes et groupes prépositionnels
Prépositions et conjonctions
Conjonctions de subordination et pronoms relatifs
Le morphème de
Le mot que
qui et que / Les mots qui et que
Les mots en qu-
Fonctions
La fonction sujet
L’attribut
L’apposition
Attribut, apostrophe, apposition
Épithète, apposition, apostrophe
Les compléments d’objet / La fonction objet
La complémentation verbale
Le complément d’objet direct
Les compléments circonstanciels
Appositions et compléments circonstanciels
Les emplois du participe
Syntagme verbal
L’infinitif / Les emplois de l’infinitif
Les temps de l’indicatif / Les tiroirs verbaux de l’indicatif Les emplois de l’indicatif et du subjonctif
Les participes / Les emplois du participe
Les constructions pronominales et les verbes pronominaux Les constructions de être et de faire
Les constructions de avoir et de faire
La construction des verbes
Les formes non personnelles du verbe
Les modes verbaux
La transitivité verbale
Types, formes, constructions de phrases, énonciation
La construction de la phrase complexe
Les subordonnées / Les propositions subordonnées relatives / Les subordonnées circonstancielles / Relatives et conjonctives, à l’exclusion des circonstancielles
La subordination
Types et formes de phrases
Référence et expression de la personne
L’expression de la négation / La négation L’interrogation / La syntaxe de l’interrogation
Interrogation et injonction
Les modalités interrogative et exclamative
La syntaxe de l’exclamation
Les variations en degré
L’expression de la comparaison
La coordination
L’ordre des mots
Liste non communiquée.
Le mot « que » dans la Lettre XXVI de Rousseau, La Nouvelle Héloïse.
L’emploi du verbe « être », E. Rostand, Cyrano, II, 6, « Puis… je voulais… […] c’est ce bobo », v. 768-803.
L’emploi du subjonctif, Madame d’Aulnoy, Gracieuse et Percinet, p. 56-57, « À peine y fut- elle entrée qu’on ferma les portes […] et la mirent dehors avec mille injures ».
Le mot « qui » et l’analyse de l’adverbe « heureusement », Les Regrets, sonnet 54.
L’étude des pronoms, J.-P. Sartre, L’Enfance d’un chef, p. 175, « Qui suis-je ? […] je n’existe pas ».
Les groupes compléments, Perrault, Contes, « La Belle au Bois Dormant », p. 192-194, « Il entra dans une grande avant-cour […] la moitié des choses qu’ils avaient à se dire ».
L’emploi des temps, Rousseau, La Nouvelle Héloïse, Lettre XVII, p. 616-617, « Quand je gémissais […] plus cruel que le mien ».
Les emplois de l’infinitif, Rousseau, La Nouvelle Héloïse, cinquième partie, Lettre VII, p. 711-712, « Depuis un mois […] n’en diffère pas de beaucoup ».
Les déterminants du nom, Rostand, Cyrano, I, 5, v. 477-511, p. 115-118, « Mais où te mènera […] Oui Roxanne ».
L’emploi des guillemets et des italiques, Sartre, Erostrate, p. 79-80, « Les hommes, il faut les voir d’en haut […] Je les aurais tués ».
Expliquez la construction syntaxique des vers 1-4, Du Bellay, sonnet 89, p. 101.
Session 2021
Classes des mots et groupes de mots
Les dÈterminants
Les pronoms / Les pronoms personnels / Les pronoms, à líexception des pronoms personnels
Líadjectif / La syntaxe de líadjectif / Les emplois des adjectifs
Les dÈmonstratifs
Les expansions du nom
Líadverbe / Líadverbe, à líexception des adverbes de nÈgation
Les prÈpositions / Les groupes prÈpositionnels
Les parties invariables du discours
de
qui et que
que
Fonctions
La fonction sujet
Líattribut
Attribut, apostrophe, apposition / Attribut et apposition
ÉpithËte, apposition, apostrophe / ÉpithËte et apposition
Le complÈment díobjet
Le complÈment díobjet direct
Syntagme verbal
Líinfinitif/les emplois de líinfinitif
Líemploi des temps de líindicatif / Les tiroirs verbaux de líindicatif
Les emplois de líindicatif et du subjonctif
Les formes en -ant
Le participe / Les emplois du participe
Le passif
Les constructions des verbes
Le verbe être / être et avoir
Les emplois de être
Les verbes à la forme pronominale et leurs complÈments
Les modes non personnels du verbe
La transitivitÈ verbale
Les propositions subordonnÈes / Les propositions subordonnÈes relatives
La subordination
Faire et devoir
Types, formes, constructions de phrases, Ènonciation
Le dÈtachement / Les constructions dÈtachÈes
Les phrases atypiques
Les types de phrases / Les modalitÈs et les types de phrases
Líexpression de líinjonction / Exclamation, interrogation, injonction
Líexpression de la nÈgation
Líinterrogation
Líexpression du degrÈ (de comparaison et díintensitÈ)
Le discours rapportÈ
Faites toutes les remarques nécessaires…
Faites toutes les remarques syntaxiques nécessaires…
Faites toutes les remarques utiles et nécessaires…
Énonciation, organisation communicationnelle des énoncés
Les marques grammaticales du discours et du récit
Anaphore et deixis
Les différents modes de référence
Les discours rapportés
Discours et récit
Les modalités d’énonciation
Modalités d’énonciation et types de phrase
Exclamation, injonction, interrogation
La modalité injonctive
Fonctions syntaxiques et syntaxe de la phrase
L’attribut
Les compléments d’objet
Complément d’objet et attribut
Les subordonnées
Les relatives
La phrase complexe
L’ordre des mots
Juxtaposition et coordination
La coordination
La subordination
Classes de mots, groupes de mots
L’adjectif
Les adjectifs qualificatifs
Les adjectifs
La syntaxe de l’adjectif qualificatif
Les participes
Les pronoms
Les pronoms personnels
L’adverbe
Les adverbes
Les déterminants
L’absence de déterminants
Article et absence d’article
Les déterminants du nom sauf l’article
L’absence de déterminant du nom
L’article
Les démonstratifs
Morphèmes et mots grammaticaux
Le morphème de
Le morphème que que
que et qui
Autour du verbe
L’infinitif
Les compléments du verbe
Les modes impersonnels du verbe
Les modes non personnels du verbe
Indicatif et subjonctif
Les constructions pronominales
Les valeurs des temps de l’indicatif
Les temps verbaux
Être et avoir
Les participes
Les formes en -ant
Les temps de l’indicatif
La transitivité verbale
Les constructions attributives
Les constructions verbales
Le subjonctif
Les verbes pronominaux
Études transversales
Les groupes détachés
L’expression de la négation
Les degrés d’intensité et de comparaison
Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, 10e nouvelle, p. 144-146 (« A l’heure Florinde commença […] et cruelle mort. ») : étudier l’interrogation dans la première phrase de l’extrait ; analyser la subordonnée relative l. 3 ; étudier les déterminants dans la phrase « Mais si j’avais […] », p. 147 ; étudier la négation dans la phrase « Celui qui possède votre corps […] » (p. 145) ; analyser soit dans « que le péché soit jamais imputé […] ».
Marguerite de Navarre, L’Heptaméron, 20e nouvelle, p. 248-249 (« Voilà, dist Longarine […] recit d’histoires ») : expliquer la place du pronom personnel complément dans « Saffredent luy doit demander pardon » et « comme ceulx qui aimoient mieulx leurs plaisirs que leurs oraisons, s’estoient allé cacher dedans une fosse » ; identifier la forme si et commenter son emploi dans « si est ce chose qui ne se doit soupçonner en autre » et « si est-ce que je l’ay ouy dire » ; analyser la formation et le sens de entretenement et privauté ; commenter l’emploi de aucunes dans « aucunes ont tant usé en mon endroit du conseil que vous leur donnez [..] ».
Nicolas Boileau, Satire X, p. 131-132, v. 309-340 : analyser la structure grammaticale des deux premiers vers ; étudier les groupes nominaux prépositionnels dans les vers 311-314 ; analyser la proposition subordonnée relative v. 318 ; analyser le GN dont le noyau est « présent » (v. 325) ; analyser le mot « tout », v. 330-334 ; étudier les déterminants dans les vers 333-336.
Nicolas Boileau, Art poétique, IV, p. 253-254, v. 49-84 : analyser quiconque (v. 55) ; étudier le mode dans les subordonnées des vers 59 à 61 ; analyser la structure grammaticale de la phrase [on a beau] (v. 65) ; étudier les verbes pronominaux dans les vers 66, 70, 74 ; analyser tout / tous dans le passage.
George Sand, Mauprat, chap. XI, p. 212-213 (« La violence de mon caractère […] sur ses chiens de chasse ») : étudier le GN dont le noyau est disputes (l. 3) ; justifier le subjonctif nourrît (l. 7) ; étudier les groupes prépositionnels dans la phrase « L’orateur du château […] » (l. 10) ; analyser le mot des l. 21 et l. 25 ; étudier fort (l. 26) ; étudier les GNP introduits par dans l. 6 et l. 9 ; étudier l’emploi du subjonctif dans la dernière phrase du texte.
George Sand, Mauprat, chap. XVII, p. 284-285 (« J’arrivai à La Roche-Mauprat […] le sang noir des Mauprat ») : étudier l’emploi du mot de dans le passage « […] l’air seul était rempli du mouvement et du bruit des grandes phalanges d’oiseaux de passage ; les grues dessinaient dans le ciel des triangles gigantesques, et les cigognes, passant à une hauteur incommensurable, remplissaient les nuées de cris mélancoliques […] » ; commenter l’emploi de l’article dans « les grues » et « les cigognes » ; identifier la forme tous et commenter sa valeur dans « je crois que tous les hommes sont saisis d’une tristesse instinctive à l’approche de la saison rigoureuse » et « Les bâtiments de ferme étaient tous renouvelés » ; analyser les constructions la nature s’assoupissait, Le soleil se couchait, le pont ne se levait plus ; étudier la formation et le sens de incommensurable; commenter l’emploi de l’adjectif aratoires (« instruments aratoires »).
Casanova, Histoire de ma vie, p. 1186-1187 (« Le surlendemain […] mécontent des acteurs ») : analyser vis-à-vis de (l. 1) ; étudier les verbes pronominaux dans les trois premières phrases du texte ; étudier la négation dans la phrase « Les pardons que nous devions […] se sentaient inondées » ; analyser les subordonnées relatives dans le même passage.
Casanova, Histoire de ma vie, p. 1182-1183 (« La cloche de minuit m’a éveillé. […] sur lequel mon pauvre individu reposait ») : identifier la valeur des temps verbaux dans les deux premières phrases (« La cloche de minuit m’a éveillé. Affreux réveil lorsqu’il fait regretter le rien, ou les illusions du sommeil ») ; l’emploi du mot que dans « Rendu un peu à moi-même, je me suis fait la grâce de croire que la main que j’avais cru toucher n’était qu’un objet de l’imagination » ; les formes en -ant dans « […] et je trouve la même main, que transi d’horreur, et jetant un cri perçant je serre, et je relâche en retirant mon bras » ; identification, origine et valeur de on (« […] peut-être mon ami qu’on avait étranglé, et qu’on avait ainsi placé près de moi […] ») ; la fonction des adjectifs dans « la même main froide que je tenais serrée devient vive » ; comparer les emplois de rien (« lorsqu’il fait regretter le rien » et « il n’y avait rien »).
Casanova, Histoire de ma vie, p. 1248-1250 (« Je lui ai répondu que je lui enverrai […] dûment consigné ») : expliquer l’emploi du subjonctif dans « le plus grand plat qu’il eût à la maison », « pour que le beurre sortant du plat ne coulât pas sur la bible » et « il n’y avait aucune raison qui pût lui faire détourner les yeux»; identifier les formes verbales « s’attacheraient », « aurait découvert » et « aurait pu » et commenter leur emploi ; étudier l’origine et la formation des adverbes facilement, lentement et dûment ; analyser tout dans « il me promit de faire tout à la lettre » et « fromage parmesan qu’il m’avait porté tout râpé » ; étudier les propositions dans « Je me suis vu sûr de la victoire d’abord que j’ai vu la bible sur ses bras, car les deux bouts de l’esponton qui étaient éloignés de mes yeux de toute la largeur du livre, étaient devenus invisibles pour lui lorsqu’il le tenait : ».
Jean Genet, Le Balcon, 7e tableau, p. 102-103 (« Le chef de la police. – Mais la Reine ? […] de métal et de pierre ») : expliquer l’accord de l’adjectif dans « Au centre du mouchoir, toujours brodé en soie bleu pâle » ; commenter l’ordre des mots dans le passage « C’est ici seulement que sa Majesté s’inquiète : sera-ce l’eau d’un lac, d’un étang, d’une mare ? » ; commenter la formation et le sens de insoluble ; faire toutes les remarques nécessaires sur le passage « Sa Majesté s’emploie à devenir tout entière ce qu’elle doit être : la Reine » ; donner la fonction du groupe nominal «vers l’immobilité» dans «Elle aussi, elle va vite vers l’immobilité » ; la modalité interrogative dans « Qu’avez-vous fait de Sa Majesté ? » et « La Reine est morte ? ».
Jean Genet, Les Bonnes, p. 77-80 (« MADAME. – C’est fini […] CLAIRE. – Le Tilleul, madame ») : analyser qui (l. 3, p. 77) ; analyser t’en (l. 5, p. 77) ; étudier l’interrogation p. 77-79 ; analyser le GNP depuis le temps que vous l’admirez ; analyser faire dans le texte ; étudier les déterminants, p. 79 (2e réplique de Madame).
Session 2020
• Remarques nécessaires : 1 sujet sur 10 en moyenne
• Classes des mots et groupes de mots
Les déterminants
L’article défini et le déterminant démonstratif
Les pronoms / Les pronoms personnels / Les pronoms, à l’exception des pronoms personnels
L’adjectif / La syntaxe de l’adjectif / Les emplois des adjectifs
Les démonstratifs
Les expansions du nom
L’adverbe
Les prépositions / Les groupes prépositionnels
Les parties invariables du discours
Tout et les adverbes de degré
Le morphème de
Les mots qui et que / Les mots qui, que, quel / Le mot que
• Fonctions
La fonction sujet
L’épithète
L’attribut
Attribut, apostrophe, apposition / Attribut et apposition Epithète, apposition, apostrophe / Epithète et apposition
Le complément d’objet / Le complément d’objet direct
Les compléments circonstanciels
• Syntagme verbal
L’infinitif
L’emploi des temps de l’indicatif / Les tiroirs verbaux de l’indicatif
Le subionctif
Le temps des verbes
Les formes en -ant
Le participe / Les emplois du participe
Le passif
Les constructions verbales / La syntaxe des groupes verbaux
Les emplois de être / Les constructions des verbes être et faire
Les verbes à la forme pronominale et leurs compléments
Les modes non personnels du verbe
La transitivité verbale
Les propositions subordonnées / Les propositions subordonnées relatives
La subordination
• Types, formes et constructions de phrases
Le détachement / Les constructions détachées
Les phrases atypiques
Les types de phrases / Les modalités et les types de phrases
L’injonction
La négation
L’interrogation
Interrogation et négation
• Sujets portant sur des classes de mots :
– le nom
– les adverbes
– l’adjectif qualificatif
– la place des adjectifs
– la syntaxe de l’adjectif
– les déterminants
– l’absence de déterminants
– la détermination nominale
– l’article
– les indéfinis
– les pronoms
– le pronom il/ils
– les pronoms personnels
– qui et que
– le morphème que
– le morphème de
– les mots invariables
• Sujets portant sur le verbe :
– l’infinitif
– les temps de l’indicatif
– les modes non personnels du verbe
– le subjonctif
– les temps verbaux
– les emplois du subjonctif
– forme pronominale du verbe
– les constructions verbales
– infinitif et participe
– le participe
– le verbe être
– Être, avoir et faire
– temps du discours et temps du récit
• Sujets portant sur la syntaxe de la phrase :
– les subordonnées
– les subordonnées relatives
– la phrase complexe
– les types de phrases
– l’ordre des mots
• Sujets portant sur les fonctions grammaticales :
– la fonction sujet
– la fonction épithète et attribut
– la fonction COD
– les compléments essentiels
– les expansions du nom
– les compléments indirects
• Les sujets portant sur l’énonciation et l’organisation communicationnelle des énoncés :
– modalités d’énonciation et types de phrases
– les modes de référence
– marques grammaticales du discours et du récit
– marques grammaticales du discours direct et du discours indirect
– les différents modes de référence
– l’expression de la négation
– anaphore et deixis
– discours et récit
– les discours rapportés
Robert Garnier, Hippolyte III, 1463-1498 : commenter detestable (v. 1463) ; analyser vivez infame (v. 1486) ; le groupe prépositionnel à vos pieds je me jette (v. 1473) ; les formes en -ant à partir de s’enfla grossissant (v. 1467), un Taureau mugissant (v. 1468), en vous touchant (v. 1486) et m’iray-je nettoyant (v. 1488) ; commenter ce ventre t’a porté qui s’enfla grossissant (v. 1467).
Robert Garnier, La Troade II, 939-974 : analyser sans sçavoir que résoudre (v. 941) ; analyser le groupe prépositionnel mon esprit eslancé de deux extrêmes peurs (v. 939-940) ; identifier et commenter les formes cestuy-là vit, cestuy-ci ne vit plus (v. 963) ; analyser Voici pas ton Hector qui au tombeau te prie (v. 969).
La Bruyère, Les Caractères, chap. VII, § 11 et 12, p. 298-300 : § 11 : identifier et analyser la forme quel ; analyser riches ; le présentatif c’est ; analyse de l’on ; analyser la structure à se faire moquer de soi ; § 12 : la subordonnée dans il fera demain ce qu’il fait aujourd’hui.
Voltaire, L’Ingénu, chap. 6 : analyser l’adjectif dans il avait l’esprit juste ; identifier et commenter le complément dans renvoyer chez ses parents ; analyser la structure il devint aussi furieux que le fut son patron Hercule ; commenter le groupe prit le parti ; identifier et commenter c’était de quoi la mettre au désespoir ; identifier quelque dans qui firent quelque effet.
Voltaire, Zadig, « Le nez » : analyser le complément dans revint d’une promenade (l. 1) ; le pronom personnel dans qui peut mettre ainsi hors de vous-même (l. 2-3) ; commenter lui fit entendre que (l. 25) ; la subordonnée dans si vous saviez à quoi elle s’occupait (l. 9-10) ; le subjonctif dans s’il n’y en avait pas une qui fût bonne pour le mal de rate et dans elle regretta beaucoup que le grand Hermès ne fût pas encore à Babylone (l. 31-33) ; commenter le groupe après tout (l. 40).
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, « Le Bossu Bitor » : la fonction des adjectifs mélancolique et intermittent (v. 23 et 26) ; analyser le complément dans tout le monde est à terre (v. 27) ; le pronom dans vous soulage (v. 38) ; l’emploi de l’infinitif aux vv. 31-32 ; analyse des syntagmes nominaux de la fille et du couteau (v. 35).
Tristan Corbière, Les Amours jaunes, « Frère et sœur jumeaux » : analyser les compléments dans les gendarmes, à la popote, sous les armes (v. 9-10) ; le que dans Un Dimanche de Mai que tout avait une âme (v. 13) ; le mot chaud dans tenant chaud (v. 30) ; le groupe de chien couchant (v. 28).
Blaise Cendrars, L’Homme foudroyé, pp. 452-453 : la détermination dans le syntagme nominal tous les bons compagnons tailleurs de pierre qui ont coopéré à l’édification du nouveau temple de Dieu ; le mot de dans les syntagmes plein d’échos mourants et de longs murmures et les bouquets des orchidées ; analyser le complément sous les voûtes des branches ; identifier et expliquer la construction : allaient réaliser.
AELM
Remarques nécessaires (environ 1 sujet sur 10)
Classes de mots
Les déterminants
Déterminants et absence de déterminant
L’adjectif
Les démonstratifs
Démonstratifs et possessifs
Les pronoms
Les pronoms personnels
Les pronoms interrogatifs et relatifs
Les indéfinis
Les parties du discours invariables
L’adverbe
Groupes de mots
Le groupe nominal
Les fonctions du groupe nominal
Les groupes prépositionnels
Mots grammaticaux polysémiques et polyfonctionnels
Le mot que
Qui et que
Qui, que, quoi
Le mot de
Les mots en qu-
Le mot en
Fonctions
La fonction sujet
Sujet et absence de sujet
L’attribut
Attribut, apostrophe, apposition
Les compléments du verbe
La syntaxe du groupe verbal
Le complément d’objet direct
Les compléments circonstanciels
Syntaxe de la phrase
Les propositions subordonnées
La subordination
Autour du verbe
Les emplois des temps de l’indicatif
Les emplois des temps et des modes personnels du verbe
Être et avoir
Les modes non personnels du verbe
L’infinitif
Le participe
Participe et infinitif
Adjectifs et participes
Adjectif et participe passé
Le subjonctif
Les constructions du verbe
Constructions attributives et constructions transitives
La transitivité verbale
Périphrases verbales, locutions verbales et constructions à verbe support
Les verbes pronominaux et les constructions pronominales
Types (et formes) de phrases
L’interrogation
Interrogation et exclamation
Exclamation, injonction, interrogation
Les modalités de la phrase, sauf l’assertion
La négation
Morphosyntaxe et pragmatique de l’injonction
L’injonction
Grammaire du texte et de l’énonciation
Anaphore et deixis
L’anaphore
Le discours rapporté
Études transversales
Les constructions détachées
L’expression de la comparaison
L’expression du degré (intensité et comparaison)
AELC
Classes de mots (à l’exception du verbe)
L’absence de déterminant
L’adjectif
Les adjectifs qualificatifs
L’adverbe
L’article
Article et absence d’article
de, des
de, des
Les démonstratifs
Les déterminants
Déterminants et absence de déterminants
Le morphème « de »
Le morphème qu-
Le morphème que
Les morphèmes que et qui
Les participes
Les prépositions
Les pronoms
Les pronoms personnels
Les pronoms relatifs
que
qui et que
qui, que, quoi
La sémantique de l’adjectif
Le verbe
L’aspect verbal
Auxiliaires et semi-auxiliaires
Le COD
La complémentation verbale
Les compléments du verbe
Les compléments essentiels du verbe.
La construction verbale
Les constructions pronominales du verbe
La forme pronominale du verbe
Indicatif et subjonctif
L’infinitif
Infinitifs et participes
Le verbe faire
Les modes non personnels du verbe
Les modes personnels
Les modes personnels du verbe
Les temps de l’indicatif
Temps du discours et temps du récit
Les temps verbaux
La valeur des temps de l’indicatif
Les verbes pronominaux
Groupes de mots
La détermination nominale
Les groupes nominaux
Les groupes prépositionnels
Les groupes verbaux
L’ordre des mots
Fonctions syntaxiques et prolongements sémantiques
L’attribut
Les épithètes
Epithètes et attributs
La fonction sujet
La place des adjectifs
Le sujet
La syntaxe de l’adjectif
Syntaxe de la phrase
Les constructions détachées
Les groupes détachés
Parataxe et hypotaxe
La phrase complexe
Les propositions subordonnées
Les relatives
La subordination
Les subordonnées
Les subordonnées circonstancielles
Types et formes de phrases
Grammaire énonciative, organisation communicationnelle des énoncés
Les différents modes de référence
La négation
Anaphore et deixis
Les marques grammaticales des discours rapportés
Les marques grammaticales du discours et du récit
Modalités d’énonciation et types de phrase
L’interrogation
La référence
La référence pronominale
Analyse syntaxique d’un segment du texte
Etude syntaxique
Remarques nécessaires
Remarques syntaxiques
AEGr
Marot, L’Adolescence clémentine :
• Ballade XIII, p. 266-268. Comparez s’envola et se tue ; étudiez la subordination v. 9-10 ; analysez dont (v. 15) ; analysez la séquence que si sa mort […] ; analysez la séquence à ses petits a la vie rendue ; analysez le dans le pélican, au dernier vers.
• Rondeaux XLV à XLVII, p. 322-325. Étudiez la séquence De celui qui ne pense qu’en s’amie ; étudiez de même les séquences sur le point d’enrager, un parler, toutes les nuits ; analysez la forme verbale prenne ; étudiez les propositions subordonnées relatives dans le Rondeau XLVI ; justifiez les subjonctifs dans la deuxième strophe du Rondeau XLVII.
• Chansons XII et XIII, p. 357-359. Chanson XII : analyser les formes en -ant (v. 1-8) ; analyser mien, sien (v. 9-10) ; commenter l’emploi de saurait (v. 18) ; Chanson XIII : conjuguer j’acquiers (v. 6) en entier, à l’indicatif présent et futur.
Scarron, Le Roman comique :
IIe partie, chap. XVII, p. 305-306 (« Enfin Baguenodière […] qu’on ne pouvait deviner. »). Analyser les verbes pronominaux du passage ; analyser plus merveilleux et les plus charitables ; analyser y dans tandis que l’on y travaillait ; analyser la négation dans Il n’avait pas ouvert la bouche que pour dire ; analyser le groupe des deux frères qui le gourmaient.
Marivaux, La Dispute, La Fausse Suivante, La Double Inconstance :
• La Double Inconstance, acte II, scène 1, pp. 53-54. Analysez du dans du bien ; étudiez les séquences il va venir et c’est quelque chose d’épouvantable que ce pays-ci ; justifiez le mode de la forme vienne (l. 13) ; analysez tout (l. 26) ; étudiez les types et formes de phrases (l. 19-53) ; étudiez que (deux occurrences) ; analysez et justifiez la forme verbale fût dans ces gens-là […] souhaiteraient que le Prince fût content.
• La Fausse Suivante, acte I, scène 1, pp. 31-32. Analysez un Homère dans c’est comme qui te dirait un Homère ; étudiez les pronoms relatifs l. 3 à 8 ; étudiez le mot de dans la phrase Nous avons encore… Diogène ; étudiez que depuis de vilains noms jusqu’à les modernes ? ; étudiez la forme verbale eût dans Parce qu’il voulait qu’on eût quatre mille ans sur la tête pour valoir quelque chose ; faites toutes les remarques que vous jugerez nécessaires sur la séquence Je me mis à admirer tout ce qui me paraissait ancien.
Balzac, Le Cousin Pons :
• Chapitre VIII, p. 82-84 (« – Ah ! je l’avais oublié ! […] elle ne connaissait pas le nom de Watteau »). Analysez dont dans au soin du parent, dont le seul tort était d’être un parent pauvre ; analysez le pauvre homme offusqué (anaphore infidèle) ; analysez deux occurrences de qui ; analysez de dans avoir l’air de, de son pique-assiette, le nom de Watteau.
• Chapitre XXXV, p. 187-189 (« Les galeries de tableaux ne sont possibles […] comme fit Élie Magus, un jour, en Allemagne »). Analysez que dans les galeries de tableaux ne sont possibles qu’éclairées par leurs plafonds ; analysez leur dans une vie qui leur était propre, étudiez la séquence ce petit vieillard ; étudiez la formation de démeublée ; analysez trois millions dans un Juif, au milieu de trois millions ; analysez quelque sublime qu’il soit ; analysez y dans vous y voyez souvent venir à vous des Pons ; analysez des Pons ; étudiez la négation l. 36-37 ; analysez la séquence vous vous demandez à quelle tribu parisienne ils peuvent appartenir.
• Chapitre XLV, p. 229-230 (« Arrivée au second étage au-dessus de l’entresol, […] qui s’y sentait peu, malgré son âcreté nauséabonde »). Analysez du dans du plus vilain caractère ; commenter rouge dans un rouge faux ; commenter la forme était enduite ; analyser le groupe de cette couche noirâtre ; commenter l’emploi de devait dans devait avoir inventé ; analyser quelles dans quelles arabesques !
Beauvoir, Mémoires d’une jeune fille rangée
• IIIe partie, p. 232-233 (« Il cédait à la nécessité. […] penser qu’il ne l’était pas »). Analysez avait passé dans la guerre avait passé ; étudiez les formes verbales dans je me trompais, pour se prouver sa distinction, je me trouvais (analyse des structures réfléchies) ; analysez cet dans par cet exhibitionnisme agressif ; analysez la séquence il se mit à dire merde ; analysez de dans de rares occasions ; étudiez la subordination l. 29-30.
• IVe partie, p. 447-448 (« Nous parlions d’un tas de choses, […] il ne vivait que pour écrire »). Analysez d’un tas de choses dans Nous parlions d’un tas de choses ; analysez propre dans mon propre système ; étudiez la séquence élevée comme je l’avais été ; analysez ce qu’il y avait de plus estimable en moi ; analysez cette entreprise ; étudiez les relatives de la ligne 21 à 24 ; analysez exceptionnelle dans je m’étais crue exceptionnelle.
Session 2008
AELM
A. Questions de synthèse portant sur une catégorie
Syntaxe de la phrase
conjonctions de coordination et ponctuation
coordination
propositions
relatifs et relatives
relatives
subordination
subordonnées
subordonnées circonstancielles
Le verbe
auxiliaires et semi-auxiliaires
formes en -ant
futur et conditionnel
impératif indicatif
indicatif et subjonctif
infinitifs
modes non personnels
modes personnels
participes participes passés
participes présents et participes passés
présent
subjonctif
temps de l’indicatif
temps et aspects de l’indicatif
valeur d’emploi des temps de l’indicatif
verbes à la forme pronominale
verbes impersonnels et constructions impersonnelles
verbes pronominaux
voix active, passive et pronominale
Classes de mots
absence d’article
adjectif qualificatif
adverbes
articles
article et absence d’article
conionctions
conjonctions de coordination
démonstratifs
déterminant et absence de déterminant
déterminants
formes et emplois de l’article
indéfinis
indéfinis sauf l’article
numéraux
prépositions
pronoms
pronoms personnels
substantifs non déterminés
Fonctions syntaxiques
adjectifs qualificatifs épithètes
apostrophes et appositions
appositions
appositions et épithètes
attributs et appositions
compléments du nom
compléments circonstanciels
compléments circonstanciels de temps et de lieu
compléments d’objet
compléments de lieu
expansions du nom
fonction attribut
fonction objet
fonction sujet
fonctions de l’adjectif qualificatif
groupes nominaux prépositionnels
place de l’adjectif qualificatif
place de l’épithète
B. Questions de grammaire énonciative, organisation communicationnelle des énoncés, grammaire du texte
connecteurs argumentatifs
discours rapporté
emphase et présentatifs
interrogation
marques grammaticales des discours rapportés
modalité injonctive
modalités d’énonciation
ordre des mots
ponctuation
ponctuation et signes typographiques
références endophoriques et références exophoriques
reprise anaphorique
C. Questions transversales
degrés d’intensité et de comparaison
expression de la comparaison
expression de la négation
expression du degré
expression du lieu
négation
D. Questions de sémantique grammaticale portant sur des formes polyvalentes
« avoir »
« être »
« être » et « avoir »
« être », « avoir », « faire » « qui » et « que »
«être » et « faire »
Classer et étudier « que »
Le mot « de »
Le mot « que »
Le mot « si »
Le verbe « faire »
Les formes en « qu- »
E. Questions portant sur un ensemble syntaxique
Analyse syntaxique de…
Étude syntaxique d’un passage
Faire les remarques nécessaires sur…
F. Autres
Le genre grammatical
Les accords
Les fautes de français
Les marques du genre
Les marques du pluriel