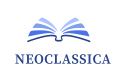Cette page regroupe les sujets de l’Agrégation externe spéciale de Lettres modernes, créée en 2017. Elle est réservée aux doctoresses et docteurs ayant soutenu leur thèse de doctorat.
Les programmes, sujets et rapports des quelques dernières années se trouvent, au format PDF, sur le site du ministère de l’Éducation nationale, de même que le descriptif des épreuves.
SYNOPSIS DES SUJETS
Première composition française (Littérature française)
Moyen Âge : 0/9
XVIe siècle : 2/9
XVIIe siècle : 3/9
XVIIIe siècle : 1/9
XIXe siècle : 1/9
XXe siècle : 2/9
2017 : Montaigne (XVIe siècle)
2018 : Flaubert (XIXe siècle)
2019 : Scarron (XVIIe siècle)
2020 : Cendrars (XXe siècle)
2021 : Casanova (XVIIIe siècle)
2022 : Perrault et D’Aulnoy (XVIIe siècle)
2023 : Jean de Léry (XVIe siècle)
2024 : D’Urfé (XVIIe siècle)
2025 : Koltès (XXe siècle)
Session 2017
Première composition française
Pour Hugo Friedrich, Montaigne « a clairement conscience de ce qu’est son essai : un poème de circonstance méditatif, dans une prose de forme ouverte, modeste en comparaison du grand art, et malgré cela, ou plutôt à cause de cela, plein d’une « merveilleuse grâce », et beau dans le libre jeu de sa force avec le multiple ».
(Hugo Friedrich, Montaigne, Paris, Gallimard, 1968, p. 353)
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture du livre III des Essais de Montaigne ?
Seconde composition française
« Moins avide du Dieu que soucieux du semblable, il [le lyrisme] ne cesse de tenter ou de rêver de réconcilier l’écriture et la vie. Si l’acte d’écrire suppose une coupure par rapport au dehors, le lyrisme voudrait l’abolir. Faire entrer dans la langue la substance et les énergies de la vie. Mais aussi bien descendre dans ce mystère que reste le langage, approcher la façon dont il vit en nous, nous enflamme ou nous manque. »
(Jean-Michel Maulpoix : « Le lyrisme comme quête de l’altérité… », entretien de avec Bertrand Leclair, paru dans La Quinzaine littéraire n° 785 du 16 mai 2000)
Quel éclairage ces propos de Jean-Michel Maulpoix jettent-ils sur les trois recueils du programme « Formes de l’action poétique » ?
Session 2018
Première composition française
Lui-même [Flaubert] trouvait L’Éducation sentimentale esthétiquement manquée, par défaut d’action, de perspective, de construction. Il ne voyait pas que ce livre était le premier à opérer cette dédramatisation, on voudrait presque dire déromanisation du roman par où commencerait toute la littérature moderne, ou plutôt il ressentait comme un défaut ce qui en est pour nous la qualité majeure.
(Gérard Genette, « Silences de Flaubert », Figures I, Le Seuil, 1966, Points, p. 243)
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture de L’Éducation sentimentale ?
Seconde composition française
« Cela nous submerge. Nous l’organisons. Cela tombe en morceaux.
Nous l’organisons de nouveau et tombons nous-mêmes en morceaux. »
(Rilke, « Huitième élégie », Élégies de Duino, 1923,
traduction J.-F. Angelloz, GF Flammarion, 1992, p. 87)
Dans quelle mesure cette citation vous semble-t-elle éclairer les oeuvres du programme « Expériences de l’histoire, poétiques de la mémoire » ?
Session 2019
Première composition française
« C’est le primesaut qui commande, l’immédiateté du récit ; le narrateur est tout entier dans l’instantané de la phrase qu’il est en train de saisir ; il brode à petit point et ne se soucie pas de haute couture : comment pourrait-il se préoccuper de transitions, d’explications, de mises en relation, de cohérence générale et de plan d’ensemble ? Plutôt qu’un roman à clefs, Scarron fabrique un roman à tiroirs, le modèle du roman implexe, entrelacs de fils narratifs, combinaison de modes, amalgame de tons. »
Yves Giraud, préface au Roman comique, GF, 1981, p. 19.
Vous analyserez et discuterez ces propos ; dans quelle mesure éclairent-ils votre lecture du Roman comique de Scarron ?
Seconde composition française
Dans un article intitulé « Les enjeux anthropologiques du témoignage. Le genre, l’acte, le rite, le jeu »(2017), Catherine Coquio écrit :
« Lorsque la vérité est un « mal de vérité », sa diction devient une ascèse et une utopie forcément inventives. Elles obligent l’auteur à se retourner sur – et parfois contre – la littérature, en tant que réservoir de procédés et d’effets éprouvés. »
(dans La Littérature testimoniale, ses enjeux génériques, textes réunis par Philippe Mesnard,
Paris, Société Française de Littérature Générale et Comparée,
« Poétiques comparatistes », 2017, p. 94)
Discutez cette affirmation en vous fondant sur votre lecture des trois oeuvres du programme « Expériences de l’histoire, poétiques de la mémoire ».
Session 2020
Première composition française
Cendrars « ne peut que dire son absence de certitudes concernant le monde et le sujet, la fragmentation des hypothèses, la scission du moi à chaque instant, l’impossible fixation du “je” par l’écriture. Il ne peut que tenter de recueillir, de sauver, de recevoir les avatars multiples de lui-même, ces mystiques déchus tombant ou sautant du ciel, comme le ferait un filet tendu sous un chapiteau. On s’aperçoit que ce que l’on prenait pour des figures christiques ne sont en fait que des incarnations de Dionysos, que des artistes retombant dans le filet, fragments de vie revenant sur terre, prêts à se renouveler. »
(Laurence Guyon, Cendrars en énigme, Champion, 2007, p. 202)
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture de L’Homme foudroyé ?
Seconde composition française
Dans ses Considérations politiques sur les coups d’État (1639) Gabriel Naudé s’exclame : « Pour moi je tiens le discours si puissant, que je n’ai rien trouvé jusques à cette heure qui soit exempt de son empire ; c’est lui qui persuade, et qui fait croire les plus fabuleuses religions, qui suscite les guerres les plus iniques, qui donne voile et couleur aux actions les plus noires, qui calme et apaise les séditions les plus violentes, qui excite la rage et la fureur aux âmes les plus paisibles. »
Dans quelle mesure cette affirmation éclaire-t-elle votre lecture des pièces inscrites au programme intitulé « Le pouvoir en scène » ?
Session 2021
Première composition française
« Casanova ne veut rien prouver sans doute à la manière des moralistes. On peut le lire sans se rendre compte de ses intentions. Pourtant il compose savamment pour que le lecteur se laisse prendre à son insu dans la gigantesque tentative à laquelle il est attelé : nier, sans en avoir l’air, les fondements de la société, se refuser à participer à l’histoire grotesque des hommes, en acceptant les risques qui endécoulent ».
François Roustang, Le Bal masqué de Giacomo Casanova [1984], réed. Paris, Payot, 2009, p. 42.
En quoi ces propos éclairent-ils votre lecture des pages de l’Histoire de ma vie inscrites au programme ?
Seconde composition française
Dans un essai consacré aux évolutions du récit, le philosophe allemand Walter Benjamin écrit :
« Le roman s’est élaboré dans les profondeurs de l’individu solitaire, qui n’est plus capable de se prononcer de façon pertinente sur ce qui lui tient le plus à cœur, qui est lui-même privé de conseil et ne saurait en donner. Écrire un roman, c’est faire ressortir par tous les moyens ce qu’il y a d’incommensurable dans la vie. »
(Walter Benjamin, « Le narrateur » [1936], Écrits français,
Paris, Gallimard, « Bibliothèque des idées », 1991, p. 209)
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des trois œuvres inscrites au programme intitulé « Solitude et communauté dans le roman » ?
Session 2022
Première composition française
« Le conte de fées ne se contente pas de reprendre de vieilles histoires, il représente cette opération même et conduit le lecteur à réfléchir sur son rapport à la fiction et aux formes archaïques de la sensibilité. »
Jean-Paul Sermain, Le Conte de fées du classicisme aux Lumières,
Paris, Desjonquères, 2005.
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des Contes de Perrault et des Contes de fées de Madame d’Aulnoy ?
Seconde composition française
Dans une lettre à Armand Fraisse (18 février 1860), Charles Baudelaire écrit :
« Quel est donc l’imbécile (c’est peut-être un homme célèbre) qui traite si légèrement le Sonnet et n’en voit pas la beauté pythagorique ? Parce que la forme est contraignante, l’idée jaillit plus intense. Tout va bien au Sonnet, la bouffonnerie, la galanterie, la passion, la rêverie, la méditation philosophique. Il y a là la beauté du métal et du minéral bien travaillés. Avez- vous observé qu’un morceau de ciel, aperçu par un soupirail, ou entre deux cheminées, deux rochers, ou par une arcade, etc., donnait une idée plus profonde de l’infini que le grand panorama vu du haut d’une montagne ? »
Baudelaire, Correspondance, t. I,
Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1973, p. 676.
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des œuvres du programme « Formes de l’amour. Sonnets de la modernité » ?
Session 2023
Première composition française
« Parler du monde, c’est recenser des différences et afficher des idées claires et distinctes. Cela n’entraîne pas que le Nouveau Monde soit sans rapport avec l’Ancien : la perception de l’altérité opère à l’intérieur d’un système où la réalité familière fonctionne comme point de référence. »
Michel Jeanneret, « Léry et Thevet : comment parler d’un monde nouveau ? »,
D’encre de Brésil. Jean de Léry, écrivain, éd. Franck Lestringant et Marie-Christine Gomez-Géraud,
Paris, Paradigme, 1999.
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture de l’Histoire d’un voyage faict en la terre du Brésil de Jean de Léry ?
Seconde composition française
« Si depuis la plus haute Antiquité ou depuis les cultures décimées, les métamorphoses rejouent, selon de nouveaux modes, leur puissante partition dans la littérature moderne et contemporaine, c’est qu’elles ébranlent et descellent les portraits en pied d’une humanité tellement droite qu’elle en est devenue rectiligne. »
Anne Simon, Une Bête entre les lignes. Essai de zoopoétique,
Marseille, Wildproject Éditions, 2001.
Dans quelle mesure cette citation éclaire-t-elle votre lecture des œuvres du programme « Fictions animales » ?
Session 2024
Première composition française
« Dans ces moments où l’image de la réalité et du sujet est ébranlée, dédoublée, c’est le plaisir de la surprise qui l’emporte, et l’intellectualisme de d’Urfé empêche l’image d’être gagnée par le vertige et la déraison baroques. L’univers pastoral, fût-il nourri de fantasmes érotiques, relève d’un imaginaire dominé, il est dépaysement et trouble délicieux, mais il n’affecte jamais vraiment l’ordre et la solidité du monde réel. »
Jean Lafond, Préface à L’Astrée, Paris, Gallimard, 1984, p. 20.
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture de la Première partie de L’Astrée ?
Seconde composition française
« Les cœurs aussi sont semblables à l’ombre ; toujours placés en porte à faux, ils aiment en vain, se cherchent et se dérobent ; leurs rencontres sont des ruptures, leurs jeux dessinent une danse dont les pas ne seraient que décrochements, glissades, sauts dans le vide et syncopes. »
Jean Rousset, La Littérature de l’âge baroque en France. Circé et le paon,
Paris, José Corti, p. 39.
Dans quelle mesure ce propos éclaire-t-il votre lecture des œuvres du programme « Théâtres de l’amour et de la mémoire » ?
Étude grammaticale d’un texte de langue française antérieur à 1500
et d’un texte de langue française postérieur à 1500
(Fabliaux et Baudelaire)
Session 2025
Première composition française
Dans « Point de fuite à l’horizon » (revue Europe, novembre-décembre 1997), Jean-Yves Coquelin écrit :
« Dans ses fables, dans les trajets de ses personnages, dans l’acte même de l’écriture, Koltès introduit du mouvement de façon presque obsessionnelle. Comme si tout reposait sur la rupture de l’immobilité, la course ou, tout au moins, sur une promesse de déplacement. Son maître-mot : bouger. »
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des oeuvres de Koltès au programme ?
Seconde composition française
« Le réalisme magique écrit le silence auquel le traumatisme ne cesse de revenir, et le convertit en histoire. »
Dans quelle mesure ces propos d’Eugene Arva (The Traumatic Imagination, Cambia Press, 2011) éclairent-ils votre lecture des œuvres du programme « Romans du “réalisme magique” » ?
Étude grammaticale d’un texte de langue française antérieur à 1500
et d’un texte de langue française postérieur à 1500
(Richard de Fournival et Hélisenne de Crenne)