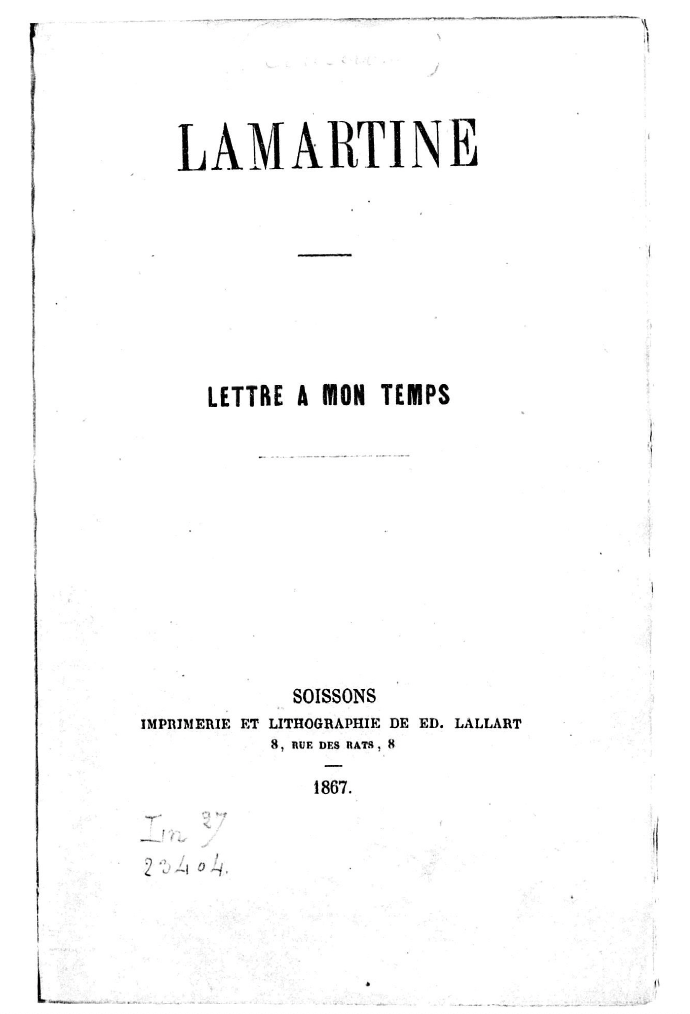LAMARTINE.
LETTRE À MON TEMPS
Augustine-Malvina Blanchecotte
SOISSONS
IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE D’ÉDOUARD LALLART
Éditeur du Progrès de l’Aisne
8, RUE DES RATS.
1867
Il s’est passé dans notre pays un fait inouï, à peu près invraisemblable pour les historiens de l’avenir. Il faut avoir assisté à cette incroyable émulation d’injures, à ce déchaînement d’outrages vis-à-vis du plus pur nom du siècle, pour ne pas douter du témoignage de ses yeux et de ses oreilles et de la stupéfaction de sa conscience.
Je veux parler de Lamartine. Je ne suis pas une Elvire. Aucune folie d’imagination et aucun intérêt de vanité ne me font sortir de mon cher silence. Je fais seulement partie de la conscience publique, j’appartiens aux générations qui seront bientôt du passé et qui sont dès à présent des documents d’histoire contemporaine et, à ce titre, de toute mon indignation et de tout mon honneur, je proteste.
Et il est temps de le faire, il est temps d’élever la voix — je parle de notre voix collective à nous autres qui ne changeons pas et qui, de nos enthousiasmes premiers, ne faisons pas une déshonorante ingratitude.
Les jours ne s’arrêtent point, les heures comptent double et triple pour le noble poète dont l’accablement présent — comme la gloire autrefois — est sans bornes. Et quand tout sera consommé, quand la mort aura mis une consécration dernière, une suprême et définitive auréole sur cette tête vénérable, il sera trop tard.
Je dis qu’il sera trop tard pour nous autres, fidèles et modestes dans notre piété au malheur, et qui chérissons par-dessus tout le désintéressement dans la vérité.
Car alors une révolution tout entière aura lieu dans l’esprit du temps. Ce seront des délires de louanges, ces débordements d’apothéoses, aucun piédestal ne sera assez gigantesque pour la statue de Lamartine défunt. Et ceux-là qui se sont montrés les plus acharnés après sa fin de vie, se dresseront les plus présomptueux et les plus lyriques en face de sa mémoire.
N’attendons pas ce moment où ce sera une bonne fortune et un triomphe d’avoir connu Lamartine, et où l’on fera de son nom, à présent insulté, un succès en littérature. —
J’écris une lettre toute simple, toute spontanée, sans aucune prétention littéraire. J’aurais pu, comme quelques autres, le grand nom y prêtant, essayer un article, rimer des vers. Je ne le fais pas. L’indignation est comme le chagrin, dépouillé d’artifices. On dit ce qu’on sent, on pleure ce qu’on souffre, sans aucune considération de rythme ou de prosodie. La conscience seule s’exprime parce que, je le répète, cette conscience individuelle se rattache à la conscience générale.
Et sous l’impulsion de cette conscience révoltée, je dis à mon temps, je dis à cette fraction d’esprits qui, en décriant Lamartine, ont un jour perdu le sentiment d’eux-mêmes : C’est mal, c’est très mal. Tôt ou tard, le manque de respect s’expie. Ce n’est pas impunément qu’une époque se renie et ose souffleter ses grands hommes. — L’histoire augure mal de ce complet oubli d’honneur, de cet entier naufrage de la dignité des lettres. Il vient un moment où la postérité à son tour venge de tels actes. La justice, cette divinité immortelle, fait son œuvre à travers les siècles ; et sa face, recouverte longtemps d’un crêpe, apparaît tout à coup inexorable.
Que reprochez-vous à Lamartine ? De n’avoir point eu l’esprit pratique, de n’avoir jamais rien compris aux spéculations de comptoir, d’avoir toujours donné plus qu’il ne recevait et, en un mot, d’avoir des dettes !
Ô gens du monde qui vous en préoccupez si peu, qui menez la vie à grandes guides sans jamais regarder derrière vous, comme vous ne connaissez guère ce grand nom que vous insultez ! Car s’il est un fantôme qui se dresse devant lui oppressif, plein d’épouvante, sous les traits de l’anxiété éternelle, c’est celui de ses dettes, son intime et plus profonde angoisse !
Que fait à Lamartine l’ingratitude humaine ? Elle ne l’a point surpris, il s’y attendait. Sa pensée, de tout temps lumineuse, lui avait enseigné à ne point espérer de l’humaine nature autre chose que ce qu’elle peut donner. Il a subi cette trahison du siècle avec un calme, avec une sérénité qui ne se sont jamais démentis. Jamais une plainte ne s’est élevée de ses lèvres contre ce pays qui l’abandonnait. S’il eût pu une nouvelle fois le préserver et le sauver, sans dire une parole, il l’eût fait. Le poète est l’impassible voyant que rien n’étonne et rien ne déconcerte.
Mais ce que dans sa probité rigide, dans son scrupule de loyauté poussé jusqu’au fanatisme, ce que Lamartine n’a jamais accepté, ce sont précisément ces dettes que vous lui reprochez.
Je ne discuterai pas d’où elles lui viennent. Toute une population de familles secourues et d’amis assistés, une multitude de protégés le savent mieux que moi ; — et quant aux créanciers, la plupart ont commencé par beaucoup gagner avant de devoir attendre ce qu’ils ne perdront pas.
Mais ce que je puis dire plus particulièrement que personne, c’est que Lamartine est hanté jusqu’au désespoir par ce spectre de ses dettes, et que ce farouche point d’honneur l’envahissant tout entier, l’a seul fait consentir à tous les essais de souscriptions plus ou moins heureux, et dont il n’est pas responsable, qui ont été tentés en son nom et qui lui ont valu les humiliations de sa vieillesse.
Avec moins de rigidité, de délicatesse et d’honneur (nous ne saurions trop répéter ce mot quand il s’agit de Lamartine), il eût, semblable aux gens du monde, laissé de côté ses dettes, et, sobre comme est sa vie, il eût encore eu trop de ce qu’il gagnait, et il eût trouvé le moyen d’en donner de plus en plus aux autres.
Devant cette préoccupation incessante qui ne lui laisse de repos ni jour ni nuit, Lamartine, ainsi qu’un travailleur obstiné, s’est attelé à son labeur et, comme fait un ouvrier besoigneux, debout dès l’aube — quelque rude que soit la saison — il écrit, toujours pour dégrever la dette ! …
Quel caractère trouverez-vous qui offre plus de fière dignité, une telle unité dans le droit chemin ?
Des concessions ou des accommodements de conscience — à quelque point de vue qu’on le place — n’ont jamais été possibles pour Lamartine. Généreux et désintéressé dans l’action, il est resté intègre et désintéressé dans le silence.
Et sa récente adhésion même, cette acceptation de la dernière heure au don que le pays (qui lui dut tant !) vient de lui faire, il ne s’y résigna qu’en vue de la Dette, il lui sembla souscrire un billet à ordre, un billet de dégrèvement mortuaire pour ses créanciers.
Voilà — abstraction faite de toute littérature et de toute politique — le Lamartine vrai, intime, douloureux, profondément pur, clément quand même, que des hommes de parti, — spirituels écrivains ou poètes nouveau-venus, (un moment fourvoyés) ont osé attaquer, sans être arrêtés par la majesté du génie et par l’inviolabilité de l’âge.
En vérité, ce temps-ci ne respecte rien. Jamais la Société n’a moins représenté la famille : de tels faits domestiques seraient monstrueux. Vous figurez-vous le chef vénéré d’une maison ainsi maltraité par les siens ? Ne croirait-on pas au sacrilège ?
N’est-ce pas une amplification, dira l’histoire ? N’y a-t-il pas là fiction poétique ? Non, malheureusement, ce n’est pas une fiction. Les injures publiques et les injures privées sont là qui nous l’attestent. Et plus tard, dans le lointain avenir, il viendra un jour où nos descendants se diront, ressongeant à nous autres : Une gloire sereine, pure, illuminait et consolait ce siècle. La vie, cette chose si triste, la vie humaine de ce temps-là avait revêtu l’enchantement de ses vers. La jeunesse aimait, soupirait, s’ennoblissait avec eux, l’âge mûr se souvenait, et la vieillesse se transfigurait aux chants de Lamartine. Et chez ceux qui font profession d’aimer le beau, parmi ceux qu’on appelle les poètes, qui avaient trempé leur première plume dans ce lac d’azur, qui avaient allumé le premier rayon de leur âme au soleil de son génie, il s’en est trouvé d’oublieux et d’égarés qui ont donné le signal et qui, fils ingrats, renouvelant la légende biblique des fils de Noé, ont soulevé le manteau de ses misères et ont dit : Voici la plaie, venez frapper ! …
Je voudrais que mon nom eût autorité et renommée pour signer cette insuffisante, mais véridique lettre. Tel qu’il est, il se sent le mandataire et le représentant de bien d’autres et considère comme un devoir, au nom de la justice et de l’antique honneur de formuler publiquement ce témoignage d’admiration absolue et d’absolu respect.
A.-M. Blanchecotte.
Paris, le 24 mai 1867.
Un grand merci à Éléonore Rambaud pour l’édition de ce texte !