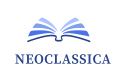Voir le Projet II.
Le site Arrête ton char propose, au format PDF, de nombreux sujets et rapports, sur plusieurs décennies. Sont regroupés, sur le même site, plusieurs sujets de version latine.
Les sujets de 1975 à 1999 ont fait l’objet d’une publication au format papier qui les regroupe tous.
Quelques copies de concours se trouvent sur cette page (voir le Projet I).
Les synopsis en début de page permettent de se faire une idée des auteur, des textes et des sujets qui tombent.
De 1975 à 1999, les trois sujets (composition française, version latine et version grecque) sont regroupés par année dans l’ordre chronologique. À partir de 2013, les sujets de composition française sont présentés du plus récent au plus ancien.
À partir de la session 2022, les sujets de la première épreuve ne sont plus des sujets de littérature générale mais portent sur l’une des œuvres au programme. Voir cette page.
SYNOPSIS
Version latine
POÉSIE : 5/29
PROSE : 24/29
1975 : Sénèque le Jeune (prose)
1976 : Tacite (prose)
1977 : Cicéron (prose)
1978 : Pline le Jeune (prose)
1979 : Cicéron (prose)
1980 : Tacite (prose)
1981 : Sénèque le Jeune (prose)
1982 : Ovide (poésie)
1983 : Tite Live (prose)
1984 : César (prose)
1985 : Virgile (poésie)
1986 : Tacite (prose)
1987 : Sénèque le Jeune (prose)
1988 : Lucain (poésie)
1989 : Tite Live (prose)
1990 : Cicéron (prose)
1991 : Ovide (poésie)
1992 : Sénèque le Jeune (prose)
1993 : Tite Live (prose)
1994 : Tacite (prose)
1995 : Cicéron (prose)
1996 : Pline le Jeune (prose)
1997 : Quinte Curce (prose)
1998 : Sénèque le Jeune (prose)
1999 : Tite Live (prose)
2022 : Tite Live (prose)
2023 : Ovide (poésie)
2024 : Sénèque (prose)
2025 : Cicéron (prose)
Version grecque
POÉSIE : 6/29
PROSE : 23/29
1975 : Platon (prose)
1976 : Polybe (prose)
1977 : Thucydide (prose)
1978 : Démosthène (prose)
1979 : Isocrate (prose)
1980 : Démosthène (prose)
1981 : Euripide (poésie)
1982 : Platon (prose)
1983 : Sophocle (poésie)
1984 : Isocrate (prose)
1985 : Démosthène (prose)
1986 : Platon (prose)
1987 : Xénophon (prose)
1988 : Euripide (poésie)
1989 : Thucydide (prose)
1990 : Isocrate (prose)
1991 : Athénion cité par Athénée (poésie)
1992 : Eschine (prose)
1993 : Euripide (poésie)
1994 : Platon (prose)
1995 : Isocrate (prose)
1996 : Polybe (prose)
1997 : Xénophon (prose)
1998 : Démosthène (prose)
1999 : Sophocle (poésie)
2022 : Xénophon (prose)
2023 : Démosthène (prose)
2024 : Isocrate (prose)
2025 : Lucien (prose)
Session 1975
Composition française
En vous interrogeant sur quelques œuvres maîtresses de notre littérature, vous vous demanderez dans quelle mesure a pu se modifier la signification qu’elles avaient à l’origine pour leurs auteurs et pour leur temps et vous tenterez d’en dégager des conclusions sur la vie des grandes œuvres à travers les siècles.
Version latine
AU SERVICE D’UNE GRANDE ŒUVRE
Non praeterit me, Lucili uirorum optime, quam magnarum rerum fundamenta ponam senex, qui mundum circuire constitui et causas secretaque eius eruere atque aliis noscenda producere. Quando tam multa consequar, tam sparsa colligam, tam occulta perspiciam ? Premit a tergo senectus et obicit annos inter uana studia consumptos. Tanto magis urgeamus et damna aetatis male exemptae labor sarciat ; nox ad diem accedat, occupationes recidantur, patrimonii longe a domino iacentis cura soluatur, sibi totus animus uacet et ad contemplationem sui saltem in ipso fine respiciat. Faciet ac sibi instabit et cotidie breuitatem temporis metietur. Quicquid amissum est, id diligenti usu praesentis uitae recolliget ; fidelissimus est ad honesta ex paenitentia transitus. Libet igitur mihi exclamare illum poetae incliti uersum :
« Tollimus ingentes animos et maxima paruo
Tempore molimur » ?
Hoc dicerem, si puer iuuenisque molirer – nullum enim non tam magnis rebus tempus angustum est – ; nunc uero ad rem seriam, grauem, immensam post meridianas horas accessimus. Faciamus quod in itinere fieri solet : qui tardius exierunt, uelocitate pensant moram. Festinemus et opus nescio an superabile, magnum certe, sine aetatis excusatione tractemus. Crescit animus, quotiens coepti magnitudinem attendit et cogitat quantum proposito, non quantum sibi supersit.
Consumpsere se quidam, dum acta regum externorum componunt quaeque passi inuicem ausique sunt populi. Quanto satius est sua mala extinguere quam aliena posteris tradere ! Quanto potius deorum opera celebrare quam Philippi aut Alexandri latrocinia ! […]
Quanto satius est quid faciendum sit quam quid factum quaerere, ac docere eos, qui sua permisere fortunae nihil stabile ab illa datum esse, munus eius omne aura fluere mobilius !
Sénèque,
Questions naturelles, III, Préface, 1-5 et 7
(250 mots)
Version grecque
LA MORALE DE CALLICLÈS
ΚΑΛΛΙΚΛΗΣ. Τοῦτ’ ἐστὶν τὸ κατὰ φύσιν καλὸν καὶ δίκαιον, ὃ ἐγώ σοι νῦν παρρησιαζόμενος λέγω, ὅτι δεῖ τὸν ὀρθῶς βιωσόμενον τὰς μὲν ἐπιθυμίας τὰς ἑαυτοῦ ἐᾶν ὡς μεγίστας εἶναι καὶ μὴ κολάζειν, ταύταις δὲ ὡς μεγίσταις οὔσαις ἱκανὸν εἶναι ὑπηρετεῖν δι’ ἀνδρείαν καὶ φρόνησιν, καὶ ἀποπιμπλάναι ὧν ἂν ἀεὶ ἡ ἐπιθυμία γίγνηται.
Ἀλλὰ τοῦτ’ οἶμαι τοῖς πολλοῖς οὐ δυνατόν· ὅθεν ψέγουσιν τοὺς τοιούτους δι’ αἰσχύνην, ἀποκρυπτόμενοι τὴν αὑτῶν ἀδυναμίαν, καὶ αἰσχρὸν δή φασιν εἶναι τὴν ἀκολασίαν, ὅπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐγὼ ἔλεγον, δουλούμενοι τοὺς βελτίους τὴν φύσιν ἀνθρώπους, καὶ αὐτοὶ οὐ δυνάμενοι ἐκπορίζεσθαι ταῖς ἡδοναῖς πλήρωσιν ἐπαινοῦσιν τὴν σωφροσύνην καὶ τὴν δικαιοσύνην διὰ τὴν αὑτῶν ἀνανδρίαν. Ἐπεί γε οἷς ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρξεν ἢ βασιλέων ὑέσιν εἶναι ἢ αὐτοὺς τῇ φύσει ἱκανοὺς ἐκπορίσασθαι ἀρχήν τινα ἢ τυραννίδα ἢ δυναστείαν, τί τῇ ἀληθείᾳ αἴσχιον καὶ κάκιον εἴη σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης τούτοις τοῖς ἀνθρώποις· οἷς ἐξὸν ἀπολαύειν τῶν ἀγαθῶν καὶ μηδενὸς ἐμποδὼν ὄντος, αὐτοὶ ἑαυτοῖς δεσπότην ἐπαγάγοιντο τὸν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων νόμον τε καὶ λόγον καὶ ψόγον ; Ἢ πῶς οὐκ ἂν ἄθλιοι γεγονότες εἶεν ὑπὸ τοῦ καλοῦ τοῦ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς σωφροσύνης, μηδὲν πλέον νέμοντες τοῖς φίλοις τοῖς αὑτῶν ἢ τοῖς ἐχθροῖς, καὶ ταῦτα ἄρχοντες ἐν τῇ ἑαυτῶν πόλει ;
Ἀλλὰ τῇ ἀληθείᾳ, ὦ Σώκρατες, ἣν φῂς σὺ διώκειν, ὧδ’ ἔχει· τρυφὴ καὶ ἀκολασία καὶ ἐλευθερία, ἐὰν ἐπικουρίαν ἔχῃ, τοῦτ’ ἐστὶν ἀρετή τε καὶ εὐδαιμονία· τὰ δὲ ἄλλα ταῦτ’ ἐστὶν τὰ καλλωπίσματα, τὰ παρὰ φύσιν συνθήματα ἀνθρώπων, φλυαρία καὶ οὐδενὸς ἄξια.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Οὐκ ἀγεννῶς γε, ὦ Καλλίκλεις, ἐπεξέρχει τῷ λόγῳ παρρησιαζόμενος· σαφῶς γὰρ σὺ νῦν λέγεις ἃ οἱ ἄλλοι διανοοῦνται μέν, λέγειν δὲ οὐκ ἐθέλουσιν.
Platon,
Gorgias, 491e-492d
(264 mots)
Session 1978
Composition française
Les pouvoirs de la poésie.
Version latine
PLINE LE JEUNE ET SA MÈRE ONT QUITTÉ MISÈNE
ET ESSAIENT D’ÉCHAPPER À L’ÉRUPTION DU VÉSUVE
Tum mater orare hortari jubere, quoquo modo fugerem ; posse enim juvenem (1), se et annis et corpore gravem bene morituram, si mihi causa mortis non fuisset. Ego contra, salvum me nisi una non futurum. Dein manum ejus amplexus addere gradum cogo. Paret aegre incusatque se quod me moretur. Jam cinis, adhuc tamen rarus. Respicio ; densa caligo tergis imminebat, quae nos torrentis modo infusa terrae sequebatur. « Deflectamus, inquam, dum videmus, ne in via strati comitantium turba in tenebris obteramur. » Vix consideramus, et nox, non qualis inlunis aut nubila, sed qualis in locis clausis lumine exstincto. Audires ululatus feminarum, infantum quiritatus, clamores virorum ; alii parentes, alii liberos, alii coniuges vocibus requirebant, vocibus noscitabant ; hi suum casum, illi suorum miserabantur ; erant qui metu mortis mortem precarentur ; multi ad deos manus tollere, plures nusquam jam deos ullos aeternamque illam et novissimam noctem mundo interpretabantur. Nec defuerunt qui fictis mentitisque terroribus vera pericula augerent. Aderant qui Miseni illud ruisse, illud ardere, falso sed credentibus nuntiabant. Paulum reluxit, quod non dies nobis sed adventantis ignis indicium videbatur. Et ignis quidem longius substitit, tenebrae rursus, cinis rursus multus et gravis. Hunc identidem adsurgentes excutiebamus ; operti alioqui atque etiam oblisi pondere essemus. Possem gloriari non gemitum mihi, non vocem parum fortem in tantis periculis excidisse, nisi me cum omnibus, omnia mecum perire misero, magno tamen mortalitatis solacio, credidissem. Tandem illa caligo tenuata quasi in fumum nebulamve discessit ; mox dies verus, sol etiam effulsit, luridus tamen qualis esse cum deficit solet.
Pline le Jeune,
Lettres, VI, 20, 12-18
(214 mots)
(1) Pline avait alors dix-huit ans.
Version grecque
UNE MALADIE QUI ENVAHIT LA GRÈCE
Νόσημα γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, νόσημα δεινὸν ἐμπέπτωκεν εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ χαλεπὸν καὶ πολλῆς τινὸς εὐτυχίας καὶ παρ’ ὑμῶν ἐπιμελείας δεόμενον. Οἱ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσι γνωριμώτατοι καὶ προεστάναι τῶν κοινῶν ἀξιούμενοι, τὴν αὑτῶν προδιδόντες ἐλευθερίαν οἱ δυστυχεῖς, αὐθαίρετον αὑτοῖς ἐπάγονται δουλείαν, Φιλίππῳ ξενίαν καὶ ἑταιρίαν καὶ φιλίαν καὶ τοιαῦθ’ ὑποκοριζόμενοι· οἱ δὲ λοιποὶ καὶ τὰ κύρι’ ἅττα ποτ’ ἔστ’ ἐν ἑκάστῃ τῶν πόλεων, οὓς ἔδει τούτους κολάζειν καὶ παραχρῆμ’ ἀποκτιννύναι, τοσοῦτ’ ἀπέχουσι τοῦ τοιοῦτόν τι ποιεῖν ὥστε θαυμάζουσι καὶ ζηλοῦσι καὶ βούλοιντ’ ἂν αὐτὸς ἕκαστος τοιοῦτος εἶναι. Καίτοι τοῦτο τὸ πρᾶγμα καὶ τὰ τοιαῦτα ζηλώματα Θετταλῶν μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μέχρι μὲν χθὲς ἢ πρώην τὴν ἡγεμονίαν καὶ τὸ κοινὸν ἀξίωμ’ ἀπωλωλέκει, νῦν δ’ ἤδη καὶ τὴν ἐλευθερίαν παραιρεῖται· τὰς γὰρ ἀκροπόλεις αὐτῶν ἐνίων Μακεδόνες φρουροῦσιν· εἰς Πελοπόννησον δ’ εἰσελθὸν τὰς ἐν Ἤλιδι σφαγὰς πεποίηκε, καὶ τοσαύτης παρανοίας καὶ μανίας ἐνέπλησε τοὺς ταλαιπώρους ἐκείνους ὥσθ’, ἵν’ ἀλλήλων ἄρχωσι καὶ Φιλίππῳ χαρίζωνται, συγγενεῖς αὑτῶν καὶ πολίτας μιαιφονεῖν. Καὶ οὐδ’ ἐνταῦθ’ ἕστηκεν, ἀλλ’ εἰς Ἀρκαδίαν εἰσελθὸν πάντ’ ἄνω καὶ κάτω τἀκεῖ πεποίηκε, καὶ νῦν Ἀρκάδων πολλοί, προσῆκον αὐτοῖς ἐπ’ ἐλευθερίᾳ μέγιστον φρονεῖν ὁμοίως ὑμῖν (μόνοι γὰρ πάντων αὐτόχθονες ὑμεῖς ἐστε κἀκεῖνοι), Φίλιππον θαυμάζουσι καὶ χαλκοῦν ἱστᾶσι καὶ στεφανοῦσι, καὶ τὸ τελευταῖον, ἂν εἰς Πελοπόννησον ἴῃ, δέχεσθαι ταῖς πόλεσίν εἰσιν ἐψηφισμένοι. Ταὐτὰ δὲ ταῦτ’ Ἀργεῖοι. Ταῦτα νὴ τὴν Δήμητρα, εἰ δεῖ μὴ ληρεῖν, εὐλαϐείας οὐ μικρᾶς δεῖται, ὡς βαδίζον γε κύκλῳ καὶ δεῦρ’ ἐλήλυθεν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὸ νόσημα τοῦτο. Ἕως οὖν ἔτ’ ἐν ἀσφαλεῖ, φυλάξασθε καὶ τοὺς πρώτους εἰσαγαγόντας ἀτιμώσατε· εἰ δὲ μή, σκοπεῖθ’ ὅπως μὴ τηνικαῦτ’ εὖ λέγεσθαι δόξει τὰ νῦν εἰρημένα ὅτ’ οὐδ’ ὅ τι χρὴ ποιεῖν ἕξετε. Οὐχ ὁρᾶθ’ ὡς ἐναργές, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ σαφὲς παράδειγμ’ οἱ ταλαίπωροι γεγόνασιν Ὀλύνθιοι ; Οἳ παρ’ οὐδὲν οὕτως ὡς τὸ τοιαῦτα ποιεῖν ἀπολώλασιν οἱ δείλαιοι.
Démosthène,
Sur les forfaitures de l’ambassade, 259-263
Session 1991
Composition française
Dans un recueil d’impressions et d’idées intitulé Rhumbs, Paul Valéry écrit :
« Une œuvre est solide quand elle résiste aux substitutions que l’esprit d’un lecteur actif et rebelle tente toujours de faire subir à ses parties.
N’oublie jamais qu’une œuvre est une chose finie, arrêtée et matérielle. L’arbitraire vivant du lecteur s’attaque à l’arbitraire mort de l’ouvrage. »
Vous direz ce que vous pensez de ces remarques en vous fondant sur des exemples précis empruntés à la littérature française.
Version latine
ARIANE, ABANDONNÉE PAR THÉSÉE SUR L’ÎLE DE DIA, Y RENCONTRE LE CORTÈGE DE BACCHUS.
Cnosis (1) in ignotis amens errabat harenis,
qua breuis aequoreis Dia feritur aquis ;
utque erat e somno, tunica uelata recincta,
nuda pedem, croceas inreligata comas,
Thesea crudelem surdas clamabat ad undas,
indigno teneras imbre rigante genas.
Clamabat flebatque simul, sed utrumque decebat ;
non facta est lacrimis turpior illa suis.
Iamque iterum tundens mollissima pectora palmis :
« Perfidus ille abiit : quid mihi fiet ? » ait.
« Quid mihi fiet ? » ait. Sonuerunt cymbala toto
litore et adtonita tympana pulsa manu.
Excidit illa metu rupitque nouissima uerba ;
nullus in exanimi corpore sanguis erat.
Ecce, Mimallonides sparsis in terga capillis,
ecce, levus satyri, praeuia turba dei.
Ebrius, ecce, senex pando Silenus asello
uix sedet et pressas continet ante iubas.
Dum sequitur Bacchas, Bacchae fugiuntque petuntque
Quadrupedem ferula dum malus urget eques,
in caput aurito cecidit delapsus asello ;
clamarunt Satyri : « Surge age, surge, pater. »
Iam deus in curru, quem summum texerat uuis,
tigribus adiunctis aurea lora dabat ;
et color et Theseus et uox abiere puellae,
terque fugam petiit terque retenta metu est.
Horruit, ut steriles agitat quas uentus aristas,
ut leuis in madida canna palude tremit.
Cui deus : « En, adsum tibi cura fidelior », inquit ;
« pone metum : Bacchi, Cnosias, uxor eris.
Munus habe caelum : caelo spectabere sidus ;
saepe reget dubiam Cressa Corona ratem. »
Dixit et e curru, ne tigres illa timeret,
Desilit, imposito cessit harena pede,
implicitamque sinu (neque enim pugnare ualebat)
abstulit ; in facili est omnia posse deo.
Ovide,
L’Art d’aimer, I, v. 527-562
(229 mots)
(1) Cnosis désigne Ariane.
Version grecque
UN CUISINIER EXPLIQUE COMMENT SON ART A CIVILISÉ L’HUMANITÉ. (Personnages : le cuisinier est désigné par A et son interlocuteur par B.)
A. Οὐκ οἶσθ’ ὅτι πάντων ἡ μαγειρικὴ τέχνη
πρὸς εὐσέϐειαν πλεῖστα προσενήνεχθ’ ὅλως ;
Β. Τοιοῦτόν ἐστι τοῦτον ; Α. Πάνυ γε, βάρϐαρε.
Τοῦ θηριώδους καὶ παρασπόνδου βίου
ἡμᾶς γὰρ ἀπολύσασα καὶ τῆς δυσχεροῦς
ἀλληλοφαγίας ἤγαγ’ εἰς τάξιν τινὰ
καὶ τουτονὶ περιῆψεν ὃν νυνὶ βίον
ζῶμεν. Β. Τίνα τρόπον ; Α. Πρόσεχε, κἀγώ σοι φράσω.
Ἀλληλοφαγίας καὶ κακῶν ὄντων συχνῶν
γενόμενος ἄνθρωπός τις οὐκ ἀϐέλτερος
ἔθυσ’ ἱερεῖον πρῶτος, ὤπτησεν κρέας.
αὑτοὺς μὲν οὐκ ἐμασῶντο, τὰ δὲ βοσκήματα
θύοντες ὤπτων. Ὡς δ’ ἅπαξ τῆς ἡδονῆς
ἐμπειρίαν τιν’ ἔλαϐον, ἀρχῆς γενομένης
ἐπὶ πλεῖον ηὖξον τὴν μαγειρικὴν τέχνην.
Ὅθεν ἔτι καὶ νῦν τῶν πρότερον μεμνημένοι
τὰ σπλάγχνα τοῖς θεοῖσιν ὀπτῶσιν φλογὶ
ἅλας οὐ προσάγοντες· οὐ γὰρ ἦσαν οὐδέπω
εἰς τὴν τοιαύτην χρῆσιν ἐξευρημένοι.
Ὡς δ’ ἤρεσ’ αὐτοῖς ὕστερον, καὶ τοὺς ἅλας
προσάγουσιν ἤδη, τῶν ἱερῶν γε δρωμένων
τὰ πάτρια διατηροῦντες. Ἅπερ ἡμῖν μόνα
ἅπασιν ἀρχὴ γέγονε τῆς σωτηρίας,
τὸ προσφιλοτεχνεῖν, διά τε τῶν ἡδυσμάτων
ἐπὶ πλεῖον αὔξειν τὴν μαγειρικὴν τέχνην. […]
Αὑτοῖς ἅπαντες ἠξίουν συζῆν, ὄχλος
ἠθροίζετ’, ἐγένονθ’ αἱ πόλεις οἰκούμεναι
διὰ τὴν τέχνην, ὅπερ εἶπα, τὴν μαγειρικήν.
Β. Ἄνθρωπε χαῖρε, περὶ πόδ’ εἶ τῷ δεσπότῃ.
Α. Καταρχόμεθ’ ἡμεῖς οἱ μάγειροι, θύομεν,
σπονδὰς ποιοῦμεν, τῷ μάλιστα τοὺς θεοὺς
ἡμῖν ὑπακούειν διὰ τὸ ταῦθ’ εὑρηκέναι
τὰ μάλιστα συντείνοντα πρὸς τὸ ζῆν καλῶς.
Β. Ὑπὲρ εὐσεϐείας οὖν ἀφεὶς παῦσαι λέγων.
Athénion, Les Habitants de Samothrace,
cité par Athénée, Deipnosophistes, XIV, 80, 660e-661d
COMPOSITION FRANÇAISE
(2000-2005 et 2013-2021)
Depuis la session ordinaire de 2014, les sujets sont communs aux Lettres modernes et aux Lettres classiques, réunis dans un même CAPES de Lettres à options de 2014 à 2018, puis présentés en deux sections distinctes depuis 2019.
À partir de la session 2022, les sujets ne sont plus des sujets de littérature générale mais portent sur une œuvre au programme.
Session 2021
S’interrogeant sur ce qui fait l’essence de la comédie, Jean-Claude Ranger en propose une définition :
« C’est avant tout, je crois, la claire conscience que rien d’essentiel n’est en jeu, ou, pour citer Aristote, que, quoi qu’en puissent penser à tel ou tel moment les personnages, “ni douleur ni destruction” ne sauraient résulter de la comédie – et c’est de cette certitude que naît le détachement du spectateur à l’égard des péripéties de l’action. »
Jean-Claude Ranger, « La comédie, ou l’esthétique de la rupture », dans Littératures classiques, n° 27, printemps 1996, p. 274-275. Vous discuterez cette proposition en vous appuyant sur des exemples d’œuvres théâtrales précis et variés.
Session 2020
« Je laisse en moi continuer ce qui s’est toujours passé en littérature, et comment pourrait-il en être autrement ? La table rase est une bêtise, nous avons lu, nous sommes quand même informés, nous écrivons sur et avec la littérature universelle, nous ne passons pas par-dessus. Nous imitons, oui, comme on l’a fait depuis le début, nous imitons passionnément et en même temps passionnément nous n’imitons pas : chaque livre, à chaque fois, est un salut aux pères et une insulte aux pères, une reconnaissance et un déni. »
Pierre Michon, Le roi vient quand il veut, Propos sur la littérature, Paris, Albin Michel, 2007, p. 110-111.
En vous appuyant sur des exemples précis et variés, vous commenterez et discuterez ces propos.
Session 2019
« La poésie, comme l’art, est inséparable de la merveille. Elle est domiciliée dans l’espace émotif et ne saurait vivre ailleurs. »
André Pieyre de Mandiargues, préface de L’Âge de craie (1961), Gallimard, collection « Poésie », 1967, p. 8.
Vous commenterez ce propos d’André Pieyre de Mandiargues en vous appuyant sur des exemples précis.
Session 2018
« L’œuvre d’art, et singulièrement l’œuvre littéraire, ne s’impose pas seulement comme un objet de jouissance ou de connaissance ; elle s’offre à l’esprit comme objet d’interrogation, d’enquête, de perplexité. »
Gaëtan Picon, L’Écrivain et son ombre, Gallimard, 1953.
Quelles réflexions vous inspirent ces propos de Gaëtan Picon ?
Session 2017
« Jamais, moi vivant, on ne m’illustrera, parce que : la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin. Du moment qu’un type est fixé par le crayon, il perd ce caractère de généralité, cette concordance avec mille objets connus qui font dire au lecteur : « J’ai vu cela » ou « Cela doit être ». Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout. L’idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles, tandis qu’une femme écrite fait rêver à mille femmes. Donc, ceci étant une question d’esthétique, je refuse formellement toute espèce d’illustration. »
Gustave Flaubert, Lettre à Ernest Duplan, 12 juin 1862, in Extraits de la correspondance ou Préface à la vie d’écrivain, présentation et choix de Geneviève Bollème, Paris, Seuil, 1963, p. 223-224.
Vous commenterez ce propos de Gustave Flaubert en vous appuyant sur des exemples empruntés aux différents genres littéraires, ainsi qu’aux arts plastiques et au cinéma.
Session 2016
« Suspendre le jugement moral ce n’est pas l’immoralité du roman, c’est sa morale. La morale qui s’oppose à l’indéracinable pratique humaine de juger tout de suite, sans cesse, et tout le monde, de juger avant et sans comprendre. Cette fervente disponibilité à juger est, du point de vue de la sagesse du roman, la plus détestable bêtise, le plus pernicieux mal. Non que le romancier conteste, dans l’absolu, la légitimité du jugement moral, mais il le renvoie au-delà du roman. Là, si cela vous chante, accusez Panurge pour sa lâcheté, accusez Emma Bovary, accusez Rastignac, c’est votre affaire ; le romancier n’y peut rien. »
Milan Kundera, Les Testaments trahis, Gallimard, 1993.
Vous analyserez et discuterez ces propos en vous appuyant sur des exemples variés et précis.
Session 2015
« Un théâtre sans convention n’a pas d’espoir. La convention c’est cette pure entrée dans l’imaginaire, sans les antichambres de l’intelligence, les salons mondains de l’élégance, etc. Le public populaire se saisit toujours plus vite d’une convention que le public savant (lequel voudrait inlassablement de la vraisemblance, de la logique psychologique, de la profondeur, de la dialectique, du parlé vrai, tout ce qui tente de se soustraire à l’architecture des conventions théâtrales).
Le public enfantin des guignols joue avec les conventions du genre comme peu de critiques savent le faire. Car il s’agit non pas de juger l’œuvre mais de jouer avec, de se jouer, de faire jouer son imaginaire, d’utiliser les conventions théâtrales pour animer son jardin intérieur. »
Olivier Py, Les Mille et une définitions du théâtre, Actes Sud, 2013.
Vous analyserez et discuterez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis empruntés à votre culture théâtrale.
Session 2014 (session ordinaire)
Évoquant sa propre vie en utilisant une énonciation à la troisième personne, Annie Ernaux écrit :
« Ce que ce monde a imprimé en elle et ses contemporains, elle s’en servira pour reconstituer un temps commun, celui qui a glissé d’il y a si longtemps à aujourd’hui – pour, en retrouvant la mémoire de la mémoire collective dans une mémoire individuelle, rendre la dimension vécue de l’Histoire.
Ce ne sera pas un travail de remémoration, tel qu’on l’entend généralement, visant à la mise en récit d’une vie, à une explication de soi. Elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde […]. »
Annie Ernaux, Les Années, Gallimard, 2008, p. 239.
Vous analyserez et discuterez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis empruntés à vos lectures.
Rapport du jury 2014 (session ordinaire)
Session 2013
Un écrivain affirme lors d’un entretien au début du 21ème siècle :
« L’oeuvre doit être partageable, elle doit donner à partager un amour possible du monde. […] Rompre avec le langage de l’autre et donc avec le monde, c’est ça l’art pour l’art. Il y a préciosité dès que l’art devient miroir de lui-même. Non, les arts doivent viser à une sorte de conciliation, de tractation avec le monde – et avec les autres. »
Commentez et, éventuellement, discutez ces propos en vous appuyant sur des exemples littéraires précis et variés.
Session 2005
Composition française
« Relire », écrit un critique contemporain, « n’est pas lire une seconde fois, mais nouer un rapport nouveau avec ce qui se fait reconnaître comme un texte ; relire est perdre notion du temps de la lecture, et se délivrer du charme qu’exerce de façon répétée la chose dite ici et maintenant. »
Vous expliquerez et commenterez cette affirmation en vous appuyant sur des exemples divers et précis.
Session 2004
Composition française
« Ayant toujours partie liée en profondeur avec les préliminaires d’une dramaturgie, la description tend non pas vers un dévoilement […] de l’objet, mais vers le battement de cœur préparé d’un lever de rideau. »
Vous commenterez ces lignes d’un romancier contemporain en vous appuyant sur des exemples précis et analysés, et sans vous limiter au genre romanesque.
Session 2003
Composition française
Paul Valéry écrit dans Ego scriptor :
« On me fait quelquefois la remarque et le reproche de mon insensibilité.
Je ne m’en défends pas. Je dis : Je sépare instinctivement l’écrivain de l’individu.
Le public n’a droit qu’à notre esprit. Le cœur est chose secrète. Un être me semble d’autant moins « sensible » qu’il exhibe et utilise le plus son sentiment. »
Quelles réflexions ces lignes vous suggèrent-elles ? Une analyse d’exemples précis étaiera ces réflexions.
Session 2002
Composition française
« La poésie est un territoire où toute affirmation devient vérité […]. Le poète n’a besoin de rien prouver ; la seule preuve réside dans l’intensité du sentiment. »
Milan Kundera, La vie est ailleurs (Gallimard, 1973)
Que pensez-vous de cette affirmation. Vous appuierez votre réflexion sur des exemples précis.
Session 2001
Composition française
« On sait que les comédies ne sont faites que pour être jouées ; et je ne conseille de lire celle-ci qu’aux personnes qui ont des yeux pour découvrir, dans la lecture, tout le jeu du théâtre. »
Molière, « Avis au lecteur » de L’Amour médecin
Que pensez-vous de cette affirmation ? Vous appuierez votre propos sur des exemples précis.
Session 2000
Composition française
Personnage de roman, personnage de théâtre.
Session 2022
Composition française
Le conte est-il un récit édifiant ?
Vous répondrez à cette question en vous fondant sur votre connaissance des Contes de Charles Perrault.
Épreuve écrite disciplinaire appliquée
Session 2023
Composition française
« Le roman dépeint un monde où toute vérité est devenue problématique. L’erreur est partout, la certitude nulle part. Les signes et le langage sombrent dans l’ambiguïté. Ils sont devenus trompeurs comme les apparences. » (Philippe Walter, Le Livre du Graal, Pléiade, tome III, 2009).
Dans quelle mesure ce propos sur La Mort du roi Arthur éclaire-t-il votre lecture de ce roman ?
Épreuve écrite disciplinaire appliquée
Session 2024
Composition française
Jean Rohou écrit à propos de Jean de La Bruyère :
« Ce style, plein de procédés, est celui qu’il fallait pour créer, mimer, dénoncer une humanité d’automates, un univers sans substance où il n’y a que des phénomènes (dans tous les sens du terme), des signes sans signification. Il convient à un esprit critique qui n’espère pas transformer le monde. » (Histoire de la littérature française du XVIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2000 (2e éd.), p. 353)
Dans quelle mesure ce propos éclaire-t-il votre lecture des livres V à XI des Caractères de La Bruyère ?
Dans ce traité, Sénèque affirme que ceux qui détiennent le pouvoir souverain doivent faire preuve de clémence.
Quoniam deorum feci mentionem, optime hoc exemplum principi constituam, ad quod formetur, ut se talem esse ciuibus, quales sibi deos uelit. Expedit ergo habere inexorabilia peccatis atque erroribus numina, expedit usque ad ultimam infesta perniciem ? Et quis regum erit tutus, cuius non membra haruspices colligant (1) ? Quod si di placabiles et aequi delicta potentium non statim fulminibus persequuntur, quanto aequius est hominem hominibus praepositum miti animo exercere imperium et cogitare, uter mundi status gratior oculis pulchriorque sit, sereno et puro die, an cum fragoribus crebris omnia quatiuntur et ignes hinc atque illinc micant ! Atqui non alia facies est quieti moratique2 imperii quam sereni caeli et nitentis. Crudele regnum turbidum tenebrisque obscurum est, inter trementes et ad repentinum sonitum expauescentes, ne eo quidem, qui omnia perturbat, inconcusso. Facilius priuatis ignoscitur pertinaciter se uindicantibus ; possunt enim laedi, dolorque eorum ab iniuria uenit.
Sénèque,
La Clémence, 7, 1-3
(1) Les crimes des souverains étaient châtiés par la foudre de Jupiter ; selon la coutume religieuse de l’expiatio de la foudre, les haruspices rassemblaient et ensevelissaient sur place les traces qu’elle avait laissées ainsi que les membres des victimes.
(2) moratique : traduire « et en ordre ».
Isocrate donne à Philippe de Macédoine des conseils sur la manière de gouverner et de se conduire avec les Grecs.
Καὶ μὴ θαυμάσῃς εἰ διὰ παντός σε τοῦ λόγου πειρῶμαι προτρέπειν ἐπί τε τὰς εὐεργεσίας τὰς τῶν Ἑλλήνων καὶ πραότητα καὶ φιλανθρωπίαν· ὁρῶ γὰρ τὰς μὲν χαλεπότητας λυπηρὰς οὔσας καὶ τοῖς ἔχουσι καὶ τοῖς ἐντυγχάνουσιν, τὰς δὲ πραότητας οὐ μόνον ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἄλλων ζῴων ἁπάντων εὐδοκιμούσας, ἀλλὰ καὶ τῶν θεῶν τοὺς μὲν τῶν ἀγαθῶν αἰτίους ἡμῖν ὄντας Ὀλυμπίους προσαγορευομένους, τοὺς δ’ ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς καὶ ταῖς τιμωρίαις τεταγμένους δυσχερεστέρας τὰς ἐπωνυμίας ἔχοντας, καὶ τῶν μὲν καὶ τοὺς ἰδιώτας καὶ τὰς πόλεις καὶ νεὼς καὶ βωμοὺς ἱδρυμένους, τοὺς δ’ οὔτ’ ἐν ταῖς εὐχαῖς οὔτ’ ἐν ταῖς θυσίαις τιμωμένους, ἀλλ’ ἀποπομπὰς αὐτῶν ἡμᾶς ποιουμένους. Ὧν ἐνθυμούμενον ἐθίζειν σαυτὸν χρὴ καὶ μελετᾶν ὅπως ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν τοιαύτην ἅπαντες περὶ σοῦ τὴν γνώμην ἕξουσιν.
Isocrate,
Philippe, 116-118
Épreuve écrite disciplinaire appliquée
Composition française
« Peut-être reconnaîtra-t-on ici la modernité du projet lérien en même temps que ses limites : la quête d’un savoir sur le monde, si familière aux auteurs de récits de voyage à la Renaissance, se voit ici concurrencée par le trésor d’une expérience qui ne saurait seulement servir à authentifier la connaissance des horizons lointains. L’écriture sur l’autre serait peut-être ici, déjà, une tentative d’écriture sur soi. » (Marie-Christine Gomez-Géraud, « Un colloque chez les Tououpinambaoults : mise en scène d’une dépossession », dans D’Encre de Brésil. Jean de Léry écrivain, textes réunis par Frank Lestringant et Marie-Christine Gomez-Géraud, Orléans, Paradigme, 1999, p.162).
Dans quelle mesure ce propos sur Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil de Jean de Léry éclaire-t-il votre lecture de ce récit ?
Version latine
Éloigné des affaires publiques depuis la dictature de César, Cicéron explique en quoi il a cependant été utile à la République grâce son activité philosophique.
Quod enim munus rei publicae adferre maius meliusue possumus, quam si docemus atque erudimus iuuentutem, his praesertim moribus atque temporibus, quibus ita prolapsa est, ut omnium opibus refrenanda ac coercenda sit ? Nec uero id effici posse confido, quod ne postulandum quidem est, ut omnes adulescentes se ad haec studia conuertant. Pauci utinam ! Quorum tamen in re publica late patere poterit industria. Equidem ex iis etiam fructum capio laboris mei, qui iam aetate prouecti in nostris libris adquiescunt ; quorum studio legendi meum scribendi studium uehementius in dies incitatur ; quos quidem plures, quam rebar, esse cognoui. Magnificum illud etiam Romanisque hominibus gloriosum, ut Graecis de philosophia litteris non egeant ; quod adsequar profecto, si instituta perfecero. Ac mihi quidem explicandae philosophiae causam attulit casus grauis ciuitatis, cum in armis ciuilibus nec tueri meo more rem publicam nec nihil agere poteram, nec quid potius, quod quidem me dignum esset, agerem reperiebam.
Cicéron,
De la divination, II, 4-6.
Version grecque
Lucien raconte comment, alors qu’il était enfant, il a vu en songe deux apparitions féminines, la Sculpture (ἡ Ἐρμογλυφική) et la Science (ἡ Παιδεία). Après le discours de la Sculpture qui a essayé d’amener Lucien à son art, c’est au tour de la Science d’argumenter pour convaincre Lucien de choisir la vie attrayante qu’elle pourrait lui offrir.
Κἄν που ἀποδημῇς, οὐδ᾿ ἐπὶ τῆς ἀλλοδαπῆς ἀγνὼς οὐδ’ ἀφανὴς ἔσῃ· τοιαῦτά σοι περιθήσω τὰ γνωρίσματα ὥστε τῶν ὁρώντων ἕκαστος τὸν πλησίον κινήσας δείξει σε τῷ δακτύλῳ, « οὗτος ἐκεῖνος » λέγων. Ἄν δέ τι σπουδῆς ἄξιον ἢ τοὺς φίλους ἢ καὶ τὴν πόλιν ὅλην καταλαμβάνῃ, εἰς σὲ πάντες ἀποβλέψονται· κἄν πού τι λέγων τύχῃς, κεχηνότες οἱ πολλοὶ ἀκούσονται, θαυμάζοντες καὶ εὐδαιμονίζοντές σε τῆς δυνάμεως τῶν λόγων καὶ τὸν πατέρα τῆς εὐποτμίας. Ὃ δὲ λέγουσιν, ὡς ἄρα καὶ ἀθάνατοι γίγνονταί τινες ἐξ ἀνθρώπων, τοῦτό σοι περιποιήσω· καὶ γὰρ ἢν αὐτὸς ἐκ τοῦ βίου ἀπέλθῃς, οὔποτε παύσῃ συνὼν τοῖς πεπαιδευμένοις καὶ προσομιλῶν τοῖς ἀρίστοις. Ὁρᾷς τὸν Δημοσθένην1 ἐκεῖνον, τίνος υἱὸν ὄντα ἐγὼ ἡλίκον ἐποίησα. Ὁρᾷς τὸν Αἰσχίνην, ὡς τυμπανιστρίας υἱὸς ἦν, ἀλλ᾿ ὅμως αὐτὸν δι᾿ ἐμὲ Φίλιππος ἐθεράπευεν. Ὁ δὲ Σωκράτης καὶ αὐτὸς ὑπὸ τῇ Ἑρμογλυφικῇ2 ταύτῃ τραφείς, ἐπειδὴ τάχιστα συνῆκεv τοῦ κρείττονος καὶ δραπετεύσας παρ᾿ αὐτῆς ηὐτομόλησεν ὡς ἐμέ, ἀκούεις ὡς παρὰ πάντων ᾄδεται.
Lucien,
Le Songe, 11-12
Épreuve disciplinaire appliquée
CONSEILS DES RAPPORTS DE JURY
Composition française
• Il faut proposer un tout agencé et harmonieux.
• Il ne suffit pas de faire des parties pour donner une organisation au devoir.
Version latine
• Renouveler et approfondir ses connaissances en littérature, en mythologie, en histoire et en civilisation.
• Acquérir et consolider les connaissances en morphologie et en syntaxe.
• Connaître les éléments de base de la métrique (cf. Traité de métrique latine classique de Louis Nougaret).
• Lire et traduire régulièrement des textes latins, afin de s’accoutumer aux structures et au lexique les plus communs.
• Bien gérer son temps.
• L’idéal est de rendre le(s) ton(s) du texte.
• Il ne faut pas lire trop vite et confondre : amens et amans ; ualebat et uolebat ; feritur et fertur ; abire et abiere.
• Il faut faire attention aux déclinaisons grecques.
• L’accusation de relation doit être maîtrisé.
• Les emplois d’ut doivent être parfaitement maîtrisés.
Version grecque
• Revoir « à fond » une grammaire scolaire puis se pénétrer la Syntaxe grecque de Marcel Bizos.
• Lire précisément le texte, avant de se plonger dans le dictionnaire.
• Ne pas reprendre sur son brouillon les notices du Bailly.
• Pourchasser le « français de version ».
• Bien relire sa copie.
• Il ne faut pas éliminer de mots.
• Les formes homonymes sont piégeantes.
***
Les fautes de français récurrentes
• la confusion de construction entre se souvenir et se rappeler
• les verbes en –ure ne se conjuguent pas comme les verbes en -uer (elle inclut — il conclut)