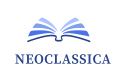Voir le Projet II.
Toutes les bonnes volontés pour aider à la compilation
de ces annales sont les bienvenues,
ne fût-ce que pour un petit sujet !
Pour le moment, cette page regroupe les sujets de compositions françaises et les sujets de thèmes et de version latine de l’Agrégation externe de Grammaire. Une partie des compositions de grammaire est disponible en PDF. La page est progressivement complétée et compte actuellement 135 sujets in extenso et de nombreux corrigés.
Les programmes, sujets et rapports des quelques dernières années se retrouvent aussi, au format PDF, sur le site du ministère de l’Éducation nationale, tout comme le descriptif des épreuves. Le site Arrête ton char propose, au format PDF, de nombreux programmes, sujets et rapports, sur plusieurs décennies. Une partie des programmes des sessions antérieures se trouve sur Wikipédia, à partir de ceux de l’agrégation externe de Lettres classiques et de Lettres modernes. On peut aussi en trouver de plus anciens dans les Bulletins officiels de l’Éducation nationale. Voir également cette page pour quelques anciens rapports du jury (2004-2007).
Les sujets de 2008 à aujourd’hui sont regroupés, en format PDF, sur le site du Département des Sciences de l’Antiquité de l’École normale supérieure de Paris, avec les rapports du jury. Les sujets de 1983 à 1999 et ceux de 2000 à 2019 ont fait l’objet d’une publication au format papier qui les regroupe tous. Afin de ne pas faire de tort aux Publications de l’Université de Saint-Étienne avec lesquelles j’ai collaboré pour les annales, susmentionnées, des agrégations externes de Lettres classiques et de Grammaire, les sujets de 2000 à 2019 ne seront présentés ici que sous la forme de liens vers les sujets en question. Vous pouvez retrouver l’ensemble au format papier.
Quelques copies de concours se trouvent sur cette page (voir le Projet I).
Lorsque le jury propose un corrigé pour les versions et les thèmes, nous le reproduisons ici. Ces textes appartiennent évidemment à leurs autrices et auteurs et à https://www.devenirenseignant.gouv.fr. Des explications plus détaillées sont disponibles dans les rapports de jury.
Les synopsis des sujets en début de page permettent de se faire une idée des auteurs et des textes qui sont tombés.
Cette Agrégation est devenue mixte lors de la session 1974.
SYNOPSIS DES SUJETS
Composition française
Moyen Âge : 0/52
XVIe siècle : 5/52
XVIIe siècle : 12/52
XVIIIe siècle : 14/52
XIXe siècle : 12/52
XXe siècle : 9/52
1974 : Montherland (XXe siècle)
1975 : Prévost (XVIIIe siècle)
1976 : Pascal (XVIIe siècle)
1977 : Molière (XVIIe siècle)
1978 : Giono (XXe siècle)
1979 : Balzac (XIXe siècle)
1980 : Saint-Simon (XVIIIe siècle)
1981 : Ronsard (XVIe siècle)
1982 : Laclos (XVIIIe siècle)
1983 : Sévigné (XVIIe siècle)
1984 : Rimbaud (XIXe siècle)
1985 : Rousseau (XVIIIe siècle)
1986 : Montaigne (XVIe siècle)
1987 : Zola (XIXe siècle)
1988 : Claudel (XXe siècle)
1989 : Corneille (XVIIe siècle)
1990 : Rousseau (XVIIIe siècle)
1991 : Musset (XIXe siècle)
1992 : La Fontaine (XVIIe siècle)
1993 : Valéry (XXe siècle)
1994 : Céline (XXe siècle)
1995 : Hugo (XIXe siècle)
1996 : Racine (XVIIe siècle)
1997 : Stendhal (XIXe siècle)
1998 : Nerval (XIXe siècle)
1999 : Laclos (XVIIIe siècle)
2000 : Molière (XVIIe siècle)
2001 : Proust (XXe siècle)
2002 : Marivaux (XVIIIe siècle)
2003 : Montaigne (XVIe siècle)
2004 : Balzac (XIXe siècle)
2005 : Beaumarchais (XVIIIe siècle)
2006 : Retz (XVIIe siècle)
2007 : Prévost (XVIIIe siècle)
2008 : Rotrou (XVIIe siècle)
2009 : Voltaire (XVIIIe siècle)
2010 : Fénelon (XVIIe siècle)
2011 : Montaigne (XVIe siècle)
2012 : La Fontaine (XVIIe siècle)
2013 : Gide (XXe siècle)
2014 : Montesquieu (XVIIIe siècle)
2015 : Baudelaire (XIXe siècle)
2016 : Beaumarchais (XVIIIe siècle)
2017 : Montaigne (XVIe siècle)
2018 : Flaubert (XIXe siècle)
2019 : Marivaux (XVIIIe siècle)
2020 : Cendras (XXe siècle)
2021 : Boileau (XVIIe siècle)
2022 : Rostand (XIXe siècle)
2023 : Proust (XXe siècle)
2024 : Prévost (XVIIIe siècle)
2025 : Vigny (XIXe siècle)
Thème latin
POÉSIE : 3/52
PROSE : 49/52
1974 : Alain (prose)
1975 : Vauvenargues (prose)
1976 : Marivaux (prose)
1977 : Valéry (prose)
1978 : Fourier (prose)
1979 : Caillois (prose)
1980 : Yourcenar (prose)
1981 : Montherland (prose)
1982 : Descartes (prose)
1983 : Guez de Balzac (prose)
1984 : France (prose)
1985 : Mably (prose)
1986 : Diderot (prose)
1987 : Pascal (prose)
1988 : Buffon (prose)
1989 : Boileau (prose)
1990 : Diderot (prose)
1991 : Perrault (prose)
1992 : Sainte-Beuve (prose)
1993 : Caillois (prose)
1994 : Pascal (prose)
1995 : Bossuet (prose)
1996 : Valéry (prose)
1997 : Diderot (prose)
1998 : Rousseau (prose)
1999 : Bossuet (prose)
2000 : Montesquieu (prose)
2001 : Gide (prose)
2002 : Du Plaisir (prose)
2003 : Fernandez (prose)
2004 : Molière (prose)
2005 : Diderot (prose)
2006 : Damilaville (prose)
2007 : Vigny (prose)
2008 : Perrault (prose)
2009 : Laclos (prose)
2010 : Lesage (prose)
2011 : Alain (prose)
2012 : Racine (poésie)
2013 : Voltaire (prose)
2014 : Rousseau (prose)
2015 : Ronsard (poésie)
2016 : Perrault (prose)
2017 : Sévigné (prose)
2018 : Stendhal (prose)
2019 : Perrault (prose)
2020 : Boileau (poésie)
2021 : Voltaire (prose)
2022 : Dumas (prose)
2023 : Fénelon (prose)
2024 : Lesage (prose)
2025 : Le Bouyer de Fontenelle (prose)
Thème grec
POÉSIE : 0/52
PROSE : 52/52
Cher jury, un peu de vers, ça serait bien pour une fois, non ? 🙂
Surtout qu’à l’agrégation de Grammaire, on peut franchement se le permettre !
1974 : Anouilh (prose)
1975 : Voltaire (prose)
1976 : Rousseau (prose)
1977 : Courier (prose)
1978 : Retz (prose)
1979 : Montaigne (prose)
1980 : Gide (prose)
1981 : La Mothe Le Vayer (prose)
1982 : Lespinasse (prose)
1983 : Sénac de Meilhan (prose)
1984 : Leiris (prose)
1985 : Fontenelle (prose)
1986 : Rousseau (prose)
1987 : Rousseau (prose)
1988 : Racine (prose)
1989 : Perrault (prose)
1990 : Marivaux (prose)
1991 : Champollion (prose)
1992 : Labé (prose)
1993 : Michaux (prose)
1994 : Voltaire (prose)
1995 : Boileau (prose)
1996 : Rollin (prose)
1997 : Montesquieu (prose)
1998 : Diderot (prose)
1999 : Gide (prose)
2000 : Caillois (prose)
2001 : Marivaux (prose)
2002 : Racine (prose)
2003 : Fénelon (prose)
2004 : Montesquieu (prose)
2005 : Rousseau (prose)
2006 : Proust (prose)
2007 : Balzac (prose)
2008 : Baudelaire (prose)
2009 : Molière (prose)
2010 : Rousseau (prose)
2011 : La Fontaine (prose)
2012 : De Salles (prose)
2013 : Montaigne (prose)
2014 : Molière (prose)
2015 : Cocteau (prose)
2016 : Chateaubriand (prose)
2017 : Montesquieu (prose)
2018 : Fontenelle (prose)
2019 : Pascal (prose)
2020 : Voltaire (prose)
2021 : Molière (prose)
2022 : Buffon (prose)
2023 : Maurice de Guérin (prose)
2024 : Sébastien Le Prestre de Vauban
2025 : Saint-Évremond
Compositions principales de grammaire
Composition principale 2023
Composition principale 2024
Composition principale 2025 (Fournival & Vigny – Lysias & Lucrèce)
Compositions complémentaires de grammaire
Composition complémentaire 2023
Composition complémentaire 2024
Composition complémentaire 2025 (Sophocle & Suétone – Fournival et Staël)
Version latine
POÉSIE : 22/52
PROSE : 30/52
1974 : Horace (poésie)
1975 : Ovide (poésie)
1976 : Cicéron (prose)
1977 : Tite Live (prose)
1978 : Silius Italicus (poésie)
1979 : Quintilien (prose)
1980 : Ovide (poésie)
1981 : Jérôme (prose)
1982 : Panégyrique de Constantin (prose)
1983 : Cicéron (prose philosophique)
1984 : Sénèque le Jeune (prose philosophique)
1985 : Tibulle (poésie élégiaque)
1986 : Suétone (prose historique)
1987 : Tacite (prose historique)
1988 : Lucain (poésie épique)
1989 : Cicéron (prose philosophique)
1990 : Pline l’Ancien (prose philosophique)
1991 : Juvénal (poésie satirique)
1992 : Minucius Félix (prose théologique)
1993 : Manilius (poésie didactique)
1994 : Vitruve (prose didactique)
1995 : Claudien (poésie épique)
1996 : Cicéron (prose philosophique)
1997 : Ovide (poésie élégiaque)
1998 : Sénèque le Jeune (prose philosophique)
1999 : Silius Italicus (poésie épique)
2000 : Cicéron (prose épistolaire)
2001 : Horace (poésie satirique)
2002 : Tacite (prose historique)
2003 : Stace (poésie épique)
2004 : Cicéron (prose rhétorique)
2005 : Pétrone (poésie)
2006 : Varron (prose didactique)
2007 : Plaute (poésie dramatique – comédie)
2008 : Tite Live (prose historique)
2009 : Lucrèce (poésie didactique)
2010 : Sénèque le Jeune (prose philosophique)
2011 : Lucain (poésie épique)
2012 : Catulle (poésie épique)
2013 : Cicéron (prose épistolaire)
2014 : Pline le Jeune (prose épistolaire)
2015 : Salluste (prose historique)
2016 : Stace (poésie épique)
2017 : Tacite (prose historique)
2018 : Aulu-Gelle (prose)
2019 : Silius Italicus (poésie épique)
2020 : Tite Live (prose historique)
2021 : Properce (poésie élégiaque)
2022 : Pétrone (prose romanesque)
2023 : Horace (poésie satirique)
2024 : Quinte Curce (prose historique)
2025 : Apulée (prose)
A. FEMMES
Session 1949
Composition française
La critique a souvent signalé, dans les sermons et les oraisons funèbres de Bossuet, un élément personnel et lyrique, et reconnu, chez ce prédicateur classique, « un homme qui a gardé jusqu’au bout l’ingénuité de son humanité ».
Dégagez, d’après les œuvres inscrites au programme, l’aspect du génie de Bossuet.
Session 1950
Composition française
Corneille dramaturge d’après L’Illusion comique et Le Cid.
Session 1951
Composition française
De la musique encore et toujours !
Que ton vers soit la chose envolé
Qu’on sent qui fuit d’une âme en allée
Vers d’autres cieux à d’autres amours,
Que ton vers soit la bonne aventure
Éparse au vent crispé du matin
Qui va fleurant la menthe et le thym…
Et tout le reste est littérature.
Appréciez l’idéal poétique qui s’exprime dans ces deux strophes et indiquez dans quelle mesure Verlaine vous paraît l’avoir réalisé dans les œuvres écrites au programme.
Session 1956
Composition française
« Vérité intérieure et caprice extérieur », a-t-on dit à propos du théâtre de Musset.
Quel sens conviendrait-il, selon vous, de donner à cette formule pour éclairer le secret de la création dramatique dans Les Caprices de Marianne, Fantasio et On ne badine pas avec l’amour ?
Session 1957
Composition française
À la fin du 4e livre des Confessions, J.-J. Rousseau écrit :
« Je voudrais pouvoir en quelque façon rendre mon âme transparente aux yeux du lecteur, et pour cela à lui montrer sous tous les points de vue, à l’éclairer par tous les jours, à faire en sorte qu’il ne s’y passe pas un mouvement qu’il n’aperçoive, afin qu’il puisse juger par lui-même du principe qui les produit.
Si je me chargeais du résultat et que je lui disse : Tel est mon caractère, il pourrait croire sinon que je le trompe, au moins que je me trompe… Le résultat doit être son ouvrage. »
Comment tenteriez-vous cette entreprise, d’après ce que Rousseau vous fait connaître mais aussi
vous laisse voir de lui-même dans les six premiers livres des Confessions ?
Session 1958
Composition française
Dans un article des Portraits littéraires consacré à Molière, Sainte-Beuve a dit :
« Cet homme savait les faiblesses et ne s’en étonnait pas […], il considérait volontiers cette triste humanité comme une vieille enfant et une incurable, qu’il s’agit de redresser un peu, de soulager surtout en l’amusant. »
Est-ce votre impression lorsque vous étudiez les comédies et les divertissements de Molière inscrits à votre programme ?
Session 1959
Composition française
« Moi, mon âme est fêlée. »
Ce cri du poète, en quoi peut-il vous aider à pénétrer le secret des Fleurs du mal, de leur accent et de leur inspiration ?
Thème latin
Comme ces étrangers-là (1) vont assez vite, ils eurent fait le tour du globe en trente-six heures ; le soleil à la vérité, ou plutôt la terre, fait un pareil voyage en une journée ; mais il faut songer qu’on va bien plus à son aise quand on tourne sur un axe que quand on marche sur ses pieds. Les voilà donc revenus d’où ils étaient partis, après avoir vu cette mare, presque imperceptible pour eux, qu’on nomme la Méditerranée, et cet autre petit étang qui, sous le nom du grand Océan, entoure la taupinière. Le nain n’en avait eu jamais qu’à mi-jambe, et à peine l’autre avait-il mouillé son talon. Ils firent tout ce qu’ils purent en allant et revenant dessus et dessous pour tâcher d’apercevoir si ce globe était habité ou non. Ils se baissèrent, ils se couchèrent, ils tâtèrent partout ; mais leurs yeux et leurs mains n’étant point proportionnés aux petits êtres qui rampent ici, ils ne reçurent pas la moindre sensation qui pût leur faire soupçonner que nous et nos confrères, les autres habitants de ce globe, avons l’honneur d’exister.
Le nain, qui jugeait quelquefois un peu trop vite, décida d’abord qu’il n’y avait personne sur la terre. Sa première raison était qu’il n’avait vu personne. Micromégas lui fit sentir poliment que c’était raisonner assez mal… Enfin l’habitant de Saturne vit quelque chose d’imperceptible qui remuait entre deux eaux dans la mer Baltique : c’était une baleine.
François-Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778),
Micromégas (1752).
(1) Ces étrangers, venus sur la Terre, sont, on se le rappelle, un habitant de Saturne (le « nain ») et un habitant de Sirius (Micromégas).
Session 1960
Composition française
« Les voies de la sagesse sont imprévisibles. » (Les Cinq Tentations de La Fontaine.)
Cette réflexion, inspirée à Jean Giraudoux par un épisode de la vie du poète, ne pourrait-on pas l’appliquer à son œuvre ? Quel est donc le sortilège qui, par-delà les contradictions apparentes souvent relevées par la critique, permet à une sagesse originale de s’épanouir librement dans les Fables ?
Thème latin
UN PRISONNIER ENIVRE SON GARDIEN
Je finis par trouver un moyen de fuir sans éveiller mon gardien et sans l’égorger. J’avais remarqué que Vasile (1) aimait à boire et qu’il portait mal le vin. Je l’invitai à dîner avec moi. Hadgi-Stavros (2), qui ne m’avait pas honoré d’une visite depuis que je n’avais plus son estime, se conduisait encore en hôte généreux. Ma table était mieux servie que la sienne. Vasile, admis à prendre part à ces magnificences, commença le repas avec une humilité touchante. Il se tenait à trois pieds de la table comme un paysan invité chez son seigneur. Peu à peu le vin rapprocha les distances. À huit heures du soir, mon gardien m’expliquait son caractère. À neuf heures, il me racontait en balbutiant les aventures de sa jeunesse, et une série d’exploits qui auraient fait dresser les cheveux d’un juge d’instruction. À dix heures, il tomba dans la philanthropie : ce cœur d’acier trempé fondait dans le rhaki (3), comme la perle de Cléopâtre dans le vinaigre. Il me jura qu’il s’était fait brigand par amour de l’humanité ; qu’il voulait faire sa fortune en dix ans, fonder un hôpital avec ses économies et se retirer ensuite dans un couvent du Mont Athos. Je profitai de ces bonnes dispositions pour lui ingérer une énorme tasse de rhaki. Bientôt il perdit la voix ; sa tête pencha de droite à gauche et de gauche à droite ; il me tendit la main, rencontra un restant de rôti, le serra cordialement, se laissa tomber à la renverse, et s’endormit du sommeil des sphinx d’Égypte.
Edmond About (1828-1885),
Le Roi des montagnes (1857)
(278 mots)
(1) Basilius, ii, m.
(2) Hadgi-Stavrus, i, m.
(3) Traduire conventionnellement comme s’il y avait « absinthe ».
Session 1961
Composition française
« On ne saurait faire sa propre biographie de la même manière qu’on fait celle des autres. Ce qu’on dit de soi est toujours poésie. »
Ce mot de Renan vous paraît-il éclairer la démarche créatrice de Chateaubriand dans les deux premières parties des Mémoires d’outre-tombe ?
Session 1962
Composition française
Dans un article écrit en hommage à Du Bellay, Jacques Rivière formule cette réserve sur sa
poésie :
« Elle n’est pas lyrique ; elle ne se développe pas selon ces amples déroulements secrets, selon ces courants intimes qui se croisent, s’unissent ou se contrarient mystérieusement dans les cœurs vraiment inspirés. Avec elle nous n’arrivons pas à nous égarer, à lâcher le sol comme se détendent doucement les genoux du nageur au moment qu’il perd pied. Mais elle reste décorative, un peu fabriquée, pareille à un blason ouvragé : j’aime chaque détail, je le touche du doigt avec satisfaction ; je me plais à l’agencement savant et un peu lourd de l’ensemble ; le contemple, c’est-à-dire je demeure. »
Votre lecture des œuvres de Du Bellay inscrites au programme vous permet-elle de comprendre et d’accepter ce jugement ?
Session 1963
Composition française
Dans un article intitulé Promenade avec Alain-Fournier, un lecteur du Grand Meaulnes imagine que viennent à sa rencontre :
« trois ombres fraternelles », bientôt confondues en une seule image car elles « n’avaient dû leurs traits distincts qu’au prisme d’une mémoire, […] l’écolier sage, l’enfant blessé s’acharnant au jeu pur, le voyageur que hante le ciel. »
Vous direz quel visage d’Alain-Fournier vous avez cru découvrir à travers les trois personnages ainsi évoqués.
Thème latin
LES DÉBATS SUSCITÉS EN GRÈCE PAR LE RAPT D’HÉLÈNE
La plupart se trouvant dans ces dispositions, la guerre eût été bien déclarée : mais Ulysse fit remarquer qu’il était inouï qu’on eût décidé une affaire de cette importance sans consulter les vieillards. « Car, après tout, pourquoi tant de précipitation ? Nous ne pouvons rien entreprendre avant la saison favorable. S’il s’agissait de quelque chasse, de jeux qu’on voulût célébrer, nous écouterions nos anciens, nous suivrions les avis de ceux qui ont acquis avec le temps la connaissance de ces choses ; et pour aller si loin, à travers tant de mers, chercher une guerre dont l’issue peut être fatale à toute la Grèce, nous ne prenons aucun conseil ! »
Malgré la fougue de cette jeunesse qui n’avait de pensée que pour la guerre, Ulysse pourtant fut écouté. On convint que ce qu’il disait était conforme à la raison et à l’usage de tous les temps ; il fut résolu d’une commune voix qu’on assemblerait les vieillards le plus tôt possible. Philoctète, Ulysse, Eumèle, Antiloque et plusieurs autres allèrent quérir leurs pères, et, partout où l’on connaissait des hommes que l’expérience et le don de la parole rendaient propres au conseil, on envoya des hérauts leur dire de venir à Argos […]. Dès que Nestor et Pélée furent arrivés, on se mit à délibérer : alors on vit dans l’assemblée une grande contrariété de sentiments et de volontés. Car les vieux étaient tous d’avis de laisser Ménélas et son frère démêler eux seuls leur querelle avec le Troyen […]. Mais les jeunes gens ne pouvaient souffrir ce langage et demandaient la guerre à grands cris.
Paul-Louis Courier de Méré (1772-1825),
Œuvres complètes (1828)
(282 mots)
Session 1964
Composition française
Selon un critique contemporain, on entend dans les Rêveries « le chant mélodieux d’une voix qui défend l’âme contre sa destruction ».
Vous apprécierez cette formule.
Session 1965
Composition française
« De toutes les douleurs douces
Je compose mes magies… »
(Jadis et Naguère, 1884, « Images d’un sou »)
En quelle mesure et selon quelles nuances ces vers (écrits dès novembre 1873) ainsi que leur titre primitif, Le Bon Alchimiste, vous semblent-ils pouvoir éclairer vos impressions personnelles dans l’étude des recueils de Verlaine inscrits à votre programme ?
Session 1966
Composition française
Paul Valéry a vu en Stendhal « un poète de l’énergie personnelle » (Pléiade, I, p. 578).
Des deux romans proposés à votre étude, Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme, quels sont les aspects qu’une telle formule vous paraît le mieux éclairer ?
[Le sujet est tiré de Variété II.]
Session 1967
Composition française
Jean Guéhenno écrit au sujet de Voltaire (1) : « Accepter de n’être que ce que l’on est, mais vouloir être tout ce que l’on est, et ainsi jouer tout le jeu de l’homme, en ces formules tient peut-être toute sa sagesse. »
Vous étudierez, avec précision, les aspects des Lettres philosophiques qui permettent, selon vous, de donner à ces suggestions toute leur portée.
(1) Tableau de la littérature française de Corneille à Chénier (Paris, Gallimard, p. 262).
B. HOMMES
.
Session 1949
Composition française
Grandeur et faiblesse de l’homme selon Bossuet et selon Vigny.
Session 1950
Composition française
Rome, vue par Du Bellay, Corneille, Montesquieu, Stendhal.
Session 1951
Composition française
Quelle impression la lecture que vous venez de faire de Verlaine vous a-t-elle laissée sur la valeur de son œuvre poétique ?
Vous donnerez librement votre sentiment personnel en essayant de le justifier.
Session 1952
Composition française
La gaîté chez Diderot.
Session 1953
Composition française
À propos des Poèmes antiques, Gustave Planche félicitait l’auteur pour son « intelligence intime » de l’Antiquité, mais regrettait que ce sentiment se trouvât « contrarié par des velléités d’érudition ». Il ajoutait : « Pourquoi faut-il que l’auteur, oubliant l’arrêt prononcé par Boileau sur Ronsard, ait voulu parler grec en français ? »
Quelles réflexions sur le problème ainsi posé vous inspirent les œuvres des trois poètes inscrites au programme ?
Session 1959
Thème latin
ÉLOGE D’UN GRAND POÈTE
Dans les temps, déjà si lointains, dont je parlais, temps heureux où les littérateurs étaient, les uns pour les autres, une société que les survivants regrettent et dont ils ne trouveront plus l’analogue, Victor Hugo (1) représentait celui vers qui chacun se tourne pour demander le mot d’ordre. Jamais royauté ne fut plus légitime, plus naturelle, plus acclamée par la reconnaissance, plus confirmée par l’impuissance de la rébellion. Quand on se figure ce qu’était la poésie française avant qu’il apparût, et quel rajeunissement elle a subi depuis qu’il est venu ; quand on imagine ce peu qu’elle eût été s’il n’était pas venu ; combien de sentiments mystérieux et profonds, qui ont été exprimés, seraient restés muets ; combien d’intelligences il a accouchées, combien d’hommes qui ont rayonné par lui seraient restés obscurs, il est impossible de ne pas le considérer comme un de ces esprits rares et providentiels qui opèrent, dans l’ordre littéraire, le salut de tous, comme d’autres dans l’ordre moral et d’autres dans l’ordre politique. Le mouvement créé par Victor Hugo se continue encore sous nos yeux. Qu’il ait été puissamment secondé, personne ne le nie ; mais si aujourd’hui des hommes mûrs, des jeunes gens, des femmes du monde ont le sentiment de la bonne poésie, de la poésie profondément rythmée et vivement colorée, si le goût du public s’est haussé vers des jouissances qu’il avait oubliées, c’est à Victor Hugo qu’on le doit… Il ne coûtera à personne d’avouer tout cela, excepté à ceux pour qui la justice n’est pas une volupté.
Charles Baudelaire (1821-1867),
L’Art romantique (1869), Réflexion sur quelques-uns de mes contemporains
(1) Ne pas traduire « Hugo ».
Session 1960
Thème latin
EFFETS DE LA SÉPARATION
Nos concitoyens, ceux du moins qui avaient le plus souffert de cette séparation, s’habituaient-ils à la situation ? Il ne serait pas tout à fait juste de l’affirmer. Il serait plus exact de dire qu’au moral comme au physique, ils souffraient de décharnement. Au début de la peste, ils se souvenaient très bien de l’être qu’ils avaient perdu et ils le regrettaient. Mais s’ils se souvenaient nettement du visage aimé, de son rire, de tel jour dont ils reconnaissaient après coup qu’il avait été heureux, ils imaginaient difficilement ce que l’autre pouvait faire à l’heure même où ils l’évoquaient et dans des lieux désormais si lointains. En somme, à ce moment-là, ils avaient de la mémoire, mais une imagination insuffisante. Au deuxième stade de la peste, ils perdirent aussi la mémoire. Non qu’ils eussent oublié ce visage, mais, ce qui revient au même, il avait perdu sa chair, ils ne l’apercevaient plus à l’intérieur d’eux-mêmes. Et alors qu’ils avaient tendance à se plaindre, les premières semaines, de n’avoir plus affaire qu’à des ombres dans les choses de leur amour, ils s’aperçurent par la suite que ces ombres pouvaient encore devenir plus décharnées, en perdant jusqu’aux infimes couleurs que leur gardait le souvenir. Tout au bout de ce long temps de séparation, ils n’imaginaient plus cette intimité qui avait été la leur, ni comment avait pu vivre près d’eux un être sur lequel, à tout moment, ils pouvaient poser la main.
De ce point de vue, ils étaient entrés dans l’ordre même de la peste, d’autant plus efficace qu’il était plus médiocre. Personne, chez nous, n’avait plus de grands sentiments. Mais tout le monde éprouvait des sentiments monotones. « Il est temps que cela finisse », disaient nos concitoyens, parce qu’en période de fléau, il est normal de souhaiter la fin des souffrances collectives, et parce qu’en fait, ils souhaitaient que cela finisse.
Albert Camus (1913-1960),
La Peste (1947)
(343 mots)
Session 1962
Thème latin
THÉÂTRE ET COMÉDIE
Quand on fait réflexion que la tragédie affecte, qu’elle occupe plus une grande partie des hommes que la comédie, il n’est plus permis de douter que les imitations ne nous intéressent qu’à proportion de l’impression plus ou moins grande que l’objet imité aurait faite sur nous. Or il est certain que les hommes en général ne sont pas autant émus par l’action théâtrale, qu’ils ne sont pas aussi livrés au spectacle durant les représentations des comédies, que durant celles des tragédies. Ceux qui font leur amusement de la poésie dramatique parlent plus souvent et avec plus d’affection des tragédies que des comédies qu’ils ont vues… Nous souffrons plus volontiers le médiocre dans le genre tragique que dans le genre comique, qui semble n’avoir pas le même droit sur notre attention que le premier. Tous ceux qui travaillent pour notre théâtre parlent de même, et ils assurent qu’il est moins dangereux de donner un rendez-vous au public pour le divertir en le faisant pleurer, que pour le divertir en le faisant rire.
Il semble cependant que la comédie dût attacher les hommes plus que la tragédie. Un poète comique ne dépeint pas aux spectateurs des héros ou des caractères qu’ils n’aient jamais connus que par les idées vagues que leur imagination peut en avoir formées sur le rapport des historiens : il n’entretient pas le parterre des conjurations contre l’État, d’oracles ni d’autres événements merveilleux, et tels que la plupart des spectateurs, qui jamais n’ont eu part à des aventures semblables, ne sauraient bien connaître si les circonstances et les suites de ces aventures sont exposées avec vraisemblance. Au contraire le poète comique dépeint nos amis et les personnes avec qui nous vivons tous les jours. Le théâtre, suivant Platon, ne subsiste, pour ainsi dire, que des fautes où tombent les hommes, parce qu’ils ne se connaissent pas bien eux-mêmes. Les uns s’imaginent être plus puissants qu’ils ne sont, d’autres plus éclairés, et d’autres enfin plus aimables.
Jean-Baptiste Dubos (1670-1742),
Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture (1719)
(352 mots)
C. MIXTE
Session 1974
Composition française
De La Reine morte au Maître de Santiago et à Port-Royal, y a-t-il progression vers l’œuvre « tout intérieure » ?
Thème latin
SOCRATE
La libre pensée est invincible ; l’exemple de Socrate le prouve assez. On n’a pu que le tuer. Que voulez-vous faire d’un homme qui annonce premièrement qu’il ne sait rien, et qu’il sait qu’il ne sait rien ? Que faire d’un homme qui se trouve autant qu’il peut où l’on enseigne, et qui interroge, et qui passe les réponses au crible, sans jamais être satisfait ? Vous lui direz qu’il a l’esprit lent ; il répondra qu’il ne le sait que trop. Vous lui direz qu’il voit des difficultés où personne n’en voit : « C’est tant mieux, dira-t-il, pour ceux qui comprennent si vite. Mais est-ce une raison pour que moi je me rende avant d’avoir compris ? »
Là-dessus quelque grand sophiste, ce qui veut dire orateur, juriste, savant, lui fera remontrance. « Qui donc es-tu, dira-t-il, pour te mêler à des discussions sur le droit, la justice, le bonheur, auxquelles tu te montres si peu préparé ? Ainsi un chétif esprit comme le tien ose se mettre en balance avec des doctrines formées par des siècles d’hommes éminents ? […] Et tu prétends disputer contre des maîtres très illustres, comme si ton petit jugement devait régler l’ordre des cités et la conduite des citoyens. À l’école ! Socrate, à l’école ! »
Ce discours a été fait bien des fois depuis ; et souvent le simple citoyen rentre dans sa coquille, et laisse dire qu’il approuve. Mais il pourrait bien, à la manière de Socrate, répondre à peu près ceci : « Rien ne m’oblige à penser promptement et brillamment. Mon esprit est sans doute lent et engourdi. Néanmoins, tel qu’il est, j’ai charge de lui et de lui seulement. Je sens bien que c’est la chose en moi qui me fait homme. Je ne dois point trahir mon esprit ; je dois même l’honorer. Mais je l’honorerais très mal, et même je le trahirais, il me semble, si je disais que je comprends ce que je ne comprends pas, et que j’admets ce qui me semble faux ou incertain. »
Émile-Auguste Chartier, dit Alain (1868-1951),
Propos sur des philosophes (1961)
Thème grec
EURYDICE. — Jurez-moi que vous ne me quitterez pas.
ORPHÉE. — Je vous le jure.
E. — Oui, mais cela, c’est un serment facile ! Je l’espère bien que vous n’avez pas l’intention de me quitter ! Si vous voulez que je sois vraiment heureuse, jurez-moi que vous n’aurez jamais envie de me quitter, même plus tard, même une minute, même si la plus jolie fille du monde vous regarde.
O. — Je le jure aussi.
E. — Vous voyez comme vous êtes faux ! Pour savoir qu’elle vous regarde, il aura fallu que vous la regardiez, vous aussi. Vous venez à peine de commencer à m’aimer et vous pensez déjà aux autres femmes. Jurez-moi que vous ne la verrez même pas, mon chéri, cette idiote…
O. — Je serai aveugle.
E. — Et puis même si vous ne la voyez pas, les gens sont si méchants qu’ils se dépêcheront de vous le dire, pour que j’aie mal. Jurez-moi que vous ne les entendrez pas !
O. — Je serai sourd.
E. — Ou plutôt, non, jurez-moi tout de suite, sincèrement, de vous-même, et pas pour me faire plaisir, que vous ne trouverez plus jamais aucune femme jolie…
O. — Je vous le jure.
E. — Et c’est de vous-même que vous jurez.
O. — C’est de moi-même.
E. — Bon. Et, bien entendu, c’est sur ma tête ?
O. — Sur votre tête.
E. — Vous n’ignorez pas que, lorsqu’on jure sur la tête, cela veut dire que l’autre meurt si on ne tient pas son serment.
O. — Je ne l’ignore pas.
E. — Bon. Mais ce n’est pas tout de même que vous pensez intérieurement : « Je peux bien jurer sur sa tête. Qu’est-ce que je risque ? Si elle meurt à ce moment-là, quand je voudrai la quitter, au fond, cela sera bien plus commode. » ?
O. — C’est ingénieux, mais je n’y avais pas pensé.
Jean Anouilh,
Eurydice, extrait du Premier acte
(avec des coupes non notées),
(322 mots)
Version latine
VIR BONUS QUIS EST ?
Tu (1) recte uiuis, si curas esse quod audis.
Iactamus iampridem omnis te Roma beatum ;
sed uereor ne cui de te plus quam tibi credas
neue putes alium sapiente bonoque beatum,
neu, si te populus sanum recteque ualentem
dictitet, occultam febrem sub tempus edendi
dissimules, donec manibus tremor incidat unctis.
Stultorum incurata pudor malus ulcera celat.
Siquis bella tibi terra pugnata marique
dicat et his uerbis uacuas permulceat auris :
« Tene magis saluum populus uelit an populum tu,
seruet in ambiguo qui consulit et tibi et urbi
Iuppiter » (2), Augusti laudes adgnoscere possis ;
cum pateris sapiens emendatusque uocari,
respondesne tuo, dic sodes, nomine ? « Nempe (3)
uir bonus et prudens dici delector ego ac tu. »
Qui dedit hoc hodie, cras, si uolet auferet, ut si
detulerit fasces indigno, detrahet idem.
« Pone, meum est », inquit ; pono tristisque recedo.
Idem si clamet furem, neget esse pudicum,
contendat laqueo collum pressisse paternum,
mordear opprobriis falsis mutemque colores ?
Falsus honor iuuat et mendax infamia terret
quem nisi mendosum et medicandum ? Vir bonus est quis ?
« Qui consulta patrum, qui leges iuraque seruat,
quo multae magnaeque secantur iudice lites,
quo res sponsore et quo causae teste tenentur. »
Sed uidet hunc omnis domus et uicinia tota
introrsum turpem, speciosum pelle decora […].
Vir bonus, omne forum quem spectat et omne tribunal,
quandocumque deos uel porco uel boue placat :
« Iane pater ! » clare, clare cum dixit, « Apollo ! »
labra mouet metuens audiri : « Pulchra Lauerna (4),
da mihi fallere, da iusto sanctoque uideri,
noctem peccatis et fraudibus obice nubem. »
Horace,
Épîtres, I, 16, v. 17-45 et 57-62
(35 vers – 241 mots)
(1) Horace s’adresse à son ami Quinctius. Il le félicite de la réputation dont il jouit mais le met en garde contre les illusions qu’elle peut comporter.
(2) Citation d’un panégyrique d’Auguste que Quinctius ne peut ignorer.
(3) Réplique d’Horace prête à Quinctius.
(4) Vieille divinité romaine. Elle passait pour la protectrice des voleurs nocturnes.
Session 1975
Composition française
La technique de la narration dans l’Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut.
Thème latin
Qu’on ne m’accuse point ici de cette humeur chagrine qui fait regretter le passé, blâmer le présent et avilir par vanité la nature humaine. En blâmant les défauts de ce siècle, je ne prétends pas lui disputer ses vrais avantages, ni le rappeler à l’ignorance dont il est sorti ; je veux, au contraire, lui apprendre à juger des siècles passés avec cette indulgence que les hommes, tels qu’ils soient, doivent toujours avoir pour d’autres hommes, et dont eux-mêmes ont toujours besoin. Ce n’est point mon dessein montrer que tout est faible dans la nature humaine, en découvrant les vices de ce siècle ; je veux, au contraire, en excusant les défauts des premiers temps, montrer qu’il y a toujours eu dans l’esprit des hommes une force et une grandeur indépendantes de la mode et des secours de l’art. Je suis bien éloigné de me joindre à ces philosophes qui méprisent tout dans le genre humain, et se font une gloire misérable de n’en montrer jamais que la faiblesse. Qui n’a des preuves de cette faiblesse dont ils parlent, et que pensent-ils nous apprendre ? Pourquoi veulent-ils nous détourner de la vertu, en nous insinuant que nous en sommes incapables ? Et moi je leur dis que nous ·en sommes capables ; car, quand je parle de vertu, je ne parle point de ces qualités imaginaires qui n’appartiennent pas à la nature humaine ; je parle de cette force et de cette grandeur d’âme qui, comparées aux sentiments des esprits faibles, méritent les noms que je leur donne ; je parle d’une grandeur de rapport, et non d’autre chose, car il n’y a rien de grand parmi les hommes que par comparaison.
Vauvenargues,
Discours sur le caractère des différents siècles
(294 mots)
Thème grec
Le langage de l’erreur est si familier aux hommes, que nous appelons encor nos vapeurs, et l’espace de la terre à la lune, du nom de ciel ; nous disons, monter au ciel, comme nous disons que le soleil tourne, quoiqu’on sache bien qu’il ne tourne pas ; nous sommes probablement le ciel pour les habitants de la lune, et chaque planète place son ciel dans la planète voisine. Si on avait demandé à Homère dans quel ciel était allée l’âme de Sarpédon, et où était celle d’Hercule, Homère eût été bien embarrassé : il eût répondu par des vers harmonieux. Car enfin, qu’entendaient les anciens par le ciel ? Ils n’en savaient rien. Il n’y a point, à proprement parler, de ciel : il y a une quantité prodigieuse de globes qui roulent dans l’espace vide, et notre globe roule comme les autres. Les anciens croyaient qu’aller dans les cieux, c’était monter ; mais on ne monte point d’un globe à un autre ; les globes célestes sont tantôt au-dessus de notre horizon, tantôt au-dessous. Ainsi, supposons que Vénus étant venue à Paphos, retournât dans sa planète quand cette planète était couchée, la déesse Vénus ne montait point alors par rapport à notre horizon : elle descendait, et on devait dire en ce cas descendre au ciel. Mais les anciens n’y entendaient pas tant de finesse. On a fait des volumes immenses pour savoir ce qu’ils pensaient sur bien des questions de cette sorte. Quatre mots auraient suffi : ils ne pensaient pas.
Voltaire,
Dictionnaire philosophique (« Le Ciel des Anciens »)
(262 mots)
Version latine
LETTRE D’ACONTIUS À CYDIPPE
Pour se justifier de lui avoir fait prêter par surprise un serment d’amour qu’il avait écrit sur une pomme et qu’elle a lu à haute voix dans le temple de Diane.
Deceptam dicas nostra te fraude licebit,
dum fraudis nostrae causa feratur amor.
Fraus mea quid petiit, nisi uti tibi iungerer uni ?
Id me quod quereris conciliare potest.
Non ego natura nec sum tam callidus usu ;
sollertem tu me, crede, puella, facis.
Te mihi compositis, siquid tamen egimus, a me
adstrinxit uerbis ingeniosus Amor.
Dictatis ab eo feci sponsalia uerbis
consultoque fui iuris Amore uafer.
Sit fraus huic facto nomen dicarque dolosus –
si tamen est quod ames uelle tenere dolus.
En iterum scribo mittoque rogantia uerba.
Altera fraus haec est quodque queraris habes.
Si noceo quod amo, fateor, sine fine nocebo
teque petam, caueas tu licet, usque petam.
Per gladios alii placitas rapuere puellas ;
scripta mihi caute littera crimen erit ?
Di faciant possim plures imponere nodos,
ut tua sit nulla libera parte fides.
Mille doli restant ; cliuo sudamus in imo ;
ardor inexpertum nil sinet esse meus.
Sit dubium possisne capi, captabere certe.
Exitus in dis est, sed capiere tamen.
Vt partem effugias, non omnia retia falles,
quae tibi, quam credis, plura tetendit Amor.
Si non proficient artes, ueniemus ad arma,
uique tui cupido rapta ferere sinu.
Non sum qui soleam Paridis reprehendere factum
nec quemquam qui uir, posset ut esse, fuit.
Nos quoque… sed taceo. Mors huius poena rapinae
ut sit, erit quam te non habuisse minor.
Aut esses formosa minus, peterere modeste ;
audaces facie cogimur esse tua.
Ovide,
Héroïdes, 20 (Acontios à Cydippe), v. 21-54
(226 mots)
Session 1976
Composition française
L’idée d’ordre dans les Pensées de Pascal (texte du programme).
Thème latin
Des exilés ont abordé dans une île sauvage. Cependant que les hommes se réunissent pour légiférer, les femmes en font autant de leur côté. Arthénice est la représentante de la noblesse, Madame Sorbin celle du peuple. (1)
Arthénice. — L’oppression dans laquelle nous vivons sous nos tyrans, pour être si ancienne, n’en est pas devenue plus raisonnable ; n’attendons pas que les hommes se corrigent d’eux-mêmes ; l’insuffisance de leurs lois a beau les punir de les avoir faites à leur tête et sans nous, rien ne les ramène à la justice qu’ils nous doivent, ils ont oublié qu’ils nous la refusent.
Madame Sorbin. — Aussi le monde va, il n’y a qu’à voir !
Arthénice. — Dans l’arrangement des affaires, il est décidé que nous n’avons pas le sens commun, mais tellement décidé que cela va tout seul, et que nous n’en appelons pas nous-mêmes.
Une des femmes. — Hé ! que voulez-vous ? On nous crie dès le berceau : « Vous n’êtes capables de rien, ne vous mêlez de rien, vous n’êtes bonnes à rien qu’à être sages. » On l’a dit à nos mères qui l’ont cru, qui nous le répètent ; on a les oreilles rebattues de ces mauvais propos ; nous sommes douces, la paresse s’en mêle, on nous mène comme des moutons.
Madame Sorbin. — Oh ! pour moi, je ne suis qu’une femme, mais depuis que j’ai l’âge de raison, le mouton n’a jamais trouvé cela bon.
Arthénice. — Je ne suis qu’une femme, dit Madame Sorbin, cela est admirable !
Madame Sorbin. — Cela vient encore de cette moutonnerie.
Arthénice. — Il faut qu’il y ait en nous une défiance bien louable de nos lumières pour avoir adopté ce jargon-là ; qu’on me trouve des hommes qui en disent autant d’eux ; cela les passe ; revenons au vrai pourtant : vous n’êtes qu’une femme, dites-vous ? Hé ! que voulez-vous donc être pour être mieux ?
Madame Sorbin. — Eh ! je m’y tiens, Mesdames, je m’y tiens, c’est nous qui avons le mieux, et je bénis le ciel de m’en avoir fait participante, il m’a comblé d’honneurs, et je lui en rends des grâces nonpareilles.
Arthénice. — Pénétrons-nous donc un peu de ce que nous valons, non par orgueil, mais par reconnaissance.
Marivaux,
La Colonie, Scène 9
(357 mots)
(1) Ne pas traduire ce paragraphe d’introduction.
(2) On mettra seulement l’initiale A. pour Arthénice, S. pour Madame Sorbin et F. pour « L’une des femmes ».
Thème grec
LE RECOURS À LA FORCE N’EST PAS LE MEILLEUR MOYEN D’OBTENIR L’OBÉISSANCE (1)
Si les politiques étoient moins aveuglés par leur ambition, ils verroient combien il est impossible qu’aucun établissement quel qu’il soit puisse marcher selon l’esprit de son institution, s’il n’est dirigé selon la loi du devoir ; ils sentiroient que le plus grand ressort de l’autorité publique est dans le cœur des citoyens, et que rien ne peut suppléer aux mœurs pour le maintien du gouvernement. Non seulement il n’y a que des gens de bien qui sachent administrer les lois, mais il n’y a dans le fond que d’honnêtes gens qui sachent leur obéir. Celui qui vient à bout de braver les remords ne tardera pas à braver les supplices, châtiment moins rigoureux, moins continuel, et auquel on a du moins l’espoir d’échapper ; et, quelques précautions qu’on prenne, ceux qui n’attendent que l’impunité pour mal faire ne manquent guère de moyens d’éluder la loi ou d’échapper à la peine. Alors, comme tous les intérêts particuliers se réunissent contre l’intérêt général qui n’est plus celui de personne, les vices publics ont plus de force pour énerver les lois que les lois n’en ont pour réprimer les vices ; et la corruption du peuple et des chefs s’étend enfin jusqu’au gouvernement, quelque sage qu’il puisse être.
Jean-Jacques Rousseau,
Discours sur l’économie politique
(242 mots)
(1) Le titre doit être traduit.
Version latine
CICÉRON À ATTICUS, ROME, JUILLET 59
Quam uellem Romae mansisses ! Mansisses profecto, si haec fore putassemus. Nam Pulchellum nostrum facillime teneremus aut certe quid esset facturus scire possemus. Nunc se res sic habet : uolitat, furit, nihil habet certi, multis denuntiat ; quod fors obtulerit id acturus uidetur. Cum uidet quo sit in odio status hic rerum, in eos qui haec egerunt impetum facturus uidetur. Cum autem rursus opes eorum et exercitus recordatur, conuertit se in nos, nobis autem ipsis tum uim tum iudicium minatur. Cum hoc Pompeius egit et, ut ad me ipse referebat (alium enim habeo neminem testem), uehementer egit, cum diceret in summa se perfidiae et sceleris infamia fore, si mihi periculum crearetur ab eo quem ipse armasset cum plebeium fieri passus esset (1) ; fidem recepisse sibi et ipsum et Appium de me ; hanc si ille non seruaret, ita laturum ut omnes intellegerent nihil sibi antiquius amicitia nostra fuisse. Haec et in eam sententiam cum multa dixisset, aiebat illum primo sane diu multa contra, ad extremum autem manus dedisse et adfirmasse nihil se contra eius uoluntatem esse facturum. Sed postea tamen ille non destitit de nobis asperrime loqui. Quod si non faceret, tamen ei nihil crederemus atque omnia, sicut facimus, pararemus. Nunc ita nos gerimus ut in dies singulos et studia in nos hominum et opes nostrae augeantur ; rem publicam nulla ex parte attingimus, in causis atque in illa opera nostra forensi summa industria uersamur ; quod egregie non modo iis qui utuntur opera, sed etiam in uulgus gratum esse sentimus. Domus celebratur, occurritur, renouatur memoria consulatus, studia significantur ; in eam spem adducimur ut nobis ea contentio quae impendet interdum non fugienda uideatur.
Cicéron,
Lettres à Atticus, II, 22, 1-3
(266 mots)
(1) En mars 59 ; Pompée a favorisé l’adoption de Publius Clodius, frère d’Appius Claudius Pulcher, par le plébéien Fonteius, pour qu’il pût devenir tribun de la plèbe.
Session 1977
Composition française
Commentez en les étendant aux Femmes savantes et au Malade imaginaire, ces réflexions de Copeau sur l’auteur des Fourberies de Scapin :
« L’émule et l’égal des plus purs anciens, auteur du Misanthrope et du Tartuffe, observateur parfait des mœurs et des caractères, il reste hanté – c’est son mérite singulier – par une poésie comique dont la vérité n’est que le support, dont la fantaisie, voire le paroxysme, iraient toucher dans leur élan les virtualités clandestines, et contraindre l’homme, âme et corps, aux postures extrêmes. »
Thème latin
SUR VOLTAIRE (1)
Il faut bien reconnaître que son « sourire hideux » éclaira, esquissa la ruine de mainte chose hideuse.
C’est, pour son immortalité, le fait décisif de sa carrière que sa métamorphose en ami et défenseur du genre humain. À l’âge où les carrières communément s’achèvent, où il était en possession de toute la renommée que les Lettres peuvent donner à quelqu’un, admiré de toutes parts, riche, n’ayant plus qu’à jouir de cette universalité légère qui se jouait dans l’atmosphère encyclopédique de son temps, si enivrant pour l’intelligence, dont ce temps fut l’âge d’or, voici qu’il se transforme en celui que nous célébrons aujourd’hui (2). S’il fût mort à soixante ans, il serait à présent à peu près oublié, et nous ne serions pas solennellement ici pour rendre hommage à l’auteur de Mérope… Nous savons bien que l’objet profond de cette assemblée est moins de commémorer la naissance d’un homme illustre, de rendre hommage à cet homme et à son œuvre, si considérable et si étincelante soit-elle, que d’exalter entre nous, Français, ce qui fut sa passion la plus constante et la plus généreuse, celle de la liberté de l’esprit. Nous savons ce que vaut cette liberté. Nous savons ce qu’elle coûte. Mais nous devrions peut-être mieux savoir que son plus digne emploi, et sa preuve, et le gage de sa durée consistent dans les limites qu’elle doit marquer elle-même à son pouvoir très précieux et très redoutable de remettre toutes choses en question. Elle est en péril, cette liberté, elle est perdue, dès qu’elle passe ses frontières parfois difficiles à discerner.
Paul Valéry,
Variété « Voltaire »
(281 mots)
(1) Ne pas traduire.
(2) Ce texte est extrait du discours prononcé à la Sorbonne par P. Valéry le 10 décembre 1944 à l’occasion du 250e anniversaire de la naissance de Voltaire.
Thème grec
J’avoue que ce malheur me parut fort petit. Je ne savais pas que ce livre fût le Palladium de Florence (1), que le destin de cette ville fût attaché aux mots que je venais d’effacer ; j’aurais dû cependant me douter que ces objets étaient sacrés pour les Florentins, car ils n’y touchent jamais. Mais enfin, je ne sentis point mon sang se glacer, ni mes cheveux se hérisser sur mon front ; je ne demeurai pas un instant sans voix, sans pouls et sans haleine. M. Furia (2) prétend que tout cela lui arriva…
Les expressions de M. Furia, pour peindre son saisissement à la vue de cette tache, qui couvrait, comme je vous ai dit, une vingtaine de mots, sont du plus haut style et d’un pathétique rare, même en Italie. Vous en avez été frappé, Monsieur, et vous les avez citées, mais sans oser les traduire. Peut-être avez-vous pensé que la faiblesse de notre langue ne pourrait atteindre à cette hauteur : je suis plus hardi, et je crois, quoi qu’en dise Horace (3), qu’on peut essayer de traduire Pindare et M. Furia ; c’est tout un. Voici ma version littérale : À un si horrible spectacle (il parle de ce pâté que je fis sur son bouquin), mon sang se gela dans mes veines ; et durant plusieurs instants, voulant crier, voulant parler, ma voix s’arrêta dans mon gosier : un frisson glacé s’empara de tous mes membres stupides… Voyez-vous, Monsieur, ce pâté, c’est pour lui la tête de Méduse. Le voilà stupide ; il l’assure, et c’est la seule assertion qui soit prouvée par son livre.
Paul-Louis Courier,
Lettre à M. Renouard… sur une tache faite à un manuscrit de Florence
(274 mots)
(1) Florence = Φλωρεντία, ας (ἡ).
(2) Furia = Ὀξυμένης, ους.
(3) Horace = Ὁράτιος, ου (ὁ).
Version latine
DISCOURS D’HANNIBAL AU CONSEIL D’ANTIOCHUS, ROI DE SYRIE,
AUPRÈS DUQUEL IL S’EST REFUGIÉ APRES SA DÉFAITE À ZAMA
Amynander, roi de l’Athamanie, et une délégation des Étoliens, menée par Thoas, assistent à ce conseil.
Ante omnia Philippum et Macedonas in societatem belli quacumque ratione censeo deducendos esse. Nam quod ad Euboeam Boeotosque et Thessalos attinet, cui dubium est quin, ut quibus nullae suae uires sint, praesentibus adulando semper, quem metum in consilio habeant, eodem ad impetrandam ueniam utantur, simul ac Romanum exercitum in Graecia uiderint, ad consuetum imperium se auertant (1) nec iis noxiae futurum sit quod, cum Romani procul abessent, uim tuam praesentis exercitusque tui experiri noluerint ? Quanto igitur prius potiusque est Philippum nobis coniungere quam hos ! Cui, si semel in causam descenderit, nihil integri futurum sit quique eas uires adferat quae non accessio tantum ad Romanum esse bellum, sed per se ipsae nuper sustinere potuerint Romanos. Hoc ego adiuncto – absit uerbo inuidia – qui dubitare de euentu possim, cum, quibus aduersus Philippum ualuerint Romani, iis nunc fore uideam ut ipsi oppugnentur ? Aetoli qui Philippum, quod inter omnes constat, uicerunt, cum Philippo aduersus Romanos pugnabunt ; Amynander atque Athamanum gens quorum secundum Aetolos plurima fuit opera in eo bello nobiscum stabunt. Philippus tum te quieto totam molem sustinebat belli ; nunc duo maximi reges Asiae Europaeque uiribus aduersus unum populum, ut meam utramque fortunam taceam, patrum certe aetate ne uni quidem Epirotarum regi parem – qui quid tandem erat uobiscum comparatus ? – geretis bellum. Quae igitur res mihi fiduciam praebet coniungi nobis Philippum posse ? Vna, communis utilitas quae societatis maximum uinculum est ; altera, auctores uos Aetoli. Vester enim legatus hic Thoas, inter cetera quae ad exciendum in Graeciam Antiochum dicere est solitus, ante omnia hoc semper adfirmauit, fremere Philippum et aegre pati sub specie pacis leges seruitutis sibi impositas. Ille quidem ferae bestiae uinctae aut clausae et refringere claustra cupienti regis iram uerbis aequabat. Cuius si talis animus est, soluamus nos eius uincula et claustra refringamus ut erumpere diu coercitam iram in hostes communes possit.
Tite Live,
Histoire romaine, XXXVI, 7, 3-13
(296 mots)
Composition française
Commentez en vous référant au Chant du monde et à Un roi sans divertissement, cette remarque de Giono dans ses Carnets de 1946 :
« Mes compositions sont monstrueuses et c’est le monstrueux qui m’attire. »
Thème latin
SUR LE MARIAGE
Le mariage semble inventé pour récompenser les pervers : plus un homme est astucieux et séducteur, plus il lui est facile d’arriver par le mariage à l’opulence et à l’estime publique ; il en est de même des femmes. Mettez en jeu les ressorts les plus infâmes pour obtenir un riche parti, dès que vous êtes parvenu à épouser, vous devenez un petit saint, un tendre époux, un modèle de vertu. Acquérir tout à coup une immense fortune pour la peine d’exploiter une jeune demoiselle, c’est un résultat si plaisant que l’opinion pardonne tout à un luron qui sait faire ce coup de partie (1). Il est déclaré de toutes voix bon mari, bon fils, bon père, bon frère, bon gendre, bon parent, bon ami, bon voisin, bon citoyen, bon républicain. Tel est aujourd’hui le style des apologistes : ils ne sauraient louer un quidam sans le déclarer bon des pieds à la tête, en gros et en détail ; l’opinion en agit de même à l’égard d’un chevalier d’industrie qui parvient à épouser une somme d’argent. Un riche mariage est comparable au baptême, par la promptitude avec laquelle il efface toute souillure antérieure. Les père et mère n’ont donc rien de mieux à faire […] que de stimuler leurs enfants à tenter, pour obtenir un riche parti, toutes les voies bonnes ou mauvaises, puisque le mariage, vrai baptême civil, efface tout péché aux yeux de l’opinion : elle n’a pas la même indulgence pour les autres parvenus ; elle leur rappelle longtemps les turpitudes qui les ont conduits à la fortune.
Mais pour un qui arrive au bonheur par un riche mariage, combien d’autres ne trouvent dans ce lien que le tourment de leur vie ! Ceux-là peuvent reconnaître que l’asservissement des femmes n’est nullement à l’avantage des hommes.
Charles Fourier,
Théorie des quatre mouvements (1808)
(314 mots)
(1) Coup de partie = un coup qui décide de la partie.
Thème grec
UNE PROFESSION DE SINCERITÉ
Madame, quelque répugnance que je puisse avoir à vous donner l’histoire de ma vie, qui a été agitée de tant d’aventures différentes, néanmoins, comme vous me l’avez commandé, je vous obéis, même aux dépens de ma réputation. Le caprice de la Fortune m’a fait honneur de beaucoup de fautes ; et je doute qu’il soit judicieux de lever le voile qui en cache une partie. Je vas cependant vous instruire nuement et sans détour des plus petites particularités, depuis le moment que j’ai commencé à connaître mon état ; et je ne vous cèlerai aucune des démarches que j’ai faites en tous les temps de ma vie.
Je vous supplie très humblement de ne pas être surprise de trouver si peu d’art et au contraire tant de désordre en toute ma narration, et de considérer que si, en récitant les diverses parties qui la composent, j’interromps quelquefois le fil de l’histoire, néanmoins je ne vous dirai rien qu’avec toute la sincérité que demande l’estime que je sens pour vous. Je mets mon nom à la tête de cet ouvrage, pour m’obliger davantage moi-même à ne diminuer et à ne grossir en rien la vérité. La fausse gloire et la fausse modestie sont les deux écueils que la plupart de ceux qui ont écrit leur propre vie n’ont pu éviter. Le président de Thou (1) l’a fait avec succès dans le dernier siècle, et dans l’antiquité César n’y a pas échoué. Vous me faites, sans doute, la justice d’être persuadée que je n’alléguerais pas ces grands noms sur un sujet qui me regarde, si la sincérité n’était une vertu dans laquelle il est permis et même commandé de s’égaler aux héros.
Retz,
Mémoires
(303 mots)
(1) On pourra rendre ce nom propre par ἐκεῖνος.
Version latine
LES DÉLICES DE CAPOUE
Nec Venerem interea fugit exoptabile tempus
Poenorum mentes caeco per laeta premendi
exitio et luxu corda importuna domandi.
Spargere tela manu passim fallentia natis (1)
imperat et tacitas in pectora mittere flammas.
Tum pueris dulce adridens : « Eat improba Iuno
et nos – nec mirum, quid enim sumus ? – acta secundis
despiciat. Valet illa manu, ualet illa lacertis ;
paruula nos arcu puerili spicula sensim
fundimus, et nullus nostro de uulnere sanguis.
Verum agite, o mea turba, precor, nunc tempus, adeste
et Tyriam pubem tacitis exurite telis.
Amplexu multoque mero somnoque uirorum
profliganda acies quam non perfregerit ensis,
non ignes, non immissis Gradiuus habenis.
Combibat illapsos ductor (2) per uiscera luxus
nec pudeat picto fultum iacuisse cubili
nec crinem Assyrio perfundere pugnet amomo.
Ille, sub hiberno somnos educere caelo
iactator, tectis malit consumere noctes,
ac ponat ritus uescendi saepe citato
dum residet sub casside equo discatque Lyaeo
imbellem donare diem. Tum deinde madenti
post epulas sit grata chelys, segnisque soporas
aut nostro uigiles ducat sub numine noctes. »
Haec postquam Venus, applaudit lasciuus et alto
mittit se caelo niueis exercitus alis.
Sentit flammiferas pubes Maurusia pennas,
et pariter fusis tepuerunt pectora telis.
Bacchi dona uolunt epulasque et carmina rursus
Pieria liquefacta lyra. Non acer aperto
desudat campo sonipes, non ulla per auras
lancea nudatos exercet torta lacertos.
Mollitae flammis lymphae languentia somno
membra fouent, miserisque bonis perit horrida uirtus.
Ipse etiam, adflatus fallente Cupidine, ductor
instaurat mensas dapibus repetitque uolentum
hospitia et patrias paulatim decolor artis
exuit, occulta mentem uitiante sagitta.
Silius Italicus,
La Guerre punique, XI, v. 385-423
(39 vers – 244 mots)
(1) Vénus s’adresse à la troupe des Amours.
(2) Hannibal.
Composition française
Commentez ce jugement d’un contemporain de Balzac : « L’auteur de La Peau de chagrin a voulu […] formuler la vie humaine et résumer son époque dans un livre de fantaisie, épopée, satire, roman, conte, histoire, drame, folie aux mille couleurs. »
Thème latin
MAUVAISE HUMEUR DE PONCE PILATE
Les instructions de Rome étaient formelles : respecter autant que possible les croyances et les coutumes indigènes. Pilate voyait là une sorte de démission inexcusable. Instruit par l’expérience, il redoutait que l’incident de la nuit passée lui apportât à la fin une nouvelle humiliation. En tout cas, il lui était pénible et il lui paraissait grotesque d’accepter que des vaincus, fussent-ils prêtres, pussent obliger le représentant de l’Empereur à les recevoir ailleurs que dans les salles où il s’acquittait normalement de ses fonctions. Il s’en voulait de se plier à des fantaisies superstitieuses, dont, à Rome, il ne se serait pas gêné pour railler ouvertement l’équivalent. Ce n’était pas, de sa part, mépris de Romain pour les Orientaux ou de conquérant pour les occupés, mais révolte de philosophe contre la crédulité humaine. À Rome, rien ne l’empêchait de se moquer des augures ou de sourire des interdits séculaires pesant sur le flamine de Jupiter. Dans ces conditions, il supportait mal de ne pouvoir traiter, à Jérusalem, la religion juive avec la même désinvolture qu’il faisait, à Rome, la religion romaine. Cette servitude politique l’indignait. En outre, représentant de Tibère, il incarnait évidemment l’ordre, la raison et la loi, la justice et le pouvoir. Il souffrait que les directives reçues fussent absurdes au point que, pour éviter les heurts, qui d’ailleurs ne pouvaient manquer de se produire de temps en temps, il dût consentir à des simagrées. Si Rome apportait la civilisation et la paix, il était indigne d’elle que, par opportunisme, elle s’inclinât devant chaque usage imbécile. Mieux valait dans ce cas être resté dans l’enceinte des Sept Collines et n’avoir jamais conquis ni l’Italie ni le monde.
Roger Caillois,
Ponce Pilate (1961),
(301 mots)
Thème grec
LE DIRE ET LE FAIRE
Le dire est autre chose que le faire : il faut considerer le presche à part et le prescheur à part. Ceux-là se sont donnez beau jeu, en nostre temps, qui ont essayé de choquer la verité de nostre Eglise par les vices des ministres d’icelle ; elle tire ses tesmoignages d’ailleurs : c’est une sotte façon d’argumenter et qui rejetteroit toutes choses en confusion. Un homme de bonnes meurs peut avoir des opinions fauces, et un meschant peut prescher verité, voire celuy qui ne la croit pas. C’est sans doute une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble, et je ne veux pas nier que le dire, lors que les actions suyvent, ne soit de plus d’authorité et efficace : comme disait Eudamidas oyant un philosophe discourir de la guerre : Ces propos sont beaux, mais celuy qui les dict n’en est pas croyable, car il n’a pas les oreilles accoustumées au son de la trompette. Et Cleomenes, oyant un Rhetoricien harenguer de la vaillance, s’en print fort à rire ; et, l’autre s’en scandalizant, il luy dict : J’en ferois de mesmes si c’estoit une arondelle qui cri parlast ; mais, si c’estoit un aigle, je l’orrois volontiers. J’apperçois, ce me semble, és escrits des anciens, que celuy qui dit ce qu’il pense, l’assene bien plus vivement que celuy qui se contrefait. Oyez Cicero parler de l’amour de la liberté, oyez en parler Brutus : les escrits mesmes vous sonnent que cettuy-cy estoit homme pour l’acheter au pris de la vie. Que Cicero, pere d’eloquence, traite du mespris de la mort ; que Seneque en traite aussi : celuy là traine languissant, et vous sentez qu’il vous veut resoudre de chose de quoy il n’est pas resolu ; il ne vous donne point de cœur, car luy-mesmes n’en a point ; l’autre vous anime et enflamme. Je ne voy jamais autheur, mesmement de ceux qui traictent de la vertu et des offices, que je ne recherche curieusement quel il a esté.
Montaigne,
Essais, II, 31
(356 mots)
Version latine
DÉFENSE ET ILLUSTRATION DE LA GRAMMAIRE
Primus in eo qui scribendi legendique adeptus erit facultatem grammaticis est locus. Nec refert de Graeco an de Latino loquar, quamquam Graecum esse priorem placet : utrique eadem uia est. Haec igitur professio, cum breuissime in duas partes diuidatur, recte loquendi scientiam et poetarum enarrationem, plus habet in recessu quam fronte promittit. Nam et scribendi ratio coniuncta cum loquendo est et enarrationem praecedit emendata lectio et mixtum his omnibus iudicium est : quo quidem ita seuere sunt usi ueteres grammatici, ut non uersus modo censoria quadam uirgula notare et libros qui falso uiderentur inscripti tamquam subditos summouere familia permiserint sibi, sed auctores alios in ordinem redegerint, alios omnino exemerint numero.
Nec poetas legisse satis est : excutiendum omne scriptorum genus, non propter historias modo, sed uerba, quae frequenter ius ab auctoribus sumunt. Tum neque citra musicen grammatice potest esse perfecta, cum ei de metris rhythmisque dicendum sit, nec, si rationem siderum ignoret, poetas intellegat, qui, ut alia mittam, totiens ortu occasuque signorum in declarandis temporibus utuntur, nec ignara philosophiae, cum propter plurimos in omnibus fere carminibus locos ex intima naturalium quaestionum subtilitate repetitos, tum uel propter Empedoclea in Graecis, Varronem ac Lucretium in Latinis, qui praecepta sapientiae uersibus tradiderunt.
Eloquentia quoque non mediocri est opus, ut de unaquaque earum quas demonstrauimus rerum dicat proprie et copiose. Quo minus sunt ferendi qui hanc artem ut tenuem atque ieiunam cauillantur. Quae nisi oratoris futuri fundamenta fideliter iecit, quidquid superstruxeris corruet : necessaria pueris, iucunda senibus, dulcis secretorum comes, et quae uel sola in omni studiorum genere plus habeat operis quam ostentationis. Ne quis igitur tamquam parua fastidiat grammatices elementa, non quia magnae sit operae consonantes a uocalibus discernere ipsasque eas in semiuocalium numerum mutarumque partiri, sed quia interiora uelut sacri huius adeuntibus apparebit multa rerum subtilitas, quae non modo acuere ingenia puerilia, sed exercere altissimam quoque eruditionem ac scientiam possit.
Quintilien,
Institution oratoire, I, 4, 1-6
(304 mots)
Composition française
Michelet écrit au sujet de saint Simon :
« Son plus grave défaut, c’est d’étendre, enfler, exagérer de petites choses éphémères, en abrégeant, rapetissant des choses vraiment grandes et durables. […] Il tourne la lorgnette et tour à tour regarde par un bout ou par l’autre, mais presque toujours pour grossir l’infiniment petit. »
Que pensez-vous de ce jugement porté par un historien sur le mémorialiste ?
Thème latin
RÉFLEXIONS DE L’EMPEREUR HADRIEN
SUR SON ACTION POLITIQUE
Humanitas, Felicitas, Libertas : ces beaux mots qui figurent sur les monnaies de mon règne, je ne les ai pas inventés. N’importe quel philosophe grec, presque tout Romain cultivé se propose du monde la même image que moi. Mis en présence d’une loi injuste, parce que trop rigoureuse, j’ai entendu Trajan s’écrier que son exécution ne répondait plus à l’esprit des temps. Mais cet esprit des temps, j’aurais peut-être été le premier à y subordonner consciemment tous mes actes […]. Et je remerciais les dieux, puisqu’ils m’avaient accordé de vivre à une époque où la tâche qui m’était échue consistait à réorganiser prudemment un monde, et non à extraire du chaos une matière encore informe, ou à se coucher sur un cadavre pour essayer de le ressusciter. Je me félicitais que notre passé fût assez long pour nous fournir d’exemples, et pas assez lourd pour nous en écraser ; que le développement de nos techniques fût arrivé à ce point où il facilitait l’hygiène des villes, la prospérité des peuples, et pas à cet excès où il risquerait d’encombrer l’homme d’acquisitions inutiles encore capables de quelques fruits délicieux. Je me réjouissais que nos religions vagues et vénérables, décantées de toute intransigeance ou de tout rite farouche, nous associassent mystérieusement aux songes les plus antiques de l’homme et de la terre, mais sans nous interdire une explication laïque des faits, une vue rationnelle de la conduite humaine. Il me plaisait enfin que ces mots même d’Humanité, de Liberté, de Bonheur, n’eussent pas encore été dévalués par trop d’applications ridicules.
Marguerite Yourcenar,
Mémoires d’Hadrien (1951)
(283 mots)
Thème grec
ŒDIPE. — Pour se grandir, il faut porter loin de soi ses regards. Et puis, ne regardez pas trop en arrière. Persuadez-vous que l’humanité est sans doute beaucoup plus loin de son but que nous ne pouvons encore entrevoir, que de son point de départ que nous ne distinguons déjà plus.
ÉTÉOCLE. — Le but… Quel peut être le but ?
ŒDIPE. — Il est devant nous, quel qu’il soit […]. Si j’ai vaincu le Sphinx, ce n’est pas pour que vous vous reposiez. Ce dragon dont tu parlais, Étéocle, est pareil à celui qui m’attendait aux portes de Thèbes, où je me devais d’entrer en vainqueur. Tirésias nous embête avec son mysticisme et sa morale. […] Tirésias n’a jamais rien inventé et ne saurait approuver ceux qui cherchent et qui inventent. Si inspiré par Dieu qu’il se dise, avec ses révélations, ses oiseaux, ce n’est pas lui qui sut répondre à l’énigme. J’ai compris, moi seul ai compris, que le seul mot de passe, pour n’être pas dévoré par le sphinx, c’est : l’Homme. Sans doute fallait-il un peu de courage pour le dire, ce mot. Mais je le tenais prêt dès avant d’avoir entendu l’énigme ; et ma force est que je n’admettais pas d’autre réponse, à quelle que pût être la question.
Car, comprenez bien, mes petits, que chacun de nous, adolescent, rencontre, au début de sa course, un monstre qui dresse devant lui telle énigme qui nous puisse empêcher d’avancer. Et, bien qu’à chacun de nous, mes enfants, ce sphinx particulier pose une question différente, persuadez-vous qu’à chacune de ses questions la réponse reste pareille ; oui, qu’il n’y a qu’une seule et même réponse à de si diverses questions ; et que cette réponse unique, c’est : l’Homme ; et que cet homme unique, pour un chacun de nous, c’est : Soi.
(Tirésias est entré.)*
TIRÉSIAS. — Œdipe, est-ce là le dernier mot de ta sagesse ? Est-ce là que ta science aboutit ?
ŒDIPE. — C’est de là qu’elle part, au contraire. C’en est le premier mot.
TIRÉSIAS. — Les mots suivants ?
ŒDIPE. — Mes fils auront à les chercher.
André Gide,
Œdipe
(368 mots)
*Ne pas traduire cette indication.
Version latine
LA FÊTE DE MERCURE
Clare nepos Atlantis, ades, quem montibus olim
edidit Arcadiis Pleias una Ioui !
Pacis et armorum superis imisque deorum
arbiter, alato qui pede carpis iter,
laete lyrae pulsu, nitida quoque laete palaestra,
quo didicit culte lingua docente loqui,
templa tibi posuere patres spectantia Circum
Idibus : ex illo est haec tibi festa dies.
Te, quicumque suas profitentur uendere merces,
ture dato, tribuas ut sibi lucra rogant.
Est aqua Mercurii portae uicina Capenae ;
si iuuat expertis credere, numen habet.
Huc uenit incinctus tunica mercator et urna
purus suffita, quam ferat, haurit aquam.
Vda fit hinc laurus, lauro sparguntur ab uda
omnia quae dominos sunt habitura nouos.
Spargit et ipse suos lauro rorante capillos
et peragit solita fallere uoce preces :
« Ablue praeteriti periuria temporis », inquit,
« ablue praeterita perfida uerba die !
Siue ego te feci testem falsoue citaui
non audituri numina uana Iouis,
siue deum prudens alium diuamue fefelli,
abstulerint celeres improba dicta noti,
et pateant ueniente die periuria nobis,
nec curent superi sib qua locutus ero !
Da modo lucra mihi, da facto gaudia lucro
et fac ut emptori uerba dedisse iuuet. »
Talia Mercurius poscenti ridet ab alto,
se memor Ortygias subripuisse boues.
At mihi pande, precor, tanto meliora petenti,
in Geminos ex quo tempore Phoebus eat.
« Cum totidem de mense dies superesse uidebis,
quot sunt Herculei facta laboris », ait.
Ovide,
Fastes, V, v. 663-696
(34 vers – 215 mots)
Composition française
« Ce parti pris de gaîté, cette recherche passionnée de l’euphorie, de la lumière, du printemps, de l’amour, cet appel au cosmos, aux forces de la vie, chez un poète anxieux et seul, il ne faut pas oublier que c’est une sorte de conjuration, et c’est le caractère quasi magique de cette démarche qui donne à la poésie de Ronsard sa puissance de radiation, et lui confère, au sens profond du mot, son charme. »
Vous direz, en vous fondant sur les œuvres inscrites au programme, ce que vous pensez de ce jugement formulé par un critique contemporain.
Thème latin
UN SACRIFICE SANS ILLUSION
— Je le ferais (1).
Alban souffle un peu, comme la Pythie au début de la transe. Cette voix de l’ombre va sur lui comme l’archet (2) va sur la corde.
— Je le ferais, s’il le fallait, – par les sacrements que j’ai reçus hier matin ! J’ignore l’utilité de mon sacrifice, et dans le fond je crois que je me sacrifie à quelque chose qui n’est rien, qui est une de ces nuées que je hais. Croyant mon sacrifice inutile, et peut-être insensé, sans témoin, sans désir, renonçant à la vie et à la chère odeur des êtres, je me précipite dans l’indifférence de l’avenir pour la seule fierté d’avoir été si libre. Dans l’Iliade, Diomède se rue sur Énée, bien qu’il sache qu’Apollon rende Énée invulnérable. Hector prédit la ruine de sa patrie, la captivité de sa femme, avant de retourner se battre comme s’il croyait en la victoire. Quand le cheval prophétique annonce à Achille sa mort prochaine : « Je le sais bien », répond le héros, mais au lieu de se croiser les bras et de l’attendre, il se rejette et tue encore d’autres hommes dans la bataille. Ainsi ai-je vécu, sachant la vanité des choses, mais agissant comme si j’en étais dupe, et jouant à faire l’homme pour n’être pas rejeté comme dieu. Oui, perdons-les l’une dans l’autre, mon indifférence et celle de l’avenir ! Après avoir feint d’avoir de l’ambition et je n’en avais pas, feint de craindre la mort et je ne la craignais pas, feint de souffrir et je n’ai jamais souffert, feint d’attendre et je n’attendais rien, je mourrai en feignant de croire que ma mort sert, mais persuadé qu’elle ne sert pas et proclamant que tout est juste. »
Montherlant,
Le Songe, I, X, « Noctium phantasmata »
(316 mots)
Thème grec
DE L’INUTILITÉ DES VOYAGES
Il est aisé d’opposer à tous ces philosophes errants l’autorité de leur coryphée Socrate, qui ne fit jamais de voyages, et qui, par la propre confession de Platon, sortait moins d’Athènes que ni les boiteux ni les aveugles. Considérons la fin des courses de Démocrite, l’un encore des plus célèbres de cette profession, et je m’assure que nous perdrons bientôt l’envie de les imiter. Il fut trouver les prêtres d’Égypte, les Chaldées de Perse et les gymnosophistes d’Éthiopie ; après quoi l’écrivain de sa vie témoigne qu’il se vit réduit, étant de retour, à vivre très bassement, nourri par son frère Damasus, et sujet, Si on ne lui eût fait grâce, à perdre par les lois de son pays le droit du sépulcre de ses ancêtres, comme celui qui avait consumé tout son patrimoine à se promener de la sorte. En vérité, le seul exemple de ce philosophe romain Élien, qui a si bien écrit en grec, et que Philostrate met entre ses plus excellents sophistes, peut faire avouer que la vie sédentaire et reposée n’a pas moins de charme que l’autre dont nous parlons. Il se vantait de n’avoir jamais passé les bornes de l’Italie, de ne s’être jamais mis en vaisseau et de ne connaître pas seulement la mer, ce qui le faisait fort estimer dans Rome, dit Philostrate, à cause qu’il paraissait en cela religieux observateur des mœurs de la patrie. Mais la Grèce même n’a-t-elle pas toujours fait grand cas de cet important oracle, qui déclara le plus heureux de tous les hommes un Aglaus Sophidius (1), possesseur d’un petit héritage d’Arcadie, duquel il n’était jamais parti, ne connaissant point d’autres terres que celle qu’il cultivait, ni d’autres eaux que celles qui servaient à l’arroser ?
François de La Mothe Le Vayer (1588-1672),
Petits traités en forme de lettres, VII
(318 mots)
(1) Sophidius : Σοφίδιος.
Version latine
Du désert de Syrie où il s’est retiré, saint Jérôme écrit à son ami Julien, diacre dans la région natale de Jérôme. Entre autres choses, il lui parle du projet qu’a formé sa sœur d’entrer dans la vie religieuse, et des critiques haineuses dont il est lui-même l’objet dans son pays (375 après J.-C.).
Antiquus sermo est : mendaces faciunt ut nec vera dicentibus credatur ; quod mihi ego a te objurgatus de silentio litterarum accidisse video. Dicam : « Saepe scripsi, sed neglegentia bajulorum fuit ? » Respondebis : « Omnium non scribentium vetus ista excusatio est. » Dicam : « Non repperi qui epistulas ferret ? » Dices hinc illuc isse quam plurimos. Contendam me etiam his dedisse ? At illi, quia non reddiderunt, negabunt et erit inter absentes incerta cognitio. Quid igitur faciam ? Sine culpa veniam postulabo rectius arbitrans pacem loco motus petere quam aequo gradu certamina concitare ; quamquam ita me jugis tam corporis aegrotatio quam animae aegritudo consumpsit, ut morte inminente nec mei paene memor fuerim. Quod ne falsum putes, oratorio more post argumenta testes vocabo.
Sanctus frater Heliodorus hic adfuit qui, cum mecum heremum vellet incolere, meis sceleribus fugatus abscessit. Verum omnem culpam praesens verbositas excusabit. Nam, ut ait Flaccus in satura : « Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos rogati ut numquam cantent, injussi numquam desistant », ita te deinceps fascibus obruam litterarum, ut e contrario incipias rogare ne scribam. Sororem meam, filiam in Christo tuam, gaudeo te primum nuntiante in eo permanere quo coeperat. Hic enim ubi nunc sum, non solum quid agatur in patria, sed an ipsa patria perstet ignoro. Et licet me sinistro Hibera excetra rumore dilaniet, non timebo hominum judicium habiturus judicem meum : « Si fractus inlabatur orbis, inpavidum ferient ruinae. » Quapropter quaeso ut apostolici memor praecepti quo docet opus nostrum permanere debere, et tibi a Domino praemium in illius salute pares et me de communi in Christo gloria crebris reddas sermonibus laetiorem.
Jérôme,
Correspondance, Lettre 6
(252 mots)
Composition française
Selon un critique contemporain, « l’action des Liaisons dangereuses est double : d’un côté, une action réelle, faite de plusieurs intrigues et d’épisodes secondaires, de l’autre une action verbale, qui est le récit de la précédente, et qui en est la véritable fin ».
Que pensez-vous de ce jugement ?
Thème latin
CONSOLATION À UN GENTILHOMME
QUI VIENT DE PERDRE SON FRÈRE
Je ne suis pas de ceux qui estiment que les larmes et la tristesse n’appartiennent qu’aux femmes, et que, pour paraître homme de cœur, on se doive contraindre à montrer toujours un visage tranquille. J’ai senti depuis peu la perte de deux personnes qui m’étaient très proches, et j’ai éprouvé que ceux qui me voulaient défendre la tristesse l’irritaient, au lieu que j’étais soulagé par la complaisance de ceux que je voyais touchés de mon déplaisir. Ainsi je m’assure que vous me souffrirez mieux si je ne m’oppose point à vos larmes, que si j’entreprenais de vous détourner d’un ressentiment que je crois juste. Mais il doit néanmoins y avoir quelque mesure ; et comme ce serait être barbare que de ne se point affliger du tout, lorsqu’on en a du sujet, aussi serait-ce être trop lâche de s’abandonner entièrement au déplaisir ; et ce serait faire fort mal son compte que de ne tâcher pas, de tout son pouvoir, à se délivrer d’une passion si incommode. La profession des armes, en laquelle vous êtes nourri, accoutume les hommes à voir mourir inopinément leurs meilleurs amis ; et il n’y a rien au monde de si fâcheux que l’accoutumance ne le rende supportable. Il y a, ce me semble, beaucoup de rapport entre la perte d’une main et d’un frère ; vous avez ci-devant souffert la première sans que j’aie jamais remarqué que vous en fussiez affligé ; pourquoi le seriez vous davantage de la seconde ? Si c’est pour votre propre intérêt, il est certain pouvez mieux réparer que l’autre, en ce que l’acquisition d’un fidèle ami peut autant valoir que l’amitié d’un bon frère.
René Descartes,
Lettre à Alphonse Pollot
(307 mots)
Thème grec
À QUOI BON ?
Quand on en est arrivé à ce degré de dégoût qui fait qu’on se demande intérieurement, et sans même le vouloir : à quoi bon ? quand on a tout perdu, quand on n’espère plus rien pour la nature, quand enfin on n’a plus même le désir de changer de disposition et que, sans avoir l’activité du désespoir qui fait qu’on se donne la mort, on sent tous les soirs qu’on serait bien heureux de ne pas se réveiller ; alors, mon ami, on n’a plus le droit de juger rien. On est de trop dans le monde, puisqu’on pourrait détruire les illusions des gens qui ne vivent que par elles et pour elles. Qu’il y a peu de choses en effet que ce triste éteignoir n’anéantisse ! À quoi bon ? Il n’y a qu’une seule chose qui y résiste c’est la passion, et c’est celle de l’amour, car toutes les autres resteraient sans réplique. Parcourez l’ambition, l’avarice, l’amour de la gloire même. En un mot, il n’y a que l’amour passion et la bienfaisance qui me paraissent valoir la peine de vivre. Voyez combien peu de gens sont assez malheureux pour avoir ainsi apprécié la vie. Vous croyez bien qu’en prêchant cette folie ou cette vérité, car je ne sais laquelle des deux, je ne ferais pas de prosélyte. Dieu m’en préserve ! Je parle à un sage, à un homme vertueux, que je ne puis ni entraîner, ni éclairer ; avec tout le reste je souffre et je me tais. J’attends, et je jouis en attendant, autant qu’il est en moi, de la douceur de l’amitié ; je n’existe encore que pour aimer et chérir mes amis. Ah ! qu’ils sont aimables ! qu’ils sont honnêtes ! et qu’ils sont généreux ! Combien je leur dois ! bon Condorcet (1), c’est de vous, c’est à vous que je parle.
Julie de Lespinasse (1732-1776),
Lettres inédites (1887)
(329 mots)
(1) Traduire : mon cher ami.
Version latine
Dans cette page du Panégyrique de Constantin, le panégyriste, s’adressant d’abord à Constantin, célèbre sa victoire sur Maxence, au pont Mulvius, en 312.
Ad primum igitur adspectum maiestatis tuae ptimumque impetum toties tui uictoris exercitus hostes territi fugatique et angustiis Muluii pontis exclusi, exceptis latrocinu illius primis auctoribus qui desperata uenia locum quem pugnae sumpserant texere corporibus, ceteri omnes in fluuium abiere praecipites, ut tandem aliquod caedis compendium fessis tuorum dexteris eueniret. Cum impios Tiberis hausisset, ipsum etiam illum (1) cum equo et armis insignibus frustra conatum per abrupta ripae ulterioris euadere idem Tiberis correptum gurgite deuorauit, ne tam deforme prodigium uel hanc obitus sui relinqueret famam quod alicuius uiri fortis gladio teloue cecidisset. Et aliorum quidem hostium corpora et arma praeceps fluuius uoluendo deuexit, ilIum autem eodem quo exstinxerat loco tenuit, ne diu populus Romanus dubitaret, si putaretur aliquo profugisse cuius mortis probatio quaereretur.
Sancte Thybri, quondam hospitis monitor Aeneae, mox Romuli conseruator expositi tu nec falsum Romulum diu uiuere nec parricidam urbis passus es enatare. Tu Romae tuae altor copiis subuehendis, tu munitor moenibus ambiendis, merito Constantini uictoriae particeps esse uoluisti, ut ille hostem in te propelleret, tu necares. Neque enim semper es rapidus et torrens, sed pro temporum ratione moderatus. Tu quietus armatum Coclitem reuexisti, tibi se placido Cloelia nirgo commisit : at nunc uiolentus et turbidus hostem rei publicae sorbuisti et, ne tuum lateret obsequium, eructato cadauere prodidisti. Reperto igitur et trucidato corpore uniuersus in gaudia et uindictam populus Romanus exarsit nec desitum tota urbe, qua suffixum hasta ferebatur, caput illud piaculare foedari, cum interim, ut sunt ioci triumphales, rideretur gestantis injuria, cum alieni capitis merita pateretur.
Panégyrique de Constantin
(246 mots)
(1) Illum = Maxence.
Composition française
« Mme de Sévigné, observe un critique récent, est en perpétuelle représentation, et c’est là qu’elle trouve son naturel. »
Expliquez et appréciez ce jugement.
Thème latin
UN BON MOT D’AUGUSTE
Avguste n’estoit pas fasché qu’on luy dediast des Temples : Mais il receuoit ces sortes d’honneurs, sans les demander. Ie dis bien davantage : il se moquoit de cette belle Religion, quand il estoit en son particulier, et avec ses Confidens. En public mesme il ne tenoit pas tousjours là-dessus sa grauité : Et voicy le bon Mot qu’il en dit vn jour, en fort bonne compagnie.
Ceux de Tarragone luy ayant basty vn Temple, comme plusieurs autres Villes de l’Empire, quelque temps après luy ils envoyerent vne Ambassade extraordinaire, pour luy donner auis qu’il estoit né vn Palmier, sur l’Autel qui luy auoit esté consacré. Ils crurent par là faire bien leur Cour, et qu’Auguste seroit raui de la nouuelle du miracle. Mais ayant oüi la Harangue qu’ils luy firent, il se contenta de leur respondre en sousriant ce peu de paroles : Ie voy bien, Messieurs, que vous ne faites gueres brusler de victimes, sur l’Autel que vous m’avez consacré…
Vn autre qu’Auguste eust fait faire des feux de ioye, pour la nouvelle de ce Miracle ; l’eust fait mettre dans les Registres du Senat ; eust enuoyé des Courriers de tous costez, pour l’annoncer aux Prouinces ; eust obligé tous les Poëtes de sa Cour à composer des Vers, sur cette belle matière. Auguste ne s’auisa point de tout cela, il se contenta de dire vn bon Mot, qui se seroit perdu, si Quintilien n’auoit eu soin de le conseruer. Il y a dequoy s’estonner, que Suetone l’ait oublié, dans la Vie d’Auguste, et que Macrobe ne s’en soit point souuenu, dans le Recueil qu’il a fait des iolies choses que disoit ordinairement ce sage Prince.
Guez de Balzac,
Les Entretiens, XXXIV, 2
(298 mots)
Thème grec
LETTRE D’UNE FEMME À DEUX AMIES
Dans peu, les vains discours des hommes me seront indifférents, ô mes chères amies ! mais ce sera pour moi une satisfaction, avant de quitter cette terre souillée de tant d’horreurs, que de m’être fait connaître entièrement à deux personnes que je me plais à ne pas séparer dans mon affection, et de leur laisser de moi un tendre souvenir. Vous avez souvent été étonnées de quelques mots qui me sont échappés, et qui indiquaient quelque chose de mystérieux dans mon existence ; vous m’entendiez parler de malheurs, et vous cherchiez ce qui pouvait avoir causé ceux d’une femme jeune, riche et libre depuis longtemps ; il est bien vrai, et vous allez en être convaincues, que peu de femmes ont été aussi malheureuses. Si je ne rendais pas justice à votre discernement, aux généreuses dispositions du cœur de mes amies, si je ne croyais pas être connue d’elles, je n’entreprendrais pas de leur raconter les tristes événements de ma vie. La crainte qu’elles ne prennent un récit simple et ingénu pour un roman artificieusement inventé pour me justifier m’arrêterait, et j’aimerais mieux emporter avec moi un secret qui n’intéresse qu’une seule personne que d’être suspecte du plus léger détour, et même d’une réticence. Vous allez voir au reste que je n’ai aucun intérêt à me justifier, car celle dont je vais vous parler a disparu du monde et de la mémoire des hommes depuis longtemps et qu’en vous parlant de moi, je vous parlerai d’une autre. Voilà une énigme, elle va se développer.
Sénac de Meilhan,
L’Émigré, Lettre 94
(274 mots)
Version latine
RAPPORT ENTRE L’INTÉRÊT PARTICULIER ET L’INTÉRÊT GENERAL
Unum debet esse omnibus propositum ut eadem sit utilitas uniuscuiusque et uniuersorum ; quam si ad se quisque rapiet, dissoluetur omnis humana consortio. Atque etiam si hoc natura praescribit ut homo homini quicumque sit, ob eam ipsam causam quod is homo sit, consultum uelit, necesse est secundum eandem naturam omnium utilitatem esse communem. Quod si ita est, una continemur omnes et eadem lege naturae, idque ipsum si ita est, certe uiolare alterum naturae lege prohibemur. Verum autem primum, uerum igitur extremum. Nam illud quidem absurdum est, quod quidam dicunt, parenti se aut fratri nihil detracturos sui commodi causa, aliam rationem esse ciuium reliquorum. Hi sibi nihil iuris, nullam societatem communis utilitatis causa statuunt esse cum ciuibus ; quae sententia omnem societatem distrahit ciuitatis. Qui autem ciuium rationem dicunt habendam, externorum negant, ii dirimunt communem humani generis societatem ; qua sublata beneficentia, liberalitas, bonitas, iustitia funditus tollitur ; quae qui tollunt, etiam aduersus deos immortales impii iudicandi sunt. Ab iis enim constitutam inter homines societatem euertunt ; cuius societatis artissimum uinculum est magis arbitrari esse contra naturam hominem homini detrahere sui commodi causa quam omnia incommoda subire uel externa uel corporis uel etiam ipsius animi, quae uacent iustitia ; haec enim una uirtus omnium est domina et regina uirtutum.
Forsitan quispiam dixerit : « Nonne igitur sapiens, si fame ipse conficiatur, abstulerit cibum alteri homini ad nullam rem utili ? — Minime uero : non enim mihi est uita mea utilior quam animi talis affectio, neminem ut uiolem commodi mei gratia.
Cicéron,
Les Devoirs, III, 26-29
(239 mots)
Composition française
L’œuvre de Rimbaud, écrit un poète contemporain, « est faite tout entière de ruptures avec la création de la veille, de recommencements, de ce qu’il nommait des départs ».
Commentez ce jugement.
Thème latin
DESCENTE D’UN MOINE AUX ENFERS
— Je te rencontre en effet, ô Virgile, parmi les héros et les sages, dans ces Champs−Élysees que toi-même as décrits. Ainsi donc, contrairement à ce que plusieurs croient sur la terre, nul n’est venu te chercher de la part de Celui qui regne là-haut ?
Apres un assez long silence :
— Je ne te cacherai rien. Il m’a fait appeler ; un de ses messagers, un homme simple, est venu me dire qu’on m’attendait et que, bien que je ne fusse point initié à leurs mystères, en consideration de mes chants prophétiques, une place m’était reservee parmi ceux de la secte nouvelle. Mais je refusai de me rendre à cette invitation ; je n’avais point envie de changer de place. Ce n’est pas que je partage l’admiration des Grecs pour les Champs-Élysees et que j’y goûte ces joies qui font perdre à Proserpine le souvenir de sa mère. Je n’ai jamais beaucoup cru moi-même a ce que j’en ai dit dans mon Éneide. Instruit par les philosophes et par les physiciens, j’avais un juste pressentiment de la vérité. La vie aux enfers est extrêmement diminuée ; on n’y sent ni plaisir ni peine ; on est comme si l’on n’était pas. Les morts n’y ont d’existence que celle que leur prêtent les vivants. Je préférai toutefois y demeurer.
— Mais quelle raison donnas−tu, Virgile, d’un refus si étrange ?
— J’en donnai d’excellentes. Je dis a l’envoyé du dieu que je ne méritais point l’honneur qu’il m’apportait, et que l’on supposait a mes vers un sens qu’ils ne comportaient pas. En effet, je n’ai point trahi dans ma quatrieme Églogue la foi de mes aieux. Des juifs ignorants ont pu seuls interpréter en faveur d’un dieu barbare un chant qui célèbre le retour de l’âge d’or, prédit par les oracles sibylliens.
Anatole France,
L’Île des Pingouins, Livre III, chapitre 6
(330 mots)
Thème grec
POURQUOI ÉCRIRE, AUJOURD’HUI ?
Après s’être demandé, très jeune, comment il devait écrire (par où faire passer les mots, et quels mots, pour arriver à produire, poème ou prose, quelque chose qui ait autant de pouvoir qu’un chant), il se demanda ce qu’il devait écrire (qu’est-ce qui valait d’être communiqué). Plus tard, une question dont, d’abord, il ne s’était pas embarrassé se posa avec une cruelle précision : pour quelle raison écrire ? Quand le monde se porte socialement si mal que la saine morale invite à tout braver (dangers immédiats et persécution) pour aider à l’asseoir sur d’autres bases, qu’est-ce que cela veut dire que travailler à donner un tour envoûtant à ce qu’on a dans la tête et qui, divulgué sans intention de prosélytisme, mais comme pure expression d’une sensibilité, ne pourra changer que peu à ce que contient la tête des autres ? Et si, chance heureuse, on modifie légèrement ce contenu, qu’est-ce que cela changera pour le monde et pour vous ? Au reste, quels autres exactement veulent bien vous écouter ? Sont-ils des étrangers dont vous forcez les retranchements ou n’étaient-ils pas déjà si voisins que vous faire écouter revenait à enfoncer une porte ouverte ? De surcroît, si vos prétentions vont plus profond que celles du baladin ou du maître d’école, autrement dit que simplement séduire ou enseigner, est-ce un authentique besoin de communion qui vous pousse à rédiger des textes et à les publier ou n’est-ce pas, plutôt, la louche envie de vous faire, à travers eux, l’objet d’une louche adhésion ? Aussi, paralysé par ces doutes accumulés, en vint-il à ne plus écrire.
Michel Leiris,
Le Ruban au cou d’Olympia
(290 mots)
Version latine
DE LA COLÈRE
Nemo dicit sibi : « Hoc propter quod irascor aut feci aut fecisse potui » ; nemo animum facientis, sed ipsum aestimat factum : atqui ille intuendus est, uoluerit an inciderit, coactus sit an deceptus, odium secutus sit an praemium, sibi morem gesserit an manum alteri commodauerit. Aliquid aetas peccantis facit, aliquid fortuna, ut ferre ac pati aut humanum sit aut utile. Eo nos loco constituamus quo ille est cui irascimur : nunc facit nos iracundos iniqua nostri aestimatio et quae facere uellemus pati nolumus. Nemo se differt : atqui maximum remedium irae dilatio est, ut primus eius feruor relanguescat et caligo quae premit mentem aut residat aut minus densa sit. Quaedam ex his quae te praecipitem ferebant hora, non tantum dies molliet, quaedam ex toto euanescent ; si nihil egerit petita aduocatio, apparebit iam iudicium esse, non iram. Quidquid uoles quale sit scire, tempori trade : nihil diligenter in fluctu cernitur. Non potuit inpetrare a se Plato tempus, cum seruo suo irasceretur, sed ponere illum statim tunicam et praebere scapulas uerberibus iussit sua manu ipse caesurus ; postquam intellexit irasci se, sicut sustulerat manum suspensam detinebat et stabat percussuro similis ; interrogatus deinde ab amico qui forte interuenerat quid ageret : « Exigo », inquit, « poenas ab homine iracundo ». Velut stupens gestum illum saeuituri deformem sapienti uiro seruabat, oblitus iam serui, quia alium quem potius castigaret inuenerat. Itaque abstulit sibi in suos potestatem et ob peccatum quoddam commotior : « Tu », inquit, « Speusippe, seruulum istum uerberibus obiurga ; nam ego irascor. » Ob hoc non cecidit propter quod alius cecidisset. « Irascor », inquit ; « plus faciam quam oportet, libentius faciam : non sit iste seruus in eius potestate qui in sua non est. »
Sénèque le Jeune,
De la colère
(263 mots)
Composition française
Baudelaire, dans la dédicace qui précède Le Spleen de Paris, écrit :
« Quel est celui de nous qui n’a pas, dans ses jours d’ambition, rêvé le miracle d’une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ? »
Dans quelle mesure, selon vous, ces propos pourraient-ils s’appliquer aux textes de Rousseau inscrits au programme ?
Thème latin
L’UTILITÉ DES TRIBUNS DE LA PLÈBE
Supposons que les plébéiens de Rome, qui se retirèrent sur le mont sacré, se fussent laissés séduire par l’apologue de Ménénius Agrippa ; et que contens d’obtenir l’abolition des dettes, d’ouvrir les prisons aux débiteurs, et de faire porter quelques lois sévères contre l’usure des grands, ils eussent négligé de demander des tribuns. N’est-il pas évident qu’en se conduisant avec cette imprudence, le peuple n’auroit joui que d’un soulagement passager ? Les patriciens n’auroient pas manqué de feindre quelque modération pour donner le temps aux esprits de se calmer, et laisser effacer les traces de leur tyrannie ; mais ils auroient préparé sourdement la ruine des lois qu’ils venoient d’accorder. Instruits par la crainte à ménager leurs intérêts avec plus d’art, tous les bienfaits auroient été autant de pièges, et leur ambition n’auroit cherché qu’à se dédommager de ce que perdoit leur avarice. Sous prétexte d’obéir scrupuleusement aux lois ou de les perfectionner, ils en auroient abusé. En désunissant les plébéiens qui n’auroient eu ni des protecteurs ni un point de réunion dans les tribuns, ils auroient trouvé le secret de les asservir. Après avoir forgé les chaînes avec lesquelles ils devoient garrotter le peuple, ils se seroient servis de leur autorité pouc s’emparer de toutes les richesses de la république.
C’est parce que les tribuns acquirent le pouvoir d’assembler le peuple, de suspendre les délibérations du sénat, d’approuver ou de rejeter ses décrets, de demander raison aux magistrats de leur administration, en un mot, c’est parce que la nouvelle constitution attaquoit et réprimoit également l’ambition et l’avarice, que la république fut heureuse. Dès qu’on est moins attentif à l’une, l’autre en profite pour être plus hardie et plus entreprenante.
Gabriel de Mably,
De la législation ou Principes des lois
(312 mots)
Thème grec
DES MÉFAITS DE LA JALOUSIE
CANDAULE (1). — Plus j’y pense et plus je trouve qu’il n’était point nécessaire que vous me fissiez mourir.
GYGÈS. — Que pouvais-je faire ? Le lendemain que vous m’eûtes fait voir les beautés cachées de la reine, elle m’envoya quérir, me dit qu’elle s’était aperçue que vous m’aviez fait entrer le soir dans sa chambre et me fit, sur l’offense qu’avait reçue sa pudeur, un très beau discours, dont la conclusion était qu’il fallait me résoudre à mourir, ou à vous tuer, et à l’épouser en même temps : car, à ce qu’elle prétendait, il était de son honneur ou que je possédasse ce que j’avais vu, ou que je ne pusse jamais me vanter de l’avoir vu. J’entendis bien ce que tout cela voulait dire. L’outrage n’était pas si grand que la reine n’eût bien pu le dissimuler, et son honneur pouvait vous laisser vivre, si elle eût voulu ; mais franchement elle était dégoûtée de vous et elle fut ravie d’avoir un prétexte de gloire pour se défaire de son mari. Vous jugez bien que, dans l’alternative qu’elle me proposait, je n’avais qu’un parti à prendre.
CANDAULE. – Je crains fort que vous n’eussiez pris plus de goût pour elle qu’elle n’avait de dégoût pour moi. Ah ! que j’eus tort de ne pas prévoir l’effet que sa beauté ferait sur vous et de vous prendre pour un trop honnête homme !
Fontenelle,
Dialogues des morts
(261 mots)
(1) Roi de Lydie de 735 à 708 avant Jésus-Christ, le dernier de la dynastie des Héraclides. Vain de la beauté de sa femme, il la fit voir au bain au berger Gygès. La reine indignée força Gygès à tuer Candaule et le prit ensuite pour époux.
Version latine
RÊVE D’UN BONHEUR RUSTIQUE
Laurus (1) ubi bona signa dedit, gaudete coloni,
distendet spicis horrea plena Ceres,
oblitus et musto feriet pede rusticus uuas,
dolia dum magni deficiantque lacus ;
ac madidus baccho sua festa Palilia pastor
concinet : a stabulis tunc procul este lupi ;
ille leuis stipulae sollemnis potus aceruos
accendet, flammas transilietque sacras ;
et fetus matrona dabit, natusque parenti
oscula comprensis auribus eripiet,
nec taedebit auum paruo aduigilare nepoti
balbaque cum puero dicere uerba senem.
Tunc operata deo pubes discumbet in herba,
arboris antiquae qua leuis umbra cadit,
aut e ueste sua tendent umbracula sertis
uincta, coronatus stabit et ipse calix ;
at sibi quisque dapes et festas extruet alte
caespitibus mensas caespitibusque torum.
ingeret hic potus iuuenis maledicta puellae,
postmodo quae uotis inrita facta uelit :
nam ferus ille suae plorabit sobrius idem
et se iurabit mente fuisse mala.
Pace tua pereant arcus pereantque sagittae,
Phoebe, modo in terris erret inermis Amor.
Ars bona : sed postquam sumpsit sibi tela Cupido,
heu ! heu ! quam multis ars dedit ista malum !
Et mihi praecipue ; iaceo cum saucius annum
et faueo morbo, cum iuuat ipse dolor,
usque cano Nemesim, sine qua uersus mihi nullus
uerba potest iustos aut reperire pedes.
Tibulle,
Élégies, II, V, 83-112
(190 mots – 30 mots)
(1) On interprétait favorablement le crépitement du laurier dans les flammes sacrées.
Composition française
« La force de Montaigne vient de ce qu’il écrit toujours au moment même, et que la grande défiance qu’il a de sa mémoire, qu’il croit mauvaise, le dissuade de réserver rien de ce qui lui vient à l’esprit, en vue d’une présentation plus savante et mieux ordonnée. »
Quelles réflexions vous suggère cette phrase d’André Gide sur la facture et la substance même des Essais ?
Thème latin
LA LEÇON DU BON SAUVAGE
Tu n’es pas esclave : tu souffrirais plutôt la mort que de l’être, et tu veux nous asservir ! Tu crois donc que le Tahitien ne sait pas défendre sa liberté et mourir ? Celui dont tu veux t’emparer comme de la brute, le Tahitien, est ton frère. Vous êtes deux enfants de la nature ; quel droit as-tu sur lui qu’il n’ait pas sur toi ? Tu es venu ; nous sommes-nous jetés sur ta personne ? avons-nous pillé ton vaisseau ? t’avons-nous saisi et exposé aux flèches de nos ennemis ? t’avons-nous associé dans nos champs au travail de nos animaux ? Nous avons respecté notre image en toi. Laisse-nous nos mœurs ; elles sont plus sages et plus honnêtes que les tiennes ; nous ne voulons point troquer ce que tu appelles notre ignorance, contre tes inutiles lumières. Tout ce qui nous est nécessaire et bon, nous le possédons. Sommes-nous dignes de mépris, parce que nous n’avons pas su nous faire des besoins superflus ? Lorsque nous avons faim, nous avons de quoi manger ; lorsque nous avons froid, nous avons de quoi nous vêtir. Tu es entré dans nos cabanes, qu’y manque-t-il, à ton avis ? Poursuis jusqu’où tu voudras ce que tu appelles commodités de la vie ; mais permets à des êtres sensés de s’arrêter, lorsqu’ils n’auraient à obtenir, de la continuité de leurs pénibles efforts, que des biens imaginaires. Si tu nous persuades de franchir l’étroite limite du besoin, quand finirons-nous de travailler ? Quand jouirons-nous ? Nous avons rendu la somme de nos fatigues annuelles et journalières la moindre qu’il était possible, parce que rien ne nous paraît préférable au repos. Va dans ta contrée t’agiter, te tourmenter tant que tu voudras ; laisse-nous reposer : ne nous entête ni de tes besoins factices, ni de tes vertus chimériques.
Denis Diderot,
Supplément au voyage de Bougainville
(320 mots)
N. B. Rendre « le Tahitien » par « l’insulaire ».
Thème grec
Au fond, quand un homme est allé admirer de belles actions dans des fables, et pleurer des malheurs imaginaires, qu’a-t-on encore à exiger de lui ? N’est-il pas content de lui-même ? Ne s’applaudit-il pas de sa belle âme ? Ne s’est-il pas acquitté de tout ce qu’il doit à la vertu par l’hommage qu’il vient de lui rendre ? Que voudrait-on qu’il fît de plus ? Qu’il la pratiquât lui-même ? Il n’a point de rôle à jouer : il n’est pas comédien.
Plus j’y réfléchis, et plus je trouve que tout ce qu’on met en représentation au théâtre, on ne l’approche pas de nous, on l’en éloigne… Le théâtre a ses règles, ses maximes, sa morale à part, ainsi que son langage et ses vêtements. On se dit bien que rien de tout cela ne nous convient, et l’on se croirait aussi ridicule d’adopter les vertus de ses héros que de parler en vers, et d’endosser un habit à la romaine. Voilà donc à peu près à quoi servent tous ces grands sentiments et toutes ces brillantes maximes qu’on vante avec tant d’emphase : à les reléguer à jamais sur la scène, et à nous montrer la vertu comme un jeu de théâtre, bon pour amuser le public, mais qu’il y aurait de la folie à vouloir transporter sérieusement dans la société. Ainsi la plus avantageuse impression des meilleures tragédies est de réduire à quelques affections passagères, stériles et sans effet tous les devoirs de l’homme, à nous faire applaudir de notre courage en louant celui des autres, de notre humanité en plaignant les maux que nous aurions pu guérir, de notre charité en disant au pauvre : Dieu vous assiste.
Jean-Jacques Rousseau,
Lettre à M. d’Alembert, sur son article « Genève »
(303 mots)
Version latine
RAPPORTS DIFFICILES DE TIBÈRE AVEC SA MÈRE
Matrem Liuiam grauatus uelut partes sibi aequas potentiae uindicantem, et congressum eius assiduum uitauit et longiores secretioresque sermones, ne consiliis, quibus tamen interdum et egere et uti solebat, regi uideretur. Tulit etiam perindigne actum in senatu, ut titulis suis quasi Augusti (1), ita et « Liuiae filius » adiceretur. Quare non « parentem patriae » appellari, non ullum insignem honorem recipere publice passus est ; sed et frequenter admonuit, maioribus nec feminae conuenientibus negotiis abstineret, praecipue ut animaduertit incendio iuxta aedem Vestae et ipsam interuenisse populumque et milites, quo enixius opem ferrent, adhortatam, sicut sub marito solita esset.
Dehinc ad simultatem usque processit hac, ut ferunt, de causa. Instanti saepius, ut ciuitate donatum in decurias adlegeret, negauit alia se condicione adlecturum, quam si pateretur ascribi albo « extortum id sibi a matre ». At illa commota ueteres quosdam ad se Augusti codicillos de acerbitate et intolerantia morum eius e sacrario protulit atque recitauit. Hos et custoditos tam diu et exprobratos tam infeste adeo grauiter tulit, ut quidam putent inter causas secessus (2) hanc ei uel praecipuam fuisse. Toto quidem triennio, quo uiuente matre afuit, semel omnino eam nec amplius quam uno die paucissimis uidit horis ; ac mox neque aegrae adesse curauit defunctamque et, dum aduentus sui spem facit, complurium dierum mora corrupto demum et tabido corpore funeratam prohibuit consecrari, quasi id ipsa mandasset. Testamentum quoque eius pro irrito habuit omnisque amicitias et familiaritates, etiam quibus ea funeris sui curam moriens demandauerat, intra breue tempus afflixit, uno ex iis, equestris ordinis uiro, et in antliam condemnato.
Suétone,
Vies des douze Césars, Tibère, 50, 2 – 51, 2
(246 mots)
(1) Devenue l’épouse d’Auguste, Livie lui avait fait adopter son fils Tibère.
(2) En 27, Tibère s’éloigna de Rome et se retira à Capri.
Composition française
Zola écrit dans Le Roman expérimental : « Décrire n’est plus notre but ; nous voulons simplement compléter et déterminer […]. Il y aurait là une nécessité de savant et non un exercice de peintre. Cela revient à dire que nous ne décrivons plus pour décrire, par un caprice et un plaisir de rhétoriciens. Nous estimons que l’homme ne peut être séparé de son milieu, qu’il est complété par son vêtement, par sa maison, par sa ville, par sa province ; et, dès lors, nous ne noterons pas un seul phénomène de son cerveau ou de son cœur sans en chercher les causes ou le contrecoup dans le milieu. De là ce qu’on appelle nos éternelles descriptions. »
Ce texte permet-il, selon vous, de rendre compte de la place et du rôle de la description dans La Curée ?
Thème latin
Monsieur,
Vous êtes le plus galant homme du monde, et je suis assurément un de ceux qui sais le mieux reconnaître ces qualités-là et les admirer infiniment, surtout quand elles sont jointes aux talents qui se trouvent singulièrement en vous : tout cela m’oblige à vous témoigner de ma main ma reconnaissance pour l’offre que vous me faites, quelque peine que j’aie encore d’écrire et de lire moi-même ; mais l’honneur que vous me faites m’est si cher, que je ne puis trop me hâter d’y répondre. Je vous dirai donc, Monsieur, que, si j’étais en santé, je serais volé à Toulouse, et que je n’aurais pas souffert qu’un homme comme vous eût fait un pas pour un homme comme moi. Je vous dirai aussi que, quoique vous soyez celui de toute l’Europe que je tiens pour le plus grand géomètre, ce ne serait pas cette qualité-là qui m’aurait attiré ; mais que je me figure tant d’esprit et d’honnêteté en votre conversation, que c’est pour cela que je vous rechercherais. Car pour vous parler franchement de la géométrie, je la trouve le plus haut exercice de l’esprit ; mais en même temps je la connais pour si inutile, que je fais peu de différence entre un homme qui n’est que géomètre et un habile artisan. Aussi je l’appelle le plus beau métier du monde ; mais enfin ce n’est qu’un métier ; et j’ai dit souvent qu’elle est bonne pour faire l’essai, mais non pas l’emploi de notre force : de sorte que je ne ferais pas deux pas pour la géométrie, et je m’assure fort que vous êtes fort de mon humeur. Mais il y a maintenant ceci de plus en moi, que je suis dans des études si éloignées de cet esprit-là, qu’à peine me souviens-je qu’il y en ait. Je m’y étais mis il y a un an ou deux par une raison tout à fait singulière.
Blaise Pascal,
Lettre à Fermat du 10 août 1660
(347 mots)
Thème grec
La plus utile et la moins avancée de toutes les connaissances humaines me paraît être celle de l’homme, et j’ose dire que la seule inscription du temple de Delphes contenait un précepte plus important et plus difficile que tous les gros livres des moralistes. Aussi je regarde le sujet de ce Discours comme une des questions les plus intéressantes que la philosophie puisse proposer, et malheureusement pour nous comme une des plus épineuses que les philosophes puissent résoudre. Car comment connaître la source de l’inégalité parmi les hommes, si l’on ne commence par les connaître eux-mêmes ? et comment l’homme viendra-t-il à bout de se voir tel que l’a formé la nature, à travers tous les changements que la succession des temps et des choses a dû produire dans sa constitution originelle, et de démêler ce qu’il tient de son propre fonds d’avec ce que les circonstances et ses progrès ont ajouté ou changé à son état primitif ? Semblable à la statue de Glaucus que le temps, la mer et les orages avaient tellement défigurée qu’elle ressemblait moins à un dieu qu’à une bête féroce, l’âme humaine altérée au sein de la société par mille causes sans cesse renaissantes, par l’acquisition d’une multitude de connaissances et d’erreurs, par les changements arrivés à la constitution des corps, et par le choc continuel des passions, a, pour ainsi dire, changé d’apparence au point d’être presque méconnaissable.
Jean-Jacques Rousseau,
Discours sur l’origine de l’inégalité
(252 mots)
Version latine
Après la victoire de Crémone, Vespasien redouble d’énergie, Antonius Primus, le lieutenant vainqueur, n’agit pas de même…
Dum hac totius orbis nutatione fortuna imperii transit, Primus Antonius nequaquam pari innocentia post Cremonam agebat, satis factum bello ratus et cetera ex facili, seu felicitas in tali ingenio auaritiam, superbiam ceteraque occulta mala patefecit. Vt captam Italiam persultare, ut suas legiones colere ; omnibus dictis factisque uiam sibi ad potentiam struere. Vtque licentia militem imbueret interfectorum centurionum ordines legionibus offerebat. Eo suffragio turbidissimus quisque delecti ; nec miles in arbitrio ducum, sed duces militari uiolentia trahebantur. Quae seditiosa et corrumpendae disciplinae mox in praedam uertebat, nihil aduentantem Mucianum ueritus, quod exitiosius erat quam Vespasianum spreuisse.
Ceterum propinqua hieme et umentibus Pado campis expeditum agmen incedere. Signa aquilaeque uictricium legionum, milites uolneribus aut aetate graues, plerique etiam integri Veronae relicti : sufficere cohortes alaeque et e legionibus lecti profligato iam bello uidebantur. Vndecima legio sese adiunxerat, initio cunctata, sed prosperis rebus anxia quod defuisset ; sex milia Dalmatarum, recens dilectus, comitabantur ; ducebat Pompeius Siluanus consularis ; uis consiliorum penes Annium Bassum legionis legatum. Is Siluanum socordem bello et dies rerum uerbis terentem specie obsequii regebat ad omniaque quae agenda forent quieta cum industria aderat. Ad has copias e classicis Rauennatibus, legionariam militiam poscentibus, optimus quisque adsciti : classem Dalmatae suppleuere.
Exercitus ducesque ad Fanum Fortunae iter sistunt, de summa rerum cunctantes, quod motas ex urbe praetorias cohortis audierant et teneri praesidiis Appenninum rebantur ; et ipsos in regione bello attrita inopia et seditiosae militum uoces terrebant, clauarium (donatiui nomen est) flagitantium. Nec pecuniam aut frumentum prouiderant, et festinatio atque auiditas praepediebant, dum quae accipi poterant rapiuntur.
Celeberrimos auctores habeo tantam uictoribus aduersus fas nefasque inreuerentiam fuisse ut gregarius eques occisum a se proxima acie fratrem professus praemium a ducibus petierit. Nec illis aut honorare eam caedem ius hominum aut ulcisci ratio belli permittebat. Distulerant tamquam maiora meritum quam quae statim exoluerentur ; nec quidquam ultra traditur.
Tacite,
Histoires, III, 49-51
(298 mots)
Session 1988
Composition française
Évoquant, dans ses Mémoires improvisés, les circonstances de la composition du Soulier de salin, Paul Claudel déclarait :
« Le comique pour moi est l’extrême pointe du lyrisme inspiré par cette joie dans laquelle je baignais, par ce sentiment de triomphe dans le bien, le bien qui est venu complètement par-dessus le mal, qui l’a complètement éliminé. »
Vous direz en quoi cette confidence permet de définir la nature du rire que peuvent engendrer la lecture et la représentation du Soulier de satin.
Thème latin
LES ABEILLES NE CONSTITUENT PAS UNE SOCIÉTÉ
Nos observateurs admirent à l’envi l’intelligence et les talents des abeilles ; elles ont, disent-ils, un génie particulier, un art qui n’appartient qu’à elles, l’art de se bien gouverner. Il faut savoir observer pour s’en apercevoir ; mais une ruche est une république où chaque individu ne travaille que pour la société, où tout est ordonné, distribué, réparti avec une prévoyance, une équité, une prudence admirables ; Athènes n’était pas mieux conduite, ni mieux policée ; plus on observe ce panier de mouches, et plus on découvre de merveilles : un fond de gouvernement inaltérable et toujours le même, un respect profond pour la personne en place, une vigilance singulière pour son service, la plus soigneuse attention pour ses plaisirs, un amour constant pour la patrie, une ardeur inconcevable pour le travail, une assiduité à l’ouvrage que rien n’égale, le plus grand désintéressement joint à la plus grande économie, la plus fine géométrie employée à la plus élégante architecture, etc. Je ne finirais point si je voulais seulement parcourir les annales de cette république, et tirer de l’histoire de ces insectes tous les traits qui ont excité l’admiration de leurs historiens.
C’est qu’indépendamment de l’enthousiasme qu’on prend pour son sujet, on admire toujours d’autant plus qu’on observe davantage et qu’on raisonne moins. Y a-t-il en effet rien de plus gratuit que cette admiration pour les mouches, et que ces vues morales qu’on voudrait leur prêter, que cet amour du bien commun qu’on leur suppose, que cet instinct singulier qui équivaut à la géométrie la plus sublime, instinct qu’on leur a nouvellement accordé, par lequel les abeilles résolvent, sans hésiter, le problème de bâtir le plus solidement qu’il soit possible dans le moindre espace possible et avec la plus grande économie possible ? Que penser de l’excès auquel on a porté le détail de ces éloges ? Car enfin une mouche ne doit pas tenir dans la tête d’un Naturaliste plus de place qu’elle n’en tient dans la nature.
Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788),
Histoire naturelle, générale et particulière, t. IV (1753),
Discours sur la nature des animaux
(357 mots)
Thème grec
Iphigénie vient avec une captive grecque, qui s’étonne de sa tristesse. Elle demande si c’est qu’elle est affligée de ce que la fête de Diane se passera sans qu’on lui immole aucun étranger.
« Tu peux croire, dit Iphigénie, si c’est là un sentiment digne de la fille d’Agamemnon. Tu sais avec quelle répugnance j’ai préparé les misérables que l’on a sacrifiés depuis que je préside à ces cruelles cérémonies. Je me faisais une joie de ce que la fortune n’avait amené aucun Grec pour cette journée, et je triomphais seule de la douleur commune qui est répandue dans cette île, où l’on compte pour un présage funeste de ce que nous manquons de victimes pour cette fête. Mais je ne puis résister à la secrète tristesse dont je suis occupée depuis le songe que j’ai fait cette nuit. J’ai cru que j’étais à Mycènes, dans la maison de mon père : il m’a semblé que mon père et nia mère nageaient dans le sang, et que moi-même je tenais un poignard à la main pour en égorger mon frère Oreste. Hélas ! mon cher Oreste ! »
LA CAPTIVE
« Mais, madame, vous êtes trop éloignés l’un de l’autre pour craindre l’accomplissement de votre songe. »
IPHIGÉNIE
« Et ce n’est pas aussi ce que je crains ; mais je crains avec raison qu’il n’y ait de grands malheurs dans ma famille : les rois sont sujets à de grands changements. »
Jean Racine,
Plan du 1er acte d’Iphigénie en Tauride
(253 mots)
Version latine
Afranius, lieutenant de Pompée, demande grâce pour ses soldats épuisés et malades.
Iam domiti cessere duces, pacisque petendae
auctor damnatis supplex Afranius armis
semianimes in castra trahens hostilia turmas
uictoris stetit ante pedes. Seruata precanti
maiestas, non fracta malis, interque priorem
fortunam casusque nouos gerit omnia uicti,
sed ducis, et ueniam securo pectore poscit :
« Si me degeneri strauissent fata sub hoste,
non derat fortis rapiendo dextera leto.
At nunc causa mihi est orandae sola salutis,
dignum donanda, Caesar, te credere uita.
Non partis studiis agimur, nec sumpsimus arma
consiliis inimica tuis. Nos denique bellum
inuenit ciuile duces, causaeque priori,
dum potuit, seruata fides. Nil fata moramur :
tradimus Hesperias gentes, aperimus eoas
securumque orbis patimur post terga relicti.
Nec cruor effusus campis tibi bella peregit
nec ferrum lassaeque manus. Hoc hostibus unum,
quod uincas, ignosce tuis. Nec magna petuntur :
otia des fessis, uitam patiaris inermes
degere quam tribuis. Campis prostrata iacere
agmina nostra putes ; nec enim felicibus armis
misceri damnata decet partemque triumphi
captos ferre tui ; turba haec sua fata peregit.
Hoc petimus, uictos ne tecum uincere cogas. »
Dixerat ; at Caesar facilis uultuque serenus
flectitur atque usus belli poenamque remittit.
Vt primum iustae placuerunt foedera pacis,
incustoditos decurrit miles ad amnes,
incumbit ripis permissaque flumina turbat.
Lucain,
La Pharsale, IV, 337-367
(31 vers – 193 mots)
Composition française
Jean Schlumberger écrit de l’œuvre dramatique de Pierre Corneille :
« Nul théâtre où l’on mente autant. On y ment, non point par peur ou faiblesse, mais par politesse ou diplomatie ; et l’on y ment beaucoup par courage. On ment moins pour cacher ses sentiments que pour les nier et commencer à les détruire. On se ment beaucoup à soi-même, et dans le même sens, non pour se flatter ou s’épargner des difficultés, mais d’une manière active et créatrice, pour imposer une loi au désordre intérieur. » (Tableau de la littérature française, 1939)
Vous examinerez dans quelle mesure les diverses manifestations du mensonge que l’on peut relever dans le Cid, Othon et Suréna permettent aux héros de Corneille d’inventer leur vérité.
Thème latin
Minos. — Bien qu’il (1) n’ait dit que des sottises, il n’en a avancé pas une qu’il n’ait appuyé de l’autorité de tous les Anciens, et, quoiqu’il les fît parler de la plus mauvaise grâce du monde, il leur a donné à tous, en les citant, de la galanterie, de la gentillesse et de la bonne grâce du monde. « Platon dit galamment dans son Timée. Sénèque est joli dans son Traité des bienfaits. Ésope a bonne grâce dans un de ses apologues. »
Pluton. — Vous me peignez là un maître impertinent ; mais pourquoi le laissiez-vous parler si longtemps ? Que ne lui imposiez-vous silence ?
Minos. — Silence, lui ! C’est bien un homme qu’on puisse faire taire quand il a commencé à parler ! J’ai eu beau faire semblant vingt fois de me vouloir lever de mon siège ; j’ai eu beau lui crier : Avocat, concluez ; de grâce, concluez, avocat ; il a été jusqu’au bout, et a tenu à lui seul toute l’audience. Pour moi, je ne vis jamais une telle fureur de parler ; et si ce désordre-là continue, je crois que je serai obligé de quitter la charge.
Pluton. — Il est vrai que les morts n’ont jamais été si sots qu’aujourd’hui. Il n’est pas venu ici depuis longtemps une ombre qui eût le sens commun ; et, sans parler des gens de palais, je ne vois rien de si impertinent que ceux qu’ils nomment gens du monde. Ils parlent tous un certain langage qu’ils appellent galanterie ; et, quand nous leur témoignons, Proserpine et moi, que cela nous choque, ils nous traitent de bourgeois et disent que nous ne sommes pas galants. On m’a assuré même que cette pestilente galanterie avait infecté tous les pays infernaux, et même les champs Élysées, de sorte que les héros et surtout les héroïnes qui les habitent sont aujourd’hui les plus sottes gens du monde, grâce à certains auteurs qui leur ont appris, dit-on, ce beau langage, et qui en ont fait des amoureux transis. À vous dire le vrai, j’ai bien de la peine à le croire.
Nicolas Boileau,
Les Héros de roman
(361 mots)
Thème grec
Comme il ne savait pas les violences que l’on venait de faire à la princesse, il attendait l’heure de la revoir avec mille impatiences ; il voulut parler d’elle à ceux que le roi avait mis auprès de lui pour lui faire plus d’honneur ; mais par l’ordre de la reine, ils lui en dirent tout le mal qu’ils purent : […] qu’elle tourmentait ses amis et ses domestiques ; qu’on ne pouvait être plus malpropre, et qu’elle poussait si loin l’avarice qu’elle aimait mieux être habillée comme une petite bergère que d’acheter de riches étoffes de l’argent que lui donnait le roi son père. À tout ce détail, Charmant souffrait et se sentait des mouvements de colère qu’il avait de la peine à modérer.
« Non, disait-il en lui-même, il est impossible que le Ciel ait mis une âme si mal faite dans le chef-d’œuvre de la nature. […] Quoi ! elle serait mauvaise avec cet air de modestie et de douceur qui enchante ? Ce n’est pas une chose qui me tombe sous le sens ; il m’est bien plus aisé de croire que c’est la reine qui la décrie ainsi : l’on n’est pas belle-mère pour rien ; et la princesse Truitonne est une si laide bête qu’il ne serait point extraordinaire qu’elle portât envie à la plus parfaite de toutes les créatures. »
Charles Perrault,
L’Oiseau bleu
(240 mots)
Version latine
Dans Le songe de Scipion, l’Africain s’adresse à son petit-fils et l’invite à ne pas attribuer d’éternité à la gloire terrestre.
Quis in reliquis orientis aut obeuntis solis ultimis aut aquilonis austriue partibus tuum nomen audiet ? Quibus amputatis cernis profecto quantis in angustiis uestra se gloria dilatari uelit. Ipsi autem qui de nobis loquuntur, quam loquentur diu ?
Quin etiam si cupiat proles illa futurorum hominum deinceps laudes unius cuiusque nostrum a patribus acceptas posteris prodere, tamen propter eluuiones exustionesque terrarum, quas accidere tempore certo necesse est, non modo non aeternam, sed ne diuturnam quidem gloriam adsequi possumus. Quid autem interest ab iis qui postea nascentur sermonem fore de te, cum ab iis nullus fuerit qui ante nati sunt ? Qui nec pauciores et certe meliores fuerunt uiri.
Praesertim cum, apud eos ipsos a quibus audiri nomen nostrum potest, nemo unius anni memoriam consequi possit. Homines enim populariter annum tantum modo solis, id est unius astri reditu metiuntur ; cum autem ad idem unde semel profecta sunt cuncta astra redierint eandemque totius caeli discriptionem longis interuallis rettulerint, tum ille uere uertens annus appellari potest ; in quo uix dicere audeo quam multa hominum saecula teneantur. Namque ut olim deficere sol hominibus exstinguique uisus est, cum Romuli animus haec ipsa in templa penetrauit, quandoque ab eadem parte sol eodemque tempore iterum defecerit, tum signis omnibus ad principium stellisque reuocatis expletum annum habeto ; cuius quidem anni nondum uicesimam partem scito esse conuersam.
Quocirca si reditum in hunc locum desperaueris, in quo omnia sunt magnis et praestantibus uiris, quanti tandem est ista hominum gloria quae pertinere uix ad unius anni partem exiguam potest ? Igitur alte spectare si uoles atque hanc sedem et aeternam domum contueri, neque te sermonibus uulgi dedideris nec in praemiis humanis spem posueris rerum tuarum ; suis te oportet inlecebris ipsa uirtus trahat ad uerum decus. Quid de te alii loquantur, ipsi uideant, sed loquentur tamen ; sermo autem omnis ille et angustiis cingitur iis regionum quas uides nec umquam de ullo perennis fuit et obruitur hominum interitu et obliuione posteritatis exstinguitur.
Cicéron,
La République, VI, 22-25
(315 mots)
Session 1990
Composition française
Bernard Guyon écrit dans un article des Cahiers du Sud à propos de La Nouvelle Héloïse :
« Si vous êtes sensible à ce moyen d’expression des sentiments qu’est la voix humaine, alors écoutez ce roman comme vous feriez d’un disque. Car il est cela d’abord : un ample recueil d’airs, de récitatifs, de chœurs, entremêlés de fragments de musique pure. Monologues tumultueux ou mélancoliques, ardents ou méditatifs ; dialogues dramatiques où les cœurs s’affrontent, s’écartent, se répondent ; ensembles polyphoniques où les personnages rassemblés communient dans une même ferveur de joie et de douleur. »
À partir de ce conseil, comment présenteriez-vous votre écoute musicale du roman de Jean-Jacques Rousseau ?
Thème latin
LE SECOND
Vous savez qu’anciennement des acteurs faisaient des rôles de femmes ?
LE PREMIER
Je le sais.
LE SECOND
Aulu-Gelle raconte, dans ses Nuits attiques, qu’un certain Paulus, couvert des habits lugubres d’Électre, au lieu de se présenter sur la scène avec l’urne d’Oreste, parut en embrassant l’urne qui renfermait les cendres de son propre fils qu’il venait de perdre, et qu’alors ce ne fut point une vaine représentation, une petite douleur de spectacle, mais que la salle retentit de cris et de vrais gémissements.
LE PREMIER
Et vous croyez que Paulus dans ce moment parla sur la scène comme il aurait parlé dans ses foyers ? Non, non. Ce prodigieux effet, dont je ne doute pas, ne tint ni aux vers d’Euripide, ni à la déclamation de l’acteur, mais bien à la vue d’un père désolé qui baignait de ses pleurs l’urne de son propre fils. Ce Paulus n’était peut-être qu’un médiocre comédien ; non plus que cet Æsopus dont Plutarque rapporte que « jouant un jour en plein théâtre le rôle d’Atréus délibérant en lui-même comment il se pourra venger de son frère Thyestès, il y eut d’aventure quelqu’un des serviteurs qui voulut soudain passer en courant devant lui, et que lui, Æsopus, étant hors de lui-même pour l’affection véhémente et pour l’ardeur qu’il avait de représenter au vif la passion furieuse du roi Atréus, lui donna sur la tête un tel coup du sceptre qu’il tenait en sa main, qu’il le tua sur la place… ». C’était un fou que le tribun devait envoyer sur-le-champ au mont Tarpéien.
LE SECOND
Comme il fit apparemment.
LE PREMIER
J’en doute. Les Romains faisaient tant de cas de la vie d’un grand comédien, et si peu de la vie d’un esclave !
Denis Diderot,
Paradoxes sur le comédien (1773-1778)
(318 mots)
Thème grec
Me voyant enfin si maltraité des hommes et, du côté du bien, de moitié moins à mon aise que je ne l’avais été d’abord, il me prit un jour une si grande colère contre mon philosophe, pour la tromperie que je croyais qu’il m’avait faite quand j’avais été le consulter, que je partis tout d’un coup pour aller lui témoigner mon ressentiment. J’arrivai bientôt chez lui et je frappai avec emportement à sa porte ; il se présenta d’un air aussi froid que s’il avait eu affaire à l’homme le plus tranquille. « Me reconnaissez-vous ? lui dis-je. — Oui, reprit-il ; que me voulez-vous ? — Vous reprocher, répondis-je, la fourberie de vos conseils. — Dites plutôt mon ignorance, s’il est vrai que tous mes conseils vous aient fait tort, repartit-il. — Non, non, m’écriai-je, vous vous êtes joué de ma jeunesse. Je vous ai demandé ce qu’il fallait faire pour être aimé des hommes, vous avez eu la cruauté de me dire que je n’avais qu’à être bon, et c’est cette bonté que vous m’avez conseillée qui m’a perdu près d’eux, loin qu’elle m’ait conduit à la fortune, comme je l’espérais, et peu s’en faut qu’elle n’ait causé ma ruine entière. — Vouloir faire fortune est une autre chose que de souhaiter d’être aimé des hommes, me répondit-il. Que ne vous expliquiez-vous mieux, quand vous m’avez interrogé ! »
Marivaux,
Le Scythe et le Solitaire
(255 mots)
Version latine
Réflexions sur la divinité que les uns assimilent à la Fortune, d’autres aux astres.
Huic (1) omnia expensa, huic (1) feruntur accepta, et in tota ratione mortalium sola utramque paginam facit, adeoque obnoxiae sumus sortis, ut ipsa pro deo sit qua deus probatur incertus.
Pars alia et hanc pellit astroque suo euentus adsignat et nascendi legibus, semelque in omnes futuros umquam deo decretum, in reliquum uero otium datum. Sedere coepit sententia haec, pariterque et eruditum uulgus et rude in eam cursus uadit. Ecce fulgurum monitus, oraculorum praescita, haruspicum praedicta atque etiam parua dictu in auguriis sternumenta et offensiones pedum. Diuus Augustus prodidit laeuum sibi calceum praepostere inductum quo die seditione militari prope adflictus est. Quae singula inprouidam mortalitatem inuoluunt, solum ut inter ista uel certum sit nihil esse certi nec quicquam miserius homine aut superbius ; ceteris quippe animantium sola uictus cura est, in quo sponte naturae benignitas sufficit, uno quidem uel praeferendo cunctis bonis, quod de gloria, de pecunia, ambitione superque de morte non cogitant.
Verum in his deos agere curam rerum humanarum credi ex usu uitae est, poenasque maleficiis aliquando seras, occupato deo in tanta mole, numquam autem inritas esse, nec ideo proximum illi genitum hominem, ut uilitate iuxta beluas esset. Inperfectae uero in homine naturae praecipua solatia, ne deum quidem posse omnia – namque nec sibi potest motem consciscere, si uelit, quod homini dedit optimum in tantis uitae poenis, nec mortales aeternitate donare aut reuocare defunctos, nec facere ut qui uixit non uixerit, qui honores gessit non gesserit – nullumque habere in praeterita ius praeterquem obliuionis atque (ut facetis quoque argumentis societas haec cum deo copuletur) ut bis dena uiginti non sunt aut multa similiter efficere non posse ; per quae declaratur haud dubie naturae potentia idque esse quod deum uocemus.
Pline l’Ancien,
Histoire naturelle, II, 22-27
(274 mots)
(1) Huic représente la Fortune.
Composition française
« Le théâtre de Musset nous propose des personnages dont le visage se dérobe. Les silhouettes nocturnes errant dans les jardins y côtoient les amants dissimulés dans l’ombre, les bourgeois déguisés en bouffons des princes travestis. Sur ce monde fictif le masque se déploie comme une figure obsédante. Il ordonne le temps car nombreux sont les êtres qui, pour courir les mascarades, « font de la nuit le jour ». Il occupe l’espace en y faisant surgir une multitude d’accessoires […]. Le masque modèle donc le visage du monde. »
En analysant ce jugement de Bernadette Bricourt, extrait d’un article de 1977, vous réfléchirez au rôle du masque, dans son acception la plus large, chez Musset dramaturge, grâce aux deux pièces inscrites au programme.
Thème latin
Il revint de son voyage dès le soir même, et dit qu’il avait reçu des lettres, dans le chemin, qui lui avaient appris que l’affaire pour laquelle il était parti venait d’être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu’elle put pour lui témoigner qu’elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui demanda les clefs, et elle les lui donna, mais d’une main si tremblante qu’il devina sans peine tout ce qui s’était passé. « D’où vient, lui dit-il, que la clef du cabinet n’est point avec les autres ? — Il faut, dit-elle, que je l’aie laissée là-haut sur ma table. — Ne manquez pas, dit la Barbe-Bleue, de me la donner tantôt. » Après plusieurs remises, il fallut apporter la clef. La Barbe-Bleue, l’ayant considérée, dit à sa femme : « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clef ? — Je n’en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. — Vous n’en savez rien ? reprit la Barbe-Bleue ; je le sais bien, moi ! Vous avez voulu entrer dans le cabinet ? Hé bien, Madame, vous y entrerez, et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. » Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d’un vrai repentir de n’avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était ; mais la Barbe-Bleue avait le cœur plus dur qu’un rocher. « Il faut mourir, Madame, lui dit-il, et tout à l’heure. — Puisqu’il faut mourir, répondit-elle, en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. — Je vous donne un demi-quart d’heure, reprit la Barbe-Bleue ; mais pas un moment davantage. » Lorsqu’elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit : « Ma sœur Anne (car elle s’appelait ainsi), monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point ; ils m’ont promis qu’ils me viendraient voir aujourd’hui, et si tu les vois, fais-leur signe de se hâter. » La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps : « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? »
Charles Perrault (1628-1703),
Histoires ou Contes du temps passé (1697), La Barbe bleue
(404 mots)
Thème grec
Je le répète encore ; l’art égyptien ne doit qu’à lui-même tout ce qu’il a produit de grand, de pur et de beau et, n’en déplaise aux savants qui se font une religion de croire fermement à la génération spontanée des arts en Grèce, il est évident pour moi, comme pour tous ceux qui ont bien vu l’Égypte ou qui ont une connaissance réelle des monuments égyptiens existant en Europe, que les arts ont commencé en Grèce par une imitation servile des arts de l’Égypte, beaucoup plus avancés qu’on ne le croit vulgairement, à l’époque où les premières colonies égyptiennes furent en contact avec les sauvages habitants de l’Attique ou du Péloponnèse.
La vieille Égypte enseigna les arts à la Grèce, celle-ci leur donna le développement le plus sublime, mais, sans l’Égypte, la Grèce ne serait probablement point devenue la terre classique des beaux-arts. Voilà ma profession de foi tout entière sur cette grande question. Je trace ces lignes presque en face des bas-reliefs (1) que les Égyptiens ont exécutés, avec la plus grande finesse de travail, mille sept cents ans avant l’ère chrétienne. Que faisaient les Grecs alors ?
Jean-François Champollion
(202 mots)
(1) Bas-relief : ἀναγλυφή, ῆς (ἡ).
Version latine
LA TRISTE CONDITION DES GRAMMAIRIENS
Quis gremio Celadi doctique Palaemonis (1) adfert
quantum grammaticus meruit labor ? Et tamen ex hoc
quodcumque est, minus est autem quam rhetoris aera,
discipuli custos praemordet acoenonoetus
et qui dispensat frangit sibi. Cede, Palaemon,
et patere inde aliquid decrescere, non aliter quam
institor hibernae tegetis niueique cadurci,
dummodo non pereat mediae quod noctis ab hora
sedisti, qua nemo faber, qua nemo sederet
qui docet obliquo lanam deducere ferro ;
dummodo non pereat totidem olfecisse lucernas
quot stabant pueri, cum totus decolor esset
Flaccus et haereret nigro fuligo Maroni.
Rara tamen merces quae cognitione tribuni
non egeat. Sed uos saeuas inponite leges,
ut praeceptori uerborum regula constet,
ut legat historias, auctores nouerit omnes
tamquam ungues digitosque suos, ut forte rogatus,
dum petit aut thermas aut Phoebi balnea, dicat
nutricem Anchisae, nomen patriamque nouercae
Anchemoli, dicat quot Acestes uixerit annis,
quot Siculi Phrygibus uini donauerit urnas ;
exigite ut mores teneros ceu pollice ducat,
ut si quis cera uoltum facit ; exigite ut sit
et pater ipsius coetus, ne turpia ludant,
ne faciant uicibus. — « Non est leue tot puerorum
obseruare manus oculosque in fine trementis. »
« Haec, inquit, cura, sed cum se uerterit annus,
accipe, uictori populus quod postulat, aurum. »
Juvénal,
Satires, 7, v. 215-243
(29 vers – 193 mots)
Celadus, i (m.) et Palaemon, onis (m.) sont des grammairiens.
Composition française
Pierre Clarac écrit, à propos de « la pensée de La Fontaine » :
« À cette pensée, « partout hôtesse passagère », assignerons-nous une demeure unique, fût-elle plus variée et plus vaste que le palais de Psyché ? La distinction, chère à Thibaudet, entre esprits du monologue et esprits du dialogue, aide peut-être à comprendre la liberté avec laquelle le papillon du Parnasse « va de fleur en fleur » et « vole à tout sujet ». À prêter l’oreille au dialogue des Fables, on croit y discerner bien des voix différentes et qui parfois se contredisent. »
Vous direz, en vous appuyant sur votre lecture des livres VII à XII des Fables, ce que vous pensez de ce jugement.
Thème latin
Le moment est venu d’apprendre ce latin, alors si terrible et si hérissé. On apprend les langues vivantes principalement par l’usage, par le commerce avec ceux qui les parlent bien ; il faut faire de même, autant qu’on le peut, pour les langues mortes, et les apprendre par la lecture de ceux qui ont bien parlé autrefois. Mais comme la lecture de ces morts est souvent elle-même froide et morte, et que le ton de leur voix est si bas et si difficile à entendre qu’il ne diffère guère du silence, ce serait un avantage incomparable de ressusciter en quelque sorte les auteurs, et de leur rendre le mouvement, l’action, l’accent, tout ce qui faisait la vie, afin qu’ils pussent nous enseigner d’une manière toute vivante et naturelle. Or, c’est ce qu’on obtient en traduisant les ouvrages de vive voix devant les enfants. La traduction, et la traduction vivante, animée et nuancée à chaque instant par le maître, la traduction parlée plutôt qu’écrite, telle est la méthode que Port-Royal substituait tout d’abord aux thèmes : « Car n’est-ce pas un ordre tout renversé et tout contraire à la nature, que de vouloir qu’on commence par écrire en une langue, laquelle non seulement on ne sait pas parler, mais même qu’on n’entend pas ? »
Le digne maître qui me sert de guide en ce moment ajoute des vues très ingénieuses sur les avantages de la traduction qui se fait de vive voix, opposée à celle qui se fait par écrit ; il appelle la première toute naturelle : et il estime que c’est le moyen le plus direct de faire pénétrer non seulement dans la justesse du sens, mais dans les mouvements du cœur qui s’y joignaient ; le seul moyen, en vérité, de faire cesser, autant qu’il se peut, cet inconvénient d’être aux prises avec une langue morte.
Charles-Augustin Sainte-Beuve,
Port-Royal
(324 mots)
Thème grec
DÉBAT DE FOLIE ET D’AMOUR (1)
FOLIE : « Je suis déesse, comme tu es dieu : mon nom est Folie. Je suis celle qui te fait grand et abaisse à mon plaisir. Tu lâches l’arc et jettes tes flèches en l’air : mais je les assois aux cœurs que je veux. Quand tu te penses plus grand qu’il est possible d’être, alors par quelque petit dépit je te range et remets avec le vulgaire. Tu t’adresses contre Jupiter : mais il est si puissant et grand que, si je ne dressais ta main, si je n’avais bien trempé ta flèche, tu n’aurais aucun pouvoir sur lui. Et quand toi seul ferais aimer, quelle serait ta gloire, si je ne faisais paraître cet amour par mille inventions ? Tu as fait aimer Jupiter : mais je l’ai fait transmuer en cygne, en taureau, en or, en aigle : en danger des plumassiers (2), des loups, des larrons et des chasseurs. […] Qu’eût-ce été, si Pâris n’eût fait autre chose qu’aimer Hélène ? Il était à Troie, l’autre à Sparte : ils n’avaient garde d’eux assembler. Ne lui fis-je dresser une armée de mer, aller chez Ménélas, faire la cour à sa femme, l’emmener par force, et puis défendre la querelle injuste contre toute la Grèce ? […] Tu n’as rien que le cœur, le demeurant est gouverné par moi. »
Louise Labé,
Débat de Folie et d’Amour
(233 mots)
(1) Traduire le titre.
(2) On traduira « plumassier » par « oiseleur » (ὁ ὀρνιθευτής, οῦ).
Version latine
DE DIEU
Nihil in homine membrorum est, quod non et necessitatis causa sit et decoris, et, quod magis mirum est, eadem figura omnibus, sed quaedam unicuique liniamenta deflexa : sic et similes uniuersi uidemur et inter se singuli dissimiles inuenimur. Quid nascendi ratio ? quid ? cupido generandi nonne a deo data est, et ut ubera partu maturescente lactescant et ut tener fetus ubertate lactei roris adolescat ? Nec uniuersitati solummodo deus, sed et partibus consulit. Britannia sole deficitur, sed circumfluentis maris tepore recreatur ; Aegypti siccitatem temperare Nilus amnis solet, Euphrates Mesopotamiam pro imbribus pensat, Indus flumen et serere orientem dicitur et rigare. Quod si ingressus aliquam domum omnia exculta, disposita, ornata uidisses, utique praeesse ei crederes dominum et illis bonis rebus multo esse meliorem ; ita in hac mundi domo, cum caelo terraque perspicias prouidentiam ordinem legem, crede esse uniuersitatis dominum parentemque ipsis sideribus et totius mundi partibus pulchriorem.
Ni forte, quoniam de prouidentia nulla dubitatio est, inquirendum putas, utrum unius imperio an arbitrio plurimorum caeleste regnum gubernetur ; quod ipsum non est multi laboris aperire cogitanti imperia terrena, quibus exempla utique de caelo. Quando umquam regni societas aut cum fide coepit aut sine cruore discessit ? Omitto Persas de equorum hinnitu augurantes principatum et Thebanorum par, mortuam fabulam, transeo. Ob pastorum et casae regnum de geminis memoria notissima est. Generi et soceri bella toto orbe diffusa sunt, et tam magni imperii duos fortuna non cepit. Vide cetera : rex unus apibus, dux unus in gregibus, in armentis rector unus. Tu in caelo summam potestatem diuidi credas et scindi ueri illius ac diuini imperii totam maiestatem, cum palam sit parentem omnium deum nec principium habere nec terminum, qui natiuitatem omnibus praestet, sibi perpetuitatem, qui ante mundum fuerit sibi ipse pro mundo ? Qui uniuersa, quaecumque sunt, uerbo iubet, ratione dispensat, uirtute consummat.
Hic non uideri potest : uisu clarior est ; nec conprehendi : tactu purior est ; nec aestimari : sensibus maior est, infinitus inmensus et soli sibi tantus, quantus est, notus. Nobis uero ad intellectum pectus angustum est, et ideo sic eum digne aestimamus, dum inaestimabilem dicimus. Eloquar quemadmodum sentio : magnitudinem dei qui se putat nosse minuit, qui non uult minuere, non nouit.
Minucius Félix,
Octavius, 18
(350 mots)
Composition française
En 1927, Valéry est à Grasse. Un matin, au lever du jour, il note dans ses Cahiers :
« À l’aurore. Ce cyprès offre. Cette maison dorée apparaît – que fait-elle ? Elle se construit à chaque instant. – Ces monts se soulèvent et ces arbres semblent offrir et attendre. Sous la lumière naissante, tout chante et les choses divisées de l’ombre désignant la direction du soleil sont à l’unisson… Comme je sens à cette heure… la profondeur de l’apparence (je ne sais l’exprimer) et c’est ceci qui est poésie. Quel étonnement muet que tout soit et que moi je sois. Ce que l’on voit alors prend valeur symbolique du total des choses. »
L’expérience ici rapportée éclaire-t-elle à vos yeux la « poésie » des œuvres de Valéry inscrites à votre programme ?
Thème latin
En attendant, il fit prévenir Mardouk qu’il monterait ce soir dans sa villa, après le dîner, si son ami voulait bien l’y accueillir. Après quoi, il fit introduire le Préfet Ménénius et lui expliqua le piège qu’il supposait que le Sanhédrin (1) tentait de refermer sur lui. Les prêtres cherchaient à lui faire endosser l’opprobre de la mort délibérée d’un innocent qui n’avait probablement que le tort de les avoir traités de sépulcres blanchis. L’image était vive, mais ne lui déplaisait pas. En tout cas, on en était désormais aux manifestations de rue. Convenait-il de céder ? Certes, c’était le plus simple, et cela ne coûtait rien que la vie d’un homme, alors qu’une émeute ferait davantage de morts. D’autre part, il était pénible, et sans doute à la longue dangereux, qu’on vît le pouvoir romain s’incliner à la première sommation d’une bande de fanatiques. En outre, le Messie était vénéré par une grande partie de la population rurale. Son exécution par les légionnaires n’apporterait à Rome qu’un surcroît de haine et, de la part des prêtres, vraisemblablement moins de reconnaissance qu’un constat de faiblesse qui ne sortirait pas de sitôt de leur mémoire. Qu’en pensait Ménénius, esprit politique, sagace, circonspect, en qui de longues années de service dans les terres périphériques avaient endormi beaucoup de sots scrupules en même temps qu’elles avaient déposé en lui une lente et précieuse expérience ?
— Seigneur, répondit-il, il faut sortir de l’impasse le plus vite possible. L’affaire est mal engagée. Nous sommes peu nombreux. Rome n’a pas cru devoir renforcer nos garnisons. Qu’une insurrection se produise et nous ne ferons pas de vieux os en Judée. Le plus sûr est d’exécuter le Galiléen. D’ailleurs, le libéreriez-vous qu’il serait très probablement écharpé par les manifestants. Ceci dit, je consens qu’il est fâcheux pour Rome d’être mêlée à l’affaire. La question est de sortir du guêpier, sans avoir l’air de prendre parti.
Roger Caillois,
Ponce Pilate, Paris, Éditions Gallimard, 1961
(347 mots)
Thème grec
Qui n’a lu de ces romans où, à cause d’un mot qu’on a omis, d’yeux qu’on a tenus baissés à un certain moment, deux cœurs qui s’aimaient se trouvent séparés pendant des années ? […]
Le Bengali fait son ordinaire de cet état. Il préfère accumuler tous les regrets, plutôt que d’intervenir trop vite. Quand ils ont le coup de foudre […], ils ne se retournent pas, ils ne sourient pas, ils ne font aucun signe, leurs paupières ne battent pas, ils sont seulement encore un peu plus lents que d’habitude et ils s’en vont. Quand alors il s’agit de retrouver l’apparition aimée, vous devinez comme c’est incommode. Ils ne s’informent pas. Non, ruminer leur plaît davantage. C’est la plénitude, le reste ne compte pas, ils perdront le goût du boire et du manger, mais ils ne feront rien. Il suffirait d’un mot pour empêcher quantité d’incompréhensions. Non, ils ne le diront pas. Ils préfèrent même le malheur […]. Il leur plaît de sentir la grande action du destin plutôt que leur petite action personnelle. Ils respirent sept fois avant de parler. Ils ne veulent pas de l’immédiat. Quand vous mettez une certaine distance entre vous et l’action, entre vous et vos gestes, pour peu que vous soyez d’un caractère hésitant, jamais plus vous n’arriverez à temps.
Henri Michaud,
Un barbare en Asie
(233 mots)
(1) Traduire « Bengali » par « Indien » (ὁ Ἰνδός, οῦ).
Version latine
RÉFLEXIONS SUR LE SENS DE LA VIE HUMAINE
Quid tam sollicitis uitam consumimus annis
torquemurque metu caecaque cupidine rerum
aeternisque senes curis, dum quaerimus aeuum
perdimus et nullo uotorum fine beati
uicturos agimus semper nec uiuimus umquam,
pauperiorque bonis quisque est, quia plura requirit
nec quod habet numerat, tantum quod non habet optat,
cumque sibi paruos usus natura reposcat
materiam struimus magnae per uota ruinae
luxuriamque lucris emimus luxuque rapinas,
et summum census pretium est effundere censum ?
Soluite, mortales, animos curasque leuate
totque superuacuis uitam deplete querellis.
Fata regunt orbem, certa stant omnia lege
longaque per certos signantur tempora casus.
Nascentes morimur, finisque ab origine pendet.
Hinc et opes et regna fluunt et saepius orta
paupertas, artesque datae moresque creatis
et uitia et laudes, damna et compendia rerum.
Nemo carere dato poterit nec habere negatum
fortunamue suis inuitam prendere uotis
aut fugere instantem : sors est sua cuique ferenda.
An, nisi fata darent leges uitaeque necisque,
fugissent ignes Aenean, Troia sub uno
non euersa uiro fatis uicisset in ipsis ?
Aut lupa proiectos nutrisset Martia fratres,
Roma casis enata foret, pecudumque magistri
in Capitolinos duxissent fulmina montes,
includiue sua potuisset Iuppiter arce,
captus et a captis orbis foret ? Igne sepulto
uulneribus uictor repetisset Mucius urbem,
solus et oppositis clausisset Horatius armis
pontem urbemque simul, rupisset foedera uirgo,
tresque sub unius fratres uirtute iacerent ?
Nulla acies tantum uicit : pendebat ab uno
Roma uiro regnumque orbis sortita iacebat.
Manilius,
Les Astronomiques, IV, v. 1-36
(36 vers – 226 mots)
Corrigé de Jacqueline Dangel disponible sur Persée
Session 1994
Composition française
Saluant la publication de Voyage au bout de la nuit, Bernanos parle de « ce langage inouï, comble du naturel et de l’artifice, inventé, créé de toutes pièces à l’exemple de celui de la tragédie, aussi loin que possible d’une reproduction servile du langage des misérables, mais fait justement pour exprimer ce que le langage des misérables ne saura jamais exprimer, leur âme puérile et sombre, la sombre enfance des misérables ».
Que pensez-vous de ce jugement ?
Thème latin
LETTRE DE PASCAL À FERMAT
[Fin mai 1660, Pascal, souffrant, était allé en Auvergne, à Bienassis et aux eaux de Bourbon. Le mathématicien Fermat, qui, pas plus que lui, « n’était en santé », vient de lui écrire de Toulouse pour lui proposer une rencontre à mi-chemin entre cette ville et Clermont-Ferrand, une rencontre au sommet entre « géomètres » : mais la géométrie vaut-elle qu’on fasse pour elle un seul pas ?] (1)
De Bianassis, le 10 août 1660
Monsieur,
Vous êtes le plus galant homme du monde, et je suis assurément un de ceux qui sais [sic] le mieux reconnaître ces qualités-là et les admirer infiniment, surtout quand elles sont jointes aux talents qui se trouvent singulièrement en vous : tout cela m’oblige à vous témoigner de ma main ma reconnaissance pour l’offre que vous me faites, quelque peine que j’aie encore d’écrire et de lire moi-même ; mais l’honneur que vous me faites m’est si cher, que je ne puis trop me hâter d’y répondre. Je vous dirai donc, monsieur, que, si j’étais en santé, je serais volé à Toulouse, et que je n’aurais pas souffert qu’un homme comme vous eût fait un pas pour un homme comme moi. Je vous dirai aussi que, quoique vous soyez celui de toute l’Europe que je tiens pour le plus grand géomètre, ce ne serait pas cette qualité-là qui m’aurait attiré ; mais que je me figure tant d’esprit et d’honnêteté en votre conversation, que c’est pour cela que je vous rechercherais. Car pour vous parler franchement de la géométrie, je la trouve le plus haut exercice de l’esprit ; mais en même temps je la connais pour si inutile, que je fais peu de différence entre un homme qui n’est que géomètre et un habile artisan. Aussi je l’appelle le plus beau métier du monde ; mais enfin ce n’est qu’un métier ; et j’ai dit souvent qu’elle est bonne pour faire l’essai, mais non pas l’emploi de notre force : de sorte que je ne ferais pas deux pas pour la géométrie, et je m’assure fort que vous êtes fort de mon humeur […].
Blaise Pascal,
Lettre à Fermat du 10 août 1660
(305 mots)
Thème grec
« Venons aux fléaux, aux inondations, aux volcans, aux tremblements de terre. Si vous ne considérez que ces calamités, si vous ne ramassez qu’un assemblage affreux de tous les accidents qui ont attaqué quelques roues de la machine de l’univers, Dieu est un tyran à vos yeux ; si vous faites attention à ses innombrables bienfaits, Dieu est un père. […]
Nous ne devons aller ni au-delà ni en deçà de la vérité : cette vérité est que, sur cent mille habitations, on en peut compter tout au plus une détruite chaque siècle par les feux nécessaires à la formation du globe.
Le feu est tellement nécessaire à l’univers entier que, sans lui, il n’y aurait ni animaux, ni végétaux, ni minéraux : il n’y aurait ni soleil ni étoiles dans l’espace. Ce feu, répandu sous la première écorce de la terre, obéit aux lois générales établies par Dieu même ; il est impossible qu’il n’en résulte pas quelques désastres particuliers : or on ne peut pas dire qu’un artisan soit un mauvais ouvrier quand une machine immense, formée par lui seul, subsiste depuis tant de siècles sans se déranger. Si un homme avait inventé une machine hydraulique qui arrosât toute une province et la rendît fertile, lui reprocheriez-vous que l’eau qu’il vous donnerait noyât quelques insectes ? »
Voltaire,
L’Histoire de Jenni ou le Sage et l’Athée
(223 mots)
Version latine
POURQUOI LA SCIENCE ET LE SUCCÈS SONT SOUVENT INCOMPATIBLES
Delphicus Apollo Socratem omnium sapientissimum Pythiae responsis est professus. Is autem memoratur prudenter doctissimeque dixisse, oportuisse hominum pectora fenestrata et aperta esse, uti non occultos haberent sensus sed patentes ad considerandum. Vtinam uero rerum natura sententiam eius secuta explicata et apparentia ea constituisset ! Si enim ita fuisset, non solum laudes aut uitia animorum ad manum aspicerentur, sed etiam disciplinarum scientiae, sub oculorum consideratione subiectae, non incertis iudiciis probarentur, sed et doctis et scientibus auctoritas egregia et stabilis adderetur. Igitur quoniam haec non ita sed uti natura rerum uoluit sunt constituta, non efficitur ut possint homines obscuratis sub pectoribus ingeniis scientias artificiorum penitus latentes quemadmodum sint iudicare, ipsique artifices pollicerentur suam prudentiam si non pecunia sint copiosi ; sed uetustate officinarum habuerint notitiam, aut etiam gratia forensi et eloquentia cum fuerint parati, pro industria studiorum auctoritates possunt habere, ut eis quod profitentur scire id crederetur. […]
Nec tamen est admirandum si propter ignotitiam artis uirtutes obscurantur, sed maxime indignandum, cum etiam saepe blandiatur gratia conuiuiorum a ueris iudiciis ad falsam probationem. Ergo, uti Socrati placuit, si ita sensus et sententiae scientiaeque disciplinis auctae perspicuae et perlucidae fuissent, non gratia neque ambitio ualeret, sed si qui ueris certisque laboribus doctrinarum peruenissent ad scientiam summam, eis ultro opera traderentur. Quoniam autem ea non sunt inlustria neque apparentia in aspectu, ut putamus oportuisse, et animaduerto potius indoctos quam doctos gratia superare, non esse certandum iudicans cum indoctis ambitione, potius hic praeceptis editis ostendam nostrae scientiae uirtutem.
Vitruve,
De l’architecture, III, Préface, 1 et 3
(240 mots)
Composition française
« Le roman qui a pour objet la peinture d’une époque présente cette époque dans sa complexité, de façon à donner une impression de vie multiple, de force inépuisable, d’un rythme de vie sociale qui déborde toute représentation individuelle, toute existence individuelle, et que l’on ne peut réduire au développement d’un organisme individuel sans le défaire ou le dénaturer. »
Réflexions sur le roman, p. 18, éd. Gallimard, 1938.
Cette réflexion d’Albert Thibaudet sur Les Misérables correspond-elle à votre analyse des livres au programme ?
Thème latin
SIMPLICITÉ ET FRUGALITÉ DES ANCIENS ROMAINS (1)
C’est ce que faisaient les Romains. Nourrir du bétail, labourer la terre, se dérober à eux-mêmes tout ce qu’ils pouvaient, vivre d’épargne et de travail : voilà quelle était leur vie ; c’est de quoi ils soutenaient leur famille, qu’ils accoutumaient à de semblables travaux.
Tite-Live a raison de dire qu’il n’y eut jamais de peuple où la frugalité, où l’épargne, où la pauvreté aient été plus longtemps en honneur. Les sénateurs les plus illustres, à n’en regarder que l’extérieur, différaient peu des paysans, et n’avaient d’éclat ni de majesté qu’en public et dans le sénat. Du reste, on les trouvait occupés du labourage et des autres soins de la vie rustique, quand on les allait quérir pour commander les armées. Ces exemples sont fréquents dans l’histoire romaine. Curius et Fabrice, ces grands capitaines qui vainquirent Pyrrhus, un roi si riche, n’avaient que de la vaisselle de terre, et le premier, à qui les Samnites en offraient d’or et d’argent, répondit que son plaisir n’était point d’en avoir, mais de commander à qui en avait. Après avoir triomphé, et avoir enrichi la république des dépouilles de ses ennemis, ils n’avaient pas de quoi se faire enterrer. Cette modération durait encore pendant les guerres puniques. Dans la première, on voit Régulus, général des armées romaines, demander son congé au sénat pour aller cultiver sa métairie abandonnée pendant son absence. Après la ruine de Carthage, on voit encore de grands exemples de la première simplicité. Æmilius Paulus, qui augmenta le trésor public par le riche trésor des rois de Macédoine, vivait selon les règles de l’ancienne frugalité, et mourut pauvre. Mummius, en ruinant Corinthe, ne profita que pour le public des richesses de cette ville opulente et voluptueuse. Ainsi les richesses étaient méprisées : la modération et l’innocence des généraux romains faisait l’admiration des peuples vaincus.
Jacques-Bénigne Bossuet,
Discours sur l’histoire universelle, Troisième partie, Chapitre 6
(326 mots)
(1) Traduire le titre.
(2) À savoir : « Ne fonder sa subsistance que sur son industrie et sur son travail. »
Thème grec
Comme il n’y a pas d’apparence qu’âgé comme je suis de plus de soixante et trois ans et accablé de beaucoup d’infirmités, ma course puisse être encore fort longue, le public trouvera bon que je prenne congé de lui dans les formes et que je le remercie de la bonté qu’il a eue d’acheter tant de fois des ouvrages si peu dignes de son admiration. Je ne saurais attribuer un si heureux succès qu’au soin que j’ai pris de me conformer toujours à ses sentiments et d’attraper, autant qu’il m’a été possible, son goût en toutes choses. C’est effectivement à quoi il me semble que les écrivains ne sauraient trop s’étudier. Un ouvrage a beau être approuvé d’un petit nombre de connaisseurs, s’il n’est plein d’un certain agrément et d’un certain sel propre à piquer le goût général des hommes, il ne passera jamais pour un bon ouvrage, et il faudra à la fin que les connaisseurs eux-mêmes avouent qu’ils se sont trompés en lui donnant leur approbation. Si on me demande ce que c’est que cet agrément et ce sel, je répondrai que c’est un je ne sais quoi qu’on peut beaucoup mieux sentir que dire. À mon avis néanmoins, il consiste principalement à ne jamais présenter au lecteur que des pensées vraies et des expressions justes.
Nicolas Boileau,
Préface pour l’édition de ses œuvres (1701)
(241 mots)
Version latine
ORPHÉE CHANTE HERCULE
Otia sopitis ageret cum cantibus Orpheus
neglectumque diu deposuisset opus,
lugebant erepta sibi solatia Nymphae,
quaerebant dulces flumina maesta modos.
Saeua feris natura redit metuensque leonem
inplorat citharae uacca tacentis opem ;
illius et duri fleuere silentia montes
siluaque Bistoniam saepe secuta chelym.
Sed postquam Inachiis Alcides missus ab Argis
Thracia pacifero contigit arua pede
diraque sanguinei uertit praesepia regis
et Diomedeos gramine pauit equos,
tunc patriae festo laetatus tempore uates
desuetae repetit fila canora lyrae
et resides leui modulatus pectine neruos
pollice festiuo nobile duxit ebur.
Vix auditus erat : uenti frenantur et undae,
pigrior astrictis torpuit Hebrus aquis,
porrexit R<h>odope sitientes carmina rupes,
excussit gelidas pronior Ossa niues.
Ardua nudato descendit populus Haemo
et comitem quercum pinus amica trahit,
Cirrhaeasque dei quamuis despexerit artes,
Orpheis laurus uocibus acta uenit.
Securum blandi leporem fouere Molossi
uicinumque lupo praebuit agna latus ;
concordes uaria ludunt cum tigride dammae,
Massylam cerui non timuere iubam.
Ille nouercales stimulos actusque canebat
Herculis et forti monstra subacta manu ;
qui timidae matri pressos ostenderit angues
intrepidusque fero riserit ore puer.
Claudien,
Le Rapt de Proserpine, II, Préface, v. 1-32
(174 mots)
Composition française
Selon Jacques Scherer (1), dans la dramaturgie de Racine…, « la tension des mécanismes du drame est poussée aussi loin que le permet leur précision. Il ne suffit pas de dire, comme on l’a souvent fait, que Racine applique aisément et sans effort les préceptes d’une esthétique que son temps considère comme efficace. Il pousse cette esthétique à ses limites, il la somme de multiplier ses tours et ses prestiges au-delà du raisonnable. La dramaturgie classique pouvait être, et a parfois été, équilibre, sérénité, raison. Par une inversion perverse, Racine en fait un instrument de torture. Le paradoxe de la cérémonie est que cette dynamisation forcenée, loin de donner des résultats grinçants où l’énergie paraît se vanter et qu’on appellera plus tard, souvent pour les critiquer de façon fort injuste, baroques ou romantiques, revêt au contraire les aspects d’une célébration paisible et d’autant plus puissante que ses redoutables ressorts sont mieux dissimulés ».
Dans quelle mesure, à votre avis, cette analyse convient-elle à Britannicus, Bérénice et Mithridate ?
(1) Scherer (J.), Racine et/ou la cérémonie, Paris, P.U.F., 1982, p. 78-79.
LE GRAND MALHEUR DES PHILOSOPHIES (1)
SOCRATE. — Ô Phèdre, tu n’es pas sans avoir remarqué dans les discours les plus importants, qu’il s’agisse de politique ou des intérêts particuliers des citoyens, ou encore dans les paroles délicates que l’on doit dire à un amant, lorsque les circonstances sont décisives, – tu as certainement remarqué quel poids et quelle portée prennent les moindres petits mots et les moindres silences qui s’y insèrent. Et moi, qui ai tant parlé, avec le désir insatiable de convaincre, je me suis moi-même à la longue convaincu que les plus graves arguments et les démonstrations les mieux conduites avaient bien peu d’effet, sans le secours de ces détails insignifiants en apparence ; et que, par contre, des raisons médiocres, convenablement suspendues à des paroles pleines de tact, ou dorées comme des couronnes, séduisent pour longtemps les oreilles. Ces entremetteuses sont aux portes de l’esprit. Elles lui répètent ce qui leur plaît, elles le lui redisent à plaisir, finissant par lui faire croire qu’il entend sa propre voix. Le réel d’un discours, c’est après tout cette chanson, et cette couleur d’une voix, que nous traitons à tort comme détails et accidents. […] Considère aussi la médecine. Le plus habile opérateur du monde, qui met ses doigts industrieux dans ta plaie, si légères que soient ses mains, si savantes, si clairvoyantes soient-elles ; pour sûr qu’il se sente de la situation des organes et des veines, de leurs rapports et de leurs profondeurs ; quelle que soit aussi sa certitude des actes qu’il se propose d’accomplir dans ta chair, des choses à retrancher et des choses à rejoindre ; si par quelque circonstance dont il ne s’est pas préoccupé, un fil, une aiguille dont il se sert, un rien qui dans son opération lui est utile, n’est point exactement pur, ou suffisamment purifié, il te tue. Te voilà mort… […] Te voilà mort, guéri selon toutes les règles ; car toutes les exigences de l’art et de l’opportunité étant satisfaites, la pensée contemple son œuvre avec amour. – Mais tu es mort. Un brin de soie mal préparé a rendu le savoir assassin ; ce plus mince des détails a fait échouer l’œuvre d’Esculape et d’Athéna. Il en est ainsi dans tous les domaines, à l’exception de celui des philosophes, dont c’est le grand malheur qu’ils ne voient jamais s’écrouler les univers qu’ils imaginent, puisque enfin ils n’existent pas.
Paul Valéry,
Eupalinos ou l’Architecte
(418 mots)
(1) Traduire le titre.
Thème grec
DE L’ÉTUDE DE LA LANGUE GRECQUE (1)
Par où les Romains vinrent-ils à bout de conduire tous les arts, et la langue latine même, à ce point de perfection où l’on sait qu’ils furent amenés du temps d’Auguste, et par là de procurer à leur empire une gloire non moins solide ni moins durable que celle de leurs conquêtes ? Ce fut par l’étude de la langue grecque. […]
Il en sera de même dans tous les siècles. Quiconque aspirera à la réputation de savant sera obligé de voyager, pour ainsi dire, longtemps chez les Grecs. La Grèce a toujours été et sera toujours la source du bon goût. C’est là qu’il faut puiser toutes les connaissances si l’on veut remonter jusqu’à leur origine. Éloquence, poésie, histoire, philosophie, médecine, c’est dans la Grèce que toutes ces sciences et tous ces arts se sont formés et pour la plupart perfectionnés : et c’est là qu’il faut les aller chercher.
Il n’y aurait qu’une chose que l’on pourrait opposer à ce sentiment, qui serait de dire que le secours des traductions nous met en état de nous passer des originaux. Mais je ne crois pas que cette réponse puisse contenter aucun esprit raisonnable.
Car premièrement, pour ce qui regarde le goût, y a-t-il quelque version, surtout parmi celles qui sont latines, qui rende tout l’agrément et toute la délicatesse des auteurs grecs ? Est-il même possible, principalement quand il s’agit d’un ouvrage de longue haleine, qu’un interprète y fasse passer toutes les beautés de son auteur ? Et n’y trouvera-t-on pas toujours un grand nombre des plus belles pensées affaiblies, tronquées, défigurées ? De telles copies, dénuées d’âme et de vie, ne ressemblent pas plus aux originaux qu’un squelette décharné à un corps vivant.
Charles Rollin,
De la manière d’enseigner et d’étudier les belles-lettres (1725)
(313 mots)
(1) Traduire le titre.
Version latine
PLAIDOYER D’UN PHILOSOPHE EN FAVEUR DE SON ŒUVRE
Sin autem dei neque possunt nos iuuare nec uolunt nec omnino curant nec quid agamus animaduertunt, nec est quod ab iis ad hominum uitam permanare possit, quid est quod ullos deis immortalibus cultus, honores, preces adhibeamus ? In specie autem fictae simulationis, sicut reliquae uirtutes, item pietas inesse non potest, cum qua simul sanctitatem et religionem tolli necesse est ; quibus sublatis perturbatio uitae sequitur et magna confusio. Atque haud scio an pietate aduersus deos sublata fides etiam et societas generis humani et una excellentissuma uirtus iustitia tollatur. Sunt autem alii philosophi, et ii quidem magni atque nobiles, qui deorum mente atque ratione omnem mundum administrari et regi censeant, neque uero id solum, sed etiam ab isdem hominum uitae consuli et prouideri. Nam et fruges et reliqua quae terra pariat et tempestates ac temporum uarietates caelique mutationes, quibus omnia quae terra gignat maturata pubescant, a dis immortalibus tribui generi humano putant, multaque quae dicentur in his libris colligunt, quae talia sunt ut ea ipsa dei immortales ad usum hominum fabricati paene uideantur. Contra quos Carneades ita multa disseruit ut excitaret homines non socordes ad ueri inuestigandi cupiditatem. Res enim nulla est, de qua tantopere non solum indocti, sed etiam docti dissentiant. Quorum opiniones cum tam uariae sint tamque inter se dissidentes, alterum fieri profecto potest, ut earum nulla, alterum certe non potest, ut plus una uera sit.
Qua quidem in causa et beniuolos obiurgatores placare et inuidos uituperatores confutare possumus, ut alteros reprehendisse paeniteat, alteri didicisse se gaudeant ; nam qui admonent amice docendi sunt, qui inimice sectantur repellendi. Multum autem fluxisse uideo de libris nostris, quos compluris breui tempore edidimus, uariumque sermonem partim admirantium unde hoc philosophandi nobis subito studium extitisset, partim quid quaque de re certi haberemus scire cupientium. Multis etiam sensi mirabile uideri eam nobis potissimum probatam esse philosophiam, quae lucem eriperet et quasi noctem quandam rebus offunderet, desertaeque disciplinae et iam pridem relictae patrocinium necopinatum a nobis esse susceptum. Nos autem nec subito coepimus philosophari nec mediocrem a primo tempore aetatis in eo studio operam curamque consumpsimus et, cum minime uidebamur, tum maxime philosophabamur.
Cicéron,
La Nature des dieux, I, 3-6
(345 mots)
Composition française
« Le bonheur est ce qu’il y a de plus difficile à communiquer, dans la mesure où le bonheur est précisément une sorte de silence, d’absence d’illusion, de légèreté immatérielle, dans la mesure où être heureux est le seul état injustifiable de l’homme, dans la mesure enfin où le bonheur peut se définir mieux par ce qu’il n’est pas, que par ce qu’il est. » (1)
Dans quelle mesure, à votre avis, ce propos de Claude Roy rend-il compte des intentions et de l’écriture de Stendhal dans La Chartreuse de Parme ?
(1) Claude Roy, Stendhal par lui-même, éd. du Seuil, coll. « Écrivains de toujours », 1951, p. 55 dans l’éd. de 1962.
Thème latin
UN EXPLOIT ÉTONNANT (1)
Tarquin projette d’ajouter de nouveaux corps de cavalerie à ceux que Romulus avait formés. Un augure lui soutient que toute innovation dans cette milice est sacrilège, si les dieux ne l’ont autorisée. Choqué de la liberté de ce prêtre, et résolu de le confondre et de décrier en sa personne un art qui croisait son autorité, Tarquin le fait appeler sur la place publique, et lui dit : « Devin, ce que je pense est-il possible ? Si ta science est telle que tu la vantes, elle te met en état de répondre. » L’augure ne se déconcerte point, consulte les oiseaux et répond : « Oui, prince, ce que tu penses se peut faire. » Lors, Tarquin tirant un rasoir de dessous sa robe, et prenant à la main un caillou : « Approche, dit-il au devin, coupe-moi ce caillou avec ce rasoir ; car j’ai pensé que cela se pouvait. » Navius, c’est le nom de l’augure, se tourne vers le peuple, et dit avec assurance : « Qu’on applique le rasoir au caillou, et qu’on me traîne au supplice, s’il n’est divisé sur-le-champ. » L’on vit en effet, contre toute attente, la dureté du caillou céder au tranchant du rasoir : ses parties se séparent si promptement, que le rasoir porte sur la main de Tarquin, et en tire du sang. Le peuple étonné fait des acclamations ; Tarquin renonce à ses projets, et se déclare protecteur des augures ; on enferme sous un autel le rasoir et les fragments du caillou. On élève une statue au devin : cette statue subsistait encore sous le règne d’Auguste ; et l’antiquité profane et sacrée nous atteste la vérité de ce fait, dans les écrits de Lactance, de Denys d’Halicarnasse, et de saint Augustin.
Denis Diderot,
Pensées philosophiques, chapitre 47
(298 mots)
(1) Traduire le titre.
Thème grec
Lorsque j’arrivai à Paris, je les trouvai échauffés sur une dispute la plus mince qui se puisse imaginer : il s’agissait de la réputation d’un vieux poète grec dont, depuis deux mille ans, on ignore la patrie, aussi bien que le temps de sa mort. Les deux partis avouaient que c’était un poète excellent : il n’était question que du plus ou du moins de mérite qu’il fallait lui attribuer. Chacun en voulait donner le taux : mais parmi ces distributeurs de réputation, les uns faisaient meilleur poids que les autres : voilà la querelle. Elle était bien vive, car on se disait cordialement, de part et d’autre des injures si grossières, on faisait des plaisanteries si amères, que je n’admirais pas moins la manière de disputer que le sujet de la dispute. Si quelqu’un, disais-je en moi-même, était assez étourdi pour aller, devant un de ces défenseurs du poète grec, attaquer la réputation de quelque honnête citoyen, il ne serait pas mal relevé ! et je crois que ce zèle, si délicat sur la réputation des morts, s’embraserait bien pour défendre celle des vivants ! Mais quoi qu’il en soit, ajoutais-je, Dieu me garde de m’attirer jamais l’inimitié des censeurs de ce poète, que le séjour de deux mille ans dans le tombeau n’a pu garantir d’une haine si implacable ! Ils frappent à présent des coups en l’air : mais que serait-ce, si leur fureur était animée par la présence d’un ennemi ?
Montesquieu,
Lettres persanes
(257 mots)
Version latine
LA POÉSIE CONFÈRE UNE GLOIRE IMMORTELLE
Quid mihi, Liuor edax, ignauos obicis annos,
ingeniique uocas carmen inertis opus,
non me more patrum, dum strenua sustinet aetas,
praemia militiae puluerulenta sequi
nec me uerbosas leges ediscere nec me
ingrato uocem prostituisse foro ?
Mortale est, quod quaeris, opus ; mihi fama perennis
quaeritur, in toto semper ut orbe canar.
Viuet Maeonides, Tenedos dum stabit et Ide,
dum rapidas Simois in mare uoluet aquas.
Viuet et Ascraeus, dum mustis uua tumebit,
dum cadet incurua falce resecta Ceres.
Battiades semper toto cantabitur orbe,
quamuis ingenio non ualet, arte ualet ;
nulla Sophocleo ueniet iactura cothurno.
Cum sole et luna semper Aratus erit.
Dum fallax seruus, durus pater, inproba lena
uiuent et meretrix blanda, Menandros erit.
Ennius arte carens animosique Accius oris
casurum nullo tempore nomen habent.
Varronem primamque ratem quae nesciet aetas,
aureaque Aesonio terga petita duci ?
Carmina sublimis tunc sunt peritura Lucreti,
exitio terras cum dabit una dies.
Tityrus et segetes Aeneiaque arma legentur,
Roma triumphati dum caput orbis erit.
Donec erunt ignes arcusque Cupidinis arma,
discentur numeri, culte Tibulle, tui ;
Gallus et Hesperiis et Gallus notus Eois,
et sua cum Gallo nota Lycoris erit.
Ergo cum silices, cum dens patientis aratri
depereant aeuo, carmina morte carent.
Cedant carminibus reges regumque triumphi,
cedat et auriferi ripa benigna Tagi.
Vilia miretur uolgus ; mihi flauus Apollo
pocula Castalia plena ministret aqua,
sustineamque coma metuentem frigora myrtum
atque ita sollicito multus amante legar !
Ovide,
Amours, I, 15, v. 1-38
(38 vers – 229 mots)
Composition française
« Pour répondre aux postulations de l’esprit nervalien, le fantastique ne devait pas seulement prendre en charge, à travers des personnages de fiction, les conflits, les manques et les contradictions du scripteur – phénomène habituel dans les œuvres fantastiques, et qui est sans doute la clé de leur réussite ; il aurait fallu de surcroît qu’il offrît à ces conflits une voie de résolution, une structure d’accord et d’unification. Mais ces deux conditions ne sont-elles pas contradictoires ? Une structure unifiante, conciliant les oppositions et par là rassurante pour l’esprit, correspond à une orientation inverse de celle du fantastique, qui tend toujours à lézarder la surface tranquille des apparences : sous le monde stable régi par des lois intelligibles surgît l’inconnaissable, l’inquiétante étrangeté, vestige inintelligible d’un passé ou d’un ailleurs déplacés. »
Cette analyse d’un critique actuel vous paraît-elle éclairer la lecture des œuvres de Gérard de Nerval au programme ?
Thème latin
LA DIFFÉRENCE DES SEXES ET LA MORALE (1)
Voulez-vous donc connaître les hommes ? Étudiez les femmes. Cette maxime est générale, et jusque-là tout le monde sera d’accord avec moi. Mais si j’ajoute qu’il n’y point de bonnes mœurs pour les femmes hors d’une vie retirée et domestique ; si je dis que les paisibles soins de la famille et du ménage sont leur partage, que la dignité de leur sexe est dans sa modestie, que la honte et la pudeur sont en elles inséparables de l’honnêteté, que rechercher les regards des hommes c’est déjà s’en laisser corrompre, et que toute femme qui se montre se déshonore, à l’instant va s’élever contre moi cette philosophie d’un jour qui naît et meurt dans le coin d’une grande ville, et veut étouffer de là le cri de la Nature et la voix unanime du genre humain.
Préjuges populaires ! me crie-t-on. Petites erreurs de l’enfance ! Tromperie des lois et de l’éducation ! La pudeur n’est rien. Elle n’est qu’une invention des lois sociales pour mettre à couvert les droits des pères et des époux, et maintenir quelque ordre dans les familles. Pourquoi rougirions-nous des besoins que nous donna la Nature ? […] Pourquoi, les désirs étant égaux des deux parts, les démonstrations en seraient-elles différentes ? Pourquoi l’un des sexes se refuserait-il plus que l’autre aux penchants qui leur sont communs ? Pourquoi l’homme aurait-il sur ce point d’autres lois que les animaux ?
Tes pourquoi, dit le dieu, ne finiraient jamais. Mais n’est pas à l’homme, c’est à son auteur qu’il les faut adresser.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),
Lettre à M. d’Alembert
(286 mots)
(1) Traduire le titre.
Thème grec
FAUT-IL REPRÉSENTER DES SCÈNES VIOLENTES AU THÉÂTRE ? (1)
Je vous répondrai qu’il faut être conséquent, et que, quand on se révolte contre ce spectacle, il ne faut pas souffrir qu’Œdipe se montre avec ses yeux crevés, et qu’il faut chasser de la scène Philoctète tourmenté de sa blessure et exhalant sa douleur par des cris inarticulés. Les anciens avaient, ce me semble, une autre idée de la tragédie que nous, et ces anciens-là, c’étaient les Grecs, c’étaient les Athéniens, ce peuple si délicat, qui nous a laissé en tout genre des modèles que les autres nations n’ont point encore égalés. Eschyle, Sophocle, Euripide ne veillaient pas des années entières pour ne produire que de ces petites impressions passagères qui se dissipent dans la gaieté d’un souper. Ils voulaient profondément attrister sur le sort de ces malheureux ; ils voulaient, non pas amuser seulement leurs contemporains, mais les rendre meilleurs. Avaient-ils tort ? Avaient-ils raison ? Pour cet effet, ils faisaient courir sur la scène les Euménides suivant la trace du parricide, et conduites par la vapeur du sang qui frappait leur odorat. Ils avaient trop de jugement pour applaudir à ces imbroglios, à ces escamotages de poignards qui ne sont bons que pour des enfants.
Denis Diderot,
Paradoxe sur le comédien
(212 mots)
(1) Le titre doit être traduit.
Version latine
LE SAGE STOÏCIEN
Nuper, cum incidisset mentio M. Catonis, indigne ferebas (1), sicut es iniquitatis impatiens, quod Catonem aetas sua parum intellexisset, quod supra Pompeios et Caeseres surgentem infra Vatinios posuisset, et tibi indignum uidebatur quod illi dissuasuro legem toga in foro esset erepta quodque, a Rostris usque ad Arcum Fabianum per seditiosae factionis manus traditus, uoces improbas et sputa et omnes alias insanae multitudinis contumelias pertulisset. Tum ego respondi habere te quod rei publicae nomine mouereris, quam hinc P. Claudius, hinc Vatinius ac pessimus quisque uenundabat et, caeca cupiditate correpti, non intellegabant se, dum uendunt, et uenire ; pro ipso quidem Catone securum te esse iussi : nullum enim sapientem nec iniuriam accipere nec contumeliam posse, Catonem autem certius exemplar sapientis uiri nobis deos immortales dedisse quam Ulixen et Herculem prioribus saeculis. Hos enim Stoici nostri sapientes pronuntiauerunt, inuictos laboribus et contemptores uoluptatis et uictores omnium terrorum. Cato non cum feris manus contulit, quas consectari uenatoris agrestisque est, nec monstra igne ac ferro persecutus est, nec in ea tempore incidit quibus credi posset caelum umeris unius inniti, excussa iam antiqua credulitate et saeculo ad summam perducto sollertiam. Cum ambitu congressus, multiformi malo, et cum potentiae immensa cupiditate, quam totus orbis in tres diuisus satiare non poterat, aduersus uitia ciuitatis degenerantis et pessum sua mole sidentis stetit solus, et cadentem rem publicam, quantum modo una retrahi manu poterat, tenuit, donec abstractus comitem se diu sustentatae ruinae dedit simulque exstincta sunt quae nefas erat diuidi : neque enim Cato post libertatem uixit, nec libertas post Catonem. Huic tu putas iniuriam fieri potuisse a populo, quod aut praeturam illi detraxit aut togam, quod sacrum illud caput purgamentis oris aspersit ? Tutus est sapiens, nec ulla affici aut iniuria aut contumelia potest.
Videor mihi intueri animum tuum incensum et efferuescentem. Paras acclamare : « Haec sunt quae auctoritatem praeceptis uestris detrahant : magna promittitis et quae ne optari quidem, nedum credi possint ; deinde, ingentia locuti, cum pauperem negastis esse sapientem, non negatis solere illi et seruum et tectum et cibum deesse ; cum sapientem negastis insanire, non negatis et alienari et parum sana uerba emittere et quicquid uis morbi cogit audere ; cum sapientem negastis seruum esse, idem non itis infitias et ueniturum et imperata facturum et domino suo seruilia praestaturum ministeria… »
(1) Sénèque s’adresse à Sérénus.
Sénèque le Jeune,
De la constance du sage, II, 1, 3 – 3, 1
(365 mots)
Session 1999
Composition française
André Malraux écrivait en 1958, en préface à une édition des Liaisons dangereuses :
« Les personnages significatifs de Laclos […] imitent leur propre personnage. Fait nouveau en littérature : ils se conçoivent […]. Les deux personnages essentiels agissent avec d’autant plus de virulence qu’ils le font à deux degrés, sous leur image mythique et leur image vivante ; celle-ci devenant son modèle en action, confronté à la vie, incarné ; l’œuvre d’art bénéficiant à la fois de la méthode nécessaire à cette image incarnée pour agir, et du prestige permanent de l’image mythique. Comme le destin de tous les personnages des Liaisons est, à des degrés divers, gouverné par ces deux-là, ils ont exactement une situation de démiurges, ils sont descendus de l’Olympe de l’intelligence pour tromper des mortels. […]
Mais si le rêve de Laclos est mythologique, son roman ne l’est pas. […] La matière des Liaisons […] est la plus opposée au mythe : celle d’une expérience humaine. Et nous sentons bien que c’est dans le rapport entre les deux domaines du livre, entre sa mythologie et sa psychologie, que se cache le secret des Liaisons. »
Ces propos rejoignent-ils votre propre lecture du roman de Laclos au programme ?
Thème latin
LES ÉTHIOPIENS (1)
Les Éthiopiens, dont il était roi, étaient, selon Hérodote, les mieux faits de tous les hommes, et de la plus belle taille. […] Leurs rois étaient électifs, et ils mettaient sur le trône le plus grand et le plus fort. On peut juger de leur humeur par une action que nous raconte Hérodote. Lorsque Cambyse leur envoya, pour les surprendre, des ambassadeurs et des présents tels que les Perses les donnaient, de la pourpre, des bracelets d’or, et des compositions de parfums, ils se moquèrent de ses présents, où ils ne voyaient rien d’utile à la vie, aussi bien que de ses ambassadeurs, qu’ils prirent pour ce qu’ils étaient, c’est-à-dire pour des espions. Mais leur roi voulut aussi faire un présent à sa mode au roi de Perse ; et prenant en main un arc qu’un Perse eût à peine soutenu, loin de le pouvoir tirer, il le banda en présence des ambassadeurs, et leur dit : « Voici le conseil que le roi d’Éthiopie donne au roi de Perse. Quand les Perses se pourront servir aussi aisément que je viens de faire d’un arc de cette grandeur et de cette force, qu’ils viennent attaquer les Éthiopiens, et qu’ils amènent plus de troupes que n’en a Cambyse. En attendant, qu’ils rendent grâces aux dieux, qui n’ont pas mis dans le cœur des Éthiopiens le désir de s’étendre hors de leur pays. » Cela dit, il débanda l’arc, et le donna aux ambassadeurs. On ne peut dire quel eût été l’événement de la guerre. Cambyse, irrité de cette réponse, s’avança vers l’Éthiopie comme un insensé, sans ordre, sans convois, sans discipline, et vit périr son armée, faute de vivres, au milieu des sables, avant que d’approcher l’ennemi.
Jacques-Bénigne Bossuet,
Discours sur l’histoire universelle (1681), III, 3
(305 mots)
(1) Le titre doit être traduit.
Retrouvez un corrigé commenté de ce texte dans les 80 thèmes latins commentés de Petitmangin (thème n° 3).
Thème grec
THÉSÉE ÉVOQUE DES SOUVENIRS DE JEUNESSE (1)
Il ne suffit pas d’être, puis d’avoir été : il faut léguer et faire en sorte que l’on ne s’achève pas à soi-même […]. Pitthée, Égée étaient beaucoup plus intelligents que moi, comme l’est également Pirithoüs. Mais l’on me reconnaît du bon sens ; le reste vient ensuite, avec la volonté, qui ne m’a jamais quitté, de bien faire. M’habite aussi certain courage qui me pousse aux entreprises hardies. J’étais, de plus, ambitieux les hauts faits, que l’on me rapportait, de mon cousin Hercule, impatientaient ma jeunesse, et lorsque, de Trézène où j’avais vécu jusqu’alors, je dus rejoindre mon père putatif en Athènes, je ne voulus point écouter les conseils, pour sages qu’ils fussent, de m’embarquer, la route de la mer étant de beaucoup la plus sûre. Je le savais ; mais, à cause de ses dangers mêmes, c’est la route de terre, avec son immense détour, qui me tentait ; l’occasion d’y prouver ma valeur. Des brigands de tout poil recommençaient d’infester le pays et s’en donnaient à cœur joie depuis qu’Hercule s’efféminait aux pieds d’Omphale. J’avais seize ans. J’avais beau jeu. C’était mon tour. À grands bonds mon cœur s’élançait vers l’extrémité de ma joie. Qu’ai-je affaire de sécurité ! m’écriais-je, et d’un chemin tout nettoyé ! Je tenais en mépris le repos sans gloire, et le confort, et la paresse. C’est donc sur le chemin d’Athènes, par l’isthme du Péloponnèse, que je me mis d’abord à l’épreuve, que je pris connaissance à la fois de la force de mon bras et de mon cœur, en réduisant quelques noirs bandits avérés.
André Gide,
Thésée
(300 mots)
(1) Le titre doit être traduit.
Version latine
CORVINUS CONSEILLE AU CONSUL FLAMINIUS DE DIFFÉRER L’ENGAGEMENT DU LAC TRASIMÈNE
Atque hic (1), egregius linguae nomenque superbum,
Coruinus, Phoebea sedet cui casside fulua
ostentans ales proauitae insignia pugnae,
plenus et ipse deum et socium terrente pauore,
immiscet precibus monita atque his uocibus infit :
« Iliacas per te flammas Tarpeiaque saxa,
per patrios, consul, muros suspensaque nostrae
euentu pugnae natorum pignora, cedas
oramus superis tempusque ad proelia dextrum
opperiare : dabunt idem camposque diemque
pugnandi ; tantum ne dedignare secundos
expectare deos : cum fulserit hora, cruentam
quae stragem Libyae portet, tum signa sequentur
nulla uulsa manu, uescique interritus ales
gaudebit, nullosque uomet pia terra cruores.
An te praestantem belli fugit, improba quantum
hoc possit Fortuna loco ? Sedet obuius hostis
aduersa fronte, at circa nemorosa minantur
insidias iuga, nec laeua stagnantibus undis
effugium patet, et tenui stant tramite fauces.
Si certare dolis et bellum ducere cordi est,
interea rapidis aderit Seruilius armis,
cui par imperium et uires legionibus aequae.
Bellandum est astu. leuior laus in duce dextrae. »
Talia Coruinus, primoresque addere passim
orantum uerba, et diuisus quisque timore
nunc superos, ne Flaminio, nunc deinde precari
Flaminium, ne caelicolis contendere perstet.
Acrius hoc accensa ducis surrexerat ira,
auditoque furens socias non defore uires :
« Sicine nos, inquit, Boiorum in bella ruentes
spectastis, cum tanta lues uulgusque tremendum
ingrueret, rupesque iterum Tarpeia paueret ?
Quas ego tunc animas dextra, quae corpora fudi,
irata tellure sata et uix uulnere uitam
reddentis uno ! Iacuere ingentia membra
per campos magnisque premunt nunc ossibus arua.
Scilicet has sera ad laudes Seruilius arma
adiungat, nisi diuiso uicisse triumpho
ut nequeam et decoris contentus parte quiescam ? »
Silius Italicus,
La Guerre punique, V, v. 77-116
(40 vers – 250 mots)
(1) Corvinus est un descendant de Marcus Valérius Corvus qui sortit vainqueur d’un combat singulier contre un Gaulois grâce à l’aide d’un corbeau venu se pencher sur son casque.
Tous les sujets de l’Agrégation externe
de Lettres classiques (2000-2019) en livre papier

Rapports du jury et sujets 2004-2007
Rapports du jury et sujets 2008-2019
Session 2006
Thème latin
Damilaville, Encyclopédie, article « Paix »
Corrigé proposé par le jury
Ratione si homines gubernarentur, si imperio ei debito nationum duces (principes) submitterentur, belli furori (furoribus) eos se temere dedentes non videremus, neque ii ea ferocitate quae ferarum est uterentur. Qui, animo intenti sibi ad servandam eam tranquillitatem in qua vita beata tota ponitur, omnem facultatem aliorum turbandi non arriperent, et bonis natura omnibus eius liberis datis contenti, iis quae aliis populis tribuit non inviderent ; principes ipsi urbes populosque armis domitos, sanguine populorum suorum emptos, quanti constitissent tanti numquam valere sentirent. Nunc misero fato impulsae, nationes inter se mutua diffidentia utuntur, quae, ad aliorum coepta injusta repellenda vel ad sua fingenda semper intentae, e causis vel levissimis arma capiunt, ita ut commodis providentia vel industria (arte) sibi paratis se privari velle credas. Principes quoque, caecis libidinibus moti, adducuntur ut imperii sui fines extendant, qui, de commodis populorum suorum parum laborantes, de augendo numero hominum quos miseros efficiunt tantum curant. Ex eis autem libidinibus, ab ambitiosis ministris vel ducibus (vel iis qui bella gerere solent) quorum negotium otio repugnat, incensis vel alitis, omni tempore (omni in aetate) hominibus eventus (effectus) quam perniciosissimi orti sunt (facti sunt). In annalibus enim rerum gestarum, nulla exempla nisi pacis violatae (ruptae), iniustorum crudeliumque bellorum, agrorum vastatorum, urbium exustarum invenimus.
Session 2008
Version latine
Tite Live,
XXXVI, 39, 6 – 40, 10
Corrigé proposé par le jury
Le tribun de la plèbe P. Sempronius Blaesus exprimait l’opinion qu’il ne fallait pas refuser à Scipion l’honneur d’un triomphe, mais le renvoyer à plus tard : les guerres contre les Ligures avaient toujours été liées à celles menées contre les Gaulois ; ces peuples se prêtaient mutuellement secours l’un à l’autre, en raison de leur proximité géographique. Si P. Scipio, après avoir défait les Boiens en bataille rangée, était passé en personne en territoire ligure avec son armée victorieuse ou avait envoyé une partie de ses troupes à Q. Minucius, qu’une guerre à l’issue incertaine retenait là depuis deux ans, on aurait pu mettre un terme à la guerre contre les Ligures. Mais en fait on avait détourné de la guerre, pour augmenter le nombre des participants à un triomphe, des soldats qui auraient pu agir avec une remarquable efficacité au service de l’État, qui pouvaient même le faire encore si le sénat voulait remettre en vigueur, en différant le triomphe, une mesure que l’on avait négligé de prendre par empressement à le célébrer. Qu’ils donnassent au consul l’ordre de s’en retourner dans sa zone de compétence avec ses légions et de se consacrer à la soumission des Ligures. Si ceux-ci n’étaient pas contraints à passer sous la sujétion et la domination du peuple romain, même les Boiens ne se tiendraient pas en paix : il était inévitable d’avoir soit la paix, soit la guerre sur les deux fronts. Une fois les Ligures définitivement vaincus, P. Cornelius célébrerait le triomphe en qualité de proconsul dans quelques mois, à l’exemple de nombreux généraux qui n’ont pas célébré le triomphe pendant la période de leur magistrature.
En réponse à ces arguments, le consul déclare que ce n’est pas la Ligurie que le tirage au sort lui a attribuée comme zone de compétence, que ce n’est pas contre les Ligures qu’il a conduit la guerre et que ce n’est pas pour une victoire remportée sur eux qu’il sollicite un triomphe. Il est persuadé que Q. Minucius les soumettra rapidement, puis sollicitera et obtiendra un triomphe mérité. Pour lui, c’est sur les Gaulois Boiens qu’il sollicite un triomphe, pour les avoir vaincus en bataille rangée, privés de leur camp, avoir reçu en deux jours après le combat la soumission complète du peuple tout entier, leur avoir pris et emmené des otages en gage d’une paix future. Mais en fait, un point de loin plus important est qu’il a tué en bataille rangée un nombre de Gaulois supérieur aux milliers de Boiens (pour ce qui concernait cette tribu) qu’avant lui aucun général en chef n’avait affrontés. A été tuée plus de la moitié d’une armée de cinquante mille hommes, plusieurs milliers ont été faits prisonniers ; il ne reste aux Boiens que des vieillards et des enfants. Aussi quelqu’un peut-il s’étonner et se demander pourquoi une armée victorieuse est venue à Rome afin d’assister en foule au triomphe du consul, après n’avoir laissé aucun ennemi dans sa zone de commandement ? Et si le sénat veut utiliser les services de ces soldats dans une autre zone également, dans quelles conditions, enfin, croit-il que les soldats seront le plus disposés à affronter des nouveaux périls et des peines renouvelées : si on les a pleinement récompensés des périls et des peines encourus auparavant, sans faire d’objection, ou si les sénateurs les renvoient porteurs d’espérances en lieu et place de récompenses tangibles, après les avoir déçus une fois déjà dans leurs espérances premières ? De fait, en ce qui le concerne personnellement, il a acquis suffisamment de gloire pour toute sa vie le jour où le sénat l’avait envoyé recevoir la Mère de l’Ida, parce qu’il avait été jugé l’homme le plus vertueux. L’image funéraire de P. Scipio Nasica sera suffisamment honorée et illustrée par cette inscription, même si on n’y ajoute ni le consulat ni le triomphe.
Session 2009
Thème latin
Laclos, Discours des femmes et de leur éducation
Corrigé proposé par le jury
O mulieres ! Ad uerba mea audidienda/Verba quidem mea auditum adite et uenite ! Ad utilia autem, haud ut soletis (1), intentae, curiose considerate commoda quae uobis dederat natura eaque homines rapuerunt ! Acceptum enim uenite quomodo, quamquam uiris aequales ortae/natae (eratis), istorum tamen seruae factae sitis ; quodomo deinde uos, quae in istum ignobilem statum lapsae sitis, eo iam tandem delectemini atque eum uideatis uelut natura datum uestrum ; quomodo denique, quoniam, diu seruiendo adsuefactae, magis magisque deformatae estis, ex propriis seruitudinis rebus sordida at facilia uitia grauioribus liberi honestique alicuius uirtutibus praetuleritis. Quod si quae plane depinxi placide audietis ac sedate considerabitis, uacua negotia uestra iterum gerite quia nulla remedia malis uestris sunt et uitia in mores mutata. Sin autem in audiendis rebus aduersis damniisque uestris ob pudorem atque iram erubescetis (2), et propter obirationem ex oculis lacrimae profluent, et si insigni commodorum recuperandorum atque uos in condicionem integram restituendi studio flagrabitis, nolite iam falli eis rebus quas falso uiri polliciti sunt ! Nolite (3) quidem ex uiris auxilia aliqua ullo modo exspectare quippe qui malorum uestrorum artifices sint ! Quae tollere nec uolunt nec possunt : quid enim mulieres educare uellent ante quas erubescere cogerentur (4) ? Itaque hoc accipite, quod nullo alio modo nisi nouis rebus seruire desinitur/Scite non exiri e seruitute nisi…/Scite nullo modo e seruitute exiri posse nisi… . Illaene (nouae res) euenire possunt ? Vobis autem solis id dicendum est cum in animis uestris eae constent.
(1) ou primum pour dire « pour la première fois ».
(2) système éventuel (idem dans la phrase suivante), à mettre au futur ou au futur antérieur.
(3) la tournure par ne + subjonctif parfait est une autre solution.
(4) ou mulieres ob quas eis pudendum sit/esset ? (pudere étant le plus idiomatique et le plus opérant).
Version latine
Lucrèce,
De la nature des choses, II, v. 1122-1174
Corrigé proposé par le jury
De fait, tous les organismes que tu vois grandir en une joyeuse croissance et gravir peu à peu les échelons de l’âge adulte, s’incorporent davantage d’éléments qu’ils n’en émettent d’eux, aussi longtemps que la nourriture est reçue dans toutes leurs veines et qu’ils ne se sont pas si largement distendus qu’ils en rejettent en grand nombre et effectuent une dépense supérieure à ce que leur âge absorbe d’aliments. Car il faut en convenir en toute certitude : de nombreux éléments s’écoulent et se détachent des organismes ; mais il est nécessaire qu’une quantité supérieure vienne s’ajouter aux organismes jusqu’à ce qu’ils aient atteint le sommet absolu de leur croissance. Puis, par toutes petites étapes, l’âge diminue les forces et la résistance maximales atteintes et s’écoule dans un sens moins positif. C’est que, de fait, plus un organisme est considérable et plus il est étendu, plus, une fois interrompue sa croissance, il disperse partout, dans toutes les directions, et émet davantage d’éléments, les aliments ne se distribuent pas aisément dans toutes ses veines, et ils ne suffisent pas, par rapport au flot abondant qu’il expulse, à lui fournir de quoi se régénérer et se reconstituer. Il est donc normal que les organismes périssent, lorsqu’ils ont perdu leur densité du fait de l’écoulement, et que tous succombent aux chocs venus de l’extérieur, puisque justement, pour finir, la nourriture fait défaut au grand âge, et que les éléments, frappant de l’extérieur, accablent sans cesse tous les organismes et en viennent à bout, dans leur acharnement, à force de coups. C’est donc ainsi que les remparts qui ceignent le vaste univers, eux aussi, pris d’assaut, s’effondreront et tomberont en ruines pulvérulentes. En effet, il est nécessaire que les aliments assurent l’intégrité de tous les organismes en les renouvelant, que les aliments les réparent, que les aliments les maintiennent en état : en vain, puisque les veines n’en supportent plus une quantité suffisante, et que la nature ne fournit pas autant qu’il est besoin. Et voici qu’à présent notre époque est affaiblie et que la terre épuisée crée avec peine de petits êtres, elle qui a créé toutes les espèces et a enfanté les corps énormes des bêtes sauvages. Car ce n’est pas, selon moi, une corde d’or qui a fait descendre d’en haut dans nos terres, depuis le ciel, les espèces mortelles, ni la mer ni les flots battant les rochers qui les ont créées, mais ce qui leur a donné naissance, c’est la même terre qui à présent les nourrit de sa substance. En outre elle a d’abord créé elle-même, de son propre mouvement, les brillantes moissons, les vignes riantes, elle-même a donné les doux fruits de la terre et les grasses pâtures, qui, de nos jours poussent avec peine malgré nos efforts pour les faire croître. Et nous épuisons nos bœufs et les forces de nos paysans, nous y usons le fer, bien qu’à peine fournis du nécessaire par nos champs, tant ils donnent chichement leurs produits et augmentent notre peine. Et désormais, hochant la tête, le laboureur chargé d’ans soupire assez souvent que son immense effort n’a abouti à rien, et quand il compare le temps présent au temps passé, souvent il vante le bonheur de son père De même, le planteur d’une vigne vieillissante et flétrie s’en prend au passage du temps, incrimine son époque, et déplore la manière dont l’humanité des premiers temps, emplie de piété, a si aisément pourvu à son existence grâce à des terres de faible étendue, alors qu’autrefois la part de terre par tête était bien moindre. Et il oublie que, peu à peu, tous les organismes se corrompent et vont au tombeau, épuisés par la longue durée de leur existence.
Session 2011
Thème latin
Alain, Système des Beaux-Arts
Corrigé proposé par le jury
Tragicis rebus ut fatum intersit
Res adflictas tragoediae nobis adhibent quas quidem pati soleamus omnes, at easdem e longinquo tamen prospectas, et velut ea quae obiecta sint oculis. Quibus in fabulis quod fatum habeatur, etsi res tum magis tum minus perspicue est proposita, ea quae in scaena agenda essent semper compegit. Quare qui haec adspectant timore illud genus soluuntur, qui pessimus, isque ne quid consilii sibi sit capiendum timor est. Itaque rem oportet iam peractam euasisse eo tempore quo a poeta nobis eadem renouatur, unde fit ut res olim gestae in scaenam inductae probentur. Clari enim casus nobis praenoti sane sunt, et, tempore addito, omnia aboleta ita sunt quae ex eis euenerunt ut quo agamus satis nouerimus atque ex aetate nostro et nobismet ut ita dicam ipsis exempti esse uideamur. Quem ad modum quietis uidelicet tum satis apparent animis esse spectatores cum sedem in gradibus capiunt. Itaque est ut in omni tragoedia dum (accurate) composita sit tempus primam agat partem. Constat igitur, ut dixerunt, tragicis rebus opus esse tempore uno, accipe haud soluto nempe, neque sine modo, atque id etiam adtendo tempus demensum, sole praecipue atque sideribus, talibus rebus aptius uideri. Nam commodum est gladio stellas Cassium designare inclinantes, illa in nocte quae una in omni memoria clarissima sit, et semper quidem sentiendum est horas progredientes, quodque necesse fuit animos externum urgere eosque citius quam uellent maturare. Quod enim cum procedit quae exspectemus timeamusue tempus non uidet dum eadem perficit, en hoc nimirum quo sustinentur quae modo tragica sint. At tragicis poetis neglegendi etiam sunt libidinis isti leues motus quos effectus nullus consequitur neque ullum ei exspectant. Refert ergo libidines conformari tamquam temporis catenis circumscriptas. Nam tragoediae cuiusuis materiam dixeris libidinibus, formam tempore fieri.
Version latine
Lucain,
Pharsale, II, 3, v. 3-46
Corrigé proposé par le jury
Lorsque l’Auster poussa la flotte en avant, pressant sur ses voiles qui cédaient sous lui, et que les esquifs agitèrent la haute mer, chaque matelot avait les yeux fixés sur les flots de la mer Ionienne. Seul, Magnus ne détacha pas ses regards de la terre d’Hespérie, aussi longtemps qu’il voyait s’effacer les ports de sa patrie, les rivages qui ne s’offriraient jamais plus à ses regards, une cime couverte de nuages et des collines indistinctes. Puis les membres las du général s’abandonnèrent à la torpeur du sommeil. C’est alors qu’il lui sembla que Julie, apparition pleine d’une terrible horreur, dressait sa tête sinistre au travers d’une crevasse de la terre et se tenait, telle une Furie, au- dessus de son bûcher ardent. Chassée des demeures élyséennes, plaines des mânes irréprochables, je suis entraînée, depuis la guerre civile, vers les ténèbres du Styx et les mânes coupables. J’ai vu de mes yeux les Euménides tenir en main des torches pour les agiter dans vos rangs. Le nocher de l’Achéron enflammé prépare d’innombrables esquifs ; on élargit le Tartare pour de nombreux châtiments ; c’est à peine si les Sœurs toutes réunies, bien que leur dextre s’affaire à la tâche, font face à la besogne et les fils de trame épuisent les Parques qui les tranchent. Durant notre union, Magnus, tu as célébré de joyeux triomphes. Une couche nouvelle a changé ta Fortune : Cornelia, ma rivale, condamnée à entraîner toujours ses puissants maris à leur perte, t’a épousé sur mon bûcher encore tiède. Qu’elle s’attache à tes enseignes dans les guerres, sur les flots, soit, pourvu qu’il me soit permis d’interrompre ton sommeil troublé, qu’il n’y ait nul instant libre pour vos amours et que César obsède tes jours, et Julie tes nuits. L’oubli que donnent les rives du Léthé ne m’a pas fait perdre le souvenir de ta personne, mon époux, et les souverains des morts silencieux m’ont permis de te suivre. Je viendrai au milieu des combats, quand tu feras la guerre. Jamais, Magnus, les Ombres ni mes mânes ne te permettront de cesser d’être un gendre. C’est en vain que tu essaies de trancher de ton arme les liens de famille : la guerre civile te rendra à moi. » Telles furent ses paroles, puis son ombre, échappant aux embrassements de son époux tremblant, s’enfuit. Quant à lui, bien que les dieux et les mânes le menacent d’une défaite, plus Grand encore, il court à la guerre, en pleine conscience des malheurs qui l’attendent, et dit : « Pourquoi suis-je terrifié par la vision d’une apparition sans réalité ? Ou bien après la mort il ne reste aux âmes aucune forme de conscience, ou bien la mort elle-même n’est rien. » Titan déjà, inclinant sa course, pénétrait dans les ondes et avait fait plonger une part de son globe incandescent égale à celle qui manque toujours à la lune quand elle va être pleine ou a déjà cessé de l’être. Alors une terre hospitalière offrit aux vaisseaux un accès aisé. On enroula les drisses, on coucha le mât, puis on gagna le rivage à force de rames. Quand on lança les esquifs, que les vents les entraînèrent, que la mer eut ôté la vue de la flotte et que César resta le seul général sur le sol de l’Hespérie, la gloire d’avoir mis Magnus en fuite ne le réjouit pas : il déplore que ses ennemis lui tournent le dos, en toute sécurité, sur la mer. Car aucun succès ne suffit plus désormais à ce héros dans son élan et il n’accordait pas grand prix à la victoire, pour peu qu’elle différât la guerre.
Session 2012
Thème latin
Racine, Britannicus, IV, 2
Corrigé proposé par le jury
De quibus rebus Nero Agrippinam obiurget
ou De quibus fingatur Nero Agrippinam quondam obiurgauisse
Tu quidem, dum me in suspicione tenes et adsidue quereris, effecisti ut omnes qui te audiuissent id crediderint, quod hic inter nos tibi dicere audeo, te olim nomine meo tibi uni fauendae studuisse. Tot honores, aiebant, totque obsequia, matris beneficiorum, num parua sunt praemia ? Quod facinus filius parare potuit qui tam seuere damnatus esset ? Num diadema illi imposuit ut pareret? Num imperium suum apud se tamquam depositum accepit ? Non quin ego, si usque ad ea uenire potuissem, ut tibi fauerem, libentissime, domina, hoc imperium concessissem, quod clamoribus tuis repetere uidebaris. Sed dominum, haud dominam Roma requirit. Et ad aures peruenit tuas fama haec, quam imbecillus ego concitaui : cottidie enim senatus populusque, cum irate audirent uoce mea tua praescripta sibi dictari, morientem Claudium pronuntiare solebant mihi cum imperio simplicem oboedientiam suam reliquisse. Ac centies uidisti milites nostros aquilas ad te ferentes dum mussant : nam eos pudebat illo indigno usu aliquid de uirorum magnitudine minuere, quorum etiam nunc imagines in eis inscribuntur. Quibus uocibus auditis, quaeuis alia cessisset. Sed tu, quippe quae regnum ipsa non obtinueris, semper quereris. Ipsaque cum Britannico aduersus me coniurata, eumdem auges Iuniae partibus, ac Pallas scilicet stas coniurationes omnes manu sua moliri aperte uidetur. Quod si inuitus efficio ut quies mea certior fiat, omnes te uident ira et odio commotam. Fit quidem ut aduersarium meum exercitui praebere pares : de quo fama usque ad castra percurrit.
Version latine
Catulle,
Poésies, 63, v. 44-90
Corrigé proposé par le jury
Donc, après un doux repos, débarrassé de la fureur qui l’entraînait, dès qu’Attis eut repassé dans son cœur ce qu’il avait fait, et qu’il eut constaté, l’esprit clair, ce qu’il avait perdu et où il était, l’âme bouillonnante, il revint sur ses pas vers le rivage. Là, contemplant la vaste mer de ses yeux pleins de larmes, il adressa à sa patrie, d’une manière touchante, ces paroles douloureuses : « Ô ma patrie, toi qui m’as créé, ô ma patrie, toi, ma mère, que j’ai abandonnée dans mon malheur, comme d’ordinaire les esclaves fugitifs le font avec leurs maîtres, j’ai porté mes pas vers les bois de l’Ida, pour être au pays des neiges, des tanières glacées des bêtes sauvages, et hanter tous leurs repaires furieux, où donc, en quels lieux dois-je imaginer, ma patrie, que tu te trouves ? Ma pupille d’elle-même désire diriger son regard vers toi, pendant que mon âme, pour un bref moment, est délivrée de sa rage farouche. Est-ce que moi, éloigné de ma maison, je serai emporté dans ces bois ? De ma patrie, de mes biens, de mes amis, de mes parents je serai loin ? Je serai loin du forum, de la palestre, du stade et des gymnases ? Malheureux, ah ! malheureux, il faut se plaindre encore et encore, mon cœur. En effet, de quel genre que je n’aie pas assumé est ma personne ? Moi femme, moi jeune homme, moi éphèbe, moi enfant, moi, j’ai été la fleur du gymnase, moi j’étais la gloire des athlètes frottés d’huile. Ma porte était fréquentée, mon seuil était tiède, ma maison était ornée de couronnes de fleurs, chaque fois qu’il me fallait, au lever du jour, quitter ma chambre. Moi maintenant je serai considéré comme une prêtresse des dieux et une servante de Cybèle ? Moi je serai une ménade, une partie de moi-même, un homme stérile ? Moi j’habiterai les contrées froides vêtues de neige de l’Ida verdoyant ? Moi je passerai ma vie au pied des hautes cimes de Phrygie, là où vivent la biche, l’habitante des forêts, et le sanglier, nomade des bois ? Dès maintenant je souffre de ce j’ai fait, dès maintenant, je le regrette ». Dès que de ses petites lèvres roses est sorti le son rapide, apportant aux deux oreilles des dieux ce message étonnant, aussitôt Cybèle, dénouant le joug attaché à ses lions, et aiguillonnant celui de gauche, ennemi du bétail, parle ainsi : « Eh bien allez, dit-elle, allez, va farouche, fais que le délire le harcèle, fais que sous les coups du délire il retourne dans les bois, lui qui, trop audacieusement, désire échapper à mes commandements, allez, frappe ton dos de ta queue, supporte tes propres coups, fais que tout le pays renvoie le tonnerre de ton grondement rugissant ; agite, farouche, ta crinière ardente sur ton cou musculeux ». C’est ainsi que parle Cybèle, menaçante, et elle délie le joug de sa main. Le fauve, s’encourageant lui-même, se pousse dans son cœur à l’impétuosité. Il va, il rugit, il brise de sa patte vagabonde les arbrisseaux. Mais lorsqu’il a atteint les espaces humides du rivage blanchi, et vu le tendre Attis près de la mer de marbre, il attaque ; celle-là, privée de raison, s’enfuit dans les bois sauvages, et c’est là que pour toujours, pour toute la durée de sa vie, elle fut une servante.
Session 2013
Thème latin
Voltaire, Candide ou L’Optimisme, chapitre 25
Corrigé proposé par le jury
Et Candidus : « Audeamne, Domine, inquit, a te quaerere nonne magna cum uoluptate Horatii legas opera ? » Quibus uerbis Contemptor haec respondit : « Sunt quidem apud eum sententiae nonnullae quae uiro bono prodesse possint et, in firmis uersibus constrictae, in memoria facilius imprimantur. Sed quod istud iter Brundisinum fecit, quod malam cenam descripsit, quod nescio qui Pupilius cuius uerba pus atque uenenum esse cum altero quodam balatrone contendit cuius uerba Italo perfusa aceto dixit, omnia denique haec minimo momento aestimo ; neque eos uersus sordidos quos aduersus anus ueneficasque fecit legi nisi maximo cum taedio. Neque intellego cur laus ei tribuenda sit quod Maecenati suo dixerit, si ab eo in lyricos uates insereretur, astra se sublimi uertice percussurum. Vt enim stulti apud scriptorem probatum omnia mirari solent, ita ego ad me ipsum solum delectandum lego nec quicquam probo nisi quod ad usum meum adtinet. Candidus autem quippe qui ita educatus esset ut de nulla re unquam per se iudicaret, quae audiebat, ea uehementer mirabatur. Martinus uero censebat Contemptorem mente saniore sentire. Candidus librum quemdam admirans : « Vide, inquit, hoc est Tullianum ! Illum uidelicet nonne sine ullo fastidio legere soles ? » Quibus Padanus : « Numquam eum lego. Nam quid mihi prodest eum pro Rabirio Cluentioue causam egisse ? Immo uero mihi eae causae sufficiunt quas ipse agere soleo. Mihi quidem commodiora fuissent opera quae de philosophia scripsit, nunc autem, cum eum omnibus de rebus dubitare uidi, concludi tandem tantum me scire quantum istum nec ullo alio homine mihi opus esse ut indoctus euaderem.
Version latine
Cicéron,
Aux familiers, XV, 4, 11-13
Corrigé proposé par le jury
À présent, je voudrais donc que tu sois bien persuadé de ceci : si on soumet ces événements au sénat, j’estimerai avoir reçu la plus haute marque de considération si, toi-même, tu donnes ton accord pour que cet honneur me soit décerné ; quoique, je le sais, les hommes les plus importants dans de telles affaires sollicitent et soient sollicités d’ordinaire, pourtant, j’estime devoir simplement t’en informer et non pas te solliciter. En effet, c’est bien toi qui, en de très nombreuses occasions, m’as fortifié de tes approbations, toi qui, par le discours, par la prise de parole en public, par les plus grands éloges au sénat et dans les assemblées, m’as porté aux nues. Du reste, tu es pour moi celui dont les paroles m’ont toujours paru d’un si grand poids que, quand un seul de tes mots venait s’associer à mon éloge, je pensais réaliser tous mes désirs. Enfin, je me le rappelle, comme tu refusais d’accorder une action de grâces à un homme très illustre et de la plus grande qualité, tu disais que tu l’accorderais si on soumettait cette requête eu égard à ce qu’il avait accompli comme consul dans la Cité. C’est donc toi aussi qui m’as accordé une action de grâces quand j’étais magistrat civil, non pas comme dans beaucoup de cas, « pour avoir bien gouverné la république », mais, comme jamais auparavant, « pour avoir sauvé la république ». Je passe sur le fait que tu aies enduré non seulement la jalousie, les périls et toutes les tempêtes que j’ai traversées mais que tu aies aussi été absolument déterminé à en endurer bien plus encore, si je l’avais permis, et, qu’enfin, tu aies considéré comme le tien mon adversaire personnel ; tu as été jusqu’à entériner sa disparition, alors même qu’il m’était aisé de comprendre quelle haute estime tu avais pour moi, en défendant au sénat la cause de Milon.
Tu demanderas peut-être pourquoi j’attache tant de prix à une simple marque de reconnaissance et d’honneur. Je vais désormais t’ouvrir mon cœur, comme le requièrent nos liens d’attachement et nos obligations mutuels, notre immense amitié ainsi que les liens qui unissaient nos pères. S’il y eut jamais quelqu’un qui, par sa nature et, plus encore – à mon avis du moins – par sa conviction rationnelle et son savoir, fût indifférent à toute vaine gloire et aux propos du peuple, c’est bien moi. Mon consulat l’atteste : pendant mon mandat, comme dans le reste de mon existence, je l’avoue, j’ai poursuivi avec zèle tout ce qui pouvait susciter une gloire authentique, sans penser, du reste, que la gloire en elle-même devait être recherchée pour elle-même. C’est pourquoi j’ai renoncé à une province de prestige et à l’espoir quasi certain d’un triomphe ; c’est pourquoi enfin je n’ai pas brigué de sacerdoce alors que, comme tu le penses, à mon avis, je pouvais l’obtenir sans grande difficulté. Cependant, après avoir essuyé l’injustice dont toi, tu fais un désastre pour la république – pour moi, loin d’en faire un désastre, tu vas jusqu’à en faire un titre de gloire – j’ai souhaité que les jugements les plus honorables possibles du sénat et du peuple romain portés sur mon compte viennent me protéger. C’est pourquoi, par la suite, j’ai voulu être nommé augure, ce qu’auparavant j’avais négligé, et cet honneur, qui, d’ordinaire, est accordé par le sénat pour des exploits guerriers, après l’avoir négligé autrefois, je crois à présent devoir le rechercher.
Session 2014
Thème latin
Rousseau, Correspondance
Corrigé proposé par le jury
Regis apud Lastigos comiti Iohannes Iacobus Rufus (1) salutem dat.
Tibi quanquam uidelicet, domine, ignobilis eram, id tamen certum habebam (2) has litteras a te aegre ferri nequire, quae nihil ad te traderent nisi facinoris cuiusdam patrati excusationem, cum pecunia. Modo enim Clericam puellam audiui (3) aniculae cuidam, Vauassae nomine, eidemque tam pauperi ut apud me domi maneret, e Blesensibus sportulam misisse quamdam ; qua in sportula butyro plenum inter alia uasculum positum esse, uiginti pondo ; quibus omnibus deinde in culinam, nescio quo pacto, aduectis tuam, hanc bonam anum tam simpliciter tecum egisse ut filiam suam statim, re modo cognita, cum litteris ad id tibi certius faciendum scriptis misisset, quae uel butyrum ipsum uel pretium saltem eius a te repeteret ; quibus auditis, te et uxorem tuam, cum a uobis, ut mos est, multum anus mulier ista derisa esset, nihil respondisse aliud nisi ut a seruis tuis ui foras pulsa esset. Cui mulieri maerenti cum solaciam praebere studuissem, et procerum usum et hominum politissimo cultu mores demonstrauissem (4), eamque docuissem famulos haud magno fore usui nisi saltem pauperes domo exigerent qui a dominis repetere sua ausi essent, dum denique ostendo quam rustica sint illa uerba fidei pietatisque, huic miserae tandem ita persuasi eam scilicet satis superque (5) honoratam se sibi habendam, quippe cuius butyrum edere inter regis comites unus dignatus esset, ut hoc a me petierit, domine, ut gratias uellem suas agere tibi, utpote qui honorem tantum sibi praebuisses, et item ad te referrem quantum tibi oneri fuisse se paeniteret, quantumue butyrum aueret suum tibi suavem gustu fuisse cibum. Quod si quid pro sportula missa et e cursoribus accepta pependisses, eius etiam detrimenti se uelle extemplo pretium tibi reddi, ut aequum est. De quibus nihil exspecto ad huius consilium perficiendum nisi iussa tua, et hoc tantum oro ut fas tibi uideatur quod optare audeo ut ualeas.
(1) ou Rufulus.
(2) Pour employer un imparfait épistolaire, qui n’a certes rien d’obligatoire.
(3) ou audiueram.
(4) ou procerum usu hominumque politissimo cultu moribus demonstrandis.
(5) « assez, et même trop », pour remployer un tour cicéronien.
Version latine
Pline le Jeune,
Lettres, VII, 9, 1-12
Corrigé proposé par le jury
Caius Plinius salue son cher Fuscus
Tu demandes à quelles études, selon moi, tu dois consacrer la retraite dont tu jouis depuis longtemps déjà. Voici ce qui est utile au premier chef, et nombreux sont ceux qui le recommandent : traduire du grec en latin ou du latin en grec. Ce genre d’exercice permet d’acquérir de l’exactitude et de l’éclat dans l’emploi des mots, des figures en grand nombre, de la vigueur pour développer et, de surcroît, en imitant les meilleurs, on apprend à faire preuve d’une inventivité semblable à la leur. Dans le même temps, ce que le lecteur aurait pu manquer ne peut échapper au traducteur. On y affûte son intelligence et son jugement. Cela ne saurait te nuire en rien, quand tu n’as lu des textes que pour en retenir le thème et l’argumentation, de les réécrire avec émulation, de comparer le résultat avec ce que tu as lu et de peser scrupuleusement en quoi tu as été le meilleur et en quoi c’est ton modèle qui te surpasse. Tu en tireras une grande fierté si c’est toi à quelques endroits et un grand sentiment de honte si c’est lui qui est partout le meilleur. Tu pourras également, de temps en temps, choisir les ouvrages les plus réputés et rivaliser avec ceux que tu as choisis. C’est certes osé de rivaliser avec eux, quoique en rien impudent, car cela reste un secret ; du reste nous constatons que beaucoup se sont tirés avec les honneurs de pareilles joutes et ceux qu’ils se contentaient de suivre, en refusant de perdre espoir, ils les ont dépassés. Tu pourras aussi retravailler tes discours, une fois que l’oubli aura fait son œuvre : en retenir beaucoup d’éléments, en omettre plus encore, introduire de nouveaux passages, en réécrire d’autres. C’est un travail de longue haleine et très ennuyeux, mais fécond par sa difficulté même, que de retrouver intacte sa première ardeur et de retrouver son élan, après qu’il a été brisé et perdu, et enfin de réarticuler des membres en quelque sorte nouveaux sur un corps achevé sans pourtant venir troubler les anciens.
Je sais qu’aujourd’hui tu te consacres tout spécialement à l’art oratoire ; mais je ne saurais pour autant te conseiller uniquement ce style agressif et en quelque sorte belliqueux. En effet, comme on renouvelle la culture des terres grâce à des semences variées et inédites, il en va de même pour nos talents si l’on varie les exercices. Je veux que parfois tu t’empares d’un sujet tiré de l’histoire, je veux que tu composes une épître avec un soin tout particulier. En effet, souvent, dans un discours aussi se fait sentir la nécessité de descriptions inspirées non seulement des historiens mais je dirais presque des poètes et c’est dans la correspondance que l’on peut acquérir un style concis et épuré. Il est également permis de se détendre en composant un poème, je ne dis pas continu et long (car on ne peut en venir à bout que dans le calme), mais du genre de ceux qui, subtils et brefs, sont propres à entrecouper les affaires et les soucis, si grands qu’ils soient. On les nomme « divertissements » mais ces divertissements obtiennent parfois une gloire qui n’est en rien inférieure à celle qui va aux ouvrages sérieux. Et, bien plus (pourquoi en effet ne pas t’appeler aux vers par des vers ?)
Comme la cire reçoit nos éloges chaque fois que, souple, elle s’abandonne,
Obéit aux doigts experts et accomplit l’œuvre qu’on lui a commandée
Et tantôt figure Mars ou la chaste Minerve,
Tantôt représente Vénus, et tantôt son fils ;
Et comme les sources sacrées n’éteignent pas seulement les flammes,
Mais réjouissent aussi les fleurs et les prés printaniers,
Ainsi en est-il de l’esprit des hommes qui, par des arts sans raideur,
Doit être infléchi et conduit avec une savante souplesse.
C’est pourquoi les plus grands orateurs, et même les plus grands hommes faisaient ainsi ces exercices et leurs délices, ou plutôt leurs délices et ces exercices.
Session 2015
Thème latin
Ronsard, Hymnes
Corrigé proposé par le jury
Cur mors collaudanda sit
Quam gratum hoc nobis uideatur si iam mortui simus existimemusque nos nihil esse nisi et argillam agitatam et uiuam umbram et materiam dolori, miseriis incommodisque subiectam ; immo nos cetera animalia malis miserabilibus (rem miseram dictu !) superare. Qua de causa ipsa, nos cum foliis quae hieme ex arboribus decidunt comparat Homerus quod tam imbecilli sumus et tam miseram uitam cottidie agimus dum nullo tempore intermisso sescenta mala suscipimus quasi e mole leui atque debili ficti. Itaque ualde miror cur Achilles in inferis dixerit se longius malle miserum esse famulum ac solis lumine frui quam regem mortuorum. Qui, hoc quidem concedendum est, iram aduersus Agamemnonem amiserat nec Briseidis iam meminerat nec iam Patroclum carissimum suum diligebat, cum isti saepissime, dum uiuit, ei ira moto studium moriendi praebuissent. Quod si audiuisset unum e Sapientibus cum diceret homines, dum aetatem agerent, nihil esse nisi animos semper inconstantes ac mutabiles, tempore oppressos ac Fortuna iactatos, noluisset apud mortales iterum ita renasci ut famulus uel etiam maximus rex fieret.
Version latine
Salluste,
La Guerre de Jugurtha, XVI, 18-XV, 3
Corrigé proposé par le jury
Enfin, Massinissa nous a élevés, Pères Conscrits, de telle sorte que nous n’entretenions nulle amitié, si ce n’est avec le peuple romain et que nous n’acceptions ni alliances ni traités nouveaux ; nous trouverions des secours bien assez grands dans votre amitié ; si la chance venait à tourner pour votre empire, il faudrait vous suivre dans la mort. Grâce à votre valeur et au bon vouloir des dieux, vous êtes puissants et prospères ; tout vous sourit et vous obéit : il vous est donc d’autant plus aisément loisible de remédier aux injustices dont sont victimes vos alliés.
Je ne crains qu’une seule chose : que certains ne soient égarés par les relations personnelles d’amitié, restées superficielles, qui les unissent à Jugurtha. En effet, ce sont eux, je l’entends dire moi-même, qui mettent tout leur pouvoir dans la balance, qui circonviennent, qui harcèlent chacun d’entre vous pour que vous vous absteniez de toute décision, en l’absence de celui-ci et sans avoir pris connaissance de sa cause ; selon eux, c’est moi qui fabule et qui simule un exil, alors qu’il m’était permis de rester dans le royaume. Or cet individu, puissè-je le voir, lui dont le forfait impie m’a jeté dans les souffrances qui sont les miennes, simuler les mêmes épreuves ; puissent aussi, un jour, vos cœurs et ceux des dieux immortels se soucier des affaires humaines : assurément cet individu, aujourd’hui enhardi et devenu célèbre par ses crimes, serait tourmenté par mille maux et subirait le lourd châtiment de son manque de respect envers notre père, du meurtre de mon frère et des misères qu’il me fait endurer. Actuellement, frère si cher à mon cœur, quoique la vie t’ait été arrachée bien avant le temps et par la dernière personne qui aurait dû le faire, il faut pourtant, selon moi, te réjouir de ton malheur plutôt que de t’en affliger. En effet, ce n’est pas un royaume, mais la condition de fugitif, d’exilé, d’indigent et tous les tourments qui m’accablent que tu as perdus en même temps que la vie. Moi, en revanche, infortuné, précipité du royaume de mon père dans de si grands malheurs, j’offre le spectacle des vicissitudes humaines, puisque j’ignore ce que je dois faire, si je dois venger les injustices commises à ton encontre, quand je suis moi-même privé de secours ou si je dois veiller sur mon trône, alors que c’est du pouvoir d’autrui que dépend l’éventualité de ma vie et de ma mort. Plût aux dieux que la mort pût constituer une issue honorable aux malheurs qui me frappent, que je ne parusse pas mériter à bon droit qu’on me méprisât, pour le cas où, harassé par mes maux, j’aurais cédé devant l’injustice ! En réalité je n’ai nul goût à la vie ni possibilité de mourir sans infamie.
Pères Conscrits, je vous en conjure, en votre nom, en celui de vos enfants et de vos pères, au nom de la majesté du peuple romain, venez à mon secours, infortuné que je suis, barrez la route à l’injustice, ne souffrez pas que le royaume de Numidie, qui est le vôtre, se corrompe dans le crime et le sang répandu par notre famille. »
Après que le roi eut fini de parler, les envoyés de Jugurtha, confiants dans leurs largesses plus que dans la justesse de leur cause, firent une réponse brève : Hiempsal avait été tué par les Numides, par suite de sa cruauté, alors qu’Adherbal déclenchait la guerre de son propre mouvement, après avoir été vaincu, il se plaignait de ce qu’il n’avait pu commettre d’injustice ; Jugurtha demandait aux sénateurs de ne pas le croire différent de celui qu’ils avaient connu à Numance et de ne pas préférer à ce qu’il avait accompli les paroles d’un ennemi personnel. Ensuite, les deux camps sortent de la curie. Aussitôt on consulte le sénat. Les partisans des envoyés, puis une grand partie du sénat, corrompue par des faveurs, tenaient les propos d’Adherbal pour négligeables et portaient aux nues, au contraire, la valeur de Jugurtha ; ils usaient de leur crédit, de leur parole et enfin de tous les moyens possibles pour défendre le crime et l’ignominie d’un autre comme s’il s’agissait de défendre leur propre gloire. Mais quelques-uns, en revanche, auxquels le bien et le juste tenaient plus à cœur que les richesses, pensaient qu’il fallait secourir Adherbal et tirer une sévère vengeance de la mort de Hiempsal.
Session 2016
Thème latin
Perrault, Contes, « La Barbe bleue »
Corrigé proposé par le jury
Fuit olim uir quidam cui fuerunt pulchrae domus et in urbe et ruri, aureum et argenteum uas, supellex eodem textili ornata, perfecteque auratae raedae ; at, accidit ut illi uiro fuerit caerula barba ; qua e re, tam deformis et tam terribilis fuit, ut non esset nec femina nec puella quae non fugeret ab eo. Quaedam uero ex eius uicinis, optima matrona, habebat duas filias pulcherrimas. Ille autem ex ea petiuit ut alteram in matrimonium daret, et ei optionem eligendi dedit utram uellet sibi dare. Sed ambae nolebant ei nubere et altera ad alteram eum remittebat, quae non possent animum inducere ut nuberent uiro cui esset caerulea barba. Quas etiam taedebat huius rei, ut ille multas puellas uxores iam duxisset neque quisquam sciret quid de illis feminis factum esset. Caeruleobarbus igitur, quo melius se nouerint, eas duxit cum matre et tribus uel quattuor earum amicissimis puellis et aliquot adulescentibus e uicinia, in aliquam ex uillis ubi manserunt octo dies. Nihil autem agebant nisi ambulabant, uenabantur et piscabantur, saltabant et magnifice cenabant, omnibus temporibus gustabant : Nemo enim dormiebat et omnes agebant totas noctes in secum cauillando ; itaque, res tam prospere se habuit ut filia minor natu paulatim coeperit existimare domino non esse barbam tam caeruleam et illum esse optimum uirum. Vbi igitur primum in urbem reditum est, matrimonium factum est.
Version latine
Stace,
Thébaïde, I, v. 401-446
Corrigé proposé par le jury
Or voici que, contraint par le destin d’abandonner l’antique Calydon, Tydée d’Olène – le remords horrible d’avoir répandu le sang fraternel le chasse loin de chez lui – parcourt les mêmes landes sous la nuit propice au sommeil ; il endure péniblement les mêmes bourrasques et les mêmes averses et, alors qu’il sent l’eau glacée lui couler dans le dos, qu’il sent son visage et ses cheveux ruisseler de pluie, il s’approche de l’unique abri, que s’était déjà approprié en partie un précédent occupant, étendu sur le sol glacé. Or c’est ici que le hasard suscita chez tous deux en même temps une rage sanguinaire : comme ils ne supportent pas d’écarter les dangers de la nuit en partageant le même toit, ils temporisent un peu en alternant paroles et menaces ; puis dès que leur courroux se fut suffisamment enflé des propos qu’ils se sont jetés à la face, tous deux se dressent, dénudent leurs épaules et, dans leur nudité, engagent le combat. Le premier, aux jambes plus longues, aux membres élancés, est dans la fleur de l’âge ; mais son courage anime Tydée, au demeurant nullement inférieur par ses forces, et une vaillance plus grande, répandue dans tous ses membres, dominait ce corps plus court. Acharnés maintenant, ils font pleuvoir et redoublent les coups partout sur leurs visages et au creux de leurs tempes, comme des flèches ou de la grêle sur les monts Riphées et, le genou plié, ils assènent des coups sur leurs flancs nus. C’est en tout point pareil à ce qui se passe quand le Tonnant de Pise voit, dans la cinquième année, revenir les fêtes qui lui sont consacrées et que le sable s’embrase de l’âpre sueur versée par les hommes ; mais là les encouragements contradictoires du public galvanisent les jeunes éphèbes, et les mères, tenues à l’écart, attendent des trophées : ainsi, stimulés par leur haine, sans qu’aucun désir de gloire ne les enflamme, ils fondent l’un sur l’autre, l’ongle de leur main fouaille jusqu’au fond de leur visage et s’y enfonce profondément, repoussant les yeux dans leurs orbites. Peut-être seraient-ils allés jusqu’à dégainer les épées qu’ils avaient attachées au côté – la fureur les y poussait – et, ce qui aurait mieux valu, jeune homme de Thèbes, tu serais resté au sol, tué par des armes ennemies, et ton frère aurait eu à te pleurer, si le roi, étonné́ par ces cris inhabituels et ces gémissements aigus, tirés du fond de la poitrine, poussés au milieu des ombres de la nuit, ne s’était pas déplacé, lui dont la vieillesse sage, au sommeil désormais moins bon, demeurait en alerte sous le lourd poids des soucis. Quand celui-ci, qui s’avance avec des flambeaux en grand nombre par les hautes salles, après avoir ouvert les battants, aperçoit, sur le seuil devant lui, vision terrible à dépeindre, des faces lacérées et des joues souillées par des ruisseaux de sang, [il s’écrie] : « Quelle est la cause de votre fureur, jeunes étrangers ? Car aucun de mes concitoyens n’oserait pareille violence ; quelle est cette ardeur implacable à troubler par vos déchaînements de haine les silences tranquilles de la nuit ? Le jour est-il trop bref et est-il si pénible d’accorder, ne serait- ce que momentanément, trêve et sommeil à l’esprit ? Mais révélez-moi enfin de quelle cité vous êtes issus, où vous conduit votre route, quelle est votre querelle. Car un courroux si grand m’apprend que vous n’êtes pas d’une humble condition et le sang répandu m’apparaît un indice incontestable et éclatant d’une naissance altière.
Session 2020
Composition française
« Est-ce une autobiographie ? Est-ce une hagiographie ? Est-ce un feuilleton populaire ? Cendrars brouille les pistes et produit une autobiographie qui ne s’affirme jamais complètement comme telle. Le texte revendique une réception malaisée et subtilise au lecteur les indices formels qui lui permettent ordinairement de se saisir du sens. C’est en amant du secret des choses que Cendrars conduit son lecteur sur des pistes multiples et enchevêtrées, qui ne cessent de le surprendre et de le dérouter. » (Laurence Guyon, Cendrars en énigme. Modèles mystiques, écritures poétiques, Paris, Honoré Champion, 2007, p. 143)
Ce jugement se trouve-t-il confirmé par votre lecture de L’Homme foudroyé ?
Thème latin
Dans Florence jadis vivait un médecin,
Savant hâbleur, dit-on, et célèbre assassin.
Lui seul y fit longtemps la publique misère :
Là le fils orphelin lui redemande un père ;
Ici le frère pleure un frère empoisonné.
L’un meurt vide de sang, l’autre plein de séné ;
Le rhume à son aspect se change en pleurésie,
Et par lui la migraine est bientôt frénésie.
Il quitte enfin la ville, en tous lieux détesté.
De tous ses amis morts un seul ami resté
Le mène en sa maison de superbe structure :
C’était un riche abbé, fou de l’architecture.
Le médecin d’abord semble né dans cet art,
Déjà de bâtiments parle comme Mansart :
D’un salon qu’on élève il condamne la face ;
Au vestibule obscur il marque une autre place,
Approuve l’escalier tourné d’autre façon.
Son ami le conçoit, et mande son maçon.
Le maçon vient, écoute, approuve et se corrige.
Enfin pour abréger un si plaisant prodige,
Notre assassin renonce à son art inhumain ;
Et désormais, la règle et l’équerre à la main,
Laissant de Galien la science suspecte,
De méchant médecin devient bon architecte.
Son exemple est pour nous un précepte excellent.
Soyez plutôt maçon, si c’est votre talent,
Ouvrier estimé dans un art nécessaire,
Qu’écrivain du commun et poète vulgaire.
Il est dans tout autre art des degrés différents,
On peut avec honneur remplir les seconds rangs ;
Mais dans l’art dangereux de rimer et d’écrire,
Il n’est point de degrés du médiocre au pire.
Nicolas Boileau (1636-1711),
Art Poétique (1674), IV, v. 1-32
(32 vers – 257 mots)
Corrigé proposé par le jury
Florentiae quondam uiuebat medicus quidam qui dicebatur esse homo loquacissimus et clarus interfector. Solus enim diu ciuibus suis exitio fuit : illic enim orbus filius ex eo repetit patrem, hic frater flet fratrem ueneficio interfectum. Namque alter mortuus est sanguine hausto, alter plenus casiae ; ac grauedo, ubi primum is aduenit, euadit dolor lateris et, eius opera, capitis dolor fit mox furor. Et tandem relinquit urbem, quippe qui omnibus odio sit. Cuius ex omnibus amicis unus remanet uiuus qui eum ducit in domum suam mirifice aedificatam. Fuit enim ille diues abbas, in architectura cupidissimus. Medicus autem, qui statim uidetur ad hanc artem natus esse, iam de aedificiis ut Mansartius loquitur. Itaque quomodo oecus aedificetur compareturque reprehendit, iubet caecas fauces alio loco constitui probatque scalas aliter dispositas. Cuius amicus haec concipit et arcessit structorem suum. Structor igitur uenit, eum audit, approbat consiliumque mutat. At denique, ne plura dicamus de tam iucundo prodigio, interfector de quo dicimus desinit suam sceleratam artem. Qui iam, dum relinquit suspiciosam Galeni scientiam, regula et norma in manus sumpta, ex malo medico bonus architectus fit. Cuius exemplum nobis egregium praeceptum est. Age uero, es structor, si ingenium tuum in hac re est, probatus opifex quidam in necessaria arte uersatus, potius quam popularis scriptor et uulgaris poeta. Sunt enim in ceteris artibus uarii gradus, quorum possumus honeste tenere secundum locum. At, in periculosa uersuum faciendorum et componendi arte, non sunt gradus inter mediocrem et pessimum.
Thème grec
LE VIEUX ROI DE BABYLONE, BÉLUS, DEMANDE CONSEIL À SES MINISTRES
POUR LE MARIAGE DE SA FILLE (1)
« Je suis vieux, je ne sais plus que faire, ni à qui donner ma fille. Celui qui la méritait n’est qu’un vil berger. Le roi des Indes et celui d’Égypte sont des poltrons ; le roi des Scythes me conviendrait assez, mais il n’a rempli aucune des conditions imposées. Je vais encore consulter l’oracle. En attendant, délibérez, et nous conclurons suivant ce que l’oracle aura dit ; car un roi ne doit se conduire que par l’ordre exprès des dieux immortels. »
Alors il va dans sa chapelle ; l’oracle lui répond en peu de mots suivant sa coutume : « Ta fille ne sera mariée que quand elle aura couru le monde. » Bélus, étonné, revient au conseil et rapporte cette réponse.
Tous les ministres avaient un profond respect pour les oracles ; tous convenaient ou feignaient de convenir qu’ils étaient le fondement de la religion ; que la raison doit se taire devant eux ; que c’est par eux que les rois règnent sur les peuples, et les mages sur les rois ; que sans les oracles il n’y aurait ni vertu ni repos sur la terre. Enfin, après avoir témoigné la plus profonde vénération pour eux, presque tous conclurent que celui-ci était impertinent, qu’il ne fallait pas lui obéir ; que rien n’était plus indécent pour une fille, et surtout pour celle du grand roi de Babylone, que d’aller courir sans savoir où ; […] qu’en un mot cet oracle n’avait pas le sens commun.
Jean-Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778),
La Princesse de Babylone (1768)
(251 mots)
(1) Ne pas traduire le titre.
Corrigé proposé par le jury
« Γηραιὸς ὢν, ἔφη, οὐκέτ’ ἔχω ὅ τι πράξω οὐδ’ ὅτῳ τὴν θυγατέρα ἐκδῶμαι. Ὁ μὲν γὰρ αὐτῆς ἄξιος ὢν οὐδεὶς ἄλλος ἢ ἀγεννὴς ποιμήν ἐστιν. Ὁ δὲ τῶν Ἰνδῶν βασιλεὺς καὶ ὁ τῶν Αἰγυπτίων δειλοὶ τυγχάνουσιν ὄντες· ὁ δὲ τῶν Σκυθῶν ἐπιεικῶς ἀρέσκοι ἄν μοι, ὅμως δ’ οὐδὲν τῶν προσταχθέντων ἐξεπλήρωσε. Πάλιν οὖν αὖθις χρήσομαι τῷ μαντείῳ. Ὑμῶν δὲ μεταξὺ βουλευσαμένων διαγνωσόμεθα [Ἐν δὲ τῷ μεταξὺ βουλεύσασθε καὶ διαγνωσόμεθα] καθ’ ἃ ἂν ὁ θεὸς εἴπῃ [κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ ῥηθέντα]· βασιλέα γὰρ δεῖ πάντα πρᾶξαι οὐδενὶ ἄλλῳ πειθόμενον ἢ τοῖς ὑπὸ τῶν ἀθανάτων θεῶν σαφέστατα κελευομένοις. »
Τότε δὲ πρὸς τοῦτον εἰς τὸ ἑαυτοῦ ἱερὸν ἐλθόντα ἀναιρεῖ ὁ θεὸς διὰ βραχέων ὥσπερ εἴωθε· « Ἡ θυγάτηρ σου, ἔφη, οὐ πρότερον γαμεῖται πρὶν ἂν ἀποδημήσασα διὰ τῆς γῆς πορεύηται. » Ἐκπεπληγμένος δ’ ὁ Βῆλος ἐπὶ τὴν βουλὴν ἐπανέρχεται ἀπαγγελῶν τοῦτον τὸν χρησμόν.
Πάντες δ’ οἱ βουλευταὶ πολὺ ᾐδοῦντο τοὺς χρησμούς· πάντες δ’ ὡμολόγουν ἢ προσεποιοῦντο ὁμολογῆσαι αὐτοὺς μὲν κρηπῖδας εἶναι τῆς περὶ τοὺς θεοὺς θεραπείας· διανοηθῆναι δὲ περὶ αὐτοὺς οὐ προσήκειν· διὰ δ’ αὐτοὺς τοὺς μὲν βασιλέας τῶν δήμων ἄρχειν, τοὺς δὲ μάγους τῶν βασιλέων· τῶν δὲ χρησμῶν μὴ ὄντων οὔτ’ ἀρετὴν οὐθ’ ἡσυχίαν παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ἂν ὑπάρχειν. Τέλος δέ, καίπερ μάλιστα σεβόμενοι αὐτοὺς, σχεδὸν πάντες ἐλογίσαντο τοῦτον μὲν ἄλογον εἶναι, πιθέσθαι [πείθεσθαι] δ’ αὐτῷ οὐ δεῖν· οὐδ’ ἀπρεπέστερον οὐδὲν εἶναι παρθένῳ τινί, μάλιστα δὲ τῇ τοῦ μεγάλου βασιλέως τῶν Βαβυλωνίων θυγατρί, ἢ ἀποδημησάσῃ πορεύεσθαι μὴ εἰδυίᾳ ὅποι ἔλθοι· οὐδὲ συνελόντι φρονίμως ἔχειν τοῦτον τὸν χρησμόν.
Version latine
RÉACTION DE PHILIPPE V À L’ANNONCE DU DÉSASTRE
SUBI PAR CHALCIS, VILLE ALLIÉE DE LA MACÉDOINE
Demetriade tum Philippus erat. Quo cum esset nuntiata clades sociae urbis, quamquam serum auxilium perditis rebus erat, tamen, quae proxima auxilio est, ultionem petens, cum expeditis quinque milibus peditum et trecentis equitibus extemplo profectus cursu prope Chalcidem contendit, haudquaquam dubius opprimi Romanos posse. A qua destitutus spe nec quicquam aliud quam ad deforme spectaculum semirutae ac fumantis sociae urbis cum uenisset, paucis uix qui sepelirent bello absumptos relictis aeque raptim ac uenerat transgressus ponte Euripum per Boeotiam Athenas ducit, pari incepto haud disparem euentum ratus responsurum. Et respondisset, ni speculator – hemerodromos uocant Graeci, ingens die uno cursu emetientes spatium – contemplatus regium agmen ex specula quadam, praegressus nocte media Athenas peruenisset. Idem ibi somnus eademque neglegentia erat quae Chalcidem dies ante paucos prodiderat. Excitati nuntio trepido et praetor Atheniensium et Dioxippus, praefectus cohortis mercede militantium auxiliorum, conuocatis in forum militibus tuba signum ex arce dari iubent, ut hostes adesse omnes scirent. Ita undique ad portas, ad muros discurrunt. Paucas post horas Philippus, aliquanto tamen ante lucem, adpropinquans urbi, conspectis luminibus crebris et fremitu hominum trepidantium, ut in tali tumultu, exaudito sustinuit signa et considere ac conquiescere agmen iussit, ui aperta propalam usurus quando parum dolus profuerat. Ab Dipylo accessit. Porta ea, uelut in ore urbis posita, maior aliquanto patentiorque quam ceterae est, et intra eam extraque latae uiae sunt, ut et oppidani derigere aciem a foro ad portam possent et extra limes mille ferme passus longus, in Academiae gymnasium ferens, pediti equitique hostium liberum spatium praeberet. Eo limite Athenienses cum Attali praesidio et cohorte Dioxippi acie intra portam instructa signa extulerunt. Quod ubi Philippus uidit, habere se hostes in potestate ratus et diu optata caede – neque enim ulli Graecarum ciuitatium infestior erat – iram expleturum, cohortatus milites ut se intuentes pugnarent scirentque ibi signa, ibi aciem esse debere ubi rex esset, concitat in hostes equum non ira tantum sed etiam gloria elatus, quod ingenti turba completis etiam ad spectaculum muris conspici se pugnantem egregium ducebat.
Tite Live,
Histoire romaine, XXXI, 3, 24,
(323 mots)
Corrigé proposé par le jury
Philippe était alors à Démétrias. C’est pourquoi, alors qu’avait été annoncé le désastre subi par la ville alliée, bien qu’il fût trop tard pour lui porter secours – la situation était désespérée – néanmoins, poursuivant un but très proche du secours, la vengeance, prenant avec lui cinq mille hommes d’infanterie légère et trois cents cavaliers, il partit sur-le-champ presque au pas de course pour atteindre Chalcis, sans le moindre doute sur le fait que les Romains pussent être écrasés. Mais déçu dans cet espoir et n’étant venu que pour être confronté à l’affreux spectacle d’une ville alliée à demi ruinée et partant en fumée, après y avoir laissé juste quelques hommes pour ensevelir ceux qui avaient été massacrés au combat, aussi précipitamment qu’il était venu, il prit le pont pour franchir l’Euripe puis il marche sur Athènes en passant par la Béotie, dans l’idée qu’à une entreprise semblable répondrait un succès qui ne serait pas dissemblable. Et il y eût répondu, si un observateur – un hemerodromos, comme les Grecs appellent ces hommes qui parcourent une distance immense en un seul jour au pas de course – n’avait porté son attention, depuis un certain poste d’observation, sur la marche de la colonne royale et ne l’avait devancé en parvenant à Athènes en pleine nuit. Là régnaient le même sommeil et la même insouciance que ceux qui avaient livré Chalcis quelques jours plus tôt. Réveillés par le messager tout agité, le préteur des Athéniens ainsi que Dioxippe, à la tête d’une cohorte de troupes auxiliaires constituée de mercenaires, une fois les soldats rassemblés sur le forum, ordonnent qu’au son de la trompette soit donné un signal depuis la forteresse, afin que tous sachent que les ennemis étaient là. Dès lors, de toutes parts on accourt aux portes, aux remparts. Quelques heures plus tard, mais néanmoins sensiblement avant le lever du jour, Philippe, qui s’approchait de la ville, après avoir observé de nombreux flambeaux et prêté l’oreille au fracas de gens qui s’agitaient, comme cela advient en pareil tumulte, fit une halte et ordonna à la colonne de s’arrêter et de se reposer ; il avait l’intention de faire ouvertement usage d’une force manifeste, puisque la ruse n’avait pas été assez profitable. Il lança les hostilités du côté de la porte Dipyle. Cette porte, placée comme à l’entrée de la ville, est sensiblement plus grande et plus praticable que toutes les autres, et à l’intérieur comme à l’extérieur se trouvent de larges voies, de sorte que les habitants pouvaient ranger leur armée en ligne de bataille depuis le forum jusqu’à la porte, tandis qu’à l’extérieur une route longue de mille pas environ, conduisant au gymnase de l’Académie, offrait un espace libre à l’infanterie et à la cavalerie des ennemis. Sur cette route, les Athéniens, avec la garnison d’Attale et la cohorte de Dioxippe, formèrent leur ligne de bataille à l’intérieur de la porte puis sortirent pour attaquer. Or, lorsque Philippe vit ce mouvement, dans l’idée qu’il tenait ses ennemis en son pouvoir et qu’il était à deux doigts d’assouvir sa colère en un massacre depuis longtemps souhaité – et, de fait, il n’était pas une cité grecque à qui il fût plus hostile –, il exhorta ses soldats : qu’ils combattent les yeux fixés sur lui et qu’ils sachent que les enseignes, que la ligne de bataille devaient être où le roi serait ; puis il lance son cheval sur les ennemis, emporté non seulement par la colère, mais encore par le désir de gloire : être observé en train de combattre, une foule immense amassée sur les remparts pour assister aussi au spectacle, était à ses yeux un insigne honneur.
Session 2021
Composition française
« Il [Boileau] joue avec talent de l’ambiguïté entre le jugement moral et le jugement de goût, entre l’exigence éthique qui tend à l’universel et l’évaluation esthétique qui, elle, apparaît beaucoup plus problématique. Boileau voudrait donner à ses jugements de goût la même autorité et la même universalité que des jugements moraux. » (Pascal Debailly, « Le droit à la satire chez les poètes », article paru dans les actes du colloque Morales du poème à l’âge classique, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 36).
Ce jugement se trouve-t-il confirmé par votre lecture des Satires et de l’Art poétique de Boileau ?
Thème latin
UNE BIEN ÉTRANGE MESSE (1)
On était déjà assemblé lorsque j’entrai avec mon conducteur. Il y avait environ quatre cents hommes dans l’église et trois cents femmes : les femmes se cachaient le visage avec leur éventail, les hommes étaient couverts de leurs larges chapeaux ; tous étaient assis, tous dans un profond silence. Je passai au milieu d’eux sans qu’un seul levât les yeux sur moi. Ce silence dura un quart d’heure. Enfin un d’eux se leva, ôta son chapeau et, après quelques grimaces et quelques soupirs, débita moitié avec la bouche, moitié avec le nez, un galimatias tiré de l’Évangile, à ce qu’il croyait, où ni lui ni personne n’entendait rien. Quand ce faiseur de contorsions eut fini son beau monologue et que l’assemblée se fut séparée tout édifiée et toute stupide, je demandai à mon homme pourquoi les plus sages d’entre eux souffraient de pareilles sottises. « Nous sommes obligés de les tolérer, me dit-il, parce que nous ne pouvons pas savoir si un homme qui se lève pour parler sera inspiré par l’esprit ou par la folie ; dans le doute, nous écoutons tout patiemment, nous permettons même aux femmes de parler. Deux ou trois de nos dévotes se trouvent souvent inspirées à la fois et c’est alors qu’il se fait un beau bruit dans la maison du Seigneur ! — Vous n’avez donc point de prêtres ? lui dis-je. — Non, mon ami, dit le quaker (2), et nous nous en trouvons bien ».
François-Marie Arouet, dit Voltaire (1694-1778),
Lettres philosophiques, Seconde Lettre, « Sur les Quakers »
(255 mots)
(1) Ne pas traduire le titre.
(2) quaker : traduire minister.
Corrigé proposé par le jury
Tum erat iam conuentum cum ingressus eo sum una cum duce meo. Quo in templo, prope quadringenti uiri ac trecentae mulieres inerant, quorum hae flabellis suis uultus suos abscondebant, illi latis petasis capita sua operuerant, omnesque sedebant, omnes admodum taciti. Tum, me ita inter eos progresso ut nemo eorum ad me oculos suos sustulerit, postquam haud breue tempus siluerunt, postremo unus eorum de sella surgens, petaso sublato, ore torto, haud sine suspiriis, partim ex ore, partim ex naribus confuse quaedam uerba recitauit quae sibi ex Euangelio excerpsisse uidebatur, neque ipse neque ullus quicquam intelligebat. At simul atque ille contortae orationis inuentor illius splendentis secum sermonis finem fecerat, omnesque a contione abierant perdocti atque omnino stupentes, meum comitem rogaui cur sapientissimi eorum talia ferrent. « Nobis, inquit, ideo haec sunt ferenda quod scire non possumus utrum futurum sit ut quisquam surgens ad loquendum spiritu infletur an furore inflammetur ; itaque dubitantes, patienter omnia audimus et mulieres ipsas sinimus loqui. Atque cum saepe accidat ut duae uel tres nostrarum piarum comitum simul inflentur, tum quantus in Domini aede fit tumultus ! » « Nonne uobis, aio, ulli sunt sacerdotes ? » « Minime, amice, ait minister, sed hoc bene nobis euenit. »
Thème grec
OCTAVE – Ah ! fâcheuses nouvelles pour un coeur amoureux ! Dures extrémités où je me vois réduit ! Tu viens, Silvestre, d’apprendre au port que mon père revient ?
SILVESTRE – Oui.
OCTAVE – Qu’il arrive ce matin même ?
SILVESTRE – Ce matin même.
OCTAVE – Et qu’il revient dans la résolution de me marier ?
SILVESTRE – Oui.
OCTAVE – Avec une fille du seigneur Géronte ?
SILVESTRE – Du seigneur Géronte.
OCTAVE – Et que cette fille est mandée de Tarente ici pour cela ?
SILVESTRE – Oui.
OCTAVE – Et tu tiens ces nouvelles de mon oncle ?
SILVESTRE – De votre oncle.
OCTAVE – À qui mon père les a mandées par une lettre ?
SILVESTRE – Par une lettre.
OCTAVE – Et cet oncle, dis-tu, sait toutes nos affaires.
SILVESTRE – Toutes nos affaires.
OCTAVE – Ah ! parle, si tu veux, et ne te fais point, de la sorte, arracher les mots de la bouche.
SILVESTRE – Qu’ai-je à parler davantage ? Vous n’oubliez aucune circonstance, et vous dites les choses tout justement comme elles sont.
OCTAVE – Conseille-moi, du moins, et me dis ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures.
SILVESTRE – Ma foi, je m’y trouve autant embarrassé que vous, et j’aurais bon besoin que l’on me conseillât moi-même.
OCTAVE – Je suis assassiné par ce maudit retour.
SILVESTRE – Je ne le suis pas moins.
OCTAVE – Lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d’impétueuses réprimandes.
SILVESTRE – Les réprimandes ne sont rien, et plût au Ciel que j’en fusse quitte à ce prix ! Mais, j’ai bien la mine, pour moi, de payer plus cher vos folies, et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules.
OCTAVE – Ô Ciel ! par où sortir de l’embarras où je me trouve ?
Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), dit Molière,
Les Fourberies de Scapin, Acte I, scène 1
(273 mots)
Corrigé proposé par le jury
ΝΕΑΝΙΑΣ – Φεῦ· ὡς γὰρ ἀηδεῖς αὗται αἱ ἀγγελίαι ἐκ καρδίας ἐρῶντι· ὡς δ’ ἔσχαται ἀπορίαι εἰσίν, εἰς ἃς ἐνέπεσον· ἄρτι γὰρ ἐν τῷ λιμένι ἐπύθου, ὦ οἰκέτα, τὸν πατέρα μου ἐπανιόντα ;
ΟΙΚΕΤΗΣ – Ἐπυθόμην γε.
ΝΕ. – Ἀφικνούμενον δ’ αὐτὸν τῷδε τῷ ὄρθρῳ αὐτῷ ;
ΟΙ. – Τῷδε δὴ τῷ ὄρθρῳ αὐτῷ.
ΝΕ. – Ἐπανιόντα δ’ αὐτὸν ἵνα με συζεύξῃ γάμῳ (συζεύξοντά με γάμῳ) ;
ΟΙ. – Ναί.
ΝΕ. – Ἐμέ τε καὶ θυγατέρα τινὰ τοῦ Γέροντος τοῦ δεσπότου ;
ΟΙ. – Τοῦ Γέροντός γε τοῦ δεσπότου.
ΝΕ. – Ταύτην δὲ τὴν θυγατέρα δεῦρο ἀπὸ τοῦ Τάραντος ἐπὶ τούτῳ μεταπεμπομένην ;
ΟΙ. – Ναί (Πάνυ γε).
ΝΕ. – Ταῦτα δὲ παρὰ τοῦ θείου μου ἤκουσας ;
ΟΙ. – Παρά γε δὴ τοῦ θείου σου.
ΝΕ. – Πρὸς ὅνπερ ὁ πατήρ μου ἐπέστειλε ταῦτα ἐπιστολῇ ;
ΟΙ. – Ἐπιστολῇ γε.
ΝΕ. – Καὶ οὗτος ὁ θεῖος, φῄς, πάντα τὰ ἡμέτερα (πάντα τὰ πράγματα ἡμῶν) οἶδεν ;
ΟΙ. – Πάντα γε τὰ ἡμέτερα (Πάντα γε τὰ πράγματα ἡμῶν).
ΝΕ. – Ἀλλ’ ἄγε δή, εἰπέ, ἐὰν βούλῃ, καὶ μὴ οὕτω ποιήσῃς ὥστε δεῖν σοι τὸ στόμα λύειν.
ΟΙ. – Τί δὲ πλείω εἴπω ; Οὐδενὸς γὰρ ἐπιλανθάνει τῶν παρόντων, ἀλλ’ ἅπαντα ὀρθῶς λέγεις καὶ οὕτως ὥσπερ ἔχει.
ΝΕ. – Ἐμοὶ γοῦν συμβουλεῦσον καὶ εἰπὲ ὅ τι πράξω (χρή με πράττειν) ἐν τούτοις τοῖς χαλεποῖς πράγμασιν.
ΟΙ. – Νὴ Δία, τυγχάνω τοσοῦτον ἀμήχανος ὢν ἐγὼ ἐν τούτοις ὅσον σύ· καὶ μὴν πάνυ γε δέοι ἄν τινα συμβουλεῦσαι ἔμοιγ’ αὐτῷ.
ΝΕ. – Ἀποθνῄσκω γοῦν ἅτε τούτου παρὰ καιρὸν ἐπανελθόντος.
ΟΙ. – Οὐχ ἧττον ἔγωγε.
ΝΕ. – Ὅταν ὁ πατήρ μου τὰ πράγματα πύθηται, αὐτίκα ὄψομαι χειμῶνα σφοδρῶν ψόγων πρὸς ἐμὲ προσβαλόντα.
ΟΙ. – Φαῦλοι εἰσὶν οἱ ψόγοι· διὰ δὲ τοιῶνδε (ποινῶν) ἀπαλλαγείην ἐκ τῶν κινδύνων· ἔγωγε μέντοι σφόδρα κινδυνεύω ζημιοῦσθαι δεινοτέραις ζημίαις διὰ τὴν ἄνοιάν σου (ἅτε σου ἠλιθίως πεπραγότος) καὶ ῥαπισμάτων νέφος ὁρῶ πόρρωθεν συνιστάμενον, ὅπερ μέλλει ἐπὶ τοὺς ὤμους μου διαρραγῆναι.
ΝΕ. – Ὦ Ζεῦ, πῶς ποτε σωθῶ ἐκ τῆς παρούσης ἀπορίας ;
Version latine
AFFLICTION DE TARPEIA
Vidit (1) harenosis Tatium proludere campis
pictaque per flauas arma leuare iubas :
obstupuit regis facie et regalibus armis,
interque oblitas excidit urna manus.
Saepe illa immeritae causata est omina lunae,
et sibi tingendas dixit in amne comas :
saepe tulit blandis argentea lilia Nymphis,
Romula ne faciem laederet hasta Tati :
dumque subit primo Capitolia nubila fumo,
rettulit hirsutis bracchia secta rubis,
et sua Tarpeia residens ita fleuit ab arce
uulnera uicino non patienda Ioui :
« Ignes castrorum et Tatiae praetoria turmae
et formosa oculis arma Sabina meis,
o utinam ad uestros sedeam captiua Penates,
dum captiua mei conspicer esse Tati !
Romani montes, et montibus addita Roma,
et ualeat probro Vesta pudenda meo !
Ille equus, ille meos in castra reponet amores,
cui Tatius dextras collocat ipse iubas !
Quid mirum patrios Scyllam secuisse capillos,
candidaque in saeuos inguina uersa canes ?
Prodita quid mirum fraterni cornua monstri,
cum patuit lecto stamine torta uia ?
Quantum ego sum Ausoniis crimen factura puellis,
improba uirgineo lecta ministra foco !
Pallados exstinctos si quis mirabitur ignes,
ignoscat : lacrimis spargitur ara meis.
Cras, ut rumor ait, tota pigrabitur urbe :
tum cape spinosi rorida terga iugi.
Lubrica tota uia est et perfida : quippe tacentis
fallaci celat limite semper aquas.
O utinam magicae nossem cantamina Musae !
Haec quoque formoso lingua tulisset opem.
Te toga picta decet, non quem sine matris honore
nutrit inhumanae dura papilla lupae.
Sic, hospes, pariamne tua regina sub aula ?
Dos tibi non humilis prodita Roma uenit.
Si minus, at raptae ne sint impune Sabinae,
me rape et alterna lege repende uices !
Commissas acies ego possum soluere nupta :
uos medium palla foedus inite mea.
Adde, Hymenaee, modos ; tubicen, fera murmura conde :
credite, uestra meus molliet arma torus.
Et iam quarta canit uenturam bucina lucem,
ipsaque in Oceanum sidera lapsa cadunt.
Experiar somnum, de te mihi somnia quaeram :
fac uenias oculis umbra benigna meis. »
Properce, Élégies, IV, 4, v. 19-66
(48 vers – 302 mots)
(1) Le sujet est Tarpeia.
Corrigé proposé par le jury
(Tarpeia) vit Tatius s’exercer au combat sur la plaine sablonneuse et brandir son bouclier peint au-dessus de la crinière fauve de son cheval : elle fut frappée de stupeur par la beauté du roi et par les armes royales et l’urne tomba d’entre ses mains oublieuses. Souvent elle prit injustement pour prétexte les présages de la lune et dit qu’elle devait plonger sa chevelure dans le fleuve ; souvent elle apporta des lys argentés aux Nymphes séduisantes, afin que la lance de Romulus ne blessât pas la beauté de Tatius ; et en remontant le Capitole obscurci par les premières fumées, elle ramena à elle ses bras écorchés par les piquants des ronces et assise, du haut de la citadelle tarpéienne, elle déplora en ces termes ses blessures, insupportables à Jupiter voisin :
« Ô feux du camp, tente de commandement de l’escadron de Tatius, armes sabines belles à mes yeux, oh !, puissé-je m’asseoir, captive, auprès de vos Pénates, pourvu que l’on me voie captive de mon cher Tatius ! Collines romaines, Rome posée sur ces collines et Vesta qui doit rougir de mon crime, adieu ! Ce cheval, oui !, ce cheval, dont Tatius dispose lui-même la crinière à droite, ramènera dans le camp mon amour ! Quoi d’étonnant à ce que Scylla ait coupé les cheveux de son père, à ce que son aine blanche ait été transformée en chiens cruels ? Quoi d’étonnant à ce que les cornes d’un frère monstrueux aient été trahies, quand le chemin plein de détours s’ouvrit grâce à une pelote de fil ? Quel grand déshonneur vais-je infliger aux filles d’Ausonie, moi, servante criminelle choisie pour le foyer virginal ! Si quelqu’un s’étonne de voir le feu de Pallas éteint, qu’il me pardonne : l’autel est inondé de mes larmes. Demain, comme le dit la rumeur, on fera trêve dans toute la ville : prends alors le flanc arrière, couvert de rosée, de cette crête pleine d’épines. Le chemin tout entier est glissant et traître : en effet, il cache toujours sous un sentier trompeur des eaux silencieuses. Ah ! si seulement j’avais appris les incantations de la Muse de la magie ! Ma langue aussi aurait apporté de l’aide au beau guerrier. C’est à toi que convient la toge brodée, non à celui qui, privé de l’honneur d’une mère, est nourri par la dure mamelle d’une louve inhumaine. Deviendrai-je mère ainsi, mon hôte, reine dans ton palais ? Ce n’est pas une humble dot – la trahison de Rome – qui vient à toi. Sinon, du moins, que l’enlèvement des Sabines ne demeure pas impuni : enlève-moi et fais payer les Romains en retour, par compensation ! C’est moi, si tu m’épouses, qui peux séparer les armées aux prises l’une avec l’autre : quant à vous, concluez un traité grâce à mon manteau nuptial. Ajoute ta musique, Hymen ; trompette, dissimule tes grondements sauvages ; croyez-moi, mon mariage adoucira vos armes. Et déjà, la trompette de la quatrième veille chante le jour à venir, et les étoiles elles-mêmes glissent et tombent dans l’Océan. Je tenterai de trouver le sommeil, je réclamerai des songes où tu m’apparais : fais en sorte de venir en ombre bienveillante pour mes yeux. »
Session 2022
Composition française
À propos du personnage créé par Edmond Rostand, Henri Scepi écrit :
« Lorsque Cyrano est annoncé, il est d’emblée qualifié d’hétéroclite. La disparate est sa loi ; il échappe à toute unité, se dérobe avant même d’apparaître à tout principe d’ordre et d’harmonie. Porteur d’un verbe qui l’illustre, Cyrano est le nom d’un discours placé sous le signe du mélange et de la discordance. » (Henri Scepi, « Edmond Rostand : les états de la poésie », Revue d’Histoire littéraire de la France, 118e année, n° 4, octobre-décembre 2018, p. 800-801).
Ce jugement est-il confirmé par votre lecture de Cyrano de Bergerac ?
Thème latin
Chez les Romains, […] la préoccupation du lieu où le corps dormirait son éternité était grande. D’abord, on avait enseveli dans la ville, et jusque dans l’intérieur des maisons ; mais ce mode de sépulture était contraire à la salubrité publique ; de plus, les cérémonies funèbres pouvaient à tout instant souiller les sacrifices de la ville ; en conséquence, une loi intervint qui défendait d’ensevelir ni de brûler dans l’intérieur de Rome. Deux ou trois familles de privilégiés seulement conservèrent ce droit à titre d’honneur public : c’étaient les familles de Publicola, de Tubertus et de Fabricius. Ce droit leur était fort envié.
Le triomphateur mort pendant le triomphe avait aussi droit d’être enterré dans Rome.
Aussi, bien rarement le vivant laissait-il le soin de son tombeau à ses héritiers. C’était une distraction qu’il se donnait à lui-même, de faire tailler son sépulcre sous ses yeux. […]
C’était en effet, pour un Romain, chose importante, comme on va le voir, que d’être enterré. D’après une tradition religieuse fort accréditée, même au temps de Cicéron, où ce genre de croyance commençait pourtant à disparaître, l’âme de tout individu privé de sépulture devait errer pendant cent ans sur les bords du Styx ; aussi quiconque rencontrait un cadavre le long de son chemin, et négligeait de lui donner la sépulture, commettait un sacrilège dont il ne pouvait se racheter qu’en sacrifiant une truie à Cérès.
Alexandre Dumas,
Isaac Laquedem
(243 mots)
Corrigé proposé par le jury
Romanorum multum intererat quo in loco corpus hominis mortui in perpetuum dormiturum esset. Primum enim in Vrbe corpora sepeliuerant, intus etiam in domibus ; sed hic modus sepeliendi publicae salubritati contrarius erat ; praeterea omni tempore sacra publica funeribus pollui poterant ; itaque lex lata est quae uetabat intus in Vrbe sepeliri nec cremari. Quod ius duae uel tres gentes quae praecipuo iure erant honoris causa publice retinuerunt. Hae erant Publicolae Tuberti Fabriciique gentes. Quae gentes ob illud ius apud ceteras magna in inuidia erant.
Illi qui triumphum obtinuerat ac dum triumphabat mortuus erat Romae sepeliri licebat.
Itaque perraro homo adhuc uiuus heredibus suis curandum sepulchrum tradebat. Haec erat oblectatio quam sibi dabat, monumentum ante oculos suos exsculpendum curare.
Nam Romano ciui magna res erat (iam enim uidebimus) sepeliri. E religione quadam cui maxima erat auctoritas, dum etiam Cicero uiuit, quamquam opinio eius generis iam euanescere coeperat, si quis insepultus erat, animam eius in Stygis ripis centum annos errare necesse erat ; itaque quicumque in itinere in cadauer aliquod incidebat atque id sepelire neglegebat, is nefandum facinus committebat quod expiare non poterat nisi suem Cereri immolabat.
Thème grec
L’ÂNE (1)
On ne fait pas attention que l’âne serait par lui-même, et pour nous, le premier, le plus beau, le mieux fait, le plus distingué des animaux, si dans le monde il n’y avait pas de cheval. Il est le second au lieu d’être le premier, et par cela seul il semble n’être plus rien. C’est la comparaison qui le dégrade, on le regarde, on le juge, non pas en lui-même, mais relativement au cheval : on oublie qu’il est âne, qu’il a toutes les qualités de sa nature, tous les dons attachés à son espèce ; et on ne pense qu’à la figure et aux qualités du cheval, qui lui manquent, et qu’il ne doit pas avoir.
Il est de son naturel aussi humble, aussi patient, aussi tranquille, que le cheval est fier, ardent, impétueux ; il souffre avec constance, et peut-être avec courage, les châtiments et les coups. Il est sobre et sur la quantité et sur la qualité de la nourriture : il se contente des herbes les plus dures et les plus désagréables, que le cheval et les autres animaux lui laissent et dédaignent. Il est fort délicat sur l’eau ; il ne veut boire que de la plus claire, et aux ruisseaux qui lui sont connus. Il boit aussi sobrement qu’il mange, et n’enfonce point du tout son nez dans l’eau, par la peur que lui fait, dit-on, l’ombre de ses oreilles.
Buffon,
Histoire naturelle des animaux
(251 mots)
(1) Le titre doit être traduit.
Corrigé proposé par le jury
Περὶ ὄνου
Οἱ ἄνθρωποι οὐ κατανοοῦσιν ὅτι ὁ ὄνος δι’αὑτὸν καὶ ἡμῖν τῶν ζῴων καὶ πρῶτον καὶ κάλλιστον καὶ εὐειδέστατον καὶ εὐπρεπέστατον ἂν ἦν, εἰ μὴ ἦν ἵππος ἐπὶ γῆς. Δεύτερος γάρ ἐστι, προσῆκον αὐτὸν πρῶτον εἶναι, διὰ δὲ τοῦτο μόνον οὐδὲν ἔτι δοκεῖ εἶναι. Ἅτε γὰρ παραβαλλόμενος ἀτιμάζεται, εἰς δ’αὐτὸν οἱ ἄνθρωποι ἀποβλέπουσι καὶ κρίνουσιν αὐτὸν οὐ κατ’αὐτόν, ἀλλὰ παρὰ τὸν ἵππον· ἐπιλανθάνονται δ’ὅτι ὄνος μέν ἐστι, πάντα δὲ τὰ τῆς ἑαυτοῦ φύσεως ἤθη ἔχει καὶ πάσας τὰς τῷ ἑαυτοῦ γένει προσαρμοττούσας δυνάμεις· ἐν δὲ νῷ μόνον ἔχουσι τὸ τοῦ ἵππου εἶδος καὶ τὰ ἤθη, ὧν ἐνδεῖται καὶ αὐτὰ οὐ χρὴ αὐτὸν ἔχειν.
Οὕτω δὲ ταπεινὸς καὶ καρτερικὸς καὶ ἥσυχος πέφυκε ὥσπερ καὶ ὁ ἵππος ὑπερήφανος καὶ ὀξὺς καὶ σόβαρος· τὰς δὲ τιμωρίας καὶ τὰς πληγὰς καρτερῶς καὶ ἴσως ἀνδρείως φέρει. Μέτριος δ’ἐστὶ περὶ τὰ σῖτα ὁπόσα καὶ ὁποῖα τρώγει· ἀρκεῖται γὰρ ταῖς σκληροτάταις καὶ ἀηδεστάταις βοτάναις αἷς ὁ ἵππος καὶ τὰ ἄλλα ζῷα ἀπολείπει αὐτῷ καὶ ὑπερορᾷ. Δυσαρεστότατος μέντοι ἐστὶ πρὸς τὸ ὕδωρ, καθαρώτατον μόνον πίνειν ἐθέλων καὶ ἀπὸ τῶν πηγῶν ὧν ἤδη ἔγνωκε. Οὕτω δὲ μετρίως πίνει ὥσπερ καὶ τρώγει καὶ οὐδαμῶς τὴν ῥῖνα εἰς τὸ ὕδωρ ἐμβάπτει φοβούμενος, ὡς λέγουσι, τῇ τῶν ὤτων σκιᾷ.
Version latine
Le narrateur assiste au festin donné par Trimalcion. Ce dernier, ivre, annonce qu’il a fait inscrire dans son testament l’affranchissement de tous ses esclaves.
Gratias agere omnes indulgentiae coeperant domini, cum ille oblitus nugarum exemplar testamenti iussit afferri et totum a primo ad ultimum ingemescente familia recitauit. Respiciens deinde Habinnam : « Quid dicis, inquit, amice carissime ? Aedificas monumentum meum, quemadmodum te iussi ? Valde te rogo ut secundum pedes statuae meae catellam pingas et coronas et unguenta et Petraitis (1) omnes pugnas, ut mihi contingat tuo beneficio post mortem uiuere ; praeterea ut sint in fronte pedes centum, in agrum pedes ducenti. Omne genus enim poma uolo sint circa cineres meos, et uinearum largiter. Valde enim falsum est uiuo quidem domos cultas esse, non curari eas ubi diutius nobis habitandum est. Et ideo ante omnia adici uolo : « Hoc monumentum heredem non sequatur ».
Ceterum erit mihi curae ut testamento caueam ne mortuus iniuriam accipiam. Praeponam enim unum ex libertis sepulcro meo custodiae causa, ne in monumentum meum populus cacatum currat. Te rogo ut naues etiam (2) monumenti mei facias plenis uelis euntes, et me in tribunali sedentem praetextatum cum anulis aureis quinque et nummos in publico de sacculo effundentem ; scis enim quod epulum dedi binos denarios. Faciatur, si tibi uidetur, et triclinia. Facies et totum populum sibi suauiter facientem. Ad dexteram meam pones statuam Fortunatae meae columbam tenentem, et catellam cingulo alligatam ducat, et cicaronem meum, et amphoras copiosas gypsatas, ne effluant uinum. Et urnam licet fractam sculpas, et super eam puerum plorantem. Horologium in medio, ut quisquis horas inspiciet, uelit nolit, nomen meum legat. Inscriptio quoque uide diligenter si haec satis idonea tibi uidetur : « C. Pompeius Trimalchio Maecenatianus hic requiescit. Huic seuiratus absenti decretus est. Cum posset in omnibus decuriis Romae esse, tamen noluit. Pius, fortis, fidelis, ex paruo creuit, sestertium reliquit trecenties, nec unquam philosophum audiuit. Vale. – Et tu. »
Haec ut dixit Trimalchio, flere coepit ubertim. Flebat et Fortunata, flebat et Habinnas, tota denique familia, tanquam in funus rogata, lamentatione triclinium impleuit. Immo iam coeperam etiam ego plorare, cum Trimalchio : « Ergo, inquit, cum sciamus nos morituros esse, quare non uiuamus ? Sic uos felices uideam, coniciamus nos in balneum, meo periculo, non paenitebit. Sic calet tanquam furnus. »
Pétrone,
Satiricon
(338 mots)
(1) Célèbre gladiateur.
(2) Sous-entendre in fronte après etiam.
Corrigé proposé par le jury
Tous s’étaient mis à rendre grâce au maître pour sa bonté quand celui-ci, laissant là la plaisanterie, fit apporter un exemplaire de son testament et le lut tout entier, de la première à la dernière ligne, au milieu des gémissements de la maisonnée. Puis, se tournant vers Habinnas, il lui demande : « Eh bien, très cher ami ? Fais-tu construire mon monument funéraire comme je te l’ai ordonné ? Je te prie instamment de faire représenter au pied de ma statue ma petite chienne, des couronnes de fleurs, des flacons de parfum et tous les combats de Pétraitès afin que, grâce à toi, il me soit donné de continuer à vivre après la mort. Prévois en outre cent pieds sur la façade et deux cents pieds en profondeur. Je veux en effet toutes sortes d’arbres fruitiers autour de mes cendres, et des vignes en abondance. Car il est vraiment absurde d’avoir de son vivant une maison pourvue de tous les ornements et de ne pas prendre soin de celle qu’on doit habiter plus longtemps. C’est d’ailleurs pourquoi je tiens par-dessus tout à ce qu’on ajoute ceci : « Que ce monument ne fasse pas partie de l’héritage ».
Du reste, j’aurai soin de me garder, par mon testament, de subir aucune injure une fois mort. Je placerai en effet devant mon tombeau l’un de mes affranchis, préposé à sa garde, afin que les gens pris d’un besoin pressant ne défèquent pas sur mon monument. Je te demande de faire représenter aussi, sur la façade, des bateaux qui naviguent à pleines voiles et moi-même, revêtu de la prétexte et portant cinq anneaux d’or, qui siège sur l’estrade et déverse sur le peuple des écus tirés d’une bourse ; comme tu le sais, j’ai effectivement offert un banquet public et deux deniers par personne. Qu’on y mette aussi, si bon te semble, une salle à manger. Et tu ajouteras tout le peuple en train de se régaler. À ma droite, tu feras placer une statue de ma chère Fortunata tenant une colombe – qu’elle mène aussi en laisse une petite chienne –, et ensuite mon petit mignon, et encore de larges amphores, bien cachetées pour qu’elles ne laissent pas se répandre le vin. Tu peux aussi sculpter une urne brisée, avec un enfant qui pleure au-dessus. Une horlogeau centre, pour que quiconque regarde l’heure, qu’il le veuille ou non, lise mon nom. Quant à l’inscription, sois attentif et vois si celle-ci te semble assez adaptée : « Ici repose Gaius Pompeius Trimalchio Maecenatianus. Le sévirat lui fut décerné en son absence. Alors qu’à Rome il aurait pu appartenir à toutes les confréries, il ne le voulut pas. Pieux, courageux, loyal, il partit de peu, laissa trente millions de sesterces et ne suivit jamais les leçons d’un philosophe. Porte-toi bien. – Toi aussi. »
En achevant ces mots, Trimalcion se mit à pleurer à chaudes larmes. Fortunata pleurait aussi, et Habinnas pleurait, et toute la maisonnée, comme si elle était réunie pour son enterrement, emplit la salle à manger de lamentations. Mieux encore, je m’étais mis moi aussi à sangloter lorsque Trimalcion dit : « Eh bien, puisque que nous savons que nous sommes voués à mourir, pourquoi ne pas vivre maintenant ? Aussi vrai que je veux vous voir heureux, jetons-nous dans le bain, à mes risques et périls, vous ne le regretterez pas. Il est chaud comme un four. »
Session 2023
Rapport du jury 2023 et sujets des compositions de grammaire
Composition française
« La Recherche du temps perdu, en fait, est une recherche de la vérité. Si elle s’appelle recherche du temps perdu, c’est seulement dans la mesure où la vérité a un rapport essentiel avec le temps. Aussi bien en amour que dans la nature ou dans l’art, il ne s’agit pas de plaisir, mais de vérité. »
Gilles Deleuze, Proust et les signes, Paris, PUF, 2014, chapitre II, p. 23
Ce jugement est-il confirmé par votre lecture de l’œuvre de Marcel Proust, Le Temps retrouvé ?
Thème latin
UNE MÉCHANTE FEMME (1)
Pygmalion, selon sa coutume, la fit boire la première ; elle but sans crainte, se fiant au contre-poison. Pygmalion but aussi, et peu de temps après il tomba dans une défaillance. Astarbé (2), qui le connaissait capable de la tuer sur le moindre soupçon, commença à déchirer ses habits, à arracher ses cheveux, et à pousser des cris lamentables ; elle embrassait le roi mourant, elle le tenait serré entre ses bras ; elle l’arrosait d’un torrent de larmes, car les larmes ne coûtaient rien à cette femme artificieuse. Enfin, quand elle vit que les forces du roi étaient épuisées, et qu’il était comme agonisant, dans la crainte qu’il ne revînt et qu’il ne voulût la faire mourir avec lui, elle passa des caresses et des plus tendres marques d’amitié à la plus horrible fureur ; elle se jeta sur lui, et l’étouffa. Ensuite elle arracha de son doigt l’anneau royal, lui ôta le diadème, et fit entrer Joazar (3), à qui elle donna l’un et l’autre.
Elle crut que tous ceux qui avaient été attachés à elle ne manqueraient pas de suivre sa passion, et que son amant serait proclamé roi. Mais ceux qui avaient été les plus empressés à lui plaire étaient des esprits bas et mercenaires, qui étaient incapables d’une sincère affection ; d’ailleurs ils manquaient de courage, et craignaient les ennemis qu’Astarbé s’était attirés ; enfin ils craignaient encore plus la hauteur, la dissimulation et la cruauté de cette femme impie : chacun, pour sa propre sûreté, désirait qu’elle pérît.
Fénelon,
Les Aventures de Télémaque, VII
(1) Traduire le titre.
(2) Traduire par Astarba, ae, f.
(3) Traduire par Ioazar, aris, m.
Corrigé proposé par le jury
De improba muliere quadam
Illa, postquam Pygmalion more suo eam iussit primam bibere, sine timore, antidoto (1) confisa, sic bibit ut Pygmalion quoque biberit et paulo post eum animus reliquerit. Astarba autem, quae cognouerat eum posse ipsam interficere, si quam in suspicionem caderet / cecidisset, uestitus suos lacerare coepit atque crines scindere ac flebiliter gemere et regem morientem osculans lacertisque suis amplexa ui lacrimarum (2) conspergebat, nam nullus ei callidae mulieri labor erat flere. Denique, ut primum uidit regem, uiribus exhaustis, quasi extremum uitae spiritum edere, cum timeret ne recreatus ipsam secum mori iuberet, ex adulationibus uehementissimique amoris indiciis ad immanissimum furorem commutans, in eum subito aggressa suffocauit. Deinde, anulum ab eius digito arreptum et diadema demptum Ioazari iusso ingredi utrumque dedit. Tunc, quamquam illa credidit fore ut omnes ei qui sibi deuincti essent suam libidinem certo sequerentur suusque adulter rex crearetur, illi tamen qui studiosissimi fuerant in ea colenda, cum essent abiecti uenalesque animis nec possent sincerius diligere quemquam, ceterum uirtute carerent iidemque cum hostes quos contra se ipsa Astarba coegisset, tum etiam magis illius impiae mulieris superbiam, dissimulationem saeuitiamque timerent, omnes pro sua quisque salute cupiebant eam mori.
(1) Le terme antidotum est non classique, mais il a l’avantage d’être plus précis que le simple remedium.
(2) L’expression uis lacrimarum au sens de « torrent de larmes », « larmes abondantes » est chez Cicéron, Rep., 6, 14. Nous l’avons trouvée et valorisée dans plusieurs copies. [L’expression était donnée dans le Gaffiot.]
Thème grec
« Ô Macarée ! me dit un jour le grand Chiron dont je suivais la vieillesse, nous sommes tous deux centaures des montagnes ; mais que nos pratiques sont opposées ! Vous le voyez, tous les soins de mes journées consistent dans la recherche des plantes, et vous, vous êtes semblable à ces mortels qui ont recueilli sur les eaux ou dans les bois et porté à leurs lèvres quelques fragments du chalumeau rompu par le dieu Pan. Dès lors ces mortels, ayant respiré dans ces débris du dieu un esprit sauvage ou peut-être gagné quelque fureur secrète, entrent dans les déserts, se plongent aux forêts, côtoient les eaux, se mêlent aux montagnes, inquiets et portés d’un dessein inconnu. Les cavales aimées par les vents dans la Scythie la plus lointaine ne sont ni plus farouches que vous, ni plus tristes le soir, quand l’Aquilon (1) s’est retiré. Cherchez-vous les dieux, ô Macarée ! et d’où sont issus les hommes, les animaux et les principes du feu universel ? Mais le vieil Océan, père de toutes choses, retient en lui-même ces secrets, et les nymphes qui l’entourent décrivent en chantant un chœur éternel devant lui, pour couvrir ce qui pourrait s’évader de ses lèvres entr’ouvertes par le sommeil. Les mortels qui touchèrent les dieux par leur vertu ont reçu de leurs mains des lyres pour charmer les peuples, ou des semences nouvelles pour les enrichir, mais rien de leur bouche inexorable. »
Maurice de Guérin,
Le Centaure (1840)
(1) Traduire l’Aquilon par ὁ βορέας.
Corrigé proposé par le jury
« Ὦ Μακαρεῦ, Χείρων ὁ μέγας ποτέ μοι ἔφη, ὅθ’ εἱπόμην αὐτῷ καταγεγηρακότι· ἀμφότεροι μὲν οὖν κένταυροί ἐσμεν ἐκ τῶν ὀρῶν · ὡς δ’ ἐναντία τὰ ἔθη ἡμῶν. Ὧσπερ γὰρ ὁρᾷς, ἐγὼ μὲν πᾶσαν τὴν ἡμέραν φροντίζω ὅπως φυτὰ ζητήσω, σὺ δ’ ὅμοιος εἶ τοῖς θνητοῖς οἳ παρὰ τῶν ποταμῶν ἢ τῶν ὑλῶν συνέλεξαν καὶ πρὸς τὰ στόματα προσήνεγκαν μέρη τινὰ τοῦ καλάμου τούτου, οὗ Πὰν ὁ θεὸς κατέαξεν. Ἐντεῦθεν γὰρ οἱ θνητοὶ οὗτοι, ἅτε πνεῦμά τι ἄγριον ἐν τοῖς ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἀπολειφθεῖσι πνεύσαντες ἢ καὶ μανίαν ἀπόκρυφόν τινα ἴσως ἀπολαβόντες, εἰς τὰ ἔρημα εἰσέρχονται καὶ εἰς μέσας τὰς ὕλας ὁρμῶσι καὶ παρὰ τοὺς ποταμοὺς βαίνουσι καὶ εἰς τὰ ὄρη φοιτῶσιν, ἀκαταστάτως ἔχοντες καὶ ὁρμῇ ἀγνώστῳ φερόμενοι. Αἱ δὲ παρὰ τοῖς ἐσχάτοις Σκύθαις ἵπποι, ὅταν ὑπὸ τῶν ἀνέμων φιλῶνται, οὔτε δειλότεραί σου, οὔτε μᾶλλον σκυθρωποὶ πρὸς τὴν ἑσπέραν, ἐπειδὰν ὁ βορέας ἀπολίπῃ. Ἆρ’ οὖν τοὺς θεοὺς ζητεῖς, ὦ Μακαρεῦ, καὶ πόθεν ἐγένοντο οἱ ἄνθρωποι καὶ τὰ ἄλλα ζῷα καὶ αἱ ἀρχαὶ αἱ τοῦ καθόλου πυρός ; Ὁ μέντοι Ὠκεανὸς ὁ παλαιός, πατὴρ ὢν τῶν πάντων, ταῦτα τὰ ἀπόρρητα ἐν ἑαυτῷ κατέχει, καὶ αἱ περὶ αὐτὸν νύμφαι ἀΐδιον χορείαν πρὸ αὐτοῦ χορεύουσιν ᾄδουσαι, μὴ ἀκουσθῇ ὅσα κινδυνεύοι ἂν καθεύδων ἐκ τῶν ἑαυτοῦ ἀκλῄστων χειλῶν ἀφιέναι. Οἱ δὲ θνητοὶ οἳ τοὺς θεοὺς ταῖς ἑαυτῶν ἀρεταῖς ἐκίνησαν λύρας ἔλαβον ἀπὸ τῶν ἐκείνων χειρῶν, ὥστε τὰ ἔθνη κηλεῖν, ἢ νέα σπέρματα, ὥστε ταῦτα πλουτίζειν, οὐδὲν μέντοι ἐκ τῶν ἀπαραιτήτων στομάτων τῶν ἐκείνων. »
Version latine
LA SATIRE, UN GENRE POÉTIQUE ?
Le poète cherche à rassurer ceux qui redoutent la sévérité de ses vers : la satire est inoffensive.
[…] Quem uis media elige turba ;
aut ob auaritiam aut misera ambitione laborat.
Hic nuptarum insanit amoribus, hic puerorum ;
hunc capit argenti splendor, stupet Albius (1) aere ;
hic mutat merces surgente a sole ad eum quo
uespertina tepet regio ; quin per mala praeceps
fertur, uti puluis collectus turbine, ne quid
summa deperdat metuens aut ampliet ut rem.
Omnes hi metuunt uersus, odere poetas.
« Faenum habet in cornu (2), longe fuge ; dummodo risum
excutiat sibi, non hic cuiquam parcet amico,
et quodcumque semel chartis illeuerit, omnis
gestiet (3) a furno redeuntis scire lacuque
et pueros et anus. » Agedum, pauca accipe contra.
Primum ego me illorum, dederim quibus esse poetis,
excerpam numero ; neque enim concludere uersum
dixeris esse satis, neque, siqui scribat uti nos
sermoni propiora, putes hunc esse poetam.
Ingenium cui sit, cui mens diuinior atque os
magna sonaturum, des nominis huius honorem.
Idcirco quidam, comoedia necne poema
esset, quaesiuere, quod acer spiritus ac uis
nec uerbis nec rebus inest, nisi quod pede certo
differt sermoni, sermo merus. « At pater ardens
saeuit, quod meretrice nepos insanus amica
filius uxorem grandi cum dote recuset,
ebrius et, magnum quod dedecus, ambulet ante
noctem cum facibus. » Numqui Pomponius (4) istis
audiret leuiora, pater si uiueret ? Ergo
non satis est puris uersum perscribere uerbis,
quem si dissoluas, quiuis stomachetur eodem
quo personatus pacto pater. His, ego quae nunc,
olim quae scripsit Lucilius, eripias si
tempora certa modosque, et quod prius ordine uerbum est
posterius facias, praeponens ultima primis,
non, ut si soluas « Postquam Discordia taetra
belli ferratos postis portasque refregit »,
inuenias etiam disiecti membra poetae.
Hactenus haec : alias iustum sit necne poema,
nunc illud tantum quaeram, meritone tibi sit
suspectum genus hoc scribendi. Sulcius acer
ambulat et Caprius (5), rauci male cumque libellis,
magnus uterque timor latronibus ; at bene siquis
et uiuat puris manibus, contemnat utrumque.
Vt sis tu similis Caeli Birrique latronum,
non ego sim Capri neque Sulci ; cur metuas me ?
Horace,
Satires, I, 4, v. 25-70
(1) Personnage inconnu.
(2) On mettait du foin aux cornes des bœufs dangereux pour avertir les passants de s’en méfier.
(3) Gestiet : construction inhabituelle ici, avec une proposition infinitive.
(4) Personnage inconnu.
(5) Sulcius et Caprius : avocats qui exerçaient le métier (peu estimé) d’accusateurs.
Corrigé proposé par le jury
Choisis n’importe qui au milieu de la foule ; c’est par cupidité ou par une misérable ambition qu’il se donne de la peine. L’un perd la raison à cause de son amour des femmes mariées, un autre à cause de son amour pour les jeunes garçons ; un troisième est captivé par l’éclat de l’argent, Albius demeure interdit devant le bronze. Un autre encore échange ses marchandises depuis le soleil du levant jusqu’au soleil qui tiédit les contrées du couchant ; bien plus, il est emporté, tête la première, au milieu des malheurs, comme la poussière prise dans un tourbillon, craignant de perdre une partie de son capital ou pour augmenter ses revenus. Toutes ces personnes craignent les vers, haïssent les poètes.
« Il a du foin sur la corne, fuis au loin ; pourvu qu’il s’arrache un rire à lui-même, il n’épargnera aucun ami, et dès qu’il aura barbouillé quelque chose sur ses papiers, il sera impatient que le connaissent tous ceux qui reviennent du four et de la fontaine, jeunes garçons et vieilles femmes. »
Allons ! Écoute ces quelques objections. D’abord, moi, je me retirerai du nombre de ceux auxquels je suis prêt à donner le nom de poètes. En effet, tu ne dirais pas qu’il suffit d’achever un vers régulier, et si quelqu’un écrivait, comme moi, des vers assez proches du parler quotidien, tu ne saurais le considérer comme poète. Mais à un homme qui aurait du talent, un esprit presque divin et une bouche faite pour faire entendre de grandes paroles, tu pourrais donner l’honneur de ce nom. Pour cette raison, certains se sont demandé si la comédie était ou non un poème, parce que l’inspiration vive et la force n’y résident ni dans le fond, ni dans la forme, et, si l’on omet le fait qu’elle diffère de la conversation par un pied fixe, elle est pure conversation. « Mais un père enflammé de colère se montre cruel, parce que son fils prodigue, fou d’amour pour une courtisane qui est son amie, refuse une épouse pourvue d’une grande dot et, ivre, se promène avant la tombée de la nuit avec des torches, ce qui constitue un grand déshonneur. » Est-ce que Pomponius entendrait des paroles plus frivoles que celles-là, si son père était en vie ? Donc, il ne suffit pas d’écrire tout un vers avec des mots purs : si tu le disloquais, rien ne distinguerait du premier venu le père de comédie qui se met en colère. Si à ces vers, que je compose aujourd’hui, que Lucilius composa autrefois, tu enlevais les temps et les rythmes fixés, si tu mettais à la fin le mot qui, dans l’ordre, vient en premier, en faisant passer les derniers mots en premier, comme si tu défaisais ces vers : « Après que la noire Discorde eut brisé les montants en fer et les portes de la guerre », tu ne trouverais pas même les membres du poète désarticulé. En voilà assez : nous verrons une autre fois si c’est un vrai poème ou non ; à présent, je me demanderai seulement si c’est à juste titre que ce genre d’écrit t’est suspect. Les terribles Sulcius et Caprius se promènent, fortement enroués et, avec leurs carnets de notes, tous deux objets d’une grande crainte de la part des brigands ; mais quiconque vivant honnêtement, les mains innocentes, les mépriserait l’un et l’autre. Supposons que tu sois semblable aux brigands Caelus et Birrius : pour ma part, je ne saurais ressembler à Caprius et Sulcius ; pourquoi me craindre ?
Session 2024
Rapport du jury 2024 et sujets des compositions de grammaire
Composition française
« Pour trouver la vérité, il suffit donc d’écouter le mémorialiste, mais de l’écouter autrement : ses Mémoires parlent pour lui, comme un corps qu’il s’agirait pour le lecteur d’étudier. Tout ceci attribue une valeur nouvelle à l’erreur : elle n’est plus obstacle vers la vérité, mais matériau privilégié pour l’étude de la subjectivité. » (Audrey Faulot, « La valeur de l’erreur dans l’Histoire d’une Grecque moderne de Prévost », Études françaises, vol. 54, n° 3, 2018, p. 41)
Ce jugement vous paraît-il confirmé par votre lecture de l’Histoire d’une Grecque moderne de Prévost ?
Thème latin
AU LECTEUR (1)
Deux écoliers allaient ensemble de Peñafiel (2) à Salamanque (3). Se sentant las et altérés, ils s’arrêtèrent au bord d’une fontaine qu’ils rencontrèrent sur leur chemin. Là, tand is qu’ils se délassaient après s’être désaltérés, ils aperçurent par hasard, auprès d’eux, sur une pierre à fleur de terre, quelques mots déjà un peu effacés par le temps et par les pieds des troupeaux qu’on venait abreuver à cette fontaine. Ils jetèrent de l’eau sur la pierre pour la laver, et ils lurent ces paroles castillanes (4) : « Ici est enfermée l’âme du licencié (5) Pierre Garcias ». Le plus jeune des écoliers, qui était vif et étourdi, n’eut pas achevé de lire l’inscription, qu’il dit, en riant de toute sa force : Rien n’est plus plaisant ! Ici est enfermée l’âme… Une âme enfermée !… Je voudrais savoir quel original a pu faire une si ridicule épitaphe. En achevant ces mots, il se leva pour s’en aller. Son compagnon, plus judicieux, dit en lui-même : Il y a là-dessous quelque mystère ; je veux demeurer ici pour l’éclaircir. Celui-ci laissa donc partir l’autre ; et, sans perdre de temps, se mit à creuser avec son couteau tout autour de la pierre. Il fit si bien qu’il l’enleva. Il trouva dessous une bourse de cuir qu’il ouvrit. Il y avait dedans cent ducats (6), avec une carte sur laquelle étaient écrites ces paroles en latin : « Sois mon héritier, toi qui as eu assez d’esprit pour démêler le sens de l’inscription, et fais un meilleur usage que moi de mon argent ». L’écolier, ravi de cette découverte, remit la pierre comme auparavant, et reprit le chemin de Salamanque avec l’âme du licencié.
Lesage,
Histoire de Gil Blas de Santillane, « Au lecteur »
(1) Traduire le titre.
(2) Peñafiel : Compleutica, –ae.
(3) Salamanque : Salmantica, –ae.
(4) Utiliser l’adverbe Hispanice.
(5) « licencié » : utiliser doctor, –oris.
(6) Traduire par « sesterces ».
Thème grec
Comme tous ceux qui composent un Etat, ont besoin de sa protection pour subsister, et se maintenir chacun dans son état et sa situation naturelle, il est raisonnable que tous contribuent aussi selon leurs Revenus, à ses dépenses et à son entretien : c’est l’intention des Maximes mises au commencement de ces Memoires. Rien n’est donc si injuste, que d’exempter de cette contribution ceux qui sont le plus en état de la payer, pour en rejetter le fardeau sur les moins accommodez qui succombent sous le faix ; lequel seroit d’ailleurs trés-léger, s’il étoit porté par tous à proportion des forces d’un chacun ; d’où il suit que toute Exemption à cet égard est un desordre qui doit être corrigé. Après beaucoup de réflexions et d’experiences, il m’a parû que le Roy avoit un moyen seur et efficace pour remedier à tous ces maux, presens et à venir. Ce moyen consiste à faire contribuer un chacun selon son Revenu au besoin de l’Etat ; mais d’une maniere aisée et facile, par une proportion dont personne n’aura lieu de se plaindre, parce qu’elle sera tellement répanduë et distribuée, que quoy qu’elle soit également portée par tous les Particuliers, depuis le plus grand jusqu’au plus petit, aucun n’en sera surchargé, parce que personne n’en portera qu’à proportion de son Revenu. Ce moyen aura encore cette facilité, que dans les temps fâcheux il fournira les fonds necessaires, sans avoir recours à aucune Affaire extraordinaire, en augmentant seulement la quotité des levées à proportion des besoins de l’Etat.
Sébastien Le Prestre de Vauban,
La Dîme royale (1707)
Version latine
En 323 av. J.-C., Alexandre meurt à Babylone, empoisonné. Ses généraux se partagent alors l’Empire, avant même de songer aux devoirs funèbres à rendre à son corps…
Credidere quidam testamento Alexandri distributas esse prouincias ; sed famam eius rei, quamquam ab auctoribus tradita est, uanam fuisse conperimus. Et quidem suas quisque opes diuisis imperii partibus, ut uidebatur, ipsi fundauerant, si umquam aduersus inmodicas cupiditates terminus staret. Quippe paulo ante regis ministri specie imperii alieni procurandi singuli ingentia inuaserant regna sublatis certaminum causis, cum et omnes eiusdem gentis essent, et a ceteris sui quisque imperii regione discreti. Sed difficile erat eo contentos esse, quod obtulerat occasio : quippe sordent prima quaeque, cum maiora sperantur. Itaque omnibus expeditius uidebatur augere regna, quam fuisset accipere. Septimus dies erat, ex quo corpus regis iacebat in solio, curis omnium ad formandum publicum statum a tam sollemni munere auersis. Et non alias quam Mesopotamiae regione feruidior aestus existit, adeo ut pleraque animalia, quae in nudo solo deprehendit, extinguat : tantus est uapor solis et caeli, quo cuncta uelut igne torrentur ! Fontes aquarum et rari sunt, et incolentium fraude celantur : ipsis usus patet ; ignotus est aduenis. Traditum magis quam creditum refero : ut tandem curare corpus exanimum amicis uacauit, nulla tabe, ne minimo quidem liuore corruptum uidere qui intrauerant. Vigor quoque, qui constat ex spiritu, nondum destituerat uultum. Itaque Aegyptii Chaldaeique iussi corpus suo more curare primo non sunt ausi admouere uelut spiranti manus. Deinde precati, ut ius fasque esset mortalibus attrectare deum, purgauere corpus ; repletumque est odoribus aureum solium, et capiti adiecta fortunae eius insignia. Veneno necatum esse credidere plerique : filium Antipatri inter ministros, Iollam nomine, patris iussu dedisse. Saepe certe audita erat uox Alexandri Antipatrum regium adfectare fastigium, maioremque esse praefecti opibus ac titulo Spartanae uictoriae inflatum, omnia a se data adserentem sibi. Credebant etiam Craterum cum ueterum militum manu ad interficiendum eum missum. Vim autem ueneni, quod in Macedonia gignitur, talem esse constat, ut ferrum quoque exurat, ungulam iumenti dumtaxat patientem esse constat suci. Stygem appellant fontem, ex quo pestiferum uirus emanat. Hoc per Cassandrum adlatum traditumque fratri Iollae et ab eo supremae regis potioni inditum. Haec, utcumque sunt credita, eorum, quos rumor asperserat, mox potentia extinxit. Regnum enim Macedoniae Antipater et Graeciam quoque inuasit. Suboles deinde excepit interfectis omnibus, quicumque Alexandrum etiam longinqua cognatione contigerant.
Quinte Curce, Histoires d’Alexandre
Session 2025
Rapport du jury 2025 et sujets des compositions de grammaire
Composition française
Pour Vigny, la littérature est au service de la philosophie – pour l’expliquer ou l’illustrer dans le cas du roman et du théâtre, pour la condenser en poésie. Le poème, tel qu’il le conçoit, est donc une cristallisation de pensée pure, et doit se débarrasser de tout ornement inutile. De là cette formule célèbre du Journal d’un poète, qui résonne d’une vraie modernité : « Le silence est la poésie même pour moi. »
Ce jugement vous paraît-il confirmé par votre lecture des Poèmes antiques et modernes et des Poèmes philosophiques d’Alfred de Vigny ?
Thème latin
LA DENT D’OR (1)
Assurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter de la cause. Il est vrai que cette méthode est bien lente pour la plupart des gens qui courent naturellement à la cause, et passent par-dessus la vérité du fait ; mais enfin nous éviterons le ridicule d’avoir trouvé la cause de ce qui n’est point.
Ce malheur arriva si plaisamment sur la fin du siècle passé à quelques savants d’Allemagne, que je ne puis m’empêcher d’en parler ici.
En 1593, le bruit courut que les dents étant tombées à un enfant de Silésie (2), âgé de sept ans, il lui en était venu une d’or à la place d’une de ses grosses dents. Horstius, professeur en médecine dans l’université de Helmstad (3), écrivit l’histoire de cette dent, et prétendit qu’elle était en partie naturelle, en partie miraculeuse, et qu’elle avait été envoyée de Dieu à cet enfant, pour consoler les chrétiens affligés par les Turcs. Figurez-vous quelle consolation, et quel rapport de cette dent aux chrétiens ni aux Turcs. En la même année, afin que cette dent d’or ne manquât pas d’historiens, Rullandus en écrit encore l’histoire. Deux ans après, Ingolsteterus, autre savant, écrit contre le sentiment que Rullandus avait de la dent d’or. […] Il ne manquait autre chose à tant de beaux ouvrages, sinon qu’il fût vrai que la dent était d’or. Quand un orfèvre l’eut examinée, il se trouva que c’était une feuille d’or appliquée à la dent, avec beaucoup d’adresse ; mais on commença par faire des livres, et puis on consulta l’orfèvre.
Rien n’est plus naturel que d’en faire autant sur toutes sortes de matières. […] Cela veut dire que, non seulement nous n’avons pas les principes qui mènent au vrai, mais que nous en avons d’autres qui s’accommodent très bien avec le faux.
Bernard Le Bouyer de Fontenelle,
Histoire des oracles, 1686
(1) Traduire le titre.
(2) Traduire par Silesia, ae, f.
(3) Traduire « Helmstad » par « allemande ».
Thème grec
SUR LA VIEILLESSE (1)
Quand nous sommes jeunes, l’opinion du monde nous gouverne, et nous nous étudions plus à être bien avec les autres qu’avec nous ; arrivés enfin à la vieillesse, nous trouvons moins précieux ce qui est étranger ; rien ne nous occupe tant que nous-mêmes, qui sommes sur le point de nous manquer. Il en est de la vie comme de nos autres biens ; tout se dissipe quand on pense en avoir un grand fonds : l’économie ne devient exacte que pour ménager le peu qui nous reste. C’est par là qu’on voit faire aux jeunes gens comme une profusion de leur être, quand ils croient avoir longtemps à le posséder. Nous nous devenons plus chers à mesure que nous sommes plus prêts de nous perdre. Autrefois mon imagination errante et vagabonde se portait à toutes les choses étrangères ; aujourd’hui mon esprit se ramène au corps et s’y unit davantage. À la vérité ce n’est point par le plaisir d’une douce liaison ; c’est par la nécessité du secours et de l’appui mutuel qu’ils cherchent à se donner l’un à l’autre.
En cet état languissant, je ne laisse pas de me conserver encore quelques plaisirs ; mais j’ai perdu tous les sentiments du vice, sans savoir si je dois ce changement à la faiblesse d’un corps abattu, ou à la modération d’un esprit devenu plus sage qu’il n’était auparavant.
Saint-Évremond, À M. le maréchal de Créqui,
qui m’avait demandé en quelle situation était mon esprit,
et ce que je pensais sur toutes choses dans ma vieillesse
(1) Traduire le titre.
Version latine
PUDENTILLA
Accusé d’avoir ensorcelé Pudentilla pour l’épouser et capter son héritage, Apulée se défend en dressant le portrait d’une Pudentilla tout à fait saine d’esprit. Aemilia Pudentilla, quae nunc mihi uxor est, ex quodam Sicinio Amico, quicum antea nupta fuerat, Pontianum et Pudentem filios genuit eosque pupillos relictos in potestate paterni aui – nam superstite patre Amicus decesserat – per annos ferme quattuordecim memorabili pietate sedulo aluit, non tamen libenter in ipso aetatis suae flore tam diu uidua. Sed puerorum auus inuitam eam conciliare studebat filio suo Sicinio Claro eoque ceteros procos absterrebat ; et praeterea minabatur, si extrario nupsisset, nihil se filiis eius ex paternis eorum bonis testamento relicturum. Quam condicionem cum obstinate propositam uideret mulier sapiens et egregie pia, ne quid filiis suis eo nomine incommodaret, facit quidem tabulas nuptiales cum quo iubebatur, cum Sicinio Claro, uerum enimuero uariis frustrationibus nuptias eludit eo ad (1) dum puerorum auus fato concessit, relictis filiis eius heredibus ita ut Pontianus, qui maior natu erat, fratri suo tutor esset.
Eo scrupulo liberata, cum a principibus uiris in matrimonium peteretur, decreuit sibi diutius in uiduitate non permanendum ; quippe ut solitudinis taedium perpeti posset, tamen aegritudinem corporis ferre non poterat. Mulier sancte pudica, tot annis uiduitatis sine culpa, sine fabula, assuetudine coniugis torpens et diutino situ uiscerum saucia, uitiatis intimis uteri saepe ad extremum uitae discrimen doloribus obortis exanimabatur. Medici cum obstetricibus consentiebant penuria matrimonii morbum quaesitum, malum in dies augeri, aegritudinem ingrauescere ; dum aetatis aliquid supersit, nuptiis ualetudinem medicandum. Consilium istud cum alii approbant, tum maxime Aemilianus iste, qui paulo prius confidentissimo mendacio adseuerabat numquam de nuptiis Pudentillam cogitasse, priusquam foret magicis maleficiis a me coacta, me solum repertum, qui uiduitatis eius uelut quandam uirginitatem carminibus et uenenis uiolarem. Saepe audiui non de nihilo dici mendacem memorem esse oportere ; at tibi, Aemiliane, non uenit in mentem, priusquam ego Oeam uenirem, te litteras etiam, uti nuberet, scripsisse ad filium eius Pontianum, qui tum adultus Romae agebat. Cedo tu epistulam uel potius da ipsi : legat, sua sibi uoce suisque uerbis sese reuincat.
Estne haec tua epistula ? quid palluisti ? nam erubescere tu quidem non potes. Estne tua ista subscriptio ? Recita (2) quaeso clarius, ut omnes intellegant quantum lingua eius manu discrepet, quantumque minor illi sit mecum quam secum dissensio. Scripsistine haec, Aemiliane, quae lecta sunt ?
Apulée,
Apologie
(1) Eo ad = eoad.
(2) Apulée s’adresse ici au greffier.