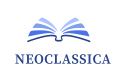Voir le Projet II.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues,
ne fût-ce que pour un petit sujet !
Les cinq sujets des épreuves écrites de l’Agrégation externe de Lettres classiques sont regroupés sur cette page et ils sont présentés selon l’ordre actuel de déroulement des épreuves. La page est progressivement complétée. Une fois complète, elle réunira plus de 300 sujets. Pour l’heure, elle en comprend 145 in extenso ainsi que de nombreux corrigés.
Les programmes, sujets et rapports des quelques dernières années se trouvent aussi, au format PDF, sur le site du ministère de l’Éducation nationale, de même que le descriptif des épreuves. Le site Arrête ton char propose, au format PDF, de nombreux programmes, sujets et rapports, sur plusieurs décennies. Une partie des programmes des sessions antérieures se trouve sur Wikipédia. On peut aussi en trouver de plus anciens dans les Bulletins officiels de l’Éducation nationale. Voir également cette page pour quelques anciens rapports du jury (2004-2007).
Les sujets de 2008 à aujourd’hui sont regroupés, en format PDF, sur le site du Département des Sciences de l’Antiquité de l’École normale supérieure de Paris, avec les rapports du jury. Les sujets de 1983 à 1999 et ceux de 2000 à 2019 ont fait l’objet d’une publication au format papier qui les regroupe tous. Afin de ne pas faire de tort aux Publications de l’Université de Saint-Étienne avec lesquelles j’ai collaboré pour les annales, susmentionnées, des agrégations externes de Lettres classiques et de Grammaire, les sujets de 2000 à 2019 ne seront présentés ici que sous la forme de liens vers les sujets en question.
Quelques copies de concours se trouvent sur cette page (voir le Projet I).
Les synopsis en début de page permettent de se faire une idée des auteur, des textes et des sujets qui tombent.
Lorsque le jury propose un corrigé pour les versions et les thèmes, nous le reproduisons ici. Ces textes appartiennent évidemment à leurs autrices et auteurs et à https://www.devenirenseignant.gouv.fr. Les explications plus détaillées se trouvent dans les rapports de jury.
Cette agrégation est devenue mixte lors de la session 1976.
SYNOPSIS DES SUJETS
Dissertation française
Moyen Âge : 2/72
XVIe siècle : 8/72
XVIIe siècle : 18/72
XVIIIe siècle : 14/72
XIXe siècle : 16/72
XXe siècle : 14/72
1962 F : ?
1962 H : Du Bellay (XVIe siècle)
1963 F : Flaubert (XIXe siècle)
1963 H : Marivaux (XVIIIe siècle)
1964 F : ?
1964 H : Molière (XVIIe siècle)
1965 F : La Bruyère (XVIIe siècle)
1965 H : Verlaine (XIXe siècle)
1966 F : Pascal (XVIIe siècle)
1966 H : Valéry (XXe siècle)
1967 F : Apollinaire (XXe siècle)
1967 H : Voltaire (XVIIIe siècle)
1968 F : /
1968 H : /
1969 F : ?
1969 H : Proust (XXe siècle)
1969 H (session spéciale) : Baudelaire (XIXe siècle)
1970 F : ?
1970 H : Hugo (XIXe siècle)
1971 F : Marivaux (XVIIIe siècle)
1971 H : Marivaux (XVIIIe siècle)
1972 F : Racine (XVIIe siècle)
1972 H : Racine (XVIIe siècle)
1973 F : Flaubert (XIXe siècle)
1973 H : Flaubert (XIXe siècle)
1974 F : Voltaire (XVIIIe siècle)
1974 H : Voltaire (XVIIIe siècle)
1975 F : Corneille (XVIIe siècle)
1975 H : Corneille (XVIIe siècle)
1976 : Giraudoux (XXe siècle)
1977 : Montesquieu (XVIIIe siècle)
1978 : Giono (XXe siècle)
1979 : Montaigne (XVIe siècle)
1980 : Vigny (XIXe siècle)
1981 : Beaumarchais (XVIIIe siècle)
1982 : Verlaine (XIXe siècle)
1983 : Sévigné (XVIIe siècle)
1984 : Proust (XXe siècle)
1985 : Molière (XVIIe siècle)
1986 : Montaigne (XVIe siècle)
1987 : Zola (XIXe siècle)
1988 : Montesquieu (XVIIIe siècle)
1989 : Aragon (XXe siècle)
1990 : Chateaubriand (XIXe siècle)
1991 : Prévost (XIXe siècle)
1992 : La Fontaine (XVIIe siècle)
1993 : Valéry (XXe siècle)
1994 : Balzac (XIXe siècle)
1995 : Voltaire (XVIIIe siècle)
1996 : Racine (XVIIe siècle)
1997 : Stendhal (XIXe siècle)
1998 : Corneille (XVIIe siècle)
1999 : Conte du Graal (Moyen Âge)
2000 : Molière (XVIIe siècle)
2001 : Proust (XXe siècle)
2002 : Corneille (XVIIe siècle)
2003 : Montaigne (XVIe siècle)
2004 : Rousseau (XVIIIe siècle)
2005 : Leiris (XXe siècle)
2006 : Retz (XVIIe siècle)
2007 : Marot (XVIe siècle)
2008 : Verlaine (XIXe siècle)
2009 : Bernanos (XXe siècle)
2010 : Érec et Énide (Moyen Âge)
2011 : Robbe-Grillet (XXe siècle)
2012 : La Fontaine (XVIIe siècle)
2013 : Rousseau (XVIIIe siècle)
2014 : Stendhal (XIXe siècle)
2015 : Corneille (XVIIe siècle)
2016 : Bonnefoy (XXe siècle)
2017 : Giono (XXe siècle)
2018 : Rabelais (XVIe siècle)
2019 : Scarron (XVIIe siècle)
2020 : Garnier (XVIe siècle)
2021 : Casanova (XVIIIe siècle)
2022 : Rostand (XIXe siècle)
2023 : Diderot (XVIIIe siècle)
2024 : D’Urfé (XVIIe siècle)
2025 : Hélisenne de Crenne (XVIe siècle)
Thème latin
POÉSIE : 4/72
PROSE : 68/72
1961 H : Rousseau
1962 F : ?
1962 H : Saint-Simon (prose)
1963 F : Gide (prose)
1963 H : Diderot (prose)
1964 F : ?
1964 H : Descartes (prose)
1965 F : Lafayette (prose)
1965 H : Saint-Évremond (prose)
1966 F : Vauvenargues (prose)
1966 H : Corneille (poésie)
1967 F : Bossuet (prose)
1967 H : Sentiments de l’Académie française sur le Cid (prose)
1968 F : /
1968 H : /
1969 F : ?
1969 H : Fontenelle (prose)
1970 F : ?
1970 H : Bossuet (prose)
1971 F : Bougainville (prose)
1971 H : Bougainville (prose)
1972 F : ?
1972 H : La Fontaine (prose)
1973 F : Montesquieu (prose)
1973 H : Montesquieu (prose)
1974 F : Diderot (prose)
1974 H : Diderot (prose)
1975 F : Vauvenargues (prose)
1975 H : Vauvenargues (prose)
1976 : Montaigne (prose)
1977 : Alain (prose)
1978 : Valéry (prose)
1979 : Laclos (prose)
1980 : Montherlant (prose)
1981 : Rousseau (prose)
1982 : Tocqueville (prose)
1983 : Retz (prose)
1984 : Diderot (prose)
1985 : La Boétie (prose)
1986 : Descartes (prose)
1987 : Rousseau (prose)
1988 : Boileau (prose)
1989 : Bayle (prose)
1990 : Fontenelle (prose)
1991 : Voltaire (prose)
1992 : Marivaux (prose)
1993 : Mirabeau (prose)
1994 : Montesquieu (prose)
1995 : Diderot (prose)
1996 : Gide (prose)
1997 : Grimal (prose)
1998 : Fromentin (prose)
1999 : Corneille (prose)
2000 : Perrault (prose)
2001 : Yourcenar (prose)
2002 : Lafayette (prose)
2003 : La Fontaine (poésie)
2004 : Bossuet (prose)
2005 : Camus (prose)
2006 : Chateaubriand (prose)
2007 : Fénelon (prose)
2008 : Montesquieu (prose)
2009 : Vigny (prose)
2010 : Renan (prose)
2011 : Proust (prose)
2012 : Fustel (prose)
2013 : Prévost (prose)
2014 : Mérimée (prose)
2015 : Rousseau (prose)
2016 : La Fontaine (poésie)
2017 : Nerval (prose)
2018 : Scudéry (prose)
2019 : Rousseau (prose)
2020 : Jaccottet (prose)
2021 : Corneille (poésie)
2022 : Émilie du Châtelet (prose)
2023 : Camus (prose)
2024 : Balzac (prose)
2025 : Bernardin de Saint-Pierre (prose)
Thème grec
POÉSIE : 7/71
PROSE : 64/71
1962 F : ?
1962 H : Gide (prose)
1963 F : Hugo (prose)
1963 H : Montaigne (prose)
1964 F : ?
1964 H : La Fontaine (prose)
1965 F : Alain (prose)
1965 H : Balzac (prose)
1966 F : La Fontaine (poésie)
1966 H : Voltaire (prose)
1967 F : France (prose)
1967 H : Chateaubriand (prose)
1968 F : /
1968 H : /
1969 F : ?
1969 H : Molière (poésie)
1970 F : ?
1970 H : Boileau (prose)
1971 F : Rousseau (prose)
1971 H : Rousseau (prose)
1972 F : ?
1972 H : Vauvenargues (prose)
1973 F : Molière (prose)
1973 H : Molière (prose)
1974 F : Thibaudet (prose)
1974 H : Thibaudet (prose)
1975 F : Rousseau (prose)
1975 H : Rousseau (prose)
1976 : Las Cases (prose)
1977 : Chateaubriand (prose)
1978 : La Fontaine (poésie)
1979 : Montaigne (prose)
1980 : Cyrano de Bergerac (prose)
1981 : Supervielle (prose)
1982 : Descartes (prose)
1983 : Montesquieu (prose)
1984 : Musset (prose)
1985 : Rousseau (prose)
1986 : Montaigne (prose)
1987 : La Rochefoucauld (prose)
1988 : Bossuet (prose)
1989 : Alain (prose)
1990 : De Gaulle (prose)
1991 : Fénelon (prose)
1992 : Fontenelle (prose)
1993 : Corneille (poésie)
1994 : Montaigne (prose)
1995 : Rousseau (prose)
1996 : Yourcenar (prose)
1997 : Vauvenargues (prose)
1998 : Fénelon (prose)
1999 : Racine (prose)
2000 : Sand (prose)
2001 : Marivaux (prose)
2002 : Corneille (poésie)
2003 : Gide (prose)
2004 : Montesquieu (prose)
2005 : Lafayette (prose)
2006 : Stendhal (prose)
2007 : Rousseau (prose)
2008 : Descartes (prose)
2009 : Condorcet (prose)
2010 : Chateaubriand (prose)
2011 : Ponge (prose)
2012 : Flaubert (prose)
2013 : Céline (prose)
2014 : De Gaulle (prose)
2015 : Bernardin de Saint-Pierre (prose)
2016 : Hugo (poésie)
2017 : Staël (prose)
2018 : Bertière (prose)
2019 : La Bruyère (prose)
2020 : Rousseau (prose)
2021 : Musset (prose)
2022 : Lacarrière (prose)
2023 : La Fontaine (poésie)
2024 : Louise Michel (prose)
2025 : Gide (prose)
Version grecque
POÉSIE : 17/71
PROSE : 54/71
1962 F : ?
1962 H : Sophocle (poésie dramatique – tragédie)
1963 F : Lucien (prose philosophique)
1963 H : Platon (prose philosophique)
1964 F : ?
1964 H : Thucydide (prose historique)
1965 F : Aristophane (poésie dramatique – comédie)
1965 H : Isocrate (prose oratoire)
1966 F : Platon (prose philosophique)
1966 H : Euripide (poésie dramatique – tragédie)
1967 F : Eschyle (poésie dramatique – tragédie)
1967 H : Démosthène (prose oratoire)
1968 F : /
1968 H : /
1969 F : ?
1969 H : Platon (prose philosophique)
1970 F : ?
1970 H : Thucydide (prose historique)
1971 F : Platon (prose philosophique)
1971 H : Platon (prose philosophique)
1972 F : ?
1972 H : Plutarque (prose philosophique)
1973 F : Isocrate (prose oratoire)
1973 H : Isocrate (prose oratoire)
1974 F : Eschine (prose oratoire)
1974 H : Eschine (prose oratoire)
1975 F : Hippocrate (prose didactique)
1975 H : Hippocrate (prose didactique)
1976 : Démosthène (prose oratoire)
1977 : Platon (prose philosophique)
1978 : Thucydide (prose historique)
1979 : Platon (prose philosophique)
1980 : Plutarque (prose philosophique)
1981 : Thucydide (prose historique)
1982 : Eschyle (poésie dramatique – tragédie)
1983 : Démosthène (prose oratoire)
1984 : Xénophon (prose historique)
1985 : Grégoire de Naziance (prose épistolaire)
1986 : Euripide (poésie dramatique – tragédie)
1987 : Démosthène (prose oratoire)
1988 : Thucydide (prose historique)
1989 : Platon (prose philosophique)
1990 : Isocrate (prose épistolaire)
1991 : Antiphon (prose oratoire)
1992 : Sophocle (poésie dramatique – tragédie)
1993 : Platon (prose philosophique)
1994 : Plutarque (prose philosophique)
1995 : Lysias (prose oratoire)
1996 : Sophocle (poésie dramatique – tragédie)
1997 : Démosthène (prose oratoire)
1998 : Eschyle (poésie dramatique – tragédie)
1999 : Démosthène (prose oratoire)
2000 : Hérodote (prose historique)
2001 : Platon (prose philosophique)
2002 : Thucydide (prose historique)
2003 : Eschyle (poésie dramatique – tragédie)
2004 : Plutarque (prose philosophique)
2005 : Platon (prose philosophique)
2006 : Démosthène (prose oratoire)
2007 : Pseudo-Longin (prose didactique)
2008 : Apollonios de Rhodes (poésie épique)
2009 : Eschine (prose oratoire)
2010 : Lycurgue (prose oratoire)
2011 : Euripide (poésie dramatique – tragédie)
2012 : Thucydide (prose historique)
2013 : Aristote (prose philosophique)
2014 : Théocrite (poésie)
2015 : Démosthène (prose oratoire)
2016 : Julien (prose épistolaire)
2017 : Aristophane (poésie dramatique – poésie)
2018 : Andocide (prose oratoire)
2019 : Plutarque (prose philosophique)
2020 : Euripide (poésie dramatique – tragédie)
2021 : Antiphon (prose oratoire)
2022 : Xénophon (prose)
2023 : Critias cité dans Sextus Empiricus (poésie philosophique)
2024 : Sophocle (poésie dramatique – tragédie)
2025 : Libanios (prose)
Version latine
POÉSIE : 26/72
PROSE : 46/72
1962 F : ?
1962 H : Brutus (prose épistolaire)
1963 F : Tacite (prose historique)
1963 H : Stace (poésie funèbre)
1964 F : ?
1964 H : Sénèque l’Ancien (prose philosophique)
1965 F : Cicéron (prose oratoire)
1965 H : Velléius Paterculus (prose historique)
1966 F : Tibulle (poésie élégiaque)
1966 H : Cicéron (poésie !)
1967 F : Tacite (prose historique)
1967 H : Sénèque l’Ancien (prose philosophique)
1968 F : /
1968 H : /
1969 F : ?
1969 H : Cicéron (prose oratoire)
1970 F : ?
1970 H : Tite Live (prose historique)
1971 F : Sénèque le Jeune (prose philosophique)
1971 H : Sénèque le Jeune (prose philosophique)
1972 F : ?
1972 H : Tacite (prose historique)
1973 F : Ovide (poésie élégiaque)
1973 H : Ovide (poésie élégiaque)
1974 F : Tite Live (prose historique)
1974 H : Tite Live (prose historique)
1975 F : Martial (poésie satirique)
1975 H : Martial (poésie satirique)
1976 : Tite Live (prose historique)
1977 : Lucain (poésie épique)
1978 : Tacite (prose historique)
1979 : Salluste (prose historique)
1980 : Quintilien (prose didactique)
1981 : Juvénal (poésie satirique)
1982 : Tite Live (prose historique)
1983 : Cicéron (prose philosophique)
1984 : Stace (poésie épique)
1985 : Quinte Curce (prose historique)
1986 : Quintilien (prose didactique)
1987 : Cicéron (prose philosophique)
1988 : Ovide (poésie élégiaque)
1989 : Jérôme (prose philosophique)
1990 : Tite Live (prose historique)
1991 : Silius Italicus (poésie épique)
1992 : Brutus (prose épistolaire)
1993 : Properce (poésie élégiaque)
1994 : Tacite (prose historique)
1995 : Tite Live (prose historique)
1996 : Tacite (prose historique)
1997 : Rhétorique à Hérennius (prose rhétorique)
1998 : Cicéron (prose épistolaire)
1999 : Virgile (poésie épique)
2000 : Silius Italicus (poésie épique)
2001 : Tacite (prose historique)
2002 : Ovide (poésie élégiaque)
2003 : Tite Live (prose historique)
2004 : Properce (poésie élégiaque)
2005 : Cicéron (prose philosophique)
2006 : Cicéron (poésie !)
2007 : Tacite (prose historique)
2008 : Juvénal (poésie satirique)
2009 : Tite Live (prose historique)
2010 : Virgile (poésie épique)
2011 : Sénèque le Jeune (prose philosophique)
2012 : Lucain (poésie épique)
2013 : Cicéron (prose philosophique)
2014 : Lucrèce (poésie didactique)
2015 : Properce (poésie élégiaque)
2016 : Juvénal (poésie satirique)
2017 : Ammien Marcellin (prose historique)
2018 : Cicéron (prose philosophique)
2019 : Claudien (poésie épique)
2020 : Tacite (prose historique)
2021 : Quintilien (prose didactique)
2022 : Ovide (poésie)
2023 : Aulu-Gelle (prose)
2024 : Pétrone (prose)
2025 : Apulée (prose)
A. FEMMES
Session 1962
Thème latin
CICÉRON APOLOGISTE DE LA VERSATILITÉ POLITIQUE
Cicéron comprenait bien que tant de complaisance et de soumission, et tous ces démentis éclatants qu’il était forcé de se donner à lui-même, finiraient par soulever contre lui l’opinion publique. Aussi s’avisa-t-il d’écrire à son ami Lentulus, l’un des chefs de l’aristocratie, une lettre importante, qu’il destinait probablement à être répandue, et où il expliquait sa conduite. Dans cette lettre, après avoir raconté les faits à sa façon et assez maltraité ceux dont il abandonnait le parti, ce qui est un moyen commode et généralement employé pour prévenir leurs plaintes et les rendre responsables du mal qu’on va leur faire, il se hasarde à présenter, avec une étrange franchise, une sorte d’apologie de la versatilité politique. Sous prétexte que Platon a dit quelque part « qu’il ne faut pas faire plus violence à sa patrie qu’à son père », Cicéron pose en principe qu’un homme politique ne doit pas s’obstiner à vouloir ce que ses concitoyens ne veulent plus, ni perdre sa peine à tenter des oppositions inutiles. Les circonstances changent, il faut changer avec elles, et s’accommoder au vent qui souffle pour ne pas se briser sur l’écueil. Est-ce là, d’ailleurs, véritablement changer ? Ne peut-on pas vouloir au fond la même chose et servir son pays sous des drapeaux différents ? On n’est pas inconstant pour défendre, selon les circonstances, des opinions qui semblent contradictoires, si par des routes opposées on marche au même but, et ne sait-on pas « qu’il faut souvent changer la direction des voiles, quand on veut arriver au port » ?
Gaston Boissier (1823-1908),
Cicéron et ses amis (1865)
(281 mots)
Session 1963
Dissertation française
Dans un article publié au moment de la mort de Flaubert, Théodore de Banville écrivait (17 mai 1880) :
« Flaubert devait, dans L’Éducation sentimentale, montrer par avance ce qui n’existera que dans bien longtemps : je veux dire le roman non romancé, triste, indécis, mystérieux comme la vie elle-même, et se contentant, comme elle, de dénouements d’autant plus terribles qu’ils ne sont pas matériellement dramatiques ».
Est-ce bien définir ce qui fait l’originalité de Faubert dans L’Éducation sentimentale ?
Thème latin
DÉDALE EXPLIQUE À THÉSÉE COMMENT IL A CONÇU LE LABYRINTHE
Estimant qu’il n’est pas de geôle qui vaille devant un propos de fuite obstiné, pas de barrière ou de fossé que hardiesse et résolution ne franchissent, je pensai que, pour retenir dans le labyrinthe, le mieux était de faire en sorte, non point tant qu’on ne pût (tâche de me bien comprendre), mais qu’on n’en voulût pas sortir. Je réunis donc dans ce lieu de quoi répondre aux appétits de toutes sortes. Ceux du Minotaure ne sont ni nombreux ni divers ; mais il s’agissait aussi bien de tous et de quiconque entrerait dans le labyrinthe. Il importait encore et surtout de diminuer jusqu’à l’annihilation leur vouloir. Pour y pourvoir je composai des électuaires que l’on mêlait aux vins qu’on leur servait. Mais cela ne suffisait pas ; je trouvai mieux J’avais remarqué que certaines plantes, lorsqu’on les jette au feu, dégagent en se consumant des fumées semi-narcotiques, qui me parurent ici d’excellent emploi. Elles répondirent exactement à ce que j’attendais d’elles. J’en fis donc alimenter des réchauds, qu’on maintient allumés jour et nuit. Les lourdes vapeurs qui s’en dégagent n’agissent pas seulement sur la volonté, qu’elles endorment ; elles procurent une ivresse pleine de charme et prodigue de flatteuses erreurs, invitent à certaine activité vaine le cerveau qui se laisse voluptueusement emplir de mirages ; activité que je dis vaine, parce qu’elle n’aboutit à rien que d’imaginaire, à des visions ou des spéculations sans consistance, sans logique et sans fermeté. L’opération de ces vapeurs n’est pas la même pour chacun de ceux qui les respirent, et chacun, d’après l’imbroglio que prépare alors sa cervelle, se perd, si je puis dire, dans son labyrinthe particulier.
André Gide (1869-1851),
Thésée (1946)
(309 mots)
Session 1965
Dissertation française
Stendhal (1783-1842) écrit dans son traité Du style : « Il y a peu de comique dans La Bruyère, la sécheresse le chasse. » Est-ce aussi votre avis ?
Thème latin
« Je veux vous parler encore avec la même sincérité que j’ai déjà commencé, reprit-elle, et je vais passer par-dessus toute la retenue et toutes les délicatesses que je devrais avoir dans une première conversation ; mais je vous conjure de m’écouter sans m’interrompre.
Je crois devoir à votre attachement la faible récompense de ne vous cacher aucun de mes sentiments, et de vous les laisser voir tels qu’ils sont. Ce sera apparemment la seule fois de ma vie que je me donnerai la liberté de vous les faire paraître ; néanmoins je ne saurais vous avouer, sans honte, que la certitude de n’être plus aimée de vous, comme je le suis, me paraît un si horrible malheur, que, quand je n’aurais point des raisons de devoir insurmontables, je doute si je pourrais me résoudre à m’exposer à ce malheur. Je sais que vous êtes libre, que je le suis, et que les choses sont d’une sorte que le public n’aurait peut-être pas sujet de vous blâmer, ni moi non plus, quand nous nous engagerions ensemble pour jamais ; mais les hommes conservent-ils de la passion dans ces engagements éternels ? Dois-je espérer un miracle en ma faveur et puis-je me mettre en état de voir certainement finir cette passion dont je ferais toute ma félicité ? M. de Clèves (1) était peut-être l’unique homme du monde capable de conserver de l’amour dans le mariage. Ma destinée n’a pas voulu que j’aie pu profiter de ce bonheur ; peut-être aussi que sa passion n’avait subsisté que parce qu’il n’en avait pas trouvé en moi. Mais je n’aurais pas le même moyen de conserver la vôtre : je crois même que les obstacles ont fait votre constance ; vous en avez assez trouvé pour vous animer à vaincre, et mes actions involontaires ou les choses que le hasard vous a apprises, vous ont donné assez d’espérance pour ne vous pas rebuter. »
Madame de Lafayette (1634-1693),
La Princesse de Clèves (1678)
(336 mots)
(1) Traduire par « Mon époux ».
Thème grec
LES NOURRICES
On se fait une idée maintenant de ce que c’est que l’enseignement des nourrices, et l’on comprend que, par respecter l’usage, il va bien plus loin qu’on ne croit. Mais il est à propos de dire comment les choses se passent ; car tous le voient, et peu le savent. Que l’enfant parle d’abord selon la structure de son corps, cela ne peut étonner personne. Qu’il parle ainsi son propre langage, par mouvement, cris variés ou gazouillements, sans savoir le moins du monde ce qu’il dit, cela n’est pas moins évident. Comment le saurait-il, tant qu’il n’est pas compris ? Comment comprendrait-il son propre langage tant que personne ne le lui parle ? C’est pourquoi les très prudentes nourrices essaient d’abord d’apprendre ce langage, afin de l’apprendre aux nourrissons. Quand on remarque que l’enfant applique d’abord aux objets familiers certains mots qu’il invente, on oublie que la nourrice ne cesse pas de chercher un sens à ces mots d’une langue inconnue, et qu’elle en trouve un. Ainsi l’enfant apprend sa propre langue ; il apprend ce qu’il demande d’après la chose qui lui est donnée. On devine que par cet échange continuel, les mots du langage enfantin sont inclinés vers les mots véritables et y ressemblent de plus en plus, par une lente transformation.
Alain (1868-1951),
Les idées et les âges (1927)
(236 mots)
Version grecque
Une femme déguisée en homme propose à l’assemblée athénienne de confier aux femmes le gouvernement de la cité.
Τοῖς θεοῖς μὲν εὔχομαι
τυχεῖν κατορθώσασα τὰ βεβουλευμένα.
Ἐμοὶ δ’ ἴσον μὲν τῆσδε τῆς χώρας μέτα
ὅσονπερ ὑμῖν· ἄχθομαι δὲ καὶ φέρω
τὰ τῆς πόλεως σαπέντα βαρέως πράγματα.
Ὁρῶ γὰρ αὐτὴν προστάταισι χρωμένην
ἀεὶ πονηροῖς· κἄν τις ἡμέραν μίαν
χρηστὸς γένηται, δέκα πονηρὸς γίγνεται.
Ἐπέτρεψας ἑτέρῳ, πλείον’ ἔτι δράσει κακά.
Χαλεπὸν μὲν οὖν ἄνδρας δυσαρέστους νουθετεῖν,
οἳ τοὺς φιλεῖν μὲν βουλομένους δεδοίκατε,
τοὺς δ’ οὐκ ἐθέλοντας ἀντιβολεῖθ’ ἑκάστοτε.
Ἐκκλησίαισιν ἦν ὅτ’ οὐκ ἐχρώμεθα
οὐδὲν τὸ παράπαν, ἀλλὰ τόν γ’ Ἀγύρριον (1)
πονηρὸν ἡγούμεσθα· νῦν δὲ χρωμένων
ὁ μὲν λαβὼν ἀργύριον ὑπερεπῄνεσεν,
ὁ δ’ οὐ λαβὼν εἶναι θανάτου φήσ’ ἀξίους
τοὺς μισθοφορεῖν ζητοῦντας ἐν τἠκκλησίᾳ. […]
Tὸ συμμαχικὸν αὖ τοῦθ’, ὅτ’ ἐσκοπούμεθα,
εἰ μὴ γένοιτ’, ἀπολεῖν ἔφασκον τὴν πόλιν
ὅτε δὴ δ’ ἐγένετ’, ἤχθοντο, τῶν δὲ ῥητόρων
ὁ τοῦτ’ ἀναπείσας εὐθὺς ἀποδρὰς ᾤχετο.
Nαῦς δεῖ καθέλκειν, τῷ πένητι μὲν δοκεῖ,
τοῖς πλουσίοις δὲ καὶ γεωργοῖς οὐ δοκεῖ.
Κορινθίοις ἄχθεσθε, κἀκεῖνοί γέ σοι·
νῦν εἰσὶ χρηστοί, καὶ σύ νυν χρηστὸς γενοῦ. […]
ὑμεῖς γάρ ἐστ’ ὦ δῆμε, τούτων αἴτιοι.
τὰ δημόσια γὰρ μισθοφοροῦντες χρήματα
ἰδίᾳ σκοπεῖσθ’ ἕκαστος ὅ τι τις κερδανεῖ·
τὸ δὲ κοινὸν ὥσπερ Αἴσιμος (2) κυλίνδεται.
Ἤν οὖν ἐμοὶ πείθησθε, σωθήσεσθ’ ἔτι.
Ταῖς γὰρ γυναιξὶ φημὶ χρῆναι τὴν πόλιν
ἡμᾶς παραδοῦναι. Καὶ γὰρ ἐν ταῖς οἰκίαις
ταύταις ἐπιτρόποις καὶ ταμίαισι χρώμεθα. […]
Ὡς δ’ εἰσὶν ἡμῶν τοὺς τρόπους βελτίονες
ἐγὼ διδάξω…
Aristophane, L’Assemblée des femmes,
v. 171-215 (sans les vers 189-192, 201-204 et 213)
(36 vers – 221 mots)
(1) Débauché et démagogue.
(2) Boiteux.
Version latine
UN FAUX EN ÉCRITURES DÉMASQUÉ
Au cours de l’enquête qu’il mène contre Verrès, Cicéron a eu l’occasion d’examiner certains registres d’une société de publicains, fermière des douanes de Syracuse, dirigée par Carpinatius. Malgré sa bienveillance pour Verrès, le nouveau propréteur de Sicile Métellus est bien obligé d’en laisser prendre une copie officielle.
Cum haec maxime cognosceremus et in manibus tabulas haberemus, repente adspicimus lituras eius modi quasi quaedam uulnera tabularum recentia. Statim suspicione offensi ad ea ipsa nomina oculos animumque transtulimus. Erant acceptae pecuniae C. Verrucio C. F, sic tamen ut usque ad alterum R litterae constarent integrae, reliquae omnes essent in litura ; alterum, tertium, quartum, permulta erant eiusdem modi nomina. Cum manifesta res flagitiosa litura tabularum atque insignis turpitudo teneretur, quaerere incipimus de Carpinatio quisnam is esset Verrucius quicum tantae pecuniae rationem haberet. Haerere homo, uersari, rubere. Quod lege excipiuntur tabulae publicanorum quo minus Romam deportentur, ut res quam maxime clara et testata esse posset, in ius ad Metellum Carpinatium uoco tabulasque societatis in forum defero. Fit maximus concursus hominum ; et quod erat Carpinati nota cum isto praetore societas ac faeneratio, summe exspectabant omnes quidnam in tabulis teneretur. Rem ad Metellum defero me tabulas perspexisse sociorum ; in his tabulis magnam rationem C. Verruci permultis nominibus esse, meque hoc perspicere ex consulum mensiumque ratione hunc Verrucium neque ante aduentum C. Verris neque post decessionem quicquam cum Carpinatio rationis habuisse ; postulo ut mihi respondeat qui sit is Verrucius, mercator an negotiator an arator an pecuarius, in Sicilia sit an iam decesserit. Clamare omnes ex conuentu neminem umquam in Sicilia fuisse Verrucium. Ego instare ut mihi responderet quis esset, ubi esset, unde esset ; cur seruus societatis qui tabulas conficeret semper in Verruci nomine certo ex loco mendosus esset. Atque haec postulabam non quo illum cogi putarem oportere ut ad ea mihi responderet invitus, sed ut omnibus istius furta, illius flagitium, utriusque audacia perspicua esse posset. Itaque illum in iure metu conscientiaque peccati mutum atque exanimatum ac uix uiuum relinquo, tabulas in foro summa hominum frequentia exscribo ; adhibentur in scribendo ex conventu uiri primarii, litterae lituraeque omnes adsimulatae et expressae de tabulis in libros transferuntur. Haec omnia summa cura et diligentia recognita et collata et ab hominibus honestissimis obsignata sunt.
Cicéron,
Contre Verrès, II, 2, 187-190
(315 mots)
Session 1966
Dissertation française
Alain dit de Pascal : « Dans les Provinciales, je ne trouve pas qu’il aille au fond. Il est faible de n’avoir que de l’esprit. »
Qu’en pensez-vous ?
[Le sujet est tiré des Propos de littérature (1934) d’Alain (1868-1951).]
Thème latin
DE LA GRANDEUR D’ÂME
La grandeur d’âme est un instinct élevé qui porte les hommes au grand, de quelque nature qu’il soit ; mais qui les tourne au bien ou au mal, selon leurs passions, leurs lumières, leur éducation, leur fortune, etc. Égale à tout ce qu’il y a sur la terre de plus élevé, tantôt elle cherche à soumettre par toutes sortes d’efforts ou d’artifices les choses humaines à elle, et tantôt, dédaignant ces choses, elle s’y soumet elle-même, sans que sa soumission l’abaisse : pleine de sa propre grandeur, elle s’y repose en secret, contente de se posséder. Qu’elle est belle, quand la vertu dirige tous ses mouvements ! mais qu’elle est dangereuse alors qu’elle se soustrait à la règle ! Représentez-vous Catilina au-dessus de tous les préjugés de sa naissance, méditant de changer la face de la terre et d’anéantir le nom romain : concevez ce génie audacieux, menaçant le monde du sein des plaisirs, et formant, d’une troupe de voluptueux et de voleurs, un corps redoutable aux armées et à la sagesse de Rome. Qu’un homme de ce caractère aurait porté loin la vertu, s’il eût tourné au bien ! mais des circonstances malheureuses le poussent au crime. Catilina était né avec un amour ardent pour les plaisirs, que la sévérité des lois aigrissait & contraignait ; sa dissipation et ses débauches l’engagèrent peu à peu à des projets criminels : ruiné, décrié, traversé, il se trouva dans un état où il lui était moins facile de gouverner la république que de la détruire. […] Ainsi les hommes sont souvent portés au crime par de fatales rencontres ou par leur situation : ainsi leur vertu dépend de leur fortune.
Vauvenargues (1715-1747),
Introduction à la connaissance de l’esprit humain (1746),
« De la grandeur d’âme »
(287 mots)
Thème grec
LE POUVOIR DES FABLES
Dans Athène autrefois peuple vain et léger,
Un orateur, voyant sa patrie en danger,
Courut à la tribune ; et, d’un art tyrannique,
Voulant forcer les cœurs dans une république,
Il parla fortement sur le commun salut.
On ne l’écoutait pas ; l’orateur recourut
À ces figures violentes
Qui savent exciter les âmes les plus lentes ;
Il fit parler les morts, tonna, dit ce qu’il put.
Le vent emporta tout, personne ne s’émut ;
L’animal aux têtes frivoles,
Etant fait à ces traits, ne daignait l’écouter ;
Tous regardaient ailleurs ; il en vit s’arrêter
A des combats d’enfants, et point à ses paroles.
Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour.
« Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour
Avec l’anguille et l’hirondelle ;
Un fleuve les arrête ; et l’anguille en nageant,
Comme l’hirondelle en volant,
Le traversa bientôt. » L’assemblée, à l’instant,
Cria tout d’une voix : « Et Cérès, que fit-elle ?
— « Ce qu’elle fit ? Un prompt courroux
L’anima d’abord contre vous.
Quoi ? De contes d’enfants son peuple s’embarrasse !
Et du péril qui le menace
Lui seul, entre les Grecs, il néglige l’effet !
Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ? »
À ce reproche, l’assemblée,
Par l’apologue réveillée,
Se donne entière à l’orateur :
Un trait de fable en eut l’honneur.
La Fontaine (1621-1695),
Fables (1678), VIII, 4, v. 34-64
(30 vers – 231 mots)
Version grecque
Pour remercier Socrate d’avoir décrit la cité idéale, Critias va raconter, d’après une tradition égyptienne conservée dans sa famille, un exploit dont, en des temps très anciens, Athènes se montra capable.
ΚΡΙΤΙΑΣ. — Ἄκουε δή ὦ Σώκρατες λόγου μάλα μὲν ἀτόπου παντάπασί γε μὴν ἀληθοῦς ὡς ὁ τῶν ἑπτὰ σοφώτατος Σόλων ποτ’ ἔφη. Ἦν μὲν οὖν οἰκεῖος καὶ σφόδρα φίλος ἡμῖν Δρωπίδου τοῦ προπάππου καθάπερ λέγει πολλαχοῦ καὶ αὐτὸς ἐν τῇ ποιήσει· πρὸς δὲ Κριτίαν τὸν ἡμέτερον πάππον εἶπεν, ὡς ἀπεμνημόνευεν αὖ πρὸς ἡμᾶς ὁ γέρων, ὅτι μεγάλα καὶ θαυμαστὰ τῆσδ’ εἴη παλαιὰ ἔργα τῆς πόλεως ὑπὸ χρόνου καὶ φθορᾶς ἀνθρώπων ἠφανισμένα, πάντων δὲ ἓν μέγιστον, οὗ νῦν ἐπιμνησθεῖσιν πρέπον ἂν ἡμῖν εἴη σοί τε ἀποδοῦναι χάριν καὶ τὴν θεὸν ἅμα ἐν τῇ πανηγύρει δικαίως τε καὶ ἀληθῶς οἷόνπερ ὑμνοῦντας ἐγκωμιάζειν.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. — Εὖ λέγεις. Ἀλλὰ δὴ ποῖον ἔργον τοῦτο Κριτίας οὐ λεγόμενον μέν, ὡς δὲ πραχθὲν ὄντως ὑπὸ τῆσδε τῆς πόλεως ἀρχαῖον διηγεῖτο κατὰ τὴν Σόλωνος ἀκοήν;
ΚΡΙΤΙΑΣ. — Ἐγὼ φράσω, παλαιὸν ἀκηκοὼς λόγον οὐ νέου ἀνδρός. Ἦν μὲν γὰρ δὴ τότε Κριτίας, ὡς ἔφη, σχεδὸν ἐγγὺς ἤδη τῶν ἐνενήκοντα ἐτῶν, ἐγὼ δέ πῃ μάλιστα δεκέτης· ἡ δὲ Κουρεῶτις ἡμῖν οὖσα ἐτύγχανεν Ἀπατουρίων. Τὸ δὴ τῆς ἑορτῆς σύνηθες ἑκάστοτε καὶ τότε συνέβη τοῖς παισίν· ἆθλα γὰρ ἡμῖν οἱ πατέρες ἔθεσαν ῥαψῳδίας. Πολλῶν μὲν οὖν δὴ καὶ πολλὰ ἐλέχθη ποιητῶν ποιήματα, ἅτε δὲ νέα κατ’ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ὄντα τὰ Σόλωνος πολλοὶ τῶν παίδων ᾔσαμεν. Εἶπεν οὖν τις τῶν φρατέρων, εἴτε δὴ δοκοῦν αὐτῷ τότε εἴτε καὶ χάριν τινὰ τῷ Κριτίᾳ φέρων, δοκεῖν οἱ τά τε ἄλλα σοφώτατον γεγονέναι Σόλωνα καὶ κατὰ τὴν ποίησιν αὖ τῶν ποιητῶν πάντων ἐλευθεριώτατον. Ὁ δὴ γέρων – σφόδρα γὰρ οὖν μέμνημαι – μάλα τε ἥσθη καὶ διαμειδιάσας εἶπεν· « Εἴ γε ὦ Ἀμύνανδρε μὴ παρέργῳ τῇ ποιήσει κατεχρήσατομ ἀλλ’ ἐσπουδάκει καθάπερ ἄλλοι τόν τε λόγον ὃν ἀπ’ Αἰγύπτου δεῦρο ἠνέγκατο ἀπετέλεσεν, καὶ εἰ μὴ διὰ τὰς στάσεις ὑπὸ κακῶν τε ἄλλων ὅσα ηὗρεν ἐνθάδε ἥκων ἠναγκάσθη καταμελῆσαι κατά γε ἐμὴν δόξαν οὔτε Ἡσίοδος οὔτε Ὅμηρος οὔτε ἄλλος οὐδεὶς ποιητὴς εὐδοκιμώτερος ἐγένετο ἄν ποτε αὐτοῦ. » « Τίς δ’ ἦν ὁ λόγος », ἦ δ’ ὅς, « ὦ Κριτία » ; « Ἦ περὶ μεγίστης », ἔφη, « καὶ ὀνομαστοτάτης πασῶν δικαιότατ’ ἂν πράξεως οὔσης, ἣν ἥδε ἡ πόλις ἔπραξε. »
Platon,
Timée, 20d-21d
(336 mots)
Version latine
TOUTE SORTE DE BIENS COMBLERA NOS FAMILLES
Les sinistres présages relatifs à l’assassinat de César ayant achevé d’exercer leur maléfice, la paix et la fécondité reviendront dans un monde qui ne connaîtra plus d’autre trouble que les querelles d’amoureux.
Quicquid Amalthea, quicquid Marpesia dixit
Herophile, Phyto (1) Graia quod admonuit,
quod, quae Aniena sacras Tiburs per flumina sortes
portarit sicco pertuleritque sinu
(haec fore dixerunt belli mala signa cometen,
multus ut in terras deplueretque lapis ;
atque tubas atque arma ferunt strepitantia caelo
audita et lucos praecinuisse fugam ;
ipsum etiam Solem defectum lumine uidit
iungere pallentes nubilus annus equos
et simulacra deum lacrimas fudisse tepentes
fataque uocales praemonuisse boues),
haec fuerant olim ; sed tu iam mitis Apollo
prodigia indomitis merge sub aequoribus,
et succensa sacris crepitet bene laurea flammis,
omine quo felix et sacer annus erit.
Laurus ubi bona signa dedit, gaudete coloni,
distendet spicis horrea plena Ceres,
oblitus et musto feriet pede rusticus uuas,
dolia dum magni deficiantque lacus ;
ac madidus Baccho sua festa Palilia pastor
concinet ; a stabulis tunc procul este lupi ;
ille leuis stipulae sollemnis potus aceruos
accendet, flammas transilietque sacras ;
et fetus matrona dabit, natusque parenti
oscula comprensis auribus eripiet,
nec taedebit auum paruo aduigilare nepoti
balbaque cum puero dicere uerba senem.
Tunc operata deo pubes discumbet in herba,
arboris antiquae qua leuis umbra cadit,
aut e ueste sua tendent umbracula sertis
uincta, coronatus stabit et ipse calix ;
at sibi quisque dapes et festas exstruet alte
caespitibus mensas caespitibusque torum.
Ingeret hic potus iuuenis maledicta puellae,
postmodo quae uotis inrita facta uelit:
nam ferus ille suae plorabit sobrius idem
et se iurabit mente fuisse mala.
Tibulle,
Élégies, II, 5, v. 67-105
(38 vers – 228 mots)
(1) Nom d’une prophétesse.
Session 1967
Dissertation française
« Apollinaire réalise presque constamment ce miracle d’accommoder dans ses poèmes toutes les surprises possibles du langage, les revirements les plus brusques de l’émotion ou de l’image, sans jamais rompre le fragile courant du plaisir poétique ».
Peut-on appliquer à Alcools cette réflexion de Claude Roy (Descriptions critiques, p. 14-15) ?
Session 1971
Dissertation française
Comédie et vérité dans les pièces de Marivaux inscrites au programme.
Session 1972
Dissertation française
« La tragédie ne peint pas des êtres : elle révèle des êtres au contact d’une certaine fatalité. Elle n’est pas une quelconque représentation de l’homme et de la vie : elle est la confrontation, par une grande civilisation, de son humanisme et de son style de vie avec les sources primitives et pures de l’angoisse, de la mort et de la douleur. »
Thierry Maulnier, Racine.
Vous apprécierez ces réflexions en vous référant aux trois tragédies de Racine inscrites au programme.
Session 1973
Dissertation française
L’ironie de Flaubert dans Madame Bovary.
Session 1974
Dissertation française
Voltaire écrit dans la préface du Dictionnaire philosophique :
« Les personnes de tout état trouveront de quoi s’instruire en s’amusant. Ce livre n’exige pas une lecture suivie ; mais, à quelque endroit qu’on l’ouvre, on trouve de quoi réfléchir. Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié ; ils étendent les pensées dont on leur présente le germe ; ils corrigent ce qui leur semble défectueux et fortifient par leurs réflexions ce qui leur paraît faible. »
Pensez-vous qu’une telle présentation convienne au Dictionnaire philosophique ?
Session 1975
Dissertation française
Trouveriez-vous dans Sertorius et Suréna un reniement ou une suprême fidélité de Corneille envers lui-même ?
B. HOMMES
Session 1961
Thème latin
CE QUI ME REND PÉNIBLE LA BONNE ŒUVRE QU’ON EXIGE
Après tant de tristes expériences, j’ai appris à prévoir de loin les conséquences de mes premiers mouvements suivis, et je me suis souvent abstenu d’une bonne œuvre que j’avais le désir et le pouvoir de faire, effrayé de l’assujettissement auquel dans la suite je m’allais soumettre, si je m’y livrais inconsidérément. Je n’ai pas toujours senti cette crainte ; au contraire, dans ma jeunesse je m’attachais par mes propres bienfaits et j’ai souvent éprouvé de même que ceux que j’obligeais s’affectionnaient à moi par reconnaissance encore plus que par intérêt. Mais les choses ont bien changé de face à cet égard comme à tout autre, aussitôt que mes malheurs ont commencé. J’ai vécu dès lors dans une génération nouvelle qui ne ressemblait point à la première, et mes propres sentiments pour les autres ont souffert des changements que j’ai trouvés dans les leurs. Les mêmes gens que j’ai vus successivement dans ces deux générations si différentes, se sont pour ainsi dire assimilés successivement à l’une et à l’autre. De vrais et francs qu’ils étaient d’abord, devenus ce qu’ils sont, ils ont fait comme tous les autres, et par cela seul que les temps sont changés, les hommes ont changé comme eux. Eh ! comment pourrais-je garder les mêmes sentiments pour ceux en qui je trouve le contraire de ce qui les fit naître ! Je ne les hais point, parce que je ne saurais haïr ; mais je ne puis me défendre du mépris qu’ils méritent ni m’abstenir de le leur témoigner.
Peut-être, sans m’en apercevoir, ai-je changé moi-même plus qu’il n’aurait fallu ; quel naturel résisterait sans s’altérer à une situation pareille à la mienne ? Convaincu par vingt ans d’expérience que tout ce que la nature a mis d’heureuses dispositions dans mon cœur est tourné, par ma destinée et par ceux qui en disposent, au préjudice de moi-même ou d’autrui, je ne puis plus regarder une bonne œuvre qu’on me présente à faire que comme un piège qu’on me tend et sous lequel est caché quelque mal.
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),
Les Rêveries du promeneur solitaire (1782)
(379 mots)
Session 1962
Dissertation française
Malherbe avait-il raison de juger, au témoignage de Régnier, « du Bellay trop facile » ?
Session 1963
Dissertation française
Est-il vrai, suivant une formule souvent employée, que Marivaux ait en somme toujours écrit la même pièce ?
Thème latin
Qui est-ce qui remplira notre attente ? Sera-ce l’athlète que la douleur subjugue et que la sensibilité décompose ? Ou l’athlète académisé qui se possède et pratique les leçons de la gymnastique en rendant le dernier soupir ? Le gladiateur ancien, comme un grand comédien, un grand comédien, ainsi que le gladiateur ancien, ne meurent pas comme on meurt sur un lit, mais sont tenus de nous jouer une autre mort pour nous plaire, et le spectateur délicat sentirait que la vérité nue, l’action dénuée de tout apprêt serait mesquine et contrasterait avec la poésie du reste. Ce n’est pas que la pure nature n’ait ses moments sublimes, mais je pense que s’il est quelqu’un sûr de saisir et de conserver leur sublimité, c’est celui qui les aura pressentis d’imagination ou de génie et qui les rendra de sang-froid. Cependant je ne nierais pas qu’il n’y eût une sorte de mobilité d’entrailles acquise ou factice ; mais si vous m’en demandez mon avis, je la crois presque aussi dangereuse que la sensibilité naturelle. Elle doit conduire peu à peu l’acteur à la manière et à la monotonie. C’est un élément contraire à la diversité des fonctions d’un grand comédien ; il est souvent obligé de s’en dépouiller, et cette abnégation de soi n’est possible qu’à une tête de fer. Encore vaudrait-il mieux, pour la facilité et le succès des études, l’universalité du talent, et la perfection du jeu, n’avoir point à faire cette incompréhensible distraction de soi d’avec soi, dont l’extrême difficulté, bornant chaque comédien à un seul rôle, condamne les troupes à être très nombreuses, ou presque toutes les pièces à être mal jouées, à moins que l’on ne renverse l’ordre des choses et que les pièces ne se fassent pour les acteurs, qui, ce me semble, devraient tout au contraire être faits pour les pièces.
Denis Diderot (1713-1784),
Paradoxe sur le comédien (1830)
(331 mots)
Session 1964
Dissertation française
Dorante dit, dans la Critique :
« Lorsque vous peignez les hommes, il faut peindre d’après nature. On veut que ces portraits ressemblent ; et vous n’avez rien fait, si vous n’y faites reconnaître les gens de votre siècle. » On a, d’autre part, loué cent fois le classicisme de peindre avant tout l’homme éternel.
Que pensez-vous, sur le plan du débat ainsi posé, de l’École des femmes ?
Session 1965
Dissertation française
Dans une conversation rapportée par E. Raynaud (La Mêlée symboliste, p. 64-65), Verlaine déclarait en 1886 :
« J’aime le mot de décadence tout miroitant de pourpre et d’ors. J’en révoque, bien entendu, toute imputation injurieuse et toute idée de déchéance. Ce mot suppose au contraire des pensées raffinées d’extrême civilisation, une haute culture littéraire, une âme capable d’intensives voluptés. Il projette des éclats d’incendie et des lueurs de pierreries. Il est fait d’un mélange d’esprit charnel et de chair triste et de toutes les splendeurs violentes du bas-empire ; il respire le fard des courtisanes, les jeux du cirque, le souffle des belluaires, le bondissement des fauves, l’écroulement dans les flammes des races épuisées par la force de sentir, au bruit envahisseur des trompettes ennemies. La décadence, c’est Sardanapale allumant le brasier au milieu de ses femmes, c’est Sénèque s’ouvrant les veines en déclamant des vers, c’est Pétrone masquant de fleurs son agonie. C’est encore, si vous voulez prendre des exemples moins éloignés de nous, les marquises marchant à la guillotine avec un sourire et le souci de ne pas déranger leur coiffure. C’est l’art de mourir en beauté. C’est d’ailleurs ce sentiment qui m’a dicté le sonnet que vous connaissez :
Je suis l’Empire à la fin de la décadence.
Il y a aussi dans ce mot une part de langueur faite d’impuissance résignée, et peut-être du regret de n’avoir pu vivre aux époques robustes et grossières de foi ardente, à l’ombre des cathédrales. Nous pouvons faire une application ironique et nouvelle de ce mot, en y sous-entendant la nécessité de réagir par le délicat, le précieux, le rare, contre les platitudes des temps présents ; même s’il était impossible de laver complètement le mot décadent de son mauvais sens, cette injure pittoresque, très automne, très soleil couchant, serait encore à ramasser, en somme ! »
Les recueils inscrits au programme vous semblent-ils répondre à cette définition de goûts et de tendances ?
Session 1966
Dissertation française
Les écrits de Paul Valéry ne sont-ils que des œuvres d’intelligence ?
Session 1967
Dissertation française
M. Jean Guéhenno écrit :
« Nous ne sommes que les rapports que nous entretenons avec les choses et avec les êtres, avec les créatures, et nous sommes d’autant plus vivants que ces rapports sont plus nombreux et plus profonds. Et Voltaire en vient à écrire cette fameuse phrase qui sera la règle de sa propre vie, le credo de son siècle, et qui est sans doute le principe de tout humanisme militant : L’homme est né pour l’action comme le feu tend en haut et la pierre en bas. N’être point occupé et n’exister pas est la même chose pour l’homme […].
Voltaire aura donné l’exemple de cette foi à la terre que Nietzsche lui aussi enseigna. Il ne croit qu’à elle. Il ne croit qu’à nous. Encore prend-il bien garde qu’aucune illusion d’aucune sorte ne s’insinue dans sa foi et la pervertisse. Méfiant à l’égard d’un humanisme qui célébrerait l’Humanité, l’Homme avec des majuscules, il ne veut connaître que l’homme, les hommes […] Humaniste sans verbiage. »
En quoi ces lignes peuvent-elles vous aider à préciser l’attitude et le ton de Voltaire dans les Lettres philosophiques ?
Session 1969
Dissertation française
À propos de Marcel Proust, A. Thibaudet écrit dans son Histoire de la littérature française (p. 535) :
« Il est romancier parce qu’il peut sortir de sa durée psychologique, parce qu’il possède le don de coïncider avec la durée d’autrui, d’y voir et d’y exprimer autant et plus de complexes, de ruptures, de variété, que dans sa propre durée. Il a été ici très loin. »
Cette analyse vous paraît-elle se vérifier dans Le Côté de Guermantes ?
Session 1969 (session spéciale)
Dissertation française
« Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous, » dit Baudelaire dans le XXXIIIe des Petits Poèmes en prose.
Qu’a fait, selon vous, de ce précepte, le poète des Fleurs du mal et des Poèmes en prose ?
Session 1970
Dissertation française
Henri Heine écrit en 1840 (Lutèce, p. 53) : « Victor Hugo est forcé et faux, et souvent dans le même vers l’un des hémistiches est en contradiction avec l’autre ; il est essentiellement froid, comme le diable d’après les assertions des sorcières, froid et glacial, même dans ses effusions les plus passionnées ; son enthousiasme n’est qu’une fantasmagorie, un calcul sans amour, ou plutôt il n’aime que lui-même, il est égoïste, et pour dire quelque chose de plus, il est Hugoïste. »
Session 1971
Dissertation française
Comédie et vérité dans les pièces de Marivaux inscrites au programme.
Session 1972
Dissertation française
« La tragédie ne peint pas des êtres : elle révèle des êtres au contact d’une certaine fatalité. Elle n’est pas une quelconque représentation de l’homme et de la vie : elle est la confrontation, par une grande civilisation, de son humanisme et de son style de vie avec les sources primitives et pures de l’angoisse, de la mort et de la douleur. »
Thierry Maulnier, Racine.
Vous apprécierez ces réflexions en vous référant aux trois tragédies de Racine inscrites au programme.
Session 1973
Dissertation française
L’ironie de Flaubert dans Madame Bovary.
Session 1974
Dissertation française
Voltaire écrit dans la préface du Dictionnaire philosophique :
« Les personnages de tout état trouveront de quoi s’instruire en s’amusant. Ce livre n’exige pas une lecture suivie ; mais, à quelque endroit qu’on l’ouvre, on trouve de quoi réfléchir. Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié ; ils étendent les pensées dont on leur présente le germe ; ils corrigent ce qui leur semble défectueux et fortifient par leurs réflexions ce qui leur paraît faible. »
Pensez-vous qu’une telle présentation convienne au Dictionnaire philosophique ?
Thème latin
TÉRENCE ÉTAIT-IL L’AUTEUR DE SES COMÉDIES ?
J’aimerais mieux regarder Lælius, tout grand personnage qu’on le dit, comme un fat qui enviait à Térence une partie de son mérite, que de le croire auteur d’une scène de L’Andrienne, ou de L’Eunuque. Qu’un soir, la femme de Lælius, lassée d’attendre son mari, et curieuse de savoir ce qui le retenait dans sa bibliothèque, se soit levée sur la pointe du pied, et l’ait surpris écrivant une scène de comédie ; que, pour s’excuser d’un travail prolongé si avant dans la nuit, Lælius ait dit à sa femme qu’il ne s’était jamais senti tant de verve ; et que les vers qu’il venait de faire étaient les plus beaux qu’il eût faits de sa vie, n’en déplaise à Montaigne, c’est un conte ridicule dont quelques exemples récents pourraient nous désabuser, sans la pente naturelle qui nous porte à croire tout ce qui tend à rabattre du mérite d’un homme, en le partageant.
L’auteur des Essais a beau dire que, « si la perfection du bien parler pouvait apporter quelque gloire sortable à un grand personnage, certainement Scipion et Lælius n’eussent pas résigné l’honneur de leurs comédies, et toutes les mignardises et délices du langage latin, à un serf africain », je lui répondrai sur son ton, que le talent de s’immortaliser par les lettres n’est pas une qualité mésavenante à quelque rang que ce soit […].
Denis Diderot (1713-1784),
Éloge de Térence (1765)
(252 mots)
Thème grec
L’HISTOIRE ET LES DISCOURS
Si l’idéal de Thucydide avait été de publier autant que possible les discours dans leur texte exact, rien ne lui était plus facile. Il nous dit qu’il s’est mis au travail dès le début de la guerre, comptant bien qu’il abordait un sujet qui surpasserait en intérêt celui d’Hérodote. S’il avait tenu à posséder les discours réels, il les aurait fait noter par un assistant qu’il eût payé : c’eût été le moindre des frais que dût lui coûter son histoire, et peut-être, après tout, avait-il en effet quelques documents de ce genre, analogues à ceux sur lesquels Xénophon écrivit les Mémorables, qui ne sont sûrement pas imaginés par lui. Mais cette besogne de critique et de grammairien est étrangère à l’Athènes de cette époque. Voici, je crois, quel est l’ordre d’idées où se meut naturellement Thucydide. Le grand inconvénient de l’écriture c’est, comme le dit Platon, qu’elle est irrévocable, qu’elle n’admet plus les modifications, l’assouplissement, la végétation de la vie, qu’elle arrête la pensée, comme la mort, en un visage définitif. Elle comporte donc un germe de fausseté, puisqu’elle immobilise le vivant et que la vie, c’est la mobilité. Un discours sténographié, c’est-à-dire dépouillé de son action, de son magnétisme, de l’auditoire qui l’inspire et qu’il inspire, de son mouvement, n’est pas reproduit au vrai.
Albert Thibaudet (1874-1936),
La Campagne avec Thucydide (1922)
(251 mots)
Version grecque
Πάλιν τοίνυν ὁ αὐτὸς ποιητὴς ἐν τῷ Φοίνικι ἀποφαίνεται, ὑπὲρ τῆς γεγενημένης αὐτῷ πρὸς τὸν πατέρα διαϐολῆς ἀπολογούμενος, καὶ ἀπεθίζων τοὺς ἀνθρώπους, μὴ ἐξ ὑποψίας, μηδ’ ἐκ διαϐολῆς, ἀλλ’ ἐκ τοῦ βίου, τὰς κρίσεις ποιεῖσθαι·
Ἤδη δὲ πολλῶν ᾑρέθην λόγων κριτής,
Καὶ πόλλ’ ἁμιλληθέντα μαρτύρων ὕπο
Τἀναντί’ ἔγνων συμφορᾶς μιᾶς πάρα.
Κᾀγὼ μὲν οὕτω, χ’ ὅστις ἔστ’ ἀνὴρ σοφός,
Λογίζομαι τἀληθές, εἰς ἀνδρὸς φύσιν,
Σκοπῶν δίαιτάν ἥντιν’ ἐμπορεύεται.
Ὅστις δ’ ὁμιλῶν ἥδεται κακοῖς ἀνήρ,
Οὐ πώποτ’ ἠρώτησα, γιγνώσκων, ὅτι
Τοιοῦτός ἐσθ’ οἵοισπερ ἥδεται ξυνών.
Σκέψασθε δέ, ὦ Ἀθηναῖοι, τὰς γνώμας, ἃς ἀποφαίνεται ὁ ποιητής. Ἤδη δὲ πολλῶν πραγμάτων φησὶ γεγενῆσθαι κριτής, ὥσπερ νῦν ὑμεῖς δικασταί, καὶ τὰς κρίσεις οὐκ ἐκ τῶν μαρτυριῶν, ἀλλ’ ἐκ τῶν ἐπιτηδευμάτων καὶ τῶν ὁμιλιῶν φησι ποιεῖσθαι, ἐκεῖσε ἀποϐλέπων, πῶς τὸν καθ’ ἡμέραν βίον ζῇ ὁ κρινόμενος, καὶ ὅντινα τρόπον διοικεῖ τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν, ὡς παραπλησίως αὐτὸν καὶ τὰ τῆς πόλεως διοικήσοντα, καὶ τίσι χαίρει πλησιάζων· καὶ τελευτῶν οὐκ ὤκνησεν ἀποφήνασθαι τοιοῦτον εἶναι οἷσπερ ἥδεται ξυνών. Οὐκοῦν δίκαιον καὶ περὶ Τιμάρχου τοῖς αὐτοῖς ὑμᾶς Εὐριπίδῃ χρήσασθαι λογισμοῖς. Πῶς διῴκηκε τὴν ἑαυτοῦ οὐσίαν ; Kατεδήδοκε τὰ πατρῷα, καὶ τὰ τῶν φίλων, μεμισθαρνηκὼς τῷ σώματι καὶ δωροδοκῶν δημοσίᾳ, πάντ’ ἠφάνικεν, ὥστε μηδὲν ἄλλ’ ἢ τὰς αἰσχύνας αὐτῷ περιεῖναι. Χαίρει δὲ τῷ συνών ; Ἡγησάνδρῳ. Ὁ δ’ Ἡγήσανδρος ἐκ τίνων ἐστὶν ἐπιτηδευμάτων ; ἐκ τούτων, ἃ τὸν πράξαντα οἱ νόμοι ἀπαγορεύουσι μὴ δημηγορεῖν. Ἐγὼ δὲ τί λέγω κατὰ Τιμάρχου, καὶ τίνα ποτ’ ἐστὶν ἃ ἀντιγέγραμμαι ; μὴ δημηγορεῖν Τίμαρχον πεπορνευμένον, καὶ τὴν πατρῴαν οὐσίαν κατεδηδοκότα. Ὑμεῖς δὲ τί ὀμωμόκατε ; ὑπὲρ αὐτῶν ψηφιεῖσθαι, ὧν ἂν ἡ δίωξις ᾖ.
Eschine, Contre Timarque, 152-154
(259 mots)
Version latine
APRÈS UNE CAPITULATION ET UNE PAIX HONTEUSES
Après le désastre des Fourches Caudines, les consuls chefs de l’armée vaincue (Spurius Postumius et Titus Veturius) ont été invités par leurs successeurs (Q. Publilius Philo et L. Papirius Cursor) à se prononcer, devant le Sénat, sur l’exécution du traité qu’ils ont personnellement passé avec leurs vainqueurs.
Quo die creati sunt consules, eo – sic enim placuerat patribus – magistratum inierunt sollemnibusque senatus consultis perfectis de pace Caudina rettulerunt ; et Publilius, penes quem fasces erant : « Dic, Sp. Postumi », inquit. Qui ubi surrexit, eodem illo uoltu, quo sub iugum missus erat : « Haud sum ignarus, » inquit, « consules, ignominiae, non honoris causa me primum excitatum iussumque dicere, non tamquam senatorem sed tamquam reum qua infelicis belli qua ignominiosae pacis. Ego tamen, quando neque de noxa nostra neque de poena rettulistis, omissa defensione, quae non difficillima esset apud haud ignaros fortunarum humanarum necessitatiumque, sententiam de eo de quo rettulistis paucis peragam ; quae sententia testis erit mihine an legionibus uestris pepercerim, cum me seu turpi seu necessaria sponsione obstrinxi ; qua tamen, quando iniussu populi facta est, non tenetur populus Romanus, nec quicquam ex ea praeterquam corpora nostra debentur Samnitibus. Dedamur per fetiales nudi uinctique ; exsoluamus religione populum, si qua obligauimus, ne quid diuini humaniue obstet quo minus iustum piumque de integro ineatur bellum. Interea consules exercitum scribere, armare, educere placet, nec prius ingredi hostium fines quam omnia iusta in deditione nostra perfecta erunt. Vos, di immortales, precor quaesoque, si uobis non fuit cordi Sp. Postumium T. Veturium consules cum Samnitibus prospere bellum gerere, at uos satis habeatis uidisse nos sub iugum missos, uidisse sponsione infami obligatos, uidere nudos uinctosque hostibus deditos, omnem iram hostium nostris capitibus excipientes ; nouos consules legionesque Romanas ita cum Samnite gerere bellum uelitis, ut omnia ante nos consules bella gesta sunt. »
Quae ubi dixit, tanta simul admiratio miseratioque uiri incessit homines ut modo uix crederent illum eundem esse Sp. Postumium qui auctor tam foedae pacis fuisset, modo miserarentur quod uir talis etiam praecipuum apud hostes supplicium passurus esset ob iram diremptae pacis.
Tite Live,
Histoire romaine, IX, 8
(282 mots)
Session 1975
Dissertation française
Trouveriez-vous dans Sertorius et Suréna un reniement ou une suprême fidélité de Corneille envers lui-même ?
C. MIXTE
Session 1976
Dissertation française
L’homme et les dieux dans les pièces de Giraudoux inscrites au programme.
Thème latin
LA CLÉMENCE DE CÉSAR
Les exemples de sa douceur et de sa clémence envers ceux qui l’avoient offencé, sont infinis ; je dis outre ceux qu’il donna pendant le temps que la guerre civile estoit encore en son progrés, desquels il fait luy-mesmes assez sentir par ses escris qu’il se servoit pour amadouer ses ennemis et leur faire moins craindre sa future domination et sa victoire. Mais si faut il dire que ces exemples là, s’ils ne sont suffisans à nous tesmoigner sa naïve douceur, ils nous montrent au moins une merveilleuse confiance et grandeur de courage en ce personnage. Il luy est advenu souvent de renvoyer des armées toutes entieres à son ennemy apres les avoir vaincues, sans daigner seulement les obliger par serment, sinon de le favoriser, aumoins de se contenir sans luy faire guerre. Il a prins à trois et à quatre fois tels capitaines de Pompeius, et autant de fois remis en liberté. Pompeius declaroit ses ennemis tous ceux qui ne l’accompaignoient à la guerre ; et luy, fit proclamer qu’il tenoit pour amis tous ceux qui ne bougeoient et qui ne s’armoyent effectuellement contre luy. À ceux de ses capitaines qui se desroboient de luy pour aller prendre autre condition, il r’envoioit encore les armes, chevaux et equipage. Les villes qu’il avoit prinses par force, il les laissoit en liberté de suyvre tel party qu’il leur plairoit, ne leur donnant autre garnison que la memoire de sa douceur et clemence.
Michel de Montaigne,
Essais
(275 mots)
Thème grec
PROPOS DE NAPOLÉON EXILÉ SUR LA NATURE DE LA SOCIÉTÉ (1)
Un philosophe a prétendu que les hommes naissaient méchants ; ce serait une grande affaire et fort oiseuse que d’aller rechercher s’il a dit vrai. Ce qu’il y a de certain, c’est que la masse de la société n’est point méchante ; car si la très grande majorité voulait être criminelle et méconnaître les lois, qui est-ce qui aurait la force de l’arrêter ou de la contraindre ? Et c’est là précisément le triomphe de la civilisation, parce que cet heureux résultat sort de son sein, naît de sa propre nature. La plupart des sentiments sont des traditions ; nous les éprouvons parce qu’ils nous ont précédés : aussi la raison humaine, son développement, celui de nos facultés, voilà toute la clef sociale, tout le secret du législateur. Il n’y a que ceux qui veulent tromper les peuples, et gouverner à leur profit, qui peuvent vouloir les retenir dans l’ignorance ; car plus ils sont éclairés, plus il y aura de gens convaincus par la nécessité des lois, du besoin de les défendre, et plus la société sera assise, heureuse, prospère. Et s’il peut arriver jamais que les lumières soient nuisibles dans la multitude, ce ne sera que quand le gouvernement, en hostilité avec les intérêts du peuple, l’acculera dans une position forcée, ou réduira la dernière classe à mourir de misère.
Las Cases,
Mémorial de Sainte Hélène
(229 mots)
(1) Ne pas traduire ce titre.
Version latine
Dissertation française
Montesquieu écrit dans la Préface de l’Esprit des Lois : « Je n’ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses. »
Pensez-vous que les treize premiers Livres de l’ouvrage justifient cette affirmation ?
Thème latin
Quelquefois on rencontre sur la route un spectre humain qui se chauffe au soleil ou qui se traîne vers sa maison ; cette vue de l’extrême décrépitude et de la mort imminente nous inspire une horreur insurmontable au premier moment ; nous fuyons en disant : « Pourquoi cette chose humaine n’est-elle pas morte ? » Elle aime encore la vie, pourtant ; elle se chauffe au soleil ; elle ne veut pas mourir. Dur chemin pour nos pensées ; la réflexion souvent y trébuche, se blesse, s’irrite, se jette dans un mauvais sentier. C’est bientôt fait.
Comme je cherchais la bonne route, après une vue de ce genre, par discours prudents et tâtonnants, je voyais devant moi un ami tout tremblant de mauvaise éloquence, avec des feux d’enfer dans les yeux. Enfin il éclata : « Tout est misère, dit-il. Ceux qui se portent bien craignent la maladie et la mort, ils y mettent toutes leurs forces ; ils ne perdent rien de leur terreur ; ils la goûtent tout entière. Et voyez ces malades ; ils devraient appeler la mort ; mais point du tout ; ils la repoussent ; cette crainte s’ajoute à leurs maux. Vous dites : comment peut-on craindre la mort quand la vie est atroce à ce point-là ? Vous voyez pourtant qu’on peut haïr la mort et la souffrance en même temps ; et voilà comment nous finirons. »
Ce qu’il disait lui semblait évident absolument : et, ma foi, j’en croirais bien autant, si je voulais. Il n’est pas difficile d’être malheureux ; ce qui est difficile, c’est d’être heureux ; ce n’est pas une raison pour ne pas l’essayer ; au contraire ; le proverbe dit que toutes les belles choses sont difficiles.
Alain,
Propos sur le bonheur
(285 mots)
Thème grec
Si mon prédécesseur pouvait entendre ces paroles qui ne consolent plus que son ombre, il serait sensible à l’hommage que je rends ici à son frère, car il était naturellement généreux ; ce fut même cette générosité de caractère qui l’entraîna dans des nouveautés bien séduisantes sans doute, puisqu’elles promettaient de nous rendre les vertus de Fabricius. Mais bientôt, trompé dans son espérance, son humeur s’aigrit, son talent se dénatura. Transporté de la solitude du poète au milieu des factions, comment aurait-il pu se livrer à ces sentiments qui font le charme de la vie ? Heureux s’il n’eût vu d’autre ciel que le ciel de la Grèce, sous lequel il était né ! s’il n’eût contemplé d’autres ruines que celles de Sparte et d’Athènes ! Je l’aurais peut-être rencontré dans la belle patrie de sa mère, et nous nous serions juré amitié sur les bords du Permesse ; ou bien, puisqu’il devait revenir aux champs paternels, que ne me suivit-il dans les déserts où je fus jeté par nos tempêtes ? Le silence des forêts aurait calmé cette âme troublée, et les cabanes des sauvages l’eussent peut-être réconcilié avec les palais des rois. Vain souhait ! M. Chénier (1) resta sur le théâtre de nos agitations et de nos douleurs. Atteint, jeune encore, d’une maladie mortelle, vous le vîtes, messieurs, s’incliner lentement vers le tombeau.
François-René de Chateaubriand,
Discours de réception à l’Académie française,
où Chateaubriand succédait à Marie-Joseph Chénier
(238 mots)
(1) Traduire par un démonstratif.
Version latine
Dissertation française
« Il y a un abîme entre la vérité et la vie » écrivait Jean Giono dans Les Grands Chemins. Cette formule vous paraît-elle éclairer la création romanesque dans Le Chant du monde et dans Un roi sans divertissement ?
Thème latin
SOCRATE CONFIE À SON MÉDECIN COMBIEN SON SAVOIR L’ÉMERVEILLE (1)
« Tu es celui qui me fait du bien ou qui tente de m’en faire : mais je veux maintenant ne considérer que celui qui est en possession de me faire ce bien, et d’en faire à bien d’autres que moi. C’est ton art même qui m’est énigme. Je m’interroge comment tu sais ce que tu sais, et quel esprit peut être le tien, pour que tu puisses me parler comme tu l’as fait tout à l’heure, sans mensonge et sans présomption, quand tu m’as dit, ou prédit, que je serai guéri demain, et content de mon corps dès la pointe du jour. Je m’émerveille de ce qu’il faut que tu sois, toi et ta médecine, pour obtenir de ma nature ce bienheureux oracle et pressentir son penchant vers le mieux. Ce corps, qui est le mien, se confie donc à toi et non à moi-même, auquel il ne s’adresse que par peines, fatigues et douleurs, qui sont comme les injures et les blasphèmes qu’il peut proférer quand il est mécontent. Il parle à mon esprit comme à une bête, que l’on mène sans explications, mais par violences et outrages ; cependant qu’il te dit clairement ce qu’il veut, ce qu’il ne veut pas, et le pourquoi et le comment de son état. Il est étrange que tu en saches mille fois plus que moi sur moi-même, et que je sois comme transparent pour la lumière de ton savoir, tandis que je me suis tout à fait obscur et opaque. Que dis-je !… Tu vois même ce que je ne suis pas encore, et tu assignes à mon corps un certain bien auquel il doit se rendre, comme sur ton ordre et à tel moment que tu as fixé. »
Paul Valéry
(305 mots)
(1) Ne pas traduire ce titre.
Thème grec
LA MORT ET LE MOURANT (1)
Un mourant, qui comptait plus de cent ans de vie,
Se plaignait à la Mort que précipitamment
Elle le contraignait de partir tout à l’heure,
Sans qu’il eût fait son testament,
Sans l’avertir au moins. « Est-il juste qu’on meure
Au pied levé ? dit-il. Attendez quelque peu :
Ma femme ne veut pas que je parte sans elle ;
Il me reste à pourvoir un arrière-neveu ;
Souffrez qu’à mon logis j’ajoute encore une aile.
Que vous êtes pressante, ô déesse cruelle !
— Vieillard, lui dit la Mort, je ne t’ai point surpris ;
Tu te plains sans raison de mon impatience :
Eh ! n’as-tu pas cent ans ? Trouve-moi dans Paris
Deux mortels aussi vieux ; trouve-m’en dix en France.
Je devais, ce dis-tu, te donner quelque avis
Qui te disposât à la chose :
J’aurais trouvé ton testament tout fait,
Ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait.
Ne te donna-t-on pas des avis, quand la cause
Du marcher et du mouvement,
Quand les esprits, le sentiment,
Quand tout faillit en toi ? Plus de goût, plus d’ouïe ;
Toute chose pour toi semble être évanouie ;
Pour toi l’astre du jour prend des soins superflus ;
Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus.
Je t’ai fait voir tes camarades,
Ou morts, ou mourants, ou malades :
Qu’est-ce que tout cela, qu’un avertissement ? »
Jean de La Fontaine,
Fables, VIII, 1
(236 mots)
(1) Ne pas traduire ce titre.
Version latine
Dissertation française
Dans les premières pages de l’Apologie de Raimond Sebond, après avoir répondu aux objections des « chrétiens zélés », Montaigne écrit :
« Aucuns disent que ces argumens sont foibles et ineptes à verifier ce qu’il veut, et entreprennent de les choquer aysément. Il faut secouer ceux cy un peu plus rudement, car ils sont plus dangereux et plus malitieux que les premiers…
Le moyen que je prens pour rabatre cette frenaisie et qui me semble le plus propre, c’est de froisser et fouler aux pieds l’orgueil et humaine fierté ; leur faire sentir l’inanité, la vanité et deneantise de l’homme ; leur arracher des points les chetives armes de leur raison… »
Estimez-vous que Montaigne ait réalisé son projet ? Quelle est, à vos yeux, la valeur de sa démonstration ?
Thème latin
LE VICOMTE DE VALMONT À LA MARQUISE DE MERTEUIL (1)
Oui, j’aime à voir, à considérer cette femme prudente, engagée, sans s’en être aperçue, dans un sentier qui ne permet plus de retour et dont la pente rapide et dangereuse l’entraîne malgré elle, et la force à me suivre. Là, effrayée du péril qu’elle court, elle voudrait s’arrêter et ne peut se retenir. Ses soins et son adresse peuvent bien rendre ses pas moins grands ; mais il faut qu’ils se succèdent. Quelquefois, n’osant fixer le danger, elle ferme les yeux, et se laissant aller, s’abandonne à mes soins. Plus souvent, une nouvelle crainte ranime ses efforts : dans son effroi mortel, elle veut tenter encore de retourner en arrière ; elle épuise ses forces pour gravir péniblement un court espace ; et bientôt un magique pouvoir la replace plus près de ce danger, que vainement elle avait voulu fuir. Alors n’ayant plus que moi pour guide et pour appui, sans songer à me reprocher davantage une chute inévitable, elle m’implore pour la retarder. Les ferventes prières, les humbles supplications, tout ce que les mortels, dans leur crainte, offrent à la Divinité, c’est moi qui le reçois d’elle ; et vous voulez que, sourd à ses vœux, et détruisant moi-même le culte qu’elle me rend, j’emploie à la précipiter, la puissance qu’elle invoque pour la soutenir ! Ah ! laissez-moi du moins le temps d’observer ces touchants combats entre l’amour et la vertu.
Eh quoi ! ce même spectacle qui vous fait courir au théâtre avec empressement, que vous y applaudissez avec fureur, le croyez-vous moins attachant dans la réalité ? Ces sentiments d’une âme pure et tendre, qui redoute le bonheur qu’elle désire, et ne cesse pas de se défendre, même alors qu’elle cesse de résister, vous les écoutez avec enthousiasme : ne seraient-ils sans prix que pour celui qui les fait naître ? Voilà pourtant, voilà les délicieuses jouissances que cette femme céleste m’offre chaque jour ; et vous me reprochez d’en savourer les douceurs ! Ah ! le temps ne viendra que trop tôt, où, dégradée par sa chute, elle ne sera plus pour moi qu’une femme ordinaire.
Choderlos de Laclos,
Les Liaisons dangereuses, Lettre XCVI
(364 mots)
(1) Le titre n’est pas à traduire.
Thème grec
PLUTARQUE ET SON ESCLAVE (1)
Un sien esclave, mauvais homme et vicieux, mais qui avait les oreilles aucunement abreuvées des leçons de philosophie, ayant été, pour quelque sienne faute, dépouillé par le commandement de Plutarque, pendant qu’on le fouettait, grondait au commencement que c’était sans raison, et qu’il n’avait rien fait ; mais enfin, se mettant à crier et à injurier bien à bon escient son maître, lui reprochait qu’il n’était pas philosophe comme il s’en vantait ; qu’il lui avait souvent ouï dire qu’il était laid de se courroucer, voire qu’il en avait fait un livre ; et ce que, lors, tout plongé en la colère, il le faisait si cruellement battre, démentait entièrement ses écrits. À cela Plutarque, tout froidement et tout rassis : « Comment, dit-il, rustre, à quoi juges-tu que je sois à cette heure courroucé ? Mon visage, ma voix, ma couleur, ma parole, te donnent-ils quelque témoignage que je sois ému ? Je ne pense avoir ni les yeux effarouchés, ni le visage troublé, ni un cri effroyable. Rougis-je ? Écumé-je ? M’échappe-il de dire chose de quoi j’aie à me repentir ? Tressaux-je ? Frémis-je de courroux ? Car, pour te dire, ce sont là les vrais signes de la colère. » Et puis, se détournant à celui qui fouettoit, « Continuez, lui dit-il, toujours votre besogne, pendant que celui-ci et moi disputons. »
Michel de Montaigne,
Essais, II, 31, « De la colère »
(233 mots)
(1) Ne pas traduire le titre.
Version latine
Dissertation française
Vigny écrit dans le Journal d’un Poète :
« La perpétuelle lutte du Poète est celle qu’il livre à son idée. Si l’idée triomphe du Poète et le passionne trop, il est sa dupe et tombe dans la mise en action de cette idée et s’y perd. Si le Poète est plus fort que l’idée, il la pétrit, la forme et la met en œuvre. Elle devient ce qu’il a voulu, un monument. »
(23 août 1837.)
Vous commenterez ces lignes en vous référant au recueil des Destinées.
Thème latin
Je n’ai pas besoin de gens qui voient clair, j’ai besoin de gens qui m’approuvent ; c’est à moi de voir clair. Et j’ai besoin d’enthousiastes, c’est-à-dire de gens qui ne voient pas clair. On dit que j’ai abandonné l’Italie pour fuir César. J’ai accepté d’avoir l’air de fuir, d’être méprisé et outragé, j’ai accepté que mon parti eût l’apparence d’un parti rebelle, comparé au gouvernement de Rome, et tout cela pourquoi ? Pour ne pas porter la guerre et ses ravages dans ma patrie. Combien d’autres, à ma place, se fussent sacrifiés comme je l’ai fait ? On dit que je suis vaniteux ; si on me donnait les louanges auxquelles j’ai droit, je n’aurais pas à me les donner moi-même. On dit que je n’ai pas secouru Domitius à Corfinium ; je ne l’ai pas secouru parce qu’il n’avait pas reçu l’ordre de s’enfermer dans Corfinium ; dois-je risquer une armée pour un de mes lieutenants qui a fait une sottise ? Des critiques ! Toujours des critiques ! On dit que César m’assiège ; sa manie de remuer de la terre nous a entourés d’une enceinte débile, plus longue que le pourtour de notre camp, et qu’il tient avec la moitié moins de monde ; je suis ravitaillé par la mer : c’est moi qui l’assiège. César est un voyou ; il n’a pas auprès de lui un homme qu’on puisse nommer, sauf Antoine, encore pire que lui. Cicéron, qui était il y a peu en Italie, me disait avant-hier : « Tous les gens tarés, tous les gens propres à être condamnés et flétris sont de ce côté-là, et presque toute notre triste jeunesse, et presque toute la pègre de la ville. Il ne se trouve pas en Italie un seul être infâme qui manque au rendez-vous de César ». Cicéron s’est décidé à venir avec nous presque uniquement par le dégoût que lui inspirent ceux dont s’entoure César.
Montherlant,
La Guerre civile
(349 mots)
N. B. C’est Pompée qui parle ici.
Thème grec
JUGEMENT DU ROI AU ROYAUME DES OISEAUX
« Pendant la journée que durent les États (1), notre roi (2) est monté au sommet d’un grand if sur le bord d’un étang, les pieds et les ailes liés. Tous les oiseaux, l’un après l’autre, passent par-devant lui ; et, si quelqu’un d’eux le sait coupable du dernier supplice, il le peut jeter à l’eau. Mais il faut que sur-le-champ il justifie la raison qu’il en a eue, autrement il est condamné à la mort triste. » Je ne pus m’empêcher de l’interrompre pour lui demander ce qu’elle entendait par le mot triste, et voici ce qu’elle me répliqua : « Quand le crime d’un coupable est jugé si énorme que la mort est trop peu de chose pour l’expier, on tâche d’en choisir une qui contienne la douleur de plusieurs, et l’on y procède de cette façon : Ceux d’entre nous qui ont la voix la plus mélancolique et la plus funèbre, sont délégués vers le coupable qu’on porte sur un funeste cyprès. Là, ces tristes musiciens s’amassent tout autour de lui et lui remplissent l’âme par l’oreille de chansons si lugubres et si tragiques que, l’amertume de son chagrin désordonnant l’économie de ses organes et lui pressant le cœur, il se consume à vue d’œil et meurt suffoqué de tristesse. »
Savinien de Cyrano de Bergerac,
L’Autre Monde ou Histoire comique des États et Empires du Soleil (1657-1662)
(239 mots)
N. B. — Le titre est à traduire.
(1) Les États que le roi des oiseaux tient chaque semaine.
(2) C’est une pie qui parle.
Version latine
Dissertation française
Vous commenterez ces lignes d’un critique du XXe siècle :
« Une des séductions les plus capiteuses de La Folle Journée est qu’on y atteint aisément la limite de l’absurde et qu’on ne la franchit jamais. La “raison” y équilibre la “folie”, sans que l’on soit obligé de donner à ces deux termes le contenu qu’aurait souhaité Beaumarchais. »
Thème latin
J’ai envie, puisque nous traitons ce sujet, de vous faire ma déclaration sur ce que j’exige de l’amitié et sur ce que j’y veux mettre à mon tour. Reprenez librement ce que vous trouverez à blâmer dans mes règles : mais attendez-vous à ne m’en pas voir départir aisément ; car elles sont tirées de mon caractère que je ne puis changer.
Premièrement je veux que mes amis soient mes amis, et non pas mes maîtres ; qu’ils me conseillent sans prétendre me gouverner ; qu’ils aient toutes sortes de droits sur mon cœur, aucun sur ma liberté. Je trouve très singuliers les gens qui sous ce nom prétendent toujours se mêler de mes affaires, sans rien me dire des leurs.
Qu’ils me parlent toujours librement et franchement ; ils peuvent me tout dire : hors le mépris, je leur permets tout. Le mépris d’un indifférent m’est indifférent ; mais si je le souffrais d’un ami, j’en serais digne. S’il a le malheur de me mépriser, qu’il ne me le dise pas ; qu’il me quitte ; c’est son devoir envers lui-même. À cela près, quand il me fait ses représentations, de quelque ton qu’il les fasse, il use de son droit ; quand, après l’avoir écouté, je fais ma volonté, j’use du mien ; et je trouve mauvais qu’on me rabâche éternellement sur une chose faite.
Leurs grands empressements à me rendre mille services dont je ne me soucie point me sont à charge ; j’y trouve un certain air de supériorité qui me déplaît. D’ailleurs, tout le monde en peut faire autant ; j’aime mieux qu’ils m’aiment et se laissent aimer ; voilà ce que les amis seuls peuvent faire. Je m’indigne surtout quand le premier venu les dédommage de moi, tandis que je ne peux souffrir qu’eux au monde. Il n’y a que leurs caresses qui puissent me faire supporter leurs bienfaits.
Jean-Jacques Rousseau,
Lettre à Mme d’Épinay
(331 mots)
Thème grec
La Vierge n’hésita pas (1).
« Vous pouvez tous les faire entrer, mon enfant est aussi en sécurité dans sa crèche qu’il le serait au plus haut du ciel.
— Et un à un ! ajouta Joseph d’un ton presque militaire. Je ne veux pas qu’il passe deux bêtes à la fois par la porte, sans quoi on ne s’y reconnaîtra plus. »
On commença par les bêtes venimeuses, chacun ayant le sentiment qu’on leur devait bien cette réparation. On remarqua beaucoup le tact des serpents qui évitèrent de regarder la Vierge, passant le plus loin possible de sa personne. Et ils sortirent avec autant de calme et de dignité que s’ils eussent été des colombes ou des chiens de garde.
Il y avait aussi des bêtes si petites que l’on savait difficilement si elles étaient là ou attendaient encore dehors. On accorda une heure entière aux atomes pour se présenter et faire le tour de la crèche. Le délai expiré, bien que Joseph eût senti, à un léger picotement de la peau, qu’ils n’étaient pas tous passés, il donna aux bêtes suivantes l’ordre de se montrer.
Les chiens ne purent s’empêcher de marquer leur étonnement : ils n’avaient pas été admis à demeure à l’étable comme le bœuf et l’âne. Chacun les caressa en guise de réponse. Alors ils se retirèrent, pleins d’une gratitude visible.
Tout de même, quand on sentit à son odeur que le lion approchait, le bœuf et l’âne ne furent pas tranquilles.
Jules Supervielle,
L’Enfant de la haute mer, Le bœuf et l’âne dans la crèche
(258 mots)
(1) Par l’intermédiaire du bœuf et de l’âne, les animaux ont demandé à voir l’Enfant de Bethléem.
Version latine
Dissertation française
« Évasive, craintive et biaisante, elle ne s’achève jamais, elle attend l’achèvement, ou elle le fuit pour mieux le désirer… » C’est en ces termes que Jean Cassou caractérise la poésie de Verlaine.
Ces formules vous paraissent-elles convenir aux deux recueils inscrits à votre programme ?
Thème latin
Je me suis souvent demandé où est la source de cette passion de la liberté politique qui, dans tous les temps, a fait faire aux hommes les plus grandes choses que l’humanité ait accomplies, dans quels sentiments elle s’enracine et se nourrit.
Je vois bien que, quand les peuples sont mal conduits, ils conçoivent volontiers le désir de se gouverner eux-mêmes mais cette sorte d’amour de l’indépendance, qui ne prend naissance que dans certains maux particuliers et passagers que le despotisme amène, n’est jamais durable : elle passe avec l’accident qui l’avait fait naître ; on semblait aimer la liberté, il se trouve qu’on ne faisait que haïr le maître. Ce que haïssent les peuples faits pour être libres, c’est le mal même de la dépendance.
Je ne crois pas non plus que le véritable amour de la liberté soit jamais né de la seule vue des biens matériels qu’elle procure ; car cette vue vient souvent à s’obscurcir. Il est bien vrai qu’à la longue la liberté amène toujours, à ceux qui savent la retenir, l’aisance, le bien-être, et souvent la richesse ; mais il y a des temps où elle trouble momentanément l’usage de pareils biens ; il y en a d’autres où le despotisme seul peut en donner la jouissance passagère. Les hommes qui ne prisent que ces biens-là en elle ne l’ont jamais conservée longtemps.
Certains peuples la poursuivent obstinément à travers toutes sortes de périls et de misères. Ce ne sont pas les biens matériels qu’elle leur donne que ceux-ci aiment alors en elle ; ils la considèrent elle-même comme un bien si précieux et si nécessaire qu’aucun autre ne pourrait les consoler de sa perte et qu’ils se consolent de tout en la goûtant. D’autres se fatiguent d’elle au milieu de leurs prospérités ; ils se la laissent arracher des mains sans résistance de peur de compromettre par un effort ce même bien-être qu’ils lui doivent. Que manque-t-il à ceux-là pour rester libres ? Quoi ? Le goût même de l’être.
Alexis de Tocqueville,
L’Ancien Régime et la Révolution
(360 mots)
Thème grec
Il vaut mieux ne jamais étudier, plutôt que de s’occuper d’objets si difficiles que, dans l’incapacité où nous serions d’y distinguer le vrai du faux, nous soyons contraints d’admettre comme certain ce qui est douteux ; dans un domaine pareil, en effet, l’espérance d’étendre notre savoir n’est pas si grande que le risque de l’amoindrir. Ainsi, par la présente proposition, nous avons rejeté toutes les connaissances qui ne sont que probables, et nous avons posé qu’il ne faut accorder sa créance qu’à celles qui sont parfaitement connues et à propos desquelles le doute est impossible. Les doctes ont beau se figurer peut-être que de telles connaissances sont en très petit nombre, du fait qu’ils ont, suivant un défaut très répandu dans l’espèce humaine, négligé d’y réfléchir, comme étant trop faciles et à la portée du premier venu ; j’avertis cependant qu’elles sont bien plus nombreuses qu’ils ne pensent, et qu’elles suffisent à démontrer rigoureusement d’innombrables propositions, sur lesquelles ils n’ont pu énoncer jusqu’à présent rien de mieux que des probabilités. Et comme ils se sont persuadés qu’il était indigne d’un homme instruit d’avouer qu’il ignorait quelque chose, ils ont pris l’habitude d’enjoliver leurs doctrines illusoires, si bien qu’ils en sont venus peu à peu à s’en convaincre eux-mêmes, et qu’ils ont fini par les lancer sur le marché comme vraies.
René Descartes,
Règles pour la direction de l’esprit, Deuxième règle
(250 mots)
Version grecque
DEVANT LE CHŒUR, CLYTEMNESTRE ÉVOQUE
LA PRISE DE TROIE
ΚΛ. Τροίαν Ἀχαιοὶ τῇδ’ ἔχουσ’ ἐν ἡμέρᾳ·
οἶμαι βοὴν ἄμεικτον ἐν πόλει πρέπειν·
ὄξος τ’ ἄλειφά τ’ ἐγχέας ταὐτῷ κύτει
διχοστατοῦντ’ ἂν οὐ φίλως προσεννέποις,
καὶ τῶν ἁλόντων καὶ κρατησάντων δίχα
φθογγὰς ἀκούειν ἔστι συμφορᾶς διπλῆς·
οἳ μὲν γὰρ ἀμφὶ σώμασιν πεπτωκότες
ἀνδρῶν κασιγνήτων τε καὶ φυταλμίων
παῖδες γερόντων, οὐκέτ’ ἐξ ἐλευθέρου
δέρης ἀποιμώζουσι φιλτάτων μόρον·
τοὺς δ’ αὖτε νυκτίπλαγκτος ἐκ μάχης πόνος
νήστεις πρὸς ἀρίστοισιν ὧν ἔχει πόλις
τάσσει, πρὸς οὐδὲν ἐν μέρει τεκμήριον,
ἀλλ’ ὡς ἕκαστος ἔσπασεν τύχης πάλον
ἐν αἰχμαλώτοις Τρωϊκοῖς οἰκήμασιν
ναίουσιν ἤδη, τῶν ὑπαιθρίων πάγων
δρόσων τ’ ἀπαλλαχθέντες· ὡς δ’ εὐδαίμονες
ἀφύλακτον εὑδήσουσι πᾶσαν εὐφρόνην.
Εἰ δ’ εὐσεϐοῦσι τοὺς πολισσούχους θεούς
τοὺς τῆς ἁλούσης γῆς θεῶν θ’ ἱδρύματα,
οὔ τἂν ἑλόντες ἀνθαλοῖεν ἄν·
ἔρως δὲ μή τις πρότερον ἐμπίπτῃ στρατῷ
πορθεῖν ἃ μὴ χρή κέρδεσιν νικωμένους·
δεῖ γὰρ πρὸς οἴκους νοστίμου σωτηρίας
κάμψαι διαύλου θάτερον κῶλον πάλιν·
θεοῖς δ’ ἀναμπλάκητος εἰ μόλοι στρατός,
ἐγρηγορὸς τὸ πῆμα τῶν ὀλωλότων
γένοιτ’ ἄν – εἰ πρόσπαια μὴ τεύχοι κακά.
Τοιαῦτά τοι γυναικὸς ἐξ ἐμοῦ κλύεις.
Eschyle,
Agamemnon, v. 320-348
(29 vers – 166 mots)
Version latine
IMPASSE POLITIQUE À ROME
(372-367 AV. J.-C.)
Occasio uidebatur rerum nouandarum propter ingentem uim aeris alieni, cuius leuamen mali plebes nisi suis in summo imperio locatis nullum speraret : « accingendum ad eam cogitationem esse ; conando agendoque iam eo gradum fecisse plebeios unde, si porro adnitantur, peruenire ad summa et patribus aequari tam honore quam uirtute possent ». In praesentia tribunos plebis fieri placuit, quo in magistratu sibimet ipsi uiam ad ceteros honores aperirent ; creatique tribuni C. Licinius et L. Sextius promulgauere leges omnes aduersus opes patriciorum et pro commodis plebis : unam de aere alieno, ut deducto eo de capite quod usuris pernumeratum esset id quod superesset triennio aequis portionibus persolueretur ; alteram de modo agrorum, ne quis plus quingenta iugera agri possideret ; tertiam, ne tribunorum militum comitia fierent consulumque utique alter ex plebe crearetur : cuncta ingentia et quae sine certamine maximo obtineri non possent. Omnium igitur simul rerum quarum immodica cupido inter mortales est, agri, pecuniae, honorum, discrimine proposito conterriti patres, cum trepidassent publicis priuatisque consiliis, nullo remedio alio praeter expertam multis iam ante certaminibus intercessionem inuento, collegas aduersus tribunicias rogationes comparauerunt. Qui ubi tribus ad suffragium ineundum citari a Licinio Sextioque uiderunt, stipati patrum praesidiis nec recitari rogationes nec sollemne quicquam aliud ad sciscendum plebi fieri passi sunt. Iamque frustra saepe concilio aduocato, cum pro antiquatis rogationes essent, « Bene habet inquit Sextius ; quando quidem tantum intercessionem pollere placet, isto ipso telo tutabimur plebem. Agitedum comitia indicite, patres, tribunis militum creandis ; faxo ne iuuet uox ista ‘ueto’, qua nunc concinentes collegas nostros tam laeti auditis. » Haud inritae cecidere minae : comitia praeter aedilium tribunorumque plebi nulla sunt habita. Licinius Sextiusque tribuni plebis refecti nullos curules magistratus creari passi sunt ; eaque solitudo magistratuum et plebe reficiente duos tribunos et iis comitia tribunorum militum tollentibus per quinquennium Vrbem tenuit.
Tite Live,
Histoire romaine, VI, 35
(286 mots)
Session 1983
Dissertation française
Souscrivez-vous à ce jugement porté par l’un des personnages d’À la recherche du temps perdu sur Mme de Sévigné : « gendelettre dans l’âme, elle faisait passer la copie avant tout ».
Thème latin
CONSEILS À UN JEUNE NOBLE, POUR LE DISSUADER D’ENTREPRENDRE UNE CONJURATION (1)
Vous formez aujourd’hui un projet que le plus grand roi de la terre aurait peine à exécuter. Cette pensée naît dans votre esprit de deux faux raisonnements : vous présumez trop de vous-même, et vous ne vous défiez pas assez de vos amis. La jeunesse et l’amour-propre sont de mauvais conseillers : l’une persuade que tout est facile, l’autre que tout nous est dû. Telle est la faiblesse de l’esprit humain : il ne juge point exactement des autres, parce qu’il en juge par rapport à lui plutôt qu’à eux, et qu’il regarde comme ils le peuvent servir, et non pas comme ils le doivent ou comme ils le veulent pour leur intérêt. Le premier engage souvent à prendre de fausses mesures : comme on ne fait pas seul une grande affaire et qu’on a besoin de la communiquer à beaucoup de gens, il est très important qu’ils la croient raisonnable et possible, ou autrement celui qui l’entreprendra trouvera peu d’amis qui veuillent suivre sa fortune. Le second n’est pas moins dangereux, parce que, dans les mêmes personnes de qui l’on prétend tirer le plus de secours, on trouve souvent les plus fortes résistances. Prenez donc garde que les grandes lumières que la nature vous a données, et que vous croyez peut-être avec justice pouvoir suppléer au défaut d’expérience, ne vous fassent tomber dans le premier inconvénient, et n’espérez point qu’elles vous acquièrent, dans les esprits les mieux disposés à vous servir, une estime proportionnée à l’exécution d’une affaire si difficile. Mais il n’est pas croyable qu’elles éblouissent vos ennemis jusqu’au point de les empêcher de se servir avec utilité contre vous du prétexte que leur donnera votre jeunesse. Votre naissance et la réputation que vos bonnes qualités vous ont acquise, vos richesses et les secrètes intelligences que vous dites avoir ménagées ne sont pas des fondements si solides que vous pensez. Un homme seul, quelque noblesse, quelques biens, quelque adresse qu’il ait dans le monde, ne peut exécuter une entreprise comme celle-ci ; et qui compte sur les autres est toujours sujet à se tromper.
Cardinal de Retz,
La Conjuration du Comte Jean-Louis de Fiesque
(368 mots)
(1) Ne pas traduire le titre.
Thème grec
CONTRE LA PAIX ARMÉE (1)
Une maladie nouvelle s’est répandue en Europe ; elle a saisi nos princes, et leur fait entretenir un nombre désordonné de troupes. Elle a ses redoublements, et elle devient nécessairement contagieuse : car, sitôt qu’un État augmente ce qu’il appelle ses troupes, les autres soudain augmentent les leurs, de façon qu’on ne gagne rien par là que la ruine commune. Chaque monarque tient sur pied toutes les armées qu’il pourrait avoir si les peuples étaient en danger d’être exterminés ; et on nomme paix cet état d’effort de tous contre tous. Aussi l’Europe est-elle si ruinée, que les particuliers qui seroient dans la position où sont les trois puissances de cette partie du monde les plus opulentes, n’auraient pas de quoi vivre. Nous sommes pauvres avec les richesses et le commerce de tout l’univers ; et bientôt, à force d’avoir des soldats, nous n’aurons plus que des soldats, et nous serons comme les Tartares. […] La suite d’une telle situation est l’augmentation perpétuelle des tributs, et, ce qui prévient tous les remèdes à venir, on ne compte plus avec les revenus, mais on fait la guerre avec son capital. Il n’est pas inouï de voir des États hypothéquer leurs fonds pendant la paix même, et employer, pour se ruiner, des moyens, qu’ils appellent extraordinaires, et qui le sont si fort que le fils de famille le plus dérangé les imagine à peine.
Montesquieu,
De l’esprit des lois
(248 mots)
(1) Le titre est à traduire.
Version latine
LA JUSTICE ET LA LOI
Iam uero illud stultissimum existimare omnia iusta esse quae scita sint in populorum institutis aut legibus. Etiamne si quae leges sint tyrannorum ? Si triginta illi Athenis leges inponere uoluissent aut si omnes Athenienses delectarentur tyrannicis legibus, num idcirco eae leges iustae haberentur ? Nihilo, credo, magis illa, quam interrex noster tulit, ut dictator quem uellet ciuium indicta causa impune posset occidere. Est enim unum ius quo deuincta est hominum societas et quod lex constituit una : quae lex est recta ratio imperandi atque prohibendi ; quam qui ignorat, is est iniustus, siue est illa scripta uspiam siue nusquam. Quod si iustitia est obtemperatio scriptis legibus institutisque populorum et si, ut iidem dicunt, utilitate omnia metienda sunt, negleget leges easque perrumpet, si poterit, is qui sibi eam rem fructuosam putabit fore. Ita fit ut nulla sit omnino iustitia, si neque natura est et ea quae propter utilitatem constituitur utilitate alia conuellitur. Atqui, si natura confirmatum ius non erit, uirtutes omnes tollantur. Vbi enim liberalitas, ubi patriae caritas, ubi pietas, ubi aut bene merendi de altero aut referendae gratiae uoluntas poterit existere ? Nam haec nascuntur ex eo quod natura propensi sumus ad diligendos homines, quod fundamentum iuris est. Neque solum in homines obsequia, sed etiam indeos caerimoniae religionesque tollentur, quas non metu sed ea coniunctione quae est homini cum Deo conseruandas puto.
Quod si populorum iussis, si principum decretis, si sententiis iudicum iura constituerentur, ius esset latrocinari, ius adulterare, ius testamenta falsa supponere, si haec suffragiis aut scitis multitudinis probarentur. Quae si tanta potestas est stultorum sententiis atque iussis ut eorum suffragiis rerum natura uertatur, cur non sanciunt ut quae mala perniciosaque sunt habeantur pro bonis et salutaribus ? Aut cur, cum ius ex iniuria lex facere possit, bonum eadem facere non possit ex malo ? Atqui nos legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma diuidere possumus. Nec solum ius et iniuria natura diiudicatur, sed omnino omnia honesta et turpia. Nam et communis intellegentia nobis notas res effecit easque in animis nostris inchoauit ut honesta in uirtute ponuntur, in uitiis turpia. Haec autem in opinione existimare, non in natura posita, dementis est. Nam nec arboris nec equi uirtus quae dicitur (in quo abutimur nomine) in opinione posita est, sed in natura. Quod si ita est, honesta quoque et turpia natura diiudicanda sunt.
Nam si opinione uniuersa uirtus, eadem eius etiam partes probarentur. Quis igitur prudentem et ut ita dicam catum, non ex ipsius habitu, sed ex aliqua re externa iudicet ? Est enim uirtus boni alicuius perfecta ratio, quod certe in natura est. Igitur omnis honestas eodem modo.
Cicéron,
Les Lois, I, 42-45
(422 mots)
Session 1984
Dissertation française
Jean Rousset a pu définir la seconde partie de À l’ombre des jeunes filles en fleurs (« Nom de pays : le pays ») comme constituant, dans À la rercherche du temps perdu, le « livre de la mer ».
Quelles réflexions vous inspire cette formule ?
Thème latin
Vous m’avez donné bien de la peine et du plaisir, je me suis mis à relire le livre de Pline sur les beaux-arts ; voilà le plaisir : j’ai vu que vos citations n’étaient pas toujours bien fidèles, que la traduction n’était pas toujours exacte, voilà la peine. J’ai vu que vous aviez osé appeler petit radoteur l’homme du monde qui a le plus d’esprit et de goût. Cette injure n’était fondée que sur une demi-douzaine de lignes aussi faciles à défendre qu’à attaquer et rachetée par une infinité d’excellentes choses ; lorsque j’allais à mon tour commencer ma cérémonie expiatoire, l’auguste fantôme m’est apparu, il avait l’air tranquille et serein, il a jeté un coup d’œil sur vos observations, il a souri et a disparu.
Pline suit les progrès de l’art, Olympiade par Olympiade. Il distribue des éloges selon qu’il y a plus ou moins contribué par quelques vues nouvelles. Pour moi qui pense que tout tient à la première étincelle, qu’on doit quelquefois plus à une erreur singulière qu’à une vérité commune, qui compare la multitude des âmes serviles au petit nombre des têtes hardies qui s’affranchissent de la routine, et qui connais un peu par expérience la rapidité de la pente générale, je dis : le premier qui imagina de pétrir entre ses doigts un morceau de terre et d’en faire l’image d’un homme ou d’un animal eut une idée de génie ; ceux qui le suivirent et qui perfectionnèrent son invention méritent aussi quelque éloge. Si vous pensez autrement, c’est moi qui ai tort.
Vous êtes artiste ; Pline ne l’est pas : croyez-vous de bonne foi que si vous aviez eu un compte rapide à rendre d’un aussi grand nombre d’artistes et d’ouvrages, vous vous en seriez mieux tiré que lui ?
Denis Diderot,
Lettre à Falconet, 5 août 1766
(321 mots)
Thème grec
L’amour est un mystère inexplicable. De quelques chaînes, de quelques misères, et je dirai même de quelques dégoûts que le monde l’ait entouré, tout enseveli qu’il y est sous une montagne de préjugés qui le dénaturent et le dépravent, à travers toutes les ordures dans lesquelles on le traîne, l’amour, le vivace et fatal amour, n’en est pas moins une loi céleste aussi puissante et aussi incompréhensible que celle qui suspend le soleil dans les cieux. Qu’est-ce que c’est, je vous le demande, qu’un lien plus dur, plus solide que le fer, et qu’on ne peut ni voir ni toucher ? Qu’est-ce que c’est que de rencontrer une femme, de la regarder, de lui dire un mot, et de ne plus jamais l’oublier ? Pourquoi celle-là plutôt qu’une autre ? Invoquez la raison, l’habitude, les sens, la tête, le cœur, et expliquez, si vous pouvez. Vous ne trouverez que deux corps, un là, et l’autre ici, et entre eux, quoi ? L’air, l’espace, l’immensité. Ô insensés qui vous croyez des hommes et qui osez raisonner de l’amour ! L’avez-vous vu pour en parler ? Non, vous l’avez senti. Vous avez échangé un regard avec un être inconnu qui passait, et tout à coup il s’est envolé de vous je ne sais quoi qui n’a pas de nom.
Alfred de Musset,
La Confession d’un enfant du siècle, Troisième partie, Chapitre 6
(238 mots)
Version latine
ULYSSE DÉMASQUE ACHILLE
QUE THÉTIS A CACHÉ PARMI LES FILLES
DU ROI DE SKYROS
Soluuntur laudata cohors (1) repetuntque paterna
limina, ubi in mediae iamdudum sedibus aulae
munera uirgineos uisus tractura locarat
Tydides, signum hospitii pretiumque laboris,
hortaturque legant, nec rex placidissimus arcet.
Heu simplex nimiumque rudis, qui callida dona
Graiorumque dolos uariumque ignoret Vlixen !
Hic aliae, qua sexus iners naturaque ducit,
aut teretes thyrsos aut respondentia temptant
tympana gemmatis aut nectunt tempora limbis ;
arma uident magnoque putant donata parenti.
At ferus Aeacides, radiantem ut comminus orbem
caelatum pugnas – saeuis et forte rubebat
bellorum maculis – adclinem conspicit hastae,
infremuit torsitque genas, et fronte relicta
surrexere comae ; nusquam mandata parentis,
nusquam occultus amor, totoque in pectore Troia est.
Vt leo, materno cum raptus ab ubere mores
accepit pectique iubas hominemque uereri
edidicit nullasque rapi nisi iussus in iras,
si semel aduerso radiauit lumine ferrum,
eiurata fides domitorque inimicus, in illum
prima fames timidoque pudet servisse magistro.
Vt uero accessit propius luxque aemula uultum
reddidit et simili talem se uidit in auro,
horruit erubuitque simul. Tunc acer Vlixes
admotus lateri summissa voce : « Quid haeres ?
Scimus », ait, « tu semiferi Chironis alumnus,
tu caeli pelagique nepos, te Dorica classis,
te tua suspensis exspectat Graecia signis,
ipsaque iam dubiis nutant tibi Pergama muris.
Heia, abrumpe moras ! sine perfida palleat Ide,
et iuuet haec audire patrem pudeatque dolosam
sic pro te timuisse Thetin. »
Stace,
Achilléide, I, v. 841-874
(34 vers – 212 mots)
(1) Le mot désigne le chœur de jeunes filles qui viennent de danser en l’honneur des hôtes grecs du roi.
Session 1985
Dissertation française
« L’œuvre de Molière est essentiellement conquérante, observe un critique. Il ne s’agissait pas seulement pour lui d’imposer ses comédies, de les faire valoir : il s’agissait d’imposer aussi la Comédie elle-même, reléguée fort au-dessous des genres souverains. »
Ce jugement vous paraît-il rendre compte de la création théâtrale dans les trois pièces de Molière inscrites au programme ?
Thème latin
Qu’on mette d’un côté cinquante mille hommes en armes, d’un autre autant : qu’on les range en bataille ; qu’ils viennent à se joindre, les uns libres, combattant pour leur franchise, les autres pour la leur ôter : auxquels promettra-t-on par conjecture la victoire ? Lesquels pensera-t-on qui plus gaillardement iront au combat, ou ceux qui espèrent pour guerdon (1) de leurs peines l’entretènement (2) de leur liberté, ou ceux qui ne peuvent attendre autre loyer (3) des coups qu’ils donnent ou qu’ils reçoivent que la servitude d’autrui ? Les uns ont toujours devant les yeux le bonheur de la vie passée, l’attente de pareil aise à l’avenir ; il ne leur souvient pas tant de ce peu qu’ils endurent le temps que dure une bataille, comme de ce qu’il leur conviendra à jamais endurer, à eux, à leurs enfants et à toute la postérité. Les autres n’ont rien qui les enhardie qu’une petite pointe de convoitise qui se rebouche (4) soudain contre le danger et qui ne peut être si ardente qu’elle ne se doive, ce semble, éteindre par la moindre goutte de sang qui sorte de leurs plaies. Aux batailles tant renommées de Miltiade, de Léonide, de Thémistocle, qui ont été données deux mille ans y a et qui sont encore aujourd’hui aussi fraîches en la mémoire des livres et des hommes comme si c’eût été l’autre hier, qui furent données en Grèce pour le bien des Grecs et pour l’exemple de tout le monde, qu’est-ce qu’on pense qui donna à si petit nombre de gens comme étaient les Grecs, non le pouvoir, mais le cœur de soutenir la force de navires que la mer même en était chargée, de défaire tant de nations, qui étaient en si grand nombre que l’escadron des Grecs n’eût pas fourni, s’il eût fallu, des capitaines aux armes, des ennemis, sinon qu’il semble qu’a ces glorieux jours-là ce n’était pas tant la bataille des Grecs contre les Perses, comme la victoire de la liberté sur la domination, de la franchise sur la convoitise ?
Étienne de La Boétie,
De la servitude volontaire
(365 mots)
(1) Guerdon = récompense.
(2) Entretènement = entretien ou maintien.
(3) Loyer = contrepartie.
(4) Se reboucher = s’émousser.
Thème grec
De plus, il s’en faut bien que les faits décrits dans l’histoire soient la peinture exacte des mêmes faits tels qu’ils sont arrivés : ils changent de forme dans la tête de l’historien, ils se moulent sur ses intérêts, ils prennent la teinte de ses préjugés. Qui est-ce qui sait mettre exactement le lecteur au lieu de la scène pour voir un événement tel qu’il s’est passé ? L’ignorance ou la partialité déguise tout. Sans altérer même un trait historique, en étendant ou resserrant des circonstances qui s’y rapportent, que de faces différentes on peut lui donner ! Mettez un même objet à divers points de vue, à peine paraîtra-t-il le même, et pourtant rien n’aura changé que l’œil du spectateur. Suffit-il, pour l’honneur de la vérité, de me dire un fait véritable en me le faisant voir tout autrement qu’il n’est arrivé ? Combien de fois un arbre de plus ou de moins, un rocher à droite ou à gauche, un tourbillon de poussière élevé par le vent ont décidé de l’événement d’un combat sans que personne s’en soit aperçu ! Cela empêche-t-il que l’historien ne vous dise la cause de la défaite ou de la victoire avec autant d’assurance que s’il eût été partout ? Or que m’importent les faits en eux-mêmes, quand la raison m’en reste inconnue ? et quelles leçons puis-je tirer d’un événement dont j’ignore la vraie cause ? L’historien m’en donne une, mais il la controuve ; et la critique elle-même, dont on fait tant de bruit, n’est qu’un art de conjecturer, l’art de choisir entre plusieurs mensonges celui qui ressemble le mieux à la vérité.
Jean-Jacques Rousseau,
Émile ou De l’éducation, IV
(300 mots)
Version latine
FIÈRE RÉPONSE D’HERMOLAUS À ALEXANDRE (1)
Stupentibus ceteris Hermolaus : « Nos uero », inquit, « quoniam, quasi nescias, quaeris, occidendi te consilium iniimus, quia non ut ingenuis imperare coepisti, sed quasi in mancipia dominaris. » Primus ex omnibus pater ipsius Sopolis parricidam etiam parentis sui clamitans esse consurgit, et ad os manu obiecta scelere et malis insanientem ultra negat audiendum. Rex, inhibito patre, dicere Hermolaum iubet, quae ex magistro didicisset Callisthene. Et Hermolaus : « Vtor », inquit, « beneficio tuo, et dico quae nostris malis didici. Quota pars Macedonum saeuitiae tuae superest ? Quotus quidem non a uilissimo sanguine ? Attalus et Philotas et Parmenio et Lyncestes Alexander et Clitus, quantum ad hostes pertinet, uiuunt, stant in acie, te clipeis suis protegunt, et pro gloria tua, pro uictoria uulnera excipiunt : quibus tu egregiam gratiam retulisti. Alius mensam tuam sanguine suo adspersit ; alius ne simplici quidem morte defunctus est ; duces exercituum tuorum in eculeum inpositi Persis quos uicerant fuere spectaculo. Parmenio indicta causa trucidatus est, per quem Attalum occideras : inuicem enim miserorum uteris manibus ad expetenda supplicia et, quos paulo ante ministros caedis habuisti, subito ab aliis iubes trucidari. » Obstrepunt subinde cuncti Hermolao ; pater supremum strinxerat ferrum, percussurus haud dubie, ni inhibitus esset a rege ; quippe Hermolaum dicere iussit petiitque, ut causas supplicii augentem patienter audirent. Aegre ergo coercitis rursus Hermolaus : « Quam liberaliter », inquit, « pueris rudibus ad dicendum agere permittis ! At Callisthenis uox carcere inclusa est, quia solus potest dicere. Cur enim non producitur, cum etiam confessi audiuntur ? Nempe quia liberam uocem innocentis audire metuis, ac ne uultum quidem pateris. Atqui nihil eum fecisse contendo. Sunt hic, qui mecum rem pulcherrimam cogitauerunt : nemo est, qui conscium fuisse nobis Callisthenen dicat, cum morti olim destinatus sit a iustissimo et patientissimo rege. Haec ergo sunt Macedonum praemia, quorum ut superuacuo et sordido abuteris sanguine ! At tibi XXX milia mulorum captiuum aurum uehunt, cum milites nihil domum praeter gratuitas cicatrices relaturi sunt. Quae tamen omnia tolerare potuimus, antequam nos Barbaris dederes et nouo more uictores sub iugum mitteres. Persarum te uestis et disciplina delectat : patrios mores exosus es. Persarum ergo, non Macedonum regem occidere uoluimus. Et te transfugam belli iure persequimur. Tu Macedonas oluisti genua tibi ponere, uenerarique te ut deum ; tu Philippum patrem auersaris ; et, si quis deorum ante Iouem haberetur, fastidires etiam Iouem. Miraris, si liberi homines superbiam tuam ferre non possumus ? »
Quinte-Curce,
Histoires d’Alexandre, VIII, 7
(375 mots)
(1) Le roi réprime un complot de jeunes nobles macédoniens, inspirés peut-être par le philosophe Callisthène. Hermolaus, l’un des conjurés, parle en présence des officiers de la cour, de ses complices et de son propre père.
Session 1986
Dissertation française
« L’essai libre, inconstant et divers, comme le « moi », devient pour Montagine une forme privilégiée de peinture, sinon la méthode obligée, quasi nécessaire, de la connaissance de soi. Privilégiant l’impromptu, convaincu que « tout mouvement nous découvre », comment l’écrivain n’en aurait-il pas fait la forme spécifique par où s’exprime le refus de la conclusion comme impossible, et la soumission au désordre, à l’étalage – de l’écriture et de la pensée – comme seule chance possibilité d’identité ? »
Votre lecture des chapitres des Essais inscrits au programme vous permet-elle de souscrire à cette analyse d’un critique contemporain ?
Thème latin
LA MÉTHODE EST NÉCESSAIRE POUR LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ
Les mortels sont possédés d’une si aveugle curiosité que souvent ils conduisent leur esprit par des voies inconnues, sans aucun motif d’espérance, mais seulement pour voir si ce qu’ils cherchent n’y serait pas, comme quelqu’un qui brûlerait d’une envie si folle de découvrir un trésor qu’il parcourrait sans cesse les chemins, cherchant si par hasard il ne trouverait pas quelque chose qui aurait été perdu par un voyageur. Ainsi travaillent presque tous les chimistes, la plupart des géomètres et beaucoup de philosophes : en vérité je ne nie pas que parfois ils n’aillent ainsi à l’aventure avec assez de bonheur pour trouver quelque vérité ; ce n’est pas une raison cependant pour que je reconnaisse qu’ils sont plus habiles, mais seulement qu’ils sont plus heureux. Il est pourtant bien préférable de ne jamais chercher la vérité sur aucune chose, plutôt que de le faire sans méthode : car il est très certain que ces études désordonnées et ces méditations obscures troublent la lumière naturelle et aveuglent l’esprit ; et tous ceux qui ont ainsi coutume de marcher dans les ténèbres diminuent tellement l’acuité de leur regard qu’ensuite ils ne peuvent plus supporter la pleine lumière : chose que confirme encore l’expérience, puisqu’on voit bien souvent que ceux qui n’ont jamais donné leur soin à l’étude des lettres jugent beaucoup plus solidement et clairement sur ce qui se présente à eux que ceux qui ont toujours fréquenté les écoles.
Descartes,
Règles pour la direction de l’esprit
(262 mots)
Thème grec
Le conte dit que Psammenite, roi d’Égypte, ayant été défait et pris par Cambyse, roi de Perse, voyant passer devant lui sa fille prisonnière, habillée en servante, qu’on envoyait puiser de l’eau, tous ses amis pleurant et lamentant autour de lui, se tint coi sans mot dire, les yeux fichés en terre ; et voyant encore tantôt qu’on menait son fils à la mort, se maintint en cette même contenance ; mais qu’ayant aperçu un de ses domestiques conduit entre les captifs, il se mit à battre sa tête et mener un deuil extrême.
Ceci se pourrait apparier à ce qu’on vit dernièrement d’un prince des nôtres, qui, ayant ouï à Trente, où il était, nouvelles de la mort de son frère aîné, mais un frère en qui consistait l’appui et l’honneur de toute sa maison, et bientôt après d’un puîné, sa seconde espérance, et ayant soutenu ces deux charges d’une constance exemplaire, comme quelques jours après un de ses gens vint à mourir, il se laissa emporter à ce dernier accident, et, quittant sa résolution, s’abandonna au deuil et aux regrets, en manière qu’aucuns en prirent argument qu’il n’avait été touché au vif que de cette dernière secousse. Mais à la vérité ce fut qu’étant d’ailleurs plein et comblé de tristesse, la moindre surcharge brisa les barrières de la patience.
Michel de Montaigne,
Essais, I, 2, « De la tristesse »
(236 mots)
Version latine
QUELLES SONT LES CONDITIONS FAVORABLES
AU TRAVAIL DE COMPOSITION ET DE RÉDACTION
Liberum arbitris locum et quam altissimum silentium scribentibus maxime conuenire nemo dubitauerit.
Non tamen protinus audiendi qui credunt aptissima in hoc nemora siluasque, quod illa caeli libertas locorumque amoenitas sublimem animum et beatiorem spiritum parent. Mihi certe iucundus hic magis quam studiorum hortator uidetur esse secessus. Namque illa quae ipsa delectant necesse est auocent ab intentione operis destinati. Neque enim se bona fide in multa simul intendere animus totum potest, et quocumque respexit desinit intueri quod propositum erat. Quare siluarum amoenitas et praeterlabentia flumina et inspirantes ramis arborum aurae uolucrumque cantus, et ipsa late circumspiciendi libertas ad se trahunt, ut mihi remittere potius uoluptas ista uideatur cogitationem quam intendere. Demosthenes melius, qui se in locum ex quo nulla exaudiri uox et ex quo nihil prospici posset recondebat, ne aliud agere mentem cogerent oculi. Ideoque lucubrantes silentium noctis et clausum cubiculum et lumen unum uelut tectos maxime teneat. Sed cum in omni studiorum genere, tum in hoc praecipue bona ualetudo, quaeque eam maxime praestat, frugalitas necessaria est, cum tempora ab ipsa rerum natura ad quietem refectionemque nobis data, in acerrimum laborer conuertimus. Cui tamen non plus inrogandum est quam quod somno supererit haud deerit. Obstat enim diligentiae scribendi etiam fatigatio, et abunde si uacet lucis spatia sufficiunt : occupatos in noctem necessitas agit. Est tamen lucubratio, quotiens ad eam integri ac refecti uenimus, optimum secreti genus.
Sed silentium et secessus et undique liber animus ut sunt maxime optanda, ita non semper possunt contingere. Ideoque non statim, si quid obstrepet, abiciendi codices erunt et deplorandus dies ; uerum incommodis repugnandum, et hic faciendus usus, ut omnia quae impedient uincat intentio : quam si tota mente in opus ipsum direxeris, nihil eorum quae oculis uel auribus incursant ad animum perueniet. An uero frequenter etiam fortuita hoc cogitatio praestat, ut obuios non uideamus, et itinere deerremus ; non consequemur idem, si et uoluerimus ?
Non est indulgendum causis desidiae. Nam si non nisi refecti, non nisi hilares, non nisi omnibus aliis curis uacantes studendum existimarimus, semper erit propter quod nobis ignoscamus. Quare in turba, itinere, conuiuiis etiam faciat sibi cogitatio ipsa secretum.
Quintilien,
Institution oratoire, X, 3, 22-30
(343 mots)
Session 1987
Dissertation française
Dans ses Cahiers, Valéry note :
« Impression de Zola.
Zola – travail grossier – accumulateur – sans alchimie, sans transmutation des matériaux – mais le seul « romancier » (que j’aie lu) qui a la composition musicale. »
Votre lecture de La Curée vous conduit-elle à souscrire à ce jugement ?
Thème latin
SUR LA MULTIPLICITÉ DES LOIS (1)
Si l’on me demandait quel est le plus vicieux de tous les peuples, je répondrais sans hésiter que c’est celui qui a le plus de lois. La volonté de bien faire supplée à tout, et celui qui sait écouter la loi de sa conscience n’en a guères besoin d’autres, mais la multitude des lois annonce deux choses également dangereuses et qui marchent presque toujours ensemble, savoir que les lois sont mauvaises et qu’elles sont sans vigueur. Si la loi était assez claire elle n’aurait pas besoin sans cesse de nouvelles interprétations, ou de nouvelles modifications si elle était assez sage ; et si elle était aimée et respectée, on ne verrait pas ces funestes et odieuses contentions entre les citoyens pour l’éluder et le souverain pour la maintenir. Ces multitudes effroyables d’édits et de déclarations qu’on voit émaner journellement de certaines cours ne font qu’apprendre à tous que le peuple méprise avec raison la volonté de son souverain et l’exciter à la mépriser encore davantage en voyant qu’il ne sait lui-même ce qu’il veut. Le premier précepte de la loi doit être de faire aimer tous les autres : mais ce n’est ni le fer ni le feu qui font observer celui-là, et pourtant sans celui-là, tous les autres servent de peu ; car on prêche inutilement celui qui n’a nul désir de bien faire.
Appliquons ces principes à toutes nos lois, il nous sera facile d’assigner le degré d’estime qu’on doit à ceux qui les ont rédigées et à ceux pour qui elles ont été faites.
Jean-Jacques Rousseau,
Fragments politiques (Des lois)
(275 mots)
(1) Ne pas traduire le titre.
Thème grec
Je m’engagerais à un trop long discours si je rapportais ici en particulier toutes les raisons naturelles qui portent les vieilles gens à se retirer du commerce du monde : le changement de leur humeur, de leur figure et l’affaiblissement des organes les conduisent insensiblement, comme la plupart des autres animaux, à s’éloigner de la fréquentation de leurs semblables. L’orgueil, qui est inséparable de l’amour-propre, leur tient alors lieu de raison : il ne peut plus être flatté de plusieurs choses qui flattent les autres, l’expérience leur a fait connaître le prix de ce que tous les hommes désirent dans la jeunesse et l’impossibilité d’en jouir plus longtemps ; les diverses voies qui paraissent ouvertes aux jeunes gens pour parvenir aux grandeurs, aux plaisirs, à la réputation et à tout ce qui élève les hommes leur sont fermées, ou par la fortune, ou par leur conduite, ou par l’envie et l’injustice des autres ; le chemin pour y rentrer est trop long et trop pénible quand on s’est une fois égaré ; les difficultés leur en paraissent insurmontables, et l’âge ne leur permet plus d’y prétendre. Ils deviennent insensibles à l’amitié, non seulement parce qu’ils n’en ont peut-être jamais trouvé de véritable, mais parce qu’ils ont vu mourir un grand nombre de leurs amis qui n’avaient pas encore eu le temps ni les occasions de manquer à l’amitié et ils se persuadent aisément qu’ils auraient été plus fidèles que ceux qui leur restent.
François de La Rochefoucauld,
Réflexions morales (1664), XVIII, « De la retraite »
(260 mots)
Proposition de corrigé dans le livre de thème grec
de Romain Garnier et Lucien Pernée (thème XX, p. 92-95)
Version latine
Une adepte de l’Académie réfute la thèse de son interlocuteur stoïcien, selon laquelle le don de la raison, fait aux seuls humains, prouve la sollicitude de la providence divine pour notre espèce.
« Si enim rationem hominibus di dederunt, malitiam dederunt ; est enim malitia versuta et fallax ratio nocendi ; iidem etiam di fraudem dederunt, facinus ceteraque, quorum nihil nec suscipi sine ratione nec effici potest. Utinam igitur, ut illa anus optat
ne in nemore Pelio securibus
caesae accidissent abiegnae ad terram trabes (1),
sic istam calliditatem hominibus di ne dedissent ! Qua perpauci bene utuntur, qui tamen ipsi saepe a male utentibus opprimuntur, innumerabiles autem improbe utuntur, ut donum hoc divinum rationis et consilii ad fraudem hominibus, non ad bonitatem impertitum esse videatur.
Sed urgetis identidem hominum esse istam culpam, non deorum – ut si medicus gravitatem morbi, gubernator vim tempestatis accuset ; etsi hi quidem homunculi, sed tamen ridiculi : ‘Quis enim te adhibuisset’, dixerit quispiam, ‘si ista non essent ?’ Contra deum licet disputare liberius : ‘In hominum vitiis ais esse culpam : eam dedisses hominibus rationem, quae uitia culpamque excluderet.’ Ubi igitur locus fuit errori deorum ? Nam patrimonia spe bene tradendi relinquimus, qua possumus falli ; deus falli qui potuit ? An ut Sol in currum cum Phaëthontem filium sustulit, aut Neptunus cum Theseus Hippolytum perdidit, cum ter optandi a Neptuno patre habuisset potestatem ? Poetarum ista sunt, nos autem philosophi esse volumus, rerum auctores, non fabularum. Atque hi tamen ipsi di poetici si scissent perniciosa fore illa filiis, peccasse in beneficio putarentur. Et si verum est quod Aristo Chius dicere solebat, nocere audientibus philosophos iis qui bene dicta male interpretarentur (posse enim asotos ex Aristippi, acerbos e Zenonis schola exire), prorsus, si qui audierunt vitiosi essent discessuri quod perverse philosophorum disputationem interpretarentur, tacere praestaret philosophis quam iis qui se audissent nocere ; sic, si homines rationem bono consilio a dis immortalibus datam in fraudem malitiamque convertunt, non dari illam quam dari humano generi melius fuit. Ut, si medicus sciat eum aegrotum qui jussus sit vinum sumere meracius sumpturum statimque periturum, magna sit in culpa, sic vestra ista providentia reprendenda, quae rationem dederit iis quos scierit ea perverse et improbe usuros. Nisi forte dicitis eam nescisse. Utinam quidem ! Sed non audebitis, non enim ignoro quanti eius nomen putetis. »
Cicéron,
La Nature des dieux, XXX-XXXI
(333 mots)
(1) Citation de la Médée d’Ennius. C’est la nourrice (anus) qui parle.
Session 1988
Dissertation française
« Entrer chez les gens pour déconcerter leurs idées, leur faire la surprise d’être surpris de ce qu’ils font, de ce qu’ils pensent, et qu’ils n’ont jamais conçu différent, c’est, au moyen, de l’ingénuité feinte ou réelle, donner à ressentir toute la relativité d’une civilisation, d’une confiance habituelle dans l’Ordre établi… C’est aussi prophétiser le retour à quelque désordre ; et même faire un peu plus que de le prédire. »
Après avoir cité ces lignes de P. Valéry, P. Vernière réplique : « Manifestement c’est un ordre que recherche Montesquieu, quoi qu’en pense Valéry. »
Quelles réflexions vous inspire le débat ainsi ouvert sur les Lettres persanes ?
Thème latin
RÉFLEXIONS SUR LE SUBLIME DANS L’HISTORIOGRAPHIE (1)
Comme tout ce qui s’est fait sous son règne tient beaucoup du miracle et du prodige, il (2) n’a pas trouvé mauvais qu’au milieu de tant d’écrivains célèbres, qui s’apprêtent à l’envi à peindre ses actions dans tout leur éclat et avec tous les ornements de l’éloquence la plus sublime, un homme sans fard, accusé plutôt de trop de sincérité que de flatterie, contribuât de son travail et de ses conseils à bien mettre en jour, et dans toute la naïveté du style le plus simple, la vérité de ses actions, qui, étant si peu vraisemblables d’elles-mêmes, ont bien plus besoin d’être fidèlement écrites, que fortement exprimées.
En effet, Messieurs, lorsque des orateurs et des poètes, ou des historiens même aussi entreprenants quelquefois que les poètes et les orateurs, viendront à déployer sur une matière si heureuse toutes les hardiesses de leur art, toute la force de leurs expressions ; quand ils diront de Louis le Grand, à meilleur titre qu’on ne l’a dit d’un fameux capitaine de l’antiquité, qu’il a lui seul fait plus d’exploits que les autres n’en ont lu ; qu’il a pris plus de villes que les autres rois n’ont souhaité d’en prendre ; quand ils assureront qu’il n’y a point de potentat sur la terre, quelque ambitieux qu’il puisse être, qui, dans les vœux secrets qu’il fait au ciel, ose lui demander autant de prospérités et de gloire que le ciel en a accordé libéralement à ce prince ; quand ils écriront que sa conduite est maîtresse des événements ; que la Fortune n’oserait contredire ses desseins ; quand ils le peindront à la tête de ses armées, marchant à pas de géant au travers des fleuves et des montagnes, foudroyant les remparts, brisant les rocs, terrassant tout ce qui s’oppose à sa rencontre : ces expressions paraîtront sans doute grandes, riches, nobles, accommodées au sujet mais, en les admirant, on ne se croira pas obligé d’y ajouter foi.
Nicolas Boileau,
Remerciements à Messieurs de l’Académie française (1684)
(343 mots)
(1) Ne pas traduire le titre
(2) Il désigne le roi.
Thème grec
Que désirait ce grand conquérant (1) qui renversa le trône le plus auguste de l’Asie et de tout le monde, sinon de faire parler de lui, c’est-à-dire d’avoir une grande gloire parmi les hommes ? « Que de peine, disait-il, il se faut donner pour faire parler les Athéniens ! » Lui-même, il reconnaissait la vanité de la gloire qu’il recherchait avec tant d’ardeur ; mais il y était entraîné par une espèce de manie dont il n’était pas le maître. Et que fait Dieu pour le punir, sinon de le livrer à l’illusion de son cœur, et de lui donner cette gloire dont la soif le tourmentait, avec encore plus d’abondance qu’il n’en pouvait imaginer ? Ce ne sont pas seulement les Athéniens qui parlent de lui ; tout le monde est entré dans sa passion, et l’univers étonné lui a donné plus de gloire qu’il n’en avait osé espérer. Son nom est grand en Orient comme en Occident, et les Barbares l’ont admiré comme les Grecs. Loin de refuser la gloire à son ambition, Dieu l’en a comblé, il l’en a rassasié, pour ainsi parler, jusqu’à la gorge ; il l’en a enivré ; et il en a bu plus que sa tête n’était capable d’en porter. Ô Dieu, quel bien est celui que vous prodiguez aux hommes que vous avez livrés à eux-mêmes, et que vous avez repoussés de votre royaume !
Jacques-Bénigne Bossuet,
Traité de la concupiscence, chap. 19
(249 mots)
(1) Alexandre le Grand.
Version latine
ÉVANDRE ET SA MÈRE, LA PROPHÉTESSE CARMENTIS,
ARRIVENT SUR LE SITE DE ROME
« Nec fera tempestas toto tamen horret in anno,
et tibi, crede mihi, tempora ueris erunt. »
Vocibus Euander firmata mente parentis
naue secat fluctus Hesperiamque tenet.
Iamque ratem doctae monitu Carmentis in amnem
egerat et Tuscis obuius ibat aquis.
Fluminis illa latus, cui sunt uada iuncta Tarenti (1),
adspicit et sparsas per loca sola casas ;
utque erat, inmissis puppem stetit ante capillis,
continuitque manum torua regentis iter
et procul in dextram tendens sua bracchia ripam
pinea non sano ter pede texta ferit :
neue daret saltum properans insistere terrae,
uix est Euandri uixque retenta manu.
« Di »que « petitorum » dixit « saluete locorum,
tuque nouos caelo terra datura deos,
fluminaque et fontes, quibus utitur hospita tellus,
et nemorum siluae Naiadumque chori !
Este bonis auibus uisi natoque mihique,
ripaque felici tacta sit ista pede !
Fallor, an hi fient ingentia moenia colles,
iuraque ab hac terra cetera terra petet ?
Montibus his olim totus promittitur orbis :
quis tantum fati credat habere locum ?
Et iam Dardaniae tangent haec litora pinus,
hic quoque causa noui femina (2) Martis erit.
Care nepos, Palla, funesta quid induis arma ?
Indue : non humili uindice caesus eris.
Victa tamen uinces euersaque, Troia, resurges :
obruit hostiles ista ruina domos.
Vrite uictrices Neptunia Pergama flammae :
num minus hic toto est altior orbe cinis ?
Iam pius Aeneas sacra et, sacra altera, patrem
adferet : Iliacos excipe, Vesta, deos !
Tempus erit, cum uos orbemque tuebitur idem,
et fient ipso sacra colente deo ;
et penes Augustos patriae tutela manebit :
hanc fas imperii frena tenere domum. »
Ovide,
Fastes, I, v. 495-532
(38 vers – 243 mots)
(1) Zone située à la pointe du Champ de Mars, sur les bords du Tibre.
(2) Femina désigne Lavinia.
Session 1989
Dissertation française
Dans une série d’entretiens rassemblés sous le titre Aragon parle, Aragon déclare : « Tous mes livres, faits ou songés, achevés ou perdus, n’ont jamais été qu’un long entrelacs de parenthèses. […] Contrairement à ce que les écrivains du genre appliqué, vous savez, ceux qui aiment le bien fait, pensent, […] le roman est la terre d’élection où fleurit la parenthèse. » Et il explique : « C’est que le roman allégé de ce qui n’est pas nécessaire à l’histoire principale devient une pierre lourde, et roule dans le puits. La parenthèse en est ce que l’on appelle aussi bien la poésie. Le merveilleux inutile. »
Vous examinerez Aurélien à la lumière de ces déclarations.
Thème latin
QUE LES POLITIQUES ONT FOMENTÉ LA SUPERSTITION DES PRÉSAGES (1)
La politique s’est aussi mêlée de faire valoir les présages afin d’avoir de bonnes ressources, ou pour intimider les sujets, ou pour les remplir de confiance. Si les soldats romains eussent été des esprits forts, Drusus fils de Tibère n’eût pas eu le bonheur de calmer la mutinerie des légions de la Pannonie, qui ne gardaient plus aucune mesure. Mais une éclipse qui survint fort à propos étonna tellement ces mutins, que Drusus, qui se prévalut en habile homme de leur terreur panique, en fit tout ce qu’il voulut. Une éclipse de lune épouvanta si fort l’armée d’Alexandre le Grand, quelques jours avant la bataille d’Arbelles, que les soldats s’imaginant que le ciel leur donnait des marques de son courroux, ne voulaient point passer outre. Leurs murmures allaient à une sédition tout ouverte, lorsqu’Alexandre fit commandement aux devins égyptiens, qui étaient les mieux versés en la science des astres, de dire leur sentiment sur cette éclipse en présence des officiers de l’armée. Les devins, sans s’amuser à expliquer le secret de leur physique, qu’ils tenaient caché au vulgaire, se contentèrent d’assurer au roi que le soleil était pour les Grecs, et la lune pour les Perses, et qu’elle ne s’éclipsait jamais qu’elle ne les menaçât de quelque calamité : sur quoi ils rapportèrent plusieurs exemples des rois de Perse, qui après les éclipses de lune avaient eu les dieux contraires lorsqu’ils avaient combattu. « Rien n’est si puissant, poursuit Q. Curce, que la superstition pour tenir en bride la populace. Quelque effrénée et inconstante qu’elle soit, si elle a une fois l’esprit frappé d’une vaine image de religion, elle obéira mieux à des devins qu’à ses chefs. »
Pierre Bayle,
Pensées diverses sur la comète
(297 mots)
(1) Ne pas traduire le titre.
Thème grec
Platon a dit des choses merveilleuses sur le gouvernement de soi-même, montrant que ce gouvernement intérieur doit être aristocratique, c’est-à-dire par ce qu’il y a de meilleur sur ce qu’il y a de pire. Par le meilleur, il entend ce qui en chacun de nous sait et comprend. Le peuple, en nous-mêmes, ce sont les colères, les désirs et les besoins. Je voudrais qu’on lise La République de Platon, non pas pour en parler, c’est-à-dire pour y retrouver ce qu’on en dit communément, mais pour apprendre l’art de se gouverner soi-même, et d’établir la justice à l’intérieur de soi.
Son idée principale, c’est que, dès qu’un homme se gouverne bien lui-même, il se trouve bon et utile aux autres sans avoir seulement à y penser. C’est l’idée de toute morale ; le reste n’est que police de Barbares. Quand vous avez rendu les hommes pacifiques et secourables les uns aux autres seulement par peur, vous établissez bien, il est vrai, une espèce d’ordre dans l’État ; mais en chacun d’eux, ce n’est qu’anarchie : un tyran s’installe à la place d’un autre ; la peur tient la convoitise en prison. Tous les maux fermentent au-dedans ; l’ordre extérieur est instable. Vienne l’émeute, la guerre, ou le tremblement de terre, de même que les prisons vomissent alors les condamnés, ainsi, en chacun de nous, les prisons sont ouvertes et les monstrueux désirs s’emparent de la citadelle.
Alain,
Propos d’un Normand
(263 mots)
Version latine
DE LA TRADUCTION
Sufficit mihi ipsa translatoris (1) auctoritas qui ita in prologo earundem orationum locutus est : « Putaui mihi suscipiendum laborem utilem studiosis, mihi quidem ipsi non necessarium. Conuerti enim ex Atticis duorum eloquentissimorum nobilissimas orationes, inter seque contrarias. Aeschinis et Demosthenis ; nec conuerti ut interpres, sed ut orator, sententiis isdem et earum formis tam quam figuris, uerbis ad nostram consuetudinem aptis. In quibus non pro uerbo uerbum necesse habui reddere, sed genus omnium uerborum uimque seruaui. Non enim me ea adnumerare lectori putaui oportere sed tamquam adpendere. » Rursumque in calce sermonis : « Quorum ego », ait, « orationes si, ut spero, ita expressero uirtutibus utens illorum omnibus, id est sententiis et earum figuris et rerum ordine, uerba persequens eatenus, ut ea non abhorreant a more nostro, quae si e Graecis omnia conuersa non erunt, tamen ut generis eiusdem sint elaborauimus. »
Sed et Horatius, uir acutus et doctus, hoc idem in Arte Poetica erudito interpreti praecipit :
« nec uerbum uerbo curabis reddere fidus
interpres. »
Terentius Menandrum, Plautus et Caecilius ueteres comicos interpretati sunt : numquid haerent in uerbis, ac non decorem magis et elegantiam in translatione conseruant ? Quam uos ueritatem interpretationis, hanc eruditi κακοζηλίαν (2) nuncupant.
Vnde et ego doctus a talibus ante annos circiter uiginti, et simili tunc quoque errore (3) deceptus, certe hoc mihi a uobis obiciendum nesciens, cum Eusebii χρονικὸν in Latinum uerterem, tali inter cetera praefatione usus sum : « Difficile est alienas lineas insequentem non alicubi excidere, arduum ut, quae in alia lingua bene dicta sunt, eundem decorem in translatione conseruent. Significatum est aliquid unius uerbi proprietate : non habeo meum quod id efferam, et dum quaero inplere sententiam longo ambitu uix breuis uiae spatia consummo. Accedunt hyperbatorum anfractus dissimilitudines casuum, uarietates figurarum, ipsum postremo suum et ut ita dicam uernaculum linguae genus : si ad uerbum interpretor, absurde resonant : si ob necessitatem aliquid in ordine, in sermone mutauero, ab interpretis uidebor officio recessisse. » Et post multa quae nunc prosequi otiosum est, etiam hoc addidi : « Quodsi cui non uidetur linguae gratiam interpretatione mutari. Homerum ad uerbum exprimat in Latinum – plus aliquid dicam –, eundem sua in lingua prosae uerbis interpretetur, uidebis ordinem ridiculum, et poetam eloquentissimum uix loquentem. »
Jérôme,
Correspondance
(345 mots)
(1) Il s’agit de Cicéron traducteur de Platon, Xénophon, Eschine et Démosthène.
(2) κακοζηλίαν = « mauvais goût ».
(3) Le mot est pris dans un sens ironique.
Session 1990
Dissertation française
Dans une étude sur Chateaubriand, André Vial écrit : « La mémoire se sait promise à la mort. […] Il faut, du monument privé mais précaire, faire un monument public, du mémorial du silence, un mémorial de musique et de poésie. La mémoire doit éclater en ‘mémoire’. »
Dans quelle mesure cette réflexion vous paraît-elle s’appliquer à la quatrième partie des Mémoires d’outre-tombe ?
Thème latin
FAUT-IL TRAITER DE PHILOSOPHIE EN LANGUE VULGAIRE ? (1)
Je suis à peu près dans le même cas où se trouva Cicéron, lorsqu’il entreprit de mettre en sa langue des matières de philosophie qui, jusque-là, n’avaient été traitées qu’en grec. Il nous apprend qu’on disait que ses ouvrages seraient fort inutiles, parce que ceux qui aimaient la philosophie, s’étant bien donné la peine de la chercher dans les livres grecs, négligeraient après cela de la voir dans les livres latins, qui ne seraient pas originaux ; et que ceux qui n’avalent pas de goût pour la philosophie ne se souciaient de la voir ni en latin ni en grec.
À cela il répond qu’il arriverait tout le contraire ; que ceux qui n’étaient pas philosophes seraient tentés de le devenir, par la facilité des livres latins ; et que ceux qui l’étaient déjà par la lecture des livres grecs seraient bien aises de voir comment ces choses-là avaient été maniées en latin.
Cicéron avait raison de parler ainsi. L’excellence de son génie et la grande réputation qu’il avait déjà acquise lui garantissaient le succès de cette nouvelle sorte d’ouvrages qu’il donnait au public : mais moi, je suis bien éloigné d’avoir les mêmes sujets de confiance dans une entreprise presque pareille à la sienne… Si on me dit à peu près, comme à Cicéron, qu’un pareil ouvrage n’est propre ni aux savants, qui n’y peuvent rien apprendre, ni aux gens du monde, qui n’auront point envie d’y rien apprendre, je n’ai garde de répondre ce qu’il répondit. Il se peut bien qu’en cherchant un milieu où la philosophie convînt à tout le monde, j’en aie trouvé un où elle ne convienne à personne ; les milieux sont trop difficiles à tenir, et je ne crois pas qu’il me prenne envie de prendre une seconde fois la même peine.
Fontenelle,
Préface à l’Entretien sur la pluralité des mondes
(319 mots)
(1) Ne pas traduire le titre.
Thème grec
Face à l’événement, c’est à soi-même que recourt l’homme de caractère. Son mouvement est d’imposer à l’action sa marque, de la prendre à son compte, d’en faire son affaire. Et loin de s’abriter sous la hiérarchie, de se cacher dans les textes, le voilà qui se dresse, se campe et fait front. Non qu’il veuille ignorer les ordres ou négliger les conseils, mais il a la passion de vouloir, la jalousie de décider. Non qu’il soit inconscient du risque ou dédaigneux des conséquences, mais il les mesure de bonne foi et les accepte sans ruse. Bien mieux, il embrasse l’action avec l’orgueil du maître, car s’il s’en mêle, elle est à lui : jouissant du succès pourvu qu’il soit dû et lors même qu’il n’en tire pas profit, supportant le poids du revers non sans quelque amère satisfaction. Bref, lutteur qui trouve au-dedans son ardeur et son point d’appui, joueur qui cherche moins le gain que la réussite et paie ses dettes de son propre argent, l’homme de caractère confère à l’action la noblesse ; sans lui morne tâche d’esclave, grâce à lui jeu divin du héros.
Charles de Gaulle,
Le Fil de l’épée (1932)
(207 mots)
Version latine
Minucius Rufus, le maître de cavalerie du dictateur Q. Fabius (217 av. J.-C.), avait obtenu de lui, contrairement à la règle, de partager à égalité le commandement et les troupes. Un affrontement avec Hannibal tourne rapidement au désavantage de Minucius Rufus et de son armée.
Tum Fabius, primo clamore pauentium audito, dein conspecta procul turbata acie : « Ita est », inquit, « non celerius quam timui deprendit fortuna temeritatem ? Fabio aequatus (1) imperio, Hannibalem et uirtute et fortuna superiorem uidet. Sed aliud iurgandi suscensendique tempus erit : nunc signa extra uallum proferte ; uictoriam hosti extorqueamus, confessionem erroris ciuibus. » Iam magna ex parte caesis aliis, aliis circumspectantibus fugam, Fabiana se acies repente uelut caelo demissa ad auxilium ostendit. Itaque, priusquam ad coniectum teli ueniret aut manum consereret, et suos a fuga effusa et ab nimis feroci pugna hostes continuit. Qui solutis ordinibus uage dissipati erant undique confugerunt ad integram aciem ; qui plures simul terga dederant conuersi in hostem uoluentesque orbem nunc sensim referre pedem, nunc conglobati restare. Ac iam prope una acies facta erat uicti atque integri exercitus inferebantque signa in hostem, cum Poenus receptui cecinit, palam ferente Hannibale ab se Minucium, se ab Fabio uictum.
Ita per uariam fortunam diei maiore parte exacta, cum in castra reditum esset, Minucius conuocatis militibus : « Saepe ego », inquit, « audiui, milites, eum primum esse uirum qui ipse consulat quid in rem sit, secundum eum qui bene monenti oboediat ; qui nec ipse consulere nec alteri parere sciat, eum extremi ingenii esse. Nobis quoniam prima animi ingeniique negata sors est, secundam ac mediam teneamus et, dum imperare discimus, parere prudenti in animum inducamus. Castra cum Fabio iungamus. Ad praetorium eius signa cum tulerimus, ubi ego eum parentem appellauero, quod beneficio eius erga nos ac maiestate eius dignum est, uos, milites, eos quorum uos modo arma, dexterae texerunt patronos salutabitis, et, si nihil aliud, gratorum certe nobis animorum gloriam dies hic dederit. »
Signo dato, conclamatur inde ut colligantur uasa. Profecti et agmine incedentes in dictatoris castra in admirationem et ipsum et omnes qui circa erant conuerterunt. Vt constituta sunt ante tribunal signa, progressus ante alios magister equitum, cum patrem Fabium appellasset circumfusosque militum eius totum agmen patronos consalutasset : « Parentibus », inquit, « meis, dictator, quibus te modo nomine quod fando possum, aequaui, uitam tantum debeo. Tibi cum meam salutem, tum omnium horum. Itaque plebei scitum, quo oneratus sum magis quam honoratus, primus antiquo abrogoque… »
Tite Live,
Histoire romaine, XXII, 29-30
(343 mots)
(1) Il s’agit de Minucius.
Session 1991
Dissertation française
À propos de Manon Lescaut, un critique contemporain écrit : « Au tragique un peu hiératique et guindé du héros qui fait son malheur hors du monde, en cinq actes, en vers, – et sans bavure, – se substitue un tragique dans le monde, un tragique impur, plus souple et plus aéré. La réalité et la vie […] en sont en quelque sorte rachetées, et le tragique, s’il est dilué, ne perd rien de sa force. »
Que pensez-vous de ce jugement ?
Thème latin
COMMENT PUIS-JE PENSER ?
J’ai essayé de découvrir […] si les mêmes ressorts qui me font digérer qui me font marcher sont ceux par lesquels j’ai des idées. Je n’ai jamais pu concevoir comment et pourquoi ces idées s’enfuyaient quand la faim faisait languir mon corps, et comment elles renaissaient quand j’avais mangé.
J’ai vu une si grande différence entre des pensées et de la nourriture, sans laquelle je ne penserais point, que j’ai cru qu’il y avait en moi une substance qui raisonnait, et une autre substance qui digérait. Cependant, en cherchant toujours à me prouver que nous sommes deux, j’ai senti grossièrement que je suis un seul ; et cette contradiction m’a toujours fait une extrême peine.
J’ai demandé à quelques-uns de mes semblables, qui cultivent la terre, notre mère commune, avec beaucoup d’industrie, s’ils sentaient qu’ils étaient deux, s’ils avaient découvert par leur philosophie qu’ils possédaient une substance immortelle et cependant formée de rien, existante sans étendue, agissant sur leurs nerfs sans y toucher, envoyée expressément dans le ventre de leur mère six semaines après leur conception ; ils ont cru que je voulais rire, et ont continué à labourer leur champ sans me répondre.
Voyant donc qu’un nombre prodigieux d’hommes n’avait pas seulement la moindre idée des difficultés qui m’inquiètent et ne se doutait pas de ce qu’on dit dans les écoles, de l’être en général, de la matière, de l’esprit, etc. : voyant même qu’ils se moquaient souvent de ce que je voulais le savoir, j’ai soupçonné qu’il n’était point du tout nécessaire que nous le sussions. J’ai pensé que la nature a donné à chaque être la portion qui lui convient ; et j’ai cru que les choses auxquelles nous ne pouvions atteindre ne sont pas de notre partage. Mais, malgré ce désespoir, je ne laisse pas de désirer d’être instruit, et ma curiosité trompée est toujours insatiable.
Voltaire,
Le Philosophe ignorant
(340 mots)
Thème grec
Tout à coup Mentor dit aux rois et aux capitaines assemblés : « Désormais, sous divers noms et sous divers chefs, vous ne ferez plus qu’un seul peuple. C’est ainsi que les justes dieux, amateurs des hommes qu’ils ont formés, veulent être le lien éternel de leur parfaite concorde. Tout le genre humain n’est qu’une famille dispersée sur la face de toute la terre. Tous les peuples sont frères, et doivent s’aimer comme tels. Malheur à ces impies qui cherchent une gloire cruelle dans le sang de leurs frères, qui est leur propre sang ! La guerre est quelquefois nécessaire, il est vrai ; mais c’est la honte du genre humain qu’elle soit inévitable en certaines occasions. Ô rois, ne dites point qu’on doit la désirer pour acquérir de la gloire. La vraie gloire ne se trouve point hors de l’humanité. Quiconque préfère sa propre gloire aux sentiments de l’humanité est un monstre d’orgueil, et non pas un homme : il ne parviendra même qu’à une fausse gloire, car la vraie gloire ne se trouve que dans la modération et dans la bonté. On pourra le flatter pour contenter sa vanité folle, mais on dira toujours de lui en secret, quand on voudra parler sincèrement : “Il a d’autant moins mérité la gloire, qu’il l’a désirée avec une passion injuste ; les hommes ne doivent point l’estimer, puisqu’il a si peu estimé les hommes, et qu’il a prodigué leur sang par une brutale vanité”. »
Fénelon,
Les Aventures de Télémaque, IX
(254 mots)
Version latine
LE JEUNE SCIPION L’AFRICAIN
RENCONTRE AUX ENFERS LES OMBRES DE SON PÈRE
ET DE SON ONCLE
Succedunt simulacra uirum concordia, patris
unanimique simul patrui. Ruit ipse per umbram,
oscula uana petens, iuuenis fumoque uolucri
et nebulis similes animas apprendere certat.
« Quis te, care pater, quo stabant Itala regna,
exosus Latium deus abstulit ? Hei mihi ! Nam cur
ulla fuere adeo, quibus a te saeuus abessem,
momenta ? Opposito mutassem pectore mortem.
Quantos funeribus uestris gens Itala passim
dat gemitus ! Tumulus uobis, censente senatu,
Mauortis geminus surgit per gramina campo. »
Nec passi plura, in medio sermone loquentis
sic adeo incipiunt. Prior haec genitoris imago :
« Ipsa quidem uirtus sibimet pulcherrima merces ;
dulce tamen uenit ad manis cum gratia uitae
durat apud superos nec edunt obliuia laudem.
Verum age, fare, decus nostrum, te quanta fatiget
militia. Heu, quotiens intrat mea pectora terror
cum repeto quam saeuus eas ubi magna pericla
contingunt tibi ! Per nostri, fortissime, leti
obtestor causas, Martis moderare furori.
Sat tibi sint documenta domus ! Octaua terebat
arentem culmis messem crepitantibus aestas,
ex quo cuncta mihi calcata meoque subibat
germano deuexa iugum Tartessia tellus.
Nos miserae muros et tecta renata Sagunto,
nos dedimus Baetem nullo potare sub hoste ;
nobis indomitus conuertit terque quaterque
germanus terga Hannibalis. Pro barbara numquam
impolluta fides ! Peterem cum uictor adesum
cladibus Hasdrubalem, subito uenale, cohortes
Hispanae, uulgus, Libyci quas fecerat auri
Hasdrubal, abrupto liquerunt agmine signa.
Tunc hostis socio desertos milite, multum
ditior ipse uiris, spisso circumdedit orbe.
Non segnis nobis nec inultis, nate, peracta est
illa suprema dies, et laude inclusimus aeuum. »
Silius Italicus,
La Guerre punique, XIII, v. 650-686
(37 vers – 238 mots)
Proposition de corrigé par Georges Devallet
Session 1992
Dissertation française
Un critique contemporain écrit à propos des Livres VII à XII des Fables de La Fontaine : « En marge et en dépit de l’arène où se jouent, toujours recommencées comme les fables elles-mêmes, la comédie cruelle et la tragédie dérisoire de l’humanité aveugle sur elle-même, se dessine […] un savoir-vivre et non un simple savoir-survivre. Lié à l’art et à la science, gouverné par l’esprit de discernement, il guide l’homme désabusé et désapproprié vers la tranquillé de l’âme et vers la bienveillance envers ses frères d’armes. »
Dans quelle mesure approuvez-vous cette analyse ?
Thème latin
DE L’ESPRIT DES JOLIES FEMMES (1)
Nous autres jolies femmes (car j’ai été de ce nombre), personne n’a plus d’esprit que nous quand nous en avons un peu ; les hommes ne savent plus alors la valeur de ce que nous disons : en nous écoutant parler, ils nous regardent, et ce que nous disons profite de ce qu’ils voient.
J’ai vu une jolie femme dont la conversation passait pour un enchantement. Personne au monde ne s’exprimait comme elle ; c’était la vivacité, c’était la finesse même qui parlait. La petite vérole (2) lui vint, elle en fut extrêmement marquée ; quand la pauvre femme reparut, ce n’était plus qu’une babillarde incommode. Vous voyez combien auparavant elle avait emprunté d’esprit de son visage ! Il se pourrait bien faire que le mien m’en eût prêté aussi dans le temps qu’on m’en trouvait beaucoup. Je me souviens de mes yeux de ce temps-là, et je crois qu’ils avaient plus d’esprit que moi.
Combien de fois me suis-je surprise à dire des choses qui auraient eu bien de la peine à passer toutes seules ! Sans le jeu d’une physionomie friponne qui les accompagnait, on ne m’aurait pas applaudie comme on faisait, et si une petite vérole était venue réduire cela à ce que cela valait, franchement, je pense que j’y aurais perdu beaucoup.
Il n’y a pas plus d’un mois, par exemple, que vous me parliez encore d’un certain jour (et il y a douze ans que ce jour est passé) où, dans un repas, on se récria tant sur ma vivacité ; eh bien ! en conscience, je n’étais qu’une étourdie ! Croiriez-vous que je l’ai été souvent exprès, pour voir jusqu’où va la duperie des hommes avec nous ?
Marivaux,
La Vie de Marianne
(302 mots)
(1) Ne pas traduire le titre.
(2) Petite vérole : eruptio pustularum.
Thème grec
Oui (1), mais Antoine ne savait pas qu’il faisait la guerre pour moi, et Ménélas savait bien que c’était pour vous qu’il la faisait. C’est là un point qu’on ne saurait lui pardonner ; car au lieu que Ménélas, suivi de toute la Grèce, assiégeai Troie pendant dix ans, pour vous retirer d’entre les bras de Pâris, n’est-il pas vrai que si Pâris eût voulu absolument vous rendre, Ménélas eût dû soutenir dans Sparte un siège de dix ans pour ne pas vous recevoir ? De bonne foi, je trouve qu’ils avaient tous perdu l’esprit, tant Grecs que Troyens. Les uns étaient fous, de vous redemander; et les autres l’étaient encore plus, de vous retenir. D’où vient que tant d’honnêtes Grecs se sacrifiaient aux plaisirs d’un jeune homme qui ne savait ce qu’il faisait ? Je ne pouvais m’empêcher de rire, en lisant cet endroit d’Homère, où, après neuf ans de guerre, et un combat dans lequel on vient tout fraîchement de perdre beaucoup de monde, il s’assemble un conseil devant le palais de Priam. Là, Anténor est d’avis que l’on vous rende, et il n’y avait pas, ce me semble, à balancer ; on devait seulement se repentir de s’être avisé un peu tard de cet expédient. Cependant Pâris témoigne que la proposition lui déplaît, et Priam, qui, à ce que dit Homère, est égal aux dieux en sagesse, embarrassé de voir son Conseil qui se partage sur une affaire si difficile, et ne sachant quel parti prendre, ordonne que tout le monde aille souper.
Fontenelle,
Nouveaux dialogues des morts, II, 4
(273 mots)
(1) Réunies aux Enfers, Hélène et Fulvie dialoguent : celle-ci, femme d’Antoine, dédaignée par Auguste – ce qui, selon Hélène, déclencha la guerre entre eux – montre à son tour le ridicule de la guerre de Troie.
Version latine
BRUTUS REPROCHE À CICÉRON
DE SE MONTRER TROP CONCILIANT
ENVERS LE JEUNE OCTAVE
Extrait d’une lettre de Brutus à Cicéron (juillet 43 av. J.-C.)
Hic ipse puer, quem Caesaris nomen incitare uidetur in Caesaris interfectores, quanti aestimet, si sit commercio locus, posse nobis auctoribus tantum quantum profecto poterit, quoniam uiuere et pecunias habere et dici consulares uolumus ! Ceterum ne nequiquam perierit ille (cuius interitu quid gauisi sumus si mortuo nihilo minus seruituri eramus ?), nulla cura adhibetur.
Sed mihi prius omnia di deaeque eripuerint quam illud iudicium quo non modo heredi eius quem occidi non concesserim quod in illo non tuli sed ne patri quidem meo, si reuiuescat, ut patiente me plus legibus ac senatu possit. An hoc tibi persuasum est, fore ceteros ab eo liberos quo inuito nobis in ista ciuitate locus non sit ? Qui porro id quod petis fleri potest ut impetres ? Rogas enim uelit nos saluos esse : uidemur ergo tibi salutem accepturi cum uitam acceperimus ? Quam, si prius dimittimus dignitatem et libertatem, qui possumus accipere ? An tu Romae habitare, id putas incolumem esse ? Res, non locus, oportet praestet istuc mihi : neque incolumis Caesare uiuo fui, nisi postea quam illud consciui facinus, neque usquam exsul esse possum, dum servire et pati contumelias peius odero malis omnibus aliis. Nonne hoc est in easdem tenebras recidisse, si ab eo qui tyranni nomen adsciuit sibi, cum in Graecis ciuitatibus liberi tyrannorum oppressis illis eodem supplicio adficiantur, petitur ut uindices atque oppressores dominationis sali sint ? Hanc ego ciuitatem uidere uelim aut putem ullam quae ne traditam quidem atque inculcatam libertatem recipere possit, plusque timeat in puero nomen sublati regis quam confidat sibi, cum illum ipsum qui maximas opes habuerit paucorum uirtute sublatum uideat.
Me uero posthac ne commendaueris Caesari tuo, ne te quidem ipsum, si me audies. Valde care aestimas tot annos quot ista aetas recipit si propter eam causam puero isti supplicaturus es. Deinde, quod pulcherrime fecisti ac facis in Antonio, vide ne conuertatur a laude maximi animi ad opinionem formidinis. Nam si Octauius tibi placet a quo de nostra salute petendum sit, non dominum fugisse sed amiciorem dominum quaesisse uideberis.
Cicéron,
Correspondance, I, 16, 5-7
(325 mots)
Session 1993
Dissertation française
« Valéry est avant tout un voluptueux et tout son art est une attention voluptueuse. C’est l’esprit attentif à la chair et l’enveloppant d’une conscience épidermique. Le plaisir atteint par la définition, tout un beau corps gagné, ainsi que par un frisson, par un réseau de propositions exquises. »
Dans quelle mesure ces lignes d’un poète contemporain éclairent-elles votre lecture des œuvres de Valéry inscrites au programme ?
Thème latin
Les Suisses commercent de soldats comme les Hollandais d’épicerie : mais ils ont tous réellement une patrie, au sein de laquelle ils sont sûrs de trouver protection, tranquillité et liberté. Leurs yeux sont souillés du spectacle de la servitude de l’Europe ; mais ils ont préservé leur constitution et leurs mœurs. C’est à la Suisse qu’on peut appliquer ce qu’un historien a dit autrefois de la république romaine, « qu’il n’y en a jamais eu une qui ait conservé plus longtemps sa grandeur et son innocence, où la pudeur, la frugalité, la modestie, compagnes d’une généreuse et respectable pauvreté, aient été plus longtemps en honneur et où la contagion du luxe, de l’avarice et des autres passions qui accompagnent les richesses ait pénétré plus tard ».
Heureux, cent fois heureux ces peuples respectables, s’ils n’échangent point cette solide prospérité, cette inestimable médiocrité contre un bonheur illusoire, factice et destructeur ! heureux, si le luxe ne vient point altérer leurs principes et corrompre leurs mœurs ! si la jalousie ne prend pas chez eux la place de l’émulation ! heureux enfin si la disproportion des forces et la rivalité des différents membres de cette belle assemblée, agitée sans cesse par des intrigues républicaines, ne renversent pas bientôt l’édifice de leur liberté et ne troublent pas du moins leur sage et paisible constitution ! Que le sort de la Grèce, cette république fédérative si florissante, inspire à la Suisse une salutaire méfiance ! L’orgueil d’Athènes et la jalousie des Grecs bannirent pour jamais la liberté de ces contrées si longtemps fortunées.
Honoré-Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau (1749-1791),
Essai sur le despotisme (1775)
(265 mots)
Thème grec
MATADORE À CLINDOR
Je te le dis encor, ne sois plus en alarme :
Quand je veux, j’épouvante ; et quand je veux, je charme ;
Et, selon qu’il me plaît, je remplis tour à tour
Les hommes de terreur, et les femmes d’amour.
Du temps que ma beauté m’était inséparable,
Leurs persécutions me rendaient misérable :
Je ne pouvais sortir sans les faire pâmer.
Mille mouraient par jour à force de m’aimer :
J’avais des rendez-vous de toutes les princesses ;
Les reines à l’envi mendiaient mes caresses :
Celle d’Éthiopie, et celle du Japon (1),
Dans leurs soupirs d’amour ne mêlaient que mon nom.
De passion pour moi deux sultanes troublèrent (2) ;
Deux autres, pour me voir, du sérail s’échappèrent :
J’en fus mal quelque temps avec le Grand Seigneur. […]
Ces pratiques nuisaient à mes desseins de guerre,
Et pouvaient m’empêcher de conquérir la terre.
D’ailleurs, j’en devins las ; et pour les arrêter,
J’envoyai le Destin dire à son Jupiter
Qu’il trouvât un moyen qui fît cesser les flammes
Et l’importunité dont m’accablaient les dames :
Qu’autrement ma colère irait dedans les cieux
Le dégrader soudain de l’empire des Dieux,
Et donnerait à Mars à gouverner sa foudre.
La frayeur qu’il en eut le fit bientôt résoudre :
Ce que je demandais fut prêt en un moment ;
Et depuis, je suis beau quand je veux seulement.
Pierre Corneille,
L’Illusion comique, II, 2
(238 mots)
(1) Traduire par « les régions de l’aurore ».
(2) Troublèrent = causèrent des troubles.
Version latine
LES VIOLENCES DE L’AMOUR
Dulcis ad hesternas fuerat mihi rixa lucernas,
uocis et insanae tot maledicta tuae.
Cur furibunda mero mensam propellis et in me
proicis insana cymbia plena manu ?
Tu uero nostros audax inuade capillos
et mea formosis unguibus ora nota ;
tu minitare oculos subiecta exurere flamma,
fac mea rescisso pectora nuda sinu.
Nimirum ueri dantur mihi signa caloris,
nam sine amore graui femina nulla dolet.
Quae mulier rabida iactat conuicia lingua
et Veneris magnae uoluitur ante pedes,
custodum gregibus circa se stipat euntem,
seu sequitur medias, Maenas ut icta, uias,
seu timidam crebro dementia somnia terrent,
seu miseram in tabula picta puella mouet,
his ego tormentis animi sum uerus haruspex ;
has didici certo saepe in amore notas.
Non est certa fides, quam non in iurgia uertas :
hostibus eueniat lenta puella meis.
In morso aequales uideant mea uulnera collo :
me doceat liuor mecum habuisse meam.
Aut in amore dolere uolo aut audire dolentem,
siue meas lacrimas siue uidere tuas,
tecta superciliis si quando uerba remittis
aut tua cum digitis scripta silenda notas.
Odi ego quae numquam pungunt suspiria somnos ;
semper in irata pallidus esse uelim.
Dulcior ignis erat Paridi, cum grata per arma
Tyndaridi poterat gaudia ferre suae :
dum uincunt Danai, dum restat barbarus Hector,
ille Helenae in gremio maxima bella gerit.
Aut tecum aut pro te, mihi cum riualibus arma
semper erunt : in te pax mihi nulla placet.
Gaude, quod nulla est aeque formosa ; doleres,
si qua foret : nunc sis iure superba licet.
Properce,
Élégies, III, 8, v. 1-36
(36 vers – 241 mots)
Session 1994
Dissertation française
« Et ceux qui liront de bonne foi sentiront bien que la passion qui tient au corps et qui arrache le pansement, ce n’est pas celle qui joint un momnet Félix et l’Anglaise, et qui est si vite oubliée. Non, c’est la platonique qui fait ulcère dans l’estomax, et au survivant une ceinture d’absence et de mélancolie. »
Dans quelle mesure cette réflexion d’Alain (Avec Balzac, 1935) vous paraît-elle pouvoir rendre compte du romanesque balzacien dans Le Lys dans la vallée et La Femme de trente ans ?
Thème latin
TRÈS HUMBLE REMONTRANCE AUX INQUISITEURS
D’ESPAGNE ET DE PORTUGAL
Une Juive de dix-huit ans, brûlée à Lisbonne au dernier autodafé, donna occasion à ce petit ouvrage ; et je crois que c’est le plus inutile qui ait jamais été écrit. (1)
Quand il s’agit de prouver des choses si claires, on est sûr de ne pas convaincre.
L’auteur déclare que, quoiqu’il soit Juif, il respecte la religion chrétienne, et qu’il l’aime assez pour ôter aux princes qui ne seront pas chrétiens un prétexte plausible pour la persécuter.
« Vous vous plaignez, dit-il aux inquisiteurs, de ce que l’empereur du Japon fait brûler à petit feu tous les chrétiens qui sont dans ses États ; mais il vous répondra : Nous vous traitons, vous qui ne croyez pas comme nous, comme vous traitez vous-mêmes ceux qui ne croient pas comme vous : vous ne pouvez vous plaindre que de votre faiblesse, qui vous empêche de nous exterminer, et qui fait que nous vous exterminons.
« Mais il faut avouer que vous êtes bien plus cruels que cet empereur. Vous nous faites mourir, nous qui ne croyons que ce que vous croyez, parce que nous ne croyons pas tout ce que vous croyez. Nous suivons une religion que vous savez vous-mêmes avoir été autrefois chérie de Dieu : nous pensons que Dieu l’aime encore, et vous pensez qu’il ne l’aime plus ; et parce que vous jugez ainsi, vous faites passer par le fer et par le feu ceux qui sont dans cette erreur si pardonnable, de croire que Dieu aime encore ce qu’il a aimé.
« Si vous êtes cruels à notre égard, vous l’êtes bien plus à l’égard de nos enfants ; vous les faites brûler, parce qu’ils suivent les inspirations que leur ont données ceux que la loi naturelle et les lois de tous les peuples leur apprennent à respecter comme des dieux ».
Montesquieu,
L’Esprit des lois
(280 mots)
(1) Ne pas traduire le titre ni cet incipit.
Thème grec
COMPORTEMENT DE SOCRATE LORS D’UNE DÉROUTE (1)
Je le trouvay (dict-il) (2) apres la route (3) de nostre armée, luy et Lachez, des derniers entre les fuyans ; et le consideray tout à mon aise et en seureté, car j’estois sur un bon cheval et luy à pied, et avions ainsi combatu. Je remerquay premierement combien il montroit d’avisement et de resolution au pris de Lachez, et puis la braverie de son marcher, nullement different du sien ordinaire, sa veue ferme et reglée, considerant et jugeant ce qui se passoit autour de luy, regardant tantost les uns, tantost les autres, amis et ennemis, d’une façon qui encourageoit les uns et signifioit aux autres qu’il estoit pour vendre bien cher son sang et sa vie à qui essayeroit de la luy oster ; et se sauverent ainsi : car volontiers on n’ataque pas ceux-cy ; on court apres les effraiez. Voilà le tesmoignage de ce grand capitaine, qui nous apprend, ce que nous essayons tous les jours, qu’il n’est rien qui nous jette tant aux dangers qu’une faim inconsiderée de nous en mettre hors. […] Nostre peuple a tort de dire : celuy-là craint la mort, quand il veut exprimer qu’il y songe et qu’il la prevoit. La prevoyance convient egallement à ce qui nous touche en bien et en mal. Considerer et juger le danger est aucunement le rebours de s’en estonner.
Michel de Montaigne,
Essais, III
(238 mots)
(1) Traduire le titre.
(2) Montaigne rapporte des propos d’Alcibiade.
(3) Route : déroute.
Version latine
DÉBAT AU SÉNAT
AU DÉBUT DU PRINCIPAT DE VESPASIEN
Eo senatus die quo de imperio Vespasiani censebant, placuerat mitti ad principem legatos. Hinc inter Heluidium et Eprium (1) acre iurgium : Priscus eligi nominatim a magistratibus iuratis, Marcellus urnam postulabat, quae consulis designati sententia fuerat.
Sed Marcelli studium proprius rubor excitabat, ne aliis electis posthabitus crederetur. Paulatimque per altercationem ad continuas et infestas orationes prouecti sunt, quaerente Heluidio quid ita Marcellus iudicium magistratuum pauesceret : esse illi pecuniam et eloquentiam, quis multos anteiret, ni memoria flagitiorum urgeretur. Sorte et urna mores non discerni ; suffragia et existimationem senatus reperta, ut in cuiusque uitam famamque penetrarent. Pertinere ad utilitatem rei publicae, pertinere ad Vespasiani honorem, occurrere illi quos innocentissimos senatus habeat, qui honestis sermonibus aures imperatoris imbuant. Fuisse Vespasiano amicitiam cum Thrasea, Sorano, Sentio, quorum accusatores etiam si puniri non oporteat, ostentari non debere. Hoc senatus iudicio uelut admoneri principem, quos probet, quos reformidet. Nullum maius boni imperii instrumentum quam bonos amicos esse. Satis Marcello quod Neronem in exitium tot innocentium impulerit : frueretur praemiis et impunitate, Vespasianum melioribus relinqueret.
Marcellus non suam sententiam impugnari, sed consulem designatum censuisse dicebat, secundum uetera exempla, quae sortem legationibus posuissent, ne ambitioni aut inimicitiis locus foret. Nihil euenisse cur antiquitus instituta exolescerent aut principis honor in cuiusquam contumeliam uerteretur ; sufficere omnes obsequio. Id magis uitandum ne peruicacia quorundam inritaretur animus nouo principatu suspensus et uoltus quoque ac sermones omnium circumspectans. Se meminisse temporum quibus natus sit, quam ciuitatis formam patres auique instituerint ; ulteriora mirari, praesentia sequi ; bonos imperatores uoto expetere, qualiscumque tolerare. Non magis sua oratione Thraseam quam iudicio senatus adflictum : saeuitiam Neronis per eius modi imagines inlusisse, nec minus sibi anxiam talem amicitiam quam aliis exilium. Denique constantia, fortitudine Catonibus et Brutis aequaretur Heluidius : se unum esse ex illo senatu, qui simul seruierit. Suadere etiam Prisco ne supra principem scanderet, ne Vespasianum senem triumphalem, iuuenum liberorum patrem, praeceptis coerceret. Quo modo pessimis imperatoribus sine fine dominationem, ita quamuis egregiis modum libertatis placere. Haec magnis utrimque contentionibus iactata diuersis studiis accipiebantur.
Tacite,
Histoires, IV, 6-8
(323 mots)
(1) Helvidius Priscus était stoïcien, comme son beau-père Thraséa, victime de Néron. Éprius Marcellus était connu pour ses délations au temps de Néron.
Session 1995
Dissertation française
« […] ce siècle a fondé la liberté sur l’affranchissement de l’esprit, jusque-là lié par la chair, lié par le principe matériel de la double incarnation théologique et politique, sacerdotale et royale. Ce siècle, celui de l’esprit, abolit les dieux de chair dans l’État, dans la religion, en sorte qu’il n’y eût plus d’idole, et qu’il n’y eût de Dieu que Dieu. »
Michelet, Histoire de la Révolution française,
Préface de 1847.
Dans quelle mesure ces lignes vous paraissent-elles éclairer la démarche de Voltaire dans le Dictionnaire philosophique ?
Thème latin
SÉNÈQUE A-T-IL EU TORT D’ENCOURAGER
LES AMOURS DE NÉRON ET DE SON AFFRANCHIE ACTÈ ? (1)
Il me semble voir un de nos pudiques censeurs arracher la jeune esclave du lit de son maître ; il me semble entendre la mère de celui-ci lui applaudir, l’encourager et lui dire : « Fort bien ; chassez cette petite courtisane, et envoyez-moi mon fils que j’aime tendrement, comme vous savez, afin que je le console et lui pardonne un goût qui me choquait, et qui croisait mes desseins honnêtes. »
Mais je suppose que, par le plus absurde usage de son éloquence, Sénèque eût fait renvoyer la courtisane et jeté le fils entre les bras de sa mère ; alors que n’eût-on pas dit ? Et je demande quel est l’homme d’une assez étonnante pénétration pour soupçonner qu’en prévenant un inceste, il accélérerait un parricide ? S’il fallait que Néron couchât avec sa mère ou qu’il la tuât, je demande de ces deux crimes quel est celui qu’il fallait préférer ? Mais, censeurs, ne vous tourmentez pas autour de ce cas de conscience ; ce sont les imprudences d’Agrippine, ce fut son ambition, et non le dégoût de Néron, qui la perdirent. Le fruit de l’innocent artifice de Sénèque est évident, et j’ignore encore, je l’avoue, quel eût été celui d’une conduite opposée, si ce n’est peut-être qu’après avoir couché avec la femme impudique, Néron eût ensuite assassiné la mère ambitieuse : celui qui promena ses regards lascifs sur le cadavre d’Agrippine était capable de ces deux crimes. Dans cette circonstance, s’il y avait eu quelques reproches à faire à Sénèque et à Burrhus, la furibonde Agrippine les leur aurait-elle épargnés ?
Denis Diderot,
Essai sur les règnes de Claude et de Néron
(275 mots)
(1) Ne pas traduire le titre.
Thème grec
Les philosophes qui ont examiné les fondements de la société ont tous senti la nécessité de remonter jusqu’à l’état de nature, mais aucun d’eux n’y est arrivé. Les uns n’ont point balancé à supposer à l’homme dans cet état la notion du juste et de l’injuste, sans se soucier de montrer qu’il dût avoir cette notion, ni même qu’elle lui fût utile. D’autres ont parlé du droit naturel que chacun a de conserver ce qui lui appartient, sans expliquer ce qu’ils entendaient par appartenir ; d’autres, donnant d’abord au plus fort l’autorité sur le plus faible, ont aussitôt fait naître le gouvernement, sans songer au temps qui dut s’écouler avant que le sens des mots d’autorité et de gouvernement pût exister parmi les hommes. Enfin tous, parlant sans cesse de besoin, d’avidité, d’oppression, de désirs, et d’orgueil, ont transporté à l’état de nature des idées qu’ils avaient prises dans la société. Ils parlaient de l’homme sauvage, et ils peignaient l’homme civil. Il n’est pas même venu dans l’esprit de la plupart des nôtres de douter que l’état de nature eût existé, tandis qu’il est évident, par la lecture des livres sacrés, que le premier homme, ayant reçu immédiatement de Dieu des lumières et des préceptes, n’était point lui-même dans cet état, et qu’en ajoutant aux écrits de Moïse la foi que leur doit tout philosophe chrétien, il faut nier que, même avant le déluge, les hommes se soient jamais trouvés dans le pur état de nature, à moins qu’ils n’y soient retombés par quelque événement extraordinaire.
Jean-Jaccques Rousseau,
Discours sur l’origine et les fondements des inégalités entre les hommes
(287 mots)
Version latine
LE CONSUL LUCIUS MANLIUS VULSO
HARANGUE SES TROUPES
AVANT D’ATTAQUER LES GALATES
« Iam usu hoc cognitum est : si primum impetum, quem feruido ingenio et caeca ira effundunt (1), sustinueris, fluunt sudore et lassitudine membra, labant arma ; mollia corpora, molles, ubi ira consedit, animos sol puluis sitis, ut ferrum non admoueas, prosternunt. Non legionibus legiones eorum solum experti sumus, sed uir unus cum uiro congrediendo : T. Manlius M. Valerius quantum Gallicam rabiem uinceret Romana uirtus docuerunt ; iam M. Manlius unus agmine scandentes in Capitolium detrusit Gallos. Et illis maioribus nostris cum haud dubiis Gallis, in sua terra genitis, res erat ; hi iam degeneres sunt, mixti, et Gallograeci uere, quod appellantur ; sicut in frugibus pecudibusque non tantum semina ad seruandam indolem ualent quantum terrae proprietas caelique, sub quo aluntur mutat : Macedones, qui Alexandriam in Aegypto, qui Seleuciam ac Babyloniam, quique alias sparsas per orbem terrarum colonias habent, in Syros Parthos Aegyptios degenerarunt ; Massilia, inter Gallos sita, traxit aliquantum ab accolis animorum ; Tarentinis quid ex Spartana dura illa et horrida disciplina mansit ? Generosius in sua quidquid sede gignitur ; insitum alienae terrae, in id quo alitur, natura uertente se, degenerat. Phrygas igitur Gallicis oneratos armis, sicut in acie Antiochi cecidistis, uictos uictores caedetis. Magis uereor ne parum inde gloriae quam ne nimium belli sit. Attalus eos rex saepe fudit fugauitque. Nolite existimare beluas tantum, recens captas, feritatem illam siluestrem primo seruare, dein, cum diu manibus humanis alantur, mitescere, in hominum feritate mulcenda non eamdem naturam esse ; eosdemne hos creditis esse qui patres eorum auique fuerunt ? Extorres inopia agrorum, profecti domo per asperrimam Illyrici oram, Paeoniam inde et Thraeciam pugnando cum ferocissimis gentibus emensi, has terras ceperunt.
Duratos eos tot malis exasperatosque accepit terra quae copia omnium rerum saginaret. Vberrimo agro, mitissimo caelo, clementibus accolarum ingeniis, omnis illa cum qua uenerant mansuefacta est feritas. Vobis mehercule, Martis uiris, cauenda ac fugienda quam primum amoenitas est Asiae : tantum hae peregrinae uoluptates ad extinguendum uigorem animorum possunt, tantum contagio disciplinae morisque accolarum ualet. Hoc tamen feliciter euenit quod, sicut uim aduersus uos nequaquam, ita famam apud Graecos parem illi antiquae obtinent cum qua uenerunt, bellique gloriam uictores eamdem inter socios habebitis quam si seruantes antiquum specimen animorum Gallos uicissetis. »
Tite Live,
Histoire romaine, XXXVIII, 17
(349 mots)
(1) Sujet sous-entendu : Galli.
Session 1996
Dissertation française
« Situés en un point sans durée, possédés par l’action actuelle, les personnages de Racine semblent néanmoins doués du pouvoir de se regarder historiquement, comme s’ils n’étaient pas seulement eux-mêmes mais encore contemporains. Ils sont la proie de l’immédiat, mais ils contemplent en même temps les causes et la fin lointaine du drame où ils sont engagés. Ils se voient au futur comme nous les voyons au passé.
[…] L’extrémité d’émotion à laquelle ils atteignent ainsi a pour complément la plus poignante intensité de poésie : comme si, en reliant des états d’âme que sépare l’ordre des temps, en distribuant leurs passions dans l’espace de durée le plus vaste, ils les investissaient d’uns signification absolue, celle non plus d’une faute ou d’un malheur actuel, mais d’un désespoir qui donne son nom à toute l’existence. »
Dans quelle mesure ces lignes de Georges Poulet, extraites des Études sur le temps humain (1952), éclairent-elle votre lecture de Racine inscrites au programme ?
Thème latin
Monsieur,
J’ai compris, à la suite de certaine découverte que j’ai faite par hasard cet après-midi, que je dois cesser de vous considérer comme mon père, et c’est pour moi un immense soulagement. En me sentant si peu d’amour pour vous, j’ai longtemps cru que j’étais un fils dénaturé ; je préfère savoir que je ne suis pas votre fils du tout. Peut-être estimez-vous que je vous dois la reconnaissance pour avoir été traité par vous comme un de vos enfants ; mais d’abord j’ai toujours senti entre eux et moi votre différence d’égards, et puis tout ce que vous en avez fait, je vous connais assez pour savoir que c’était par horreur du scandale, pour cacher une situation qui ne vous faisait pas beaucoup honneur – et enfin parce que vous ne pouviez faire autrement. Je préfère partir sans revoir ma mère, parce que je craindrais, en lui faisant mes adieux définitifs, de m’attendrir et aussi parce que devant moi, elle pourrait se sentir dans une fausse situation – ce qui me serait désagréable. Je doute que son affection pour moi soit bien vive ; comme j’étais le plus souvent en pension, elle n’a guère eu le temps de me connaître, et comme ma vue lui rappelait sans cesse quelque chose de sa vie qu’elle aurait voulu effacer, je pense qu’elle me verra partir avec soulagement et plaisir. Dites-lui, si vous en avez le courage, que je ne lui en veux pas de m’avoir fait bâtard ; qu’au contraire, je préfère ça à savoir que je suis né de vous. (Excusez-moi de parler ainsi ; mon intention n’est pas de vous écrire des insultes ; mais ce que j’en dis va vous permettre de me mépriser, et cela vous soulagera.)
André Gide,
Les Faux-Monnayeurs
(307 mots)
Thème grec
J’aurais voulu reculer le plus possible, éviter s’il se peut, le moment où les barbares au-dehors, les esclaves au-dedans, se rueront sur un monde qu’on leur demande de respecter de loin ou de servir d’en bas, mais dont les bénéfices ne sont pas pour eux. Je tenais à ce que la plus déshéritée des créatures, l’esclave nettoyant les cloaques des villes, le barbare affamé rôdant aux frontières, eût intérêt à voir durer Rome. Je doute que toute la philosophie du monde parvienne à supprimer l’esclavage : on en changera tout au plus le nom. Je suis capable d’imaginer des formes de servitude pires que les nôtres, parce que plus insidieuses : soit qu’on réussisse à transformer les hommes en machines stupides et satisfaites, qui se croient libres alors qu’elles sont asservies, soit qu’on développe chez eux, à l’exclusion des loisirs et des plaisirs humains, un goût du travail aussi forcené que la passion de la guerre chez les races barbares. À cette servitude de l’esprit, ou de l’imagination humaine, je préfère encore notre esclavage de fait. Quoi qu’il en soit, l’horrible état qui met l’homme à la merci d’un autre homme demande à être soigneusement réglé par la loi. J’ai veillé à ce que l’esclave ne fût plus cette marchandise anonyme qu’on vend sans tenir compte des liens de famille qu’il s’est créés, cet objet méprisable dont un juge n’enregistre le témoignage qu’après l’avoir soumis à la torture, au lieu de l’accepter sous serment. J’ai défendu qu’on l’obligeât aux métiers déshonorants ou dangereux, qu’on le vendît aux tenanciers de maisons de prostitution ou aux écoles de gladiateurs. Que ceux qui se plaisent à ces professions les exercent seuls : elles n’en seront que mieux exercées.
Marguerite Yourcenar,
Mémoires d’Hadrien,
Paris, Plon, 1951
(315 mots)
Version latine
COMMENT PHARASMANÈS, ROI DES ARMÉNIENS,
AVEC L’AIDE DE SON FILS RADAMISTE
ET DE CHEFS ROMAINS, FIT TUER PAR TRAÎTRISE
SON FRÈRE MITHRIDATÈS, ROI DES HIBÉRIENS,
AVEC LEQUEL IL ÉTAIT EN GUERRE
Praefectus (1) hortari Mithridaten ad sanciendum foedus, coniunctionem fratrum ac priorem aetate Pharasmanen et cetera necessitudinum nomina referens, quod filiam eius in matrimonio haberet, quod ipse Radamisto socer esset ; non abnuere pacem Hiberos, quamquam in tempore (2) ualidiores ; et satis cognitam Armeniorum perfidiam, nec aliud subsidii quam castellum, commeatu egenum ; ne dubia tentare armis quam incruentas condiciones mallet. Cunctante ad ea Mithridate et suspectis praefecti consiliis, quod paelicem regiam polluerat inque omnem libidinem uenalis habebatur, Casperius interim ad Pharasmanen peruadit utque Hiberi obsidio decedant expostulat. Ille, propalam incerta et saepius molliora respondens, secretis nuntiis monet Radamistum obpugnationem quoquo modo celerare. Augetur flagitii merces, et Pollio occulta corruptione impellit milites ut pacem flagitarent seque praesidium omissuros minitarentur. Qua necessitate Mithridates diem locumque foederi accepit, castelloque egreditur.
Ac primo Radamistus, in amplexus eius effusus, simulare obsequium, socerum ac parentem appellare ; adicit ius iurandum, non ferro, non ueneno uim adlaturum. Simul in lucum propinquum trahit, prouisum illic sacrificii paratum dictitans, ut diis testibus pax firmaretur. Mos est regibus, quoties in societatem coeant, implicare dextras pollicesque inter se uincire nodoque praestringere ; mox, ubi sanguis artus extremos suffuderit, leui ictu cruorem eliciunt atque inuicem lambunt. Id foedus arcanum habetur, quasi mutuo cruore sacratum. Sed tunc qui ea uincla admouebat, decidisse simulans, genua Mithridatis inuadit ipsumque prosternit ; simulque concursu plurium iniciuntur catenae, ac compede, quod dedecorum barbaris, trahebatur. Moxque uulgus, duro imperio habitum, probra ac uerbera intentabat. Et erant contra qui tantam fortunae commutationem miserarentur ; secutaque cum paruis liberis coniunx cuncta lamentatione complebat. Diuersis et contectis uehiculis abduntur, dum Pharasmanis iussa exquirerentur. Illi cupido regni fratre et filia potior, animusque sceleribus paratus ; uisui tamen consuluit, ne coram interficeret. Et Radamistus, quasi iuris iurandi memor, non ferrum, non uenenum in sororem et patruum expromit, sed proiectos in humum et ueste multa grauique opertos necat. Filii quoque Mithridatis, quod caedibus parentum inlacrimauerant, trucidati sunt.
Tacite,
Annales, XII, 46-47
(304 mots)
(1) Désigne le messager, qui vient de révéler à Déjanire que Lichas, serviteur d’Héraclès, ne lui a pas dit la vérité : ce n’est pas pour obéir à Omphale mais pour s’emparer d’Iole qu’Héraclès a conquis la ville d’Œchalie.
(2) Désigne Iole.
Session 1997
Dissertation française
« Quelquefois il semble qu’on ne tienne plus le fil directeur, que la courbe du récit hésite ; pure apparence : la courbe intérieure reste nette et décidée, mais se trouve cachée par les accidents de la surface. L’embarras où flotte la narration ne provient pas d’une déficience, mais au contraire de la pléthore des intentions. »
Dans quelle mesure votre lecture de La Chartreuse de Parme rejoint-elle ce jugement de Jean Hytier (Les Romans de l’individu, 1928) ?
Thème latin
Les habitants de l’Empire avaient-ils le sentiment d’être « romains » ? Ou bien se considéraient-ils comme des sujets, confinés et retenus dans la servitude par la violence ? Il est impossible de donner à cette question une réponse simple et valable pour tous les temps et aussi pour toutes les classes sociales. Un riche bourgeois de Milet ou de Saintes se sentait certainement plus proche d’un sénateur romain qu’un paysan grec d’un cultivateur italien. Mais il est sûr aussi que Rome ne connut que peu de révoltes nationales. Dans la mesure où les provinciaux accédaient – et ils y accédèrent de plus en plus largement – aux privilèges juridiques des citoyens romains, ils avaient le sentiment d’être vraiment des « Romains » avant d’être des Gaulois ou des Numides. Le cadre de la nation, qui nous semble si fondamental, existait à peine, ce n’était le plus souvent qu’une notion vague, sans efficace pratique.
Une fois maîtres de la Grèce, les Romains eurent pour premier soin de proclamer la libération des cités hellènes. Les historiens modernes accusent volontiers d’hypocrisie ces conquérants « libérateurs » et soulignent que cette prétendue liberté était en fait un esclavage puisque Rome demeurait suzeraine et arbitre. Cependant, il faut bien reconnaître que la conquête romaine restaura effectivement sinon la liberté pleine et entière des cités, du moins leur autonomie. Le régime romain ne ressemblait en rien à celui qu’avaient instauré les souverains hellénistiques successeurs d’Alexandre. Tandis que les rois de Macédoine avaient purement et simplement annexé les anciennes cités en les intégrant à leur royaume, elles et leur territoire, les Romains se bornèrent à les fédérer à l’Empire. Athènes, Sparte et cent autres retrouvèrent leurs lois.
Pierre Grimal,
La Civilisation romaine,
Paris, Arthaud, 1960
(286 mots)
Thème grec
SUR L’HISTOIRE DES HOMMES ILLUSTRES (1)
Les histoires des hommes illustres trompent la jeunesse. On y présente toujours le mérite comme respectable, on y plaint les disgrâces qui l’accompagnent, et on y parle avec mépris de l’injustice du monde à l’égard de la vertu et des talents. Ainsi, quoiqu’on y fasse voir les hommes de génie presque toujours malheureux, on peint cependant leur génie et leur condition avec de si riches couleurs, qu’ils paraissent dignes d’envie dans leurs malheurs memes. Cela vient de ce que les historiens confondent leurs intérets avec ceux des hommes illustres dont ils parlent : marchant dans les mêmes sentiers, et aspirant à peu près à la meme gloire, ils relèvent autant qu’ils peuvent l’éclat des talents ; on ne s’aperçoit pas qu’ils plaident leur propre cause, et comme on n’entend que leur voix, on se laisse aisément séduire à la justice de leur cause, et on se persuade aisément que le parti le meilleur est aussi le plus appuyé des honnêtes gens. L’expérience détrompe là-dessus : pour peu qu’on ait vu le monde, on découvre bientot son injustice naturelle envers le mérite, l’envie des hommes médiocres, qui traverse jusqu’à la mort les hommes excellents, et enfin l’orgueil des hommes élevés par la fortune, qui ne se relache jamais en faveur de ceux qui n’ont que du mérite. Si on savait cela de meilleure heure, on travaillerait avec moins d’ardeur à la vertu.
Vauvenargues,
Réflexions sur divers sujets
(253 mots)
(1) Le titre doit être traduit.
Version latine
L’AUTEUR D’UN TRAITÉ DE RHÉTORIQUE
SE JUSTIFIE DE N’AVOIR PAS EMPRUNTÉ SES EXEMPLES
À AUTRUI
Nunc omnino aliunde sumenda (1) non fuisse sic intellegemus. Primum omnium quod ab artis scriptore adfertur exemplum de eius artificio debet esse. Non ut si quis purpuram aut aliud quippiam uendens dicat : « Sume a me, sed huius exemplum aliunde rogabo tibique quod ostendam. » Sic mercem ipsi qui uenditant aliunde exemplum quaeritant aliquod mercis, aceruos se dicunt tritici habere, eorum exemplum pugno non habent quod ostendant. Si Triptolemus, cum hominibus semen largiretur, ipse ab aliis id hominibus mutuaretur, aut si Prometheus, cum mortalibus ignem diuidere uellet, ipse a uicinis cum testula ambulans carbunculos corrogaret, ridiculus uideretur. Isti magistri, omnium dicendi praeceptores, non uidentur sibi ridicule facere cum id quod aliis pollicentur ab aliis quaerunt ? Si qui se fontes maximos penitus absconditos aperuisse dicat et haec sitiens quom maxime loquatur neque habeat qui sitim sedet, non rideatur ? Isti cum non modo dominos se fontium, sed se ipsos fontes esse dicant et omnium rigare debeant ingenia, non putant fore ridiculum si, cum id polliceantur, arescant ipsi siccitate ? Chares ab Lysippo statuas facere non isto modo didicit ut Lysippus caput ostenderet Myronium, brachia Praxitelea, pectus Polycletium, sed omnia coram magistrum facientem uidebat, ceterorum opera uel sua sponte poterat considerare. Isti credunt eos qui haec uelint discere alia ratione doceri posse commodius ! Praeterea ne possunt quidem ea quae sumuntur ab aliis, exempla tam esse adcommodata ad artem, propterea quod in dicendo leuiter unus quisque locus plerumque tangitur, ne ars appareat, in praecipiendo expresse conscripta ponere oportet exempla uti in artis formam conuenire possint : et post in dicendo, ne possit ars eminere et ab omnibus uideri, facultate oratoris occultatur. Ergo etiam ut magis ars cognoscatur, suis exemplis melius est uti.
Rhétorique à Hérennius, IV, 9-10
(273 mots)
(1) Sous-entendu : exempla.
Session 1998
Dissertation française
Analysant la source de la grandeur cornélienne, Octave Nadal affirme : « Son principe réside dans un désir de gloire qui ne nous permet pas d’établir ce théâtre du sublime sur le plan d’une morale des valeurs. Ou bien il faut consentir à identifier grandeur et valeur, gloire et vérité, et tenir l’exercice des passions pour celui des vertus. L’âme grande n’est pas l’âme l’âme juste ; la générosité des cornéliens est le plus souvent une cruauté. […] Mais il faut bien saisir que ce mouvement libérateur n’est pas non plus celui de la possession, qu’il tend au contraire à se déprendre de l’objet de son désir et qu’il fait ainsi paraître jusqu’à l’évidence le témoignage irrécusable d’une nature enfin dépassée. Telle est l’élévation de Corneille, c’est-à-dire le sublime. »
Dans quelle mesure ce propos éclaire-t-il votre lecture des trois tragédies de Corneille au programme ?
Thème latin
Notre langue, étonnamment saine et expressive, même en son fonds moyen et dans ses limites ordinaires, m’apparaissait comme inépuisable en ressources. Je la comparais à un sol excellent, tout borné qu’il est, que l’on peut indéfiniment exploiter dans sa profondeur, sans avoir besoin de l’étendre, propre à donner tout ce qu’on veut de lui, à la condition qu’on y creuse.
Ces remarques, assez inutiles s’il se fût agi d’un livre où l’idée domine, où le raisonnement est l’allure ordinaire de l’esprit, devenaient autant de précautions nécessaires dans une suite de récits et de tableaux visiblement puisés aux souvenirs d’un peintre. Ce que sa mémoire avec des habitudes spéciales, ce que son œil avec plus d’attention, de portée et de facettes, avaient retenu de sensations pendant le cours d’un long voyage en pleine lumière, il essayait de l’approprier aux convenances de la langue écrite. Il transposait à peu près comme fait un musicien, en pareil cas. Il aurait voulu que tout se vît sans offusquer la vue, sans blesser le goût ; que le trait fût vif, sans insistance de main ; que le coloris fût léger plutôt qu’épais ; souvent que l’émotion tînt lieu de l’image.
Ces deux livres terminés, à deux ans de distance et pour ainsi dire écrits d’une haleine, je les publiai comme ils étaient venus, sans y regarder de trop près. Les défauts qui sautent aux yeux, je les apercevais, même avant qu’on me les signalât. Soit à dessein, soit par impuissance de me corriger, je n’en fis pas disparaître un seul ; et le public voulut bien n’y voir qu’un manque excusable de maturité.
On fit à ces deux livres un bon accueil. Je dirais que l’accueil fut inespéré, si je ne craignais de manquer de mesure, pour ne pas manquer de reconnaissance.
Eugène Fromentin,
Un été dans le Sahara (1857), Préface
(318 mots)
Corrigé proposé par le jury
Sermo noster, qui mirum quam roboris argutiarumque refertum se praebet etiam si quis eo mediocribus in eius facultatibus intraque communem finem utitur, mihi eis opibus abundare uidebatur quae exhauriri nequirent.
Opimo enim quodam agro eum conferre solebam quem, quamuis finitus esset, arando ita penitus coli posset ut eum extendi opus non esset, et dummodo foderetur is ad omnia quaeuis ferenda idoneus esset.
Quae cogitationes inaniores scilicet si quidem is actus esset liber in quo res agitare plus ualuisset ratiocinarique mentis usitatus fuisset ingressus. Nunc uero eisdem omnibus tamquam cautis consiliis uti necesse fiebat eis in narrationibus picturisque inter se contextis quae manifeste ut e pictoris cuiusdam memoriae fontibus haustae essent.
Quae res sensae erant dum longum iter facit ardenti sub luce, earum quod ille memoria sua, singulari autem more ducta, acie sua, at maiore cura, ui, uarietate intenta, retinuerat, id ipsum studebat ut ad quod scriptis congrueret aptum redderetur, utpote qui eas sic fere conuerteret ut in tali re musici agere solent.
Hoc enim optauisset omnia primum ita adipisci posse ut oculis non officeretur, in elegantia nihil offenderetur, manu deinde non commorante acriter lineas adumbratas esse, coloresque leuiores uideri potius quam crassiores saepius denique pro figuris animi motus se tamquam ipsos praebere.
Quos duos libros duobus interiectis annis perfectos unoqu, ut ita dicam, spiritu scriptos, quales mihi in mentem occurrerant tales edidi, ut eos cura non prospicerem nimia. Vitiorum enim quaecumque magis obuia se praeberent ea etiam ante ipse adspiciebam quam de eis certior factus eram. Quorum, siue hoc inire consilium siue me corrigere nequibam, non abstuli ullum, quique tamen eos legerunt pro scriptoris non iam maturi peccatis libenter ista habuerunt.
Quidquid sit, benigne ei libri, quin etiam fauore quodam recepti sunt ambo quem maiorem dicerem quam spe nisi dum ingratus haberi nolo timerem ne immodicus essem.
Thème grec
MENTOR REPROCHE À TÉLÉMAQUE
DE SE LAISSER SÉDUIRE PAR LES PARURES
QUE LUI OFFRE CALYPSO
Mentor lui dit d’un ton grave : « Est-ce donc là, ô Télémaque, les pensées qui doivent occuper le coeur du fils d’Ulysse ? Songez plutôt à soutenir la réputation de votre père et à vaincre la fortune qui vous persécute. Un jeune homme qui aime à se parer vainement, comme une femme, est indigne de la sagesse et de la gloire : la gloire n’est due qu’à un coeur qui sait souffrir la peine et fouler aux pieds les plaisirs. »
Télémaque répondit en soupirant : « Que les dieux me fassent périr plutôt que de souffrir que la mollesse et la volupté s’emparent de mon cœur ! Non, non, le fils d’Ulysse ne sera jamais vaincu par les charmes d’une vie lâche et efféminée. Mais quelle faveur du ciel nous a fait trouver, après notre naufrage, cette déesse ou cette mortelle qui nous comble de biens ? »
« Craignez, repartit Mentor, qu’elle ne vous accable de maux ; craignez ses trompeuses douceurs plus que les écueils qui ont brisé votre navire : le naufrage et la mort sont moins affreux que les plaisirs qui attaquent la vertu. Gardez-vous bien de croire ce qu’elle vous racontera. La jeunesse est présomptueuse ; elle se promet tout d’elle-même : quoique fragile, elle croit pouvoir tout et n’avoir jamais rien à craindre ; elle se confie légèrement et sans précaution. Gardez-vous d’écouter les paroles douces et flatteuses de Calypso, qui se glisseront comme un serpent sous les fleurs ; craignez le poison caché ; défiez-vous de vous-même et attendez toujours mes conseils. »
Fénelon,
Les Aventures de Télémaque, I
(261 mots)
Version latine
CICERO BRVTO SALVTEM
Cum haec scribebam, res existimabatur in extremum adducta discrimen. Tristes enim de Bruto (1) nostro litterae nuntiique adferebantur. Me quidem non maxime conturbabant ; his enim exercitibus ducibusque quos habemus nullo modo poteram diffidere, neque adsentiebar maiori parti hominum ; fidem enim consulum (2) non condemnabam, quae suspecta uehementer erat, desiderabam non nullis in rebus prudentiam et celeritatem ; qua si essent usi, iam pridem rem publicam reciperassemus. Non enim ignoras quanta momenta sint in re publica temporum et quid intersit idem illud utrum ante an post decernatur, suscipiatur, agatur. Omnia quae seuere decreta sunt hoc tumultu, si aut quo die dixi sententiam perfecta essent et non in diem ex die dilata aut quo ex tempore suscepta sunt ut agerentur non tardata et procrastinata, bellum iam nullum haberemus.
Omnia, Brute, praestiti rei publicae quae praestare debuit is qui esset in eo quo ego sum gradu senatus populique iudicio conlocatus, nec illa modo quae nimirum sola ab homine sunt postulanda, fidem, uigilantiam, patriae caritatem ; ea sunt enim quae nemo est qui non praestare debeat. Ego autem ei qui sententiam dicat in principibus de re publica puto etiam prudentiam esse praestandam, nec me, cum mihi tantum sumpserim ut gubernacula rei publicae prehenderem, minus putarim reprehendendum si inutiliter aliquid senatui suaserim quam si infideliter.
Acta quae sint quaeque agantur scio perscribi ad te diligenter. Ex me autem illud est quod te uelim habere cognitum, meum quidem animum in acie esse neque respectum ullum quaerere nisi me utilitas ciuitatis forte conuerterit ; maioris autem partis animi te Cassiumque respiciunt ; quam ob rem ita te para, Brute, ut intellegas aut, si hoc tempore bene res gesta sit, tibi meliorem rem publicam esse faciendam aut, si quid offensum sit, per te esse eandem reciperandam.
Cicéron,
Lettres à Brutus, II, 1
(285 mots)
(1) Décimus Junius Brutus, assiégé dans Modène par Marc Antoine.
(2) Hirtius et Pansa, qui se portaient au secours de Décimus Junius Brutus.
Session 1999
Dissertation française
« Il n’y a pas de secret du Graal. Il n’y a que le secret que Perceval porte en lui-même. La Graal de Chrétien n’est pas un talisman, il n’a aucun pouvoir magique – sinon il eût guéri depuis longtemps le Roi Pêcheur. Ce qu’il y a de « merveilleux » dans Perceval, c’est Perceval. Ce ne sont pas les choses qui sont merveilleuses, c’est le sens qu’on leur donne. Ce n’est pas la montagne qui est merveilleuse, c’est son ascension. C’est la démarche. C’est la découverte, le dévoilement. »
Ce propos d’un critique contemporain éclaire-t-il votre lecture du Conte du Graal ?
Thème latin
Ce n’est pas une nécessité de ne mettre que les infortunes des rois sur le théâtre. Celles des autres hommes y trouveraient place, s’il leur en arrivait d’assez illustres, et d’assez extraordinaires pour la mériter, et que l’histoire prît assez de soin d’eux pour nous les apprendre. Scédase n’était qu’un paysan de Leuctres, et je ne tiendrais pas la sienne indigne d’y paraître, si la pureté de notre scène pouvait souffrir qu’on y parlât du violement effectif de ses deux filles, après que l’idée de la prostitution n’y a pu être soufferte dans la personne d’une sainte qui en fut garantie (1).
Pour nous faciliter les moyens de faire naître cette pitié et cette crainte, où Aristote semble nous obliger, il nous aide à choisir les personnes et les événements qui peuvent exciter l’une et l’autre… En premier lieu, il ne veut point qu’un homme fort vertueux y tombe de la félicité dans le malheur, et soutient que cela ne produit ni pitié ni crainte, parce que c’est un événement tout à fait injuste. Quelques interprètes poussent la force de ce mot grec μιαρόν, qu’il fait servir d’épithète à cet événement, jusqu’à le rendre par celui d’abominable. À quoi j’ajoute qu’un tel succès excite plus d’indignation et de haine contre celui qui fait souffrir que de pitié pour celui qui souffre, et qu’ainsi ce sentiment, qui n’est pas le propre de la tragédie, à moins que d’être bien ménagé, peut étouffer celui qu’elle doit produire, et laisser l’auditeur mécontent par la colère qu’il remporte, et qui se mêle à la compassion qui lui plairait, s’il la remportait seule.
Corneille,
Discours de la tragédie (1660)
(1) Corneille fait ici allusion à Théodore, vierge et martyre.
Corrigé proposé par le jury
Aduersas fortunas necesse non est nullorum in scaenam induci praeter regum, in qua quidem ceterorum hominum locum obtinere possent, dum modo tam nobiles tamque mirabiles his acciderent ut illo haud indignae ducerentur, et qui res scribunt tanti hos facerent ut eorum nobis traderent. Neque enimuero Scedasi rem malam, qui nemo fuisset amplior quam apud Leuctricos agricola quidam, indignam haberem ipsam quae in fabula proderetur, si modo in scaena nostra, quo pudore esset suo pudicitiaque, pati possemus ut de ui duabus istius filiis re ut fuit adhibita commemoraretur, cum ibidem stupri deuotae uirgini cuidam inferendi, quae tamen a re ipsa integra fuisset, ne consilium quidem iam ferri potuisset.
Quo quidem facilius facultas nobis fiat eius misericordiae eiusque timoris parandi, quod ab Aristotele cogi uidemur, ad eos homines eosque casus eligendos quibus hi animi motus moueantur ambo, ille ipse nos adiuuat. Primum enim non uult uirum optimum quemquam in tragoedia de rebus secundis in aduersas decidere, id etiam negat quidquam uel misericordiae uel timoris afferre eo ipso posse quia iste improbior sit casus. Quin etiam, eius uerbi Graeci μιαροῦ, quo ad hunc casum adiecto usus est ille, sunt interpretes qui uim usque eo auxerunt ut hoc in turpe uerterint. Ad quod hoc equidem addo talem exitum eum esse qui iram inuidiamque in illum qui dolorem faciat ita potius moueat quam in hunc qui dolore afficiatur misericordiam, ut ille animi motus qui nisi prudenter expeditus tragoediae non sit, hunc rursus qui eius generis poemati afferendus sit adeo opprimere possit ut audientes aegre ferentes dimittantur se domum iram referre quamdam, et eam cum ea misericordia permixtam quae sibi tamen uideretur si modo referrent meram.
Thème grec
AU LECTEUR (1)
Si j’appréhende quelque chose, c’est que des personnes un peu sérieuses ne traitent de badineries le procès du chien et les extravagances du juge. Mais enfin je traduis Aristophane, et l’on doit se souvenir qu’il avait affaire à des spectateurs assez difficiles. Les Athéniens savaient apparemment ce que c’était que le sel attique ; et ils étaient bien sûrs, quand ils avaient ri d’une chose, qu’ils n’avaient pas ri d’une sottise.
Pour moi, je trouve qu’Aristophane a eu raison de pousser les choses au-delà du vraisemblable. Les juges de l’Aréopage n’auraient pas peut-être trouvé bon qu’il eût marqué au naturel leur avidité de gagner, les bons tours de leurs secrétaires, et les forfanteries de leurs avocats. Il était à propos d’outrer un peu les personnages pour les empêcher de se reconnaître. Le public ne laissait pas de discerner le vrai au travers du ridicule ; et je m’assure qu’il vaut mieux avoir occupé l’impertinente éloquence de deux orateurs autour d’un chien accusé, que si l’on avait mis sur la sellette un véritable criminel, et qu’on eût intéressé les spectateurs à la vie d’un homme.
Quoi qu’il en soit, je puis dire que notre siècle n’a pas été de plus mauvaise humeur que le sien, et que si le but de ma comédie était de faire rire, jamais comédie n’a mieux attrapé son but.
Jean Racine,
Préface des Plaideurs
(247 mots)
(1) Traduire le titre.
Version latine
EN PRÉSENCE DU ROI LATINUS, DÉBAT ENTRE DRANCÈS ET TURNUS
SUR L’OPPORTUNITÉ DE FAIRE LA PAIX OU DE CONTINUER LA GUERRE
AVEC LES TROYENS D’ÉNÉE
« Rem (1) nulli obscuram nostrae nec uocis egentem
consulis, o bone rex : cuncti se scire fatentur
quid fortuna ferat populi, sed dicere mussant.
Det libertatem fandi flatusque remittat,
cuius ob auspicium infaustum moresque sinistros
(dicam equidem, licet arma mihi mortemque minetur)
lumina tot cecidisse ducum totamque videmus
consedisse urbem luctu, dum Troia temptat
castra fugae fidens et caelum territat armis.
Vnum etiam donis istis, quae plurima mitti
Dardanidis dicique iubes, unum, optime regum,
adicias, nec te ullius uiolentia uincat
quin gnatam egregio genero dignisque hymenaeis
des pater et pacem hanc aeterno foedere iungas.
Quod si tantus habet mentes et pectora terror,
ipsum obtestemur ueniamque oremus ab ipso
cedat, ius proprium regi patriaeque remittat.
Quid miseros totiens in aperta pericula ciuis
proicis, o Latio caput horum et causa malorum ?
Nulla salus bello, pacem te poscimus omnes,
Turne, simul pacis solum inuiolabile pignus.
Primus ego, inuisum quem tu tibi fingis (et esse
nil moror), en supplex venio. Miserere tuorum,
pone animos et pulsus abi. Sat funera fusi
uidimus, ingentis et desolauimus agros.
Aut, si fama mouet, si tantum pectore robur
concipis et si adeo dotalis regia cordi est,
aude atque adversum fidens fer pectus in hostem.
Scilicet ut Turno contingat regia coniunx,
nos animae uiles, inhumata infletaque turba,
sternamur campis ? Etiam tu, si qua tibi uis,
si patrii quid Martis habes, illum aspice contra,
qui vocat. »
Talibus exarsit dictis violentia Turni ;
dat gemitum rumpitque has imo pectore uoces :
« Larga quidem semper, Drance, tibi copia fandi
tum, cum bella manus poscunt, patribusque uocatis
primus ades. Sed non replenda est curia uerbis,
quae tuto tibi magna uolant, dum distinet hostem
agger moerorum nec inundant sanguine fossae. »
Virgile,
Énéide, XI, v. 343-382
(40 vers – 271 mots)
Tous les sujets de l’Agrégation externe
de Lettres classiques (2000-2019) en livre papier

Session 2000
Thème latin
Charles Perrault,
Contes, Riquet à la houppe
Corrigé proposé par le jury
Regina quaedam filium tam foedum et deformem quondam peperit ut dubium diu fuerit num isti species esset humana. Mulier autem saga carminumque perita, quae eo nascente ibi aderat, pronuntiauit eumdem tamen haud indignum Venere fore, qui ingenii frueretur acutiore ; hoc etiam futurum esse addidit ut idem, ea facultate praeditus quam a se ipsa modo accepisset, uirgini olim, si quam maxime diligeret, id ingenium quo ipse uteretur par iniicere posset. Quae maerenti reginae solacio paulum fuerunt, cum moleste se tam taetrum simiolum peperisse ferret. Enimuero puer ille, ubi primum loqui coepit, multa et uenusta uerba fecit et, quaecumque ab eo agebantur nescio quid tam facetum urbanumque praebuerunt ut omnes eis illicerentur.
Anno autem septimo uel octauo praeterito, in proximo quodam regno factum est ut altera regina filias peperit duas, quarum quae prior in lucem edita est die clarior fuit. Quod tantae illi reginae fuit laetitiae ut id uerendum etiam fuerit ne quid malum ex eo ipso maiore gaudio infelix pateretur. Cum autem saga eadem adesset, ad reginae laetitiam temperandam negauit ullum ingenium huix nuper natae regia stirpe filiae fore, eamque addidit etiam tam stultam stolidamque futuram esse quam formosa uideretur. Quod regina mater scilicet moleste tulit, cui tamen multo aegrior dolor mox accipiendus fuit, cum paulo post alteram peperit quae forte foedissimam se praebuit. Tum saga : “Ne maerore, domina, confecta sis, inquit, nam aliis rebus difformitas eius pensetur, utpote cui ingenium futurum sit tam acutum ut a nullo fere eam pulchritudine carere animaduertatur.” Tum talia dicenti : “Ita di faxint! regina ait, nonne tamen hox fieri possit ut acuti ingenii quantulumcumque maiori natu ipsi transmittatur, quae tam uenusta sit ?”
Session 2001
Thème latin
Marguerite Yourcenar,
Mémoires d’Hadrien
Corrigé proposé par le jury
Quae de Vrbe Hadrianus cogitare potuerit
Roma non iam Roma continetur, quae aut peritura, aut terrarum dimidiae parti iam adaequanda sit. Haec enim fastigia, haec plana tecta, hae insulae, haec omnia quae modo, occidente sole, aureo et tam suaui rubore quasi pinguntur non iam, ut quondam regum nostrorum memoria, timidis muris cincta sunt ; quorum ipse ego maiorem partem restitui, uel praeter Germanorum siluas uel per Britannorum solitudines. Quotiens quippe, cum fieret ut uia, nitente sudo, inflecteretur, Graecam arcem quamdam e longinquo prospexi, cum urbe sua plane ut flore adulta, et ad collem eius pertinentem, uelut ad caulem calyx, totiens sentire solebam hanc stirpem, cui par nihil esset, eximia ipsa uirtute sua tamquam contentam, atque orbis uno loco, aeui uno spatio absolutam fuisse. Etenim ex hoc uno id fieri posse ut, perinde ac gramina, ae augeretur, quod grana sua genuisset : quibus profecto notionum tamquam seminibus e Graecis orbis consita uber facta est. Immo Romam illam, utpote quae tardior et forma incertior amnis sui per ripas in campis latius uagari uideretur, adolescendo ita componi ut amplius crescere posset. Et illa nimirum e ciuitate imperium euasit. Quin ego imperium maius etiam fieri uoluissem, eumque et orbis ordinem, et rerum ordinem fieri. Quae uirtutes illi quondam exiguae urbi septemque montibus regendis pares fuissent, eas adeo faciliores uariasque fieri oportere, ut ad orbem regendam aptas redderentur. Nam Roman illam quam primus aeternam dicere ausus essem, earum dearum matrum in dies similiorem fore, quae per Asiam coli solent : felicem prole iuuenum segetumque, et leones uel apium examina in gremio fouentem. At uidelicet quaecumque in luce ab hominubus edita sunt, dummodo aeterna petant, ea ad mutationes uicissitudinesque naturae rerum accommodanda sunt, eisque cum siderum temporibus congruendum esse uidetur.
Session 2002
Thème latin
Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de Lafayette,
La Princesse de Clèves, Seconde partie
Corrigé proposé par le jury
Haec eas litteras legit atque eas iterum et saepius legit, ut quae legisset tamen nesciret. Nihil enim uidebat nisi illum se non eo modo amare quo putauisset et alias mulieres amare quas sicut se falleret. Qualia uidebat et qualia cognoscebat mulier tali animo praedita quali haec erat, quae saeuo ardebat amore, cuius signa paulo ante ostenderat uni uiro quem eo indignum putabat alterique quem quod illum amabat uexabat ! Profecto nullus maeror nec tam asper nec tam acer umquam fuit. Cui uidebatur hunc maerorem propter ea quae hoc die accidissent acerbum esse neque, nisi quid fuisset cur ille se ab ipsa amari crederet, illum alteram mulierem amare sibi curae futurum fuisse. At haec ipsa se fallebat ; nam istud malum, quod tam intelorabile ducebat, re uera erat ea sollicitudo quam aliqua aemula mouet et omnes horribiles animi motus qui eam consequi possunt. Quae eis litteris illum consuetudinem cum amica iam diu habere uidebat. Quin etiam existimabat ei quae litteras scripsisset talem urbanitatem et dignitatem esse ut ae digna quae amaretur esset, atque maiorem fortitudinem quam sibi ipsi esse ut ei in constantia inuideret qua freta sensus suos illum celauisset. Praeterea extremis litteris lectis eam mulierem se amari credere uidebat. Itaque illum nobilem uirum erga se uerecundiam — qua tam commota erat — fortasse praestitisse ob eam unam causam quia amore eius mulieris alterius arderet quam ne offenderet timeret putabat. Denique haec cogitationibus quaecumque eius maerorem et desperationem augere poterant animum agitabat.
Session 2003
Thème latin
Jean de La Fontaine,
Fables, XI, 7, v. 23-62
Corrigé proposé par le jury
Qualem contionem quidam a Danubio adueniens rusticus habuerit
« Romani, et uos, patres, qui me audituri sedetis, deos in primis obtestor ut mihi opem ferant. Vtinam dii immortales, ut qui linguam meam ducant, faciant ne quidquam quod reprehendendum sit dicam! Nam nisi dei hominibus auxilio sunt, in horum animos ita solum penetrare potest omne malum et omne nefas ut, nihi hi illos in auxilium reuocant, eorum iura polluant. Cuius testes nos sumus in quos Romanorum auaritia animaduertit. Sceleribus enim nostris magis quam rebus gestis suis Romani supplicii nostri ministri sunt. Veremini, Romani, ueremini ne caelestes lacrimas et fortunam aduersam in moenia uestra quandoque transferant neue, cum in manibus nostris aequa uicissitudine arma ponant, quibus poenas seueras petentes utuntur, irati faciant ut uos inuicem nobis seruiatis. Et cur uobus seruimus ? Aliquis mihi dicat qua re sescentis uariisque gentibus uitam perturbauistis cum quieti beatos agros coleremus et manus nostrae non solum ad agrum arandum sed etiam ad artes aptae essent ? Quid Germanos docuistis ? Qui sollertes et fortes sunt. Si auiditas ita illis ut uobis fuisset, et uis, fortasse potestas, quae uobis est, illis esset et sine inhumanitate ea uti scirent. Quam potestatem in nos praetores uestri adhibuerunt, ea animo concipi uix potest et maiestas ararum uestrarum ipsa ea laesa est. Nam scitote/scite deos immortales oculus in nobis defixos habent. Exemplis uestris illi nihil uident nisi res horribiles, se contemni et templa sua, auaritiae signa quae furori coniuncta est. Profecto istis qui ad nos Roma ueniunt nihil satis est. Itaque tellus et homines labore suo frustra nituntur ut istos satient. »
Version grecque
Eschyle,
Les Sept contre Thèbes, v. 182-225
Corrigé proposé par le jury
Étéocle. Je vous le demande, créatures insupportables, est-ce donc là l’attitude la meilleure pour sauver la cité, est-ce là donner confiance à notre armée enfermée en ses tours que de tomber aux pieds des statues des dieux protecteurs de la cité de crier, de hurler, conduite que haïssent les gens sensés ? Puissé-je, ni dans le malheur ni dans la douce prospérité, ne pas vivre dans la même maison que l’engeance féminine : a-t-elle le dessus, elle est une impudence à faire fuir, mais a-t-elle pris peur, elle est, pour sa maison comme pour la cité, un mal encore plus grand. Et maintenant, en vous mettant à courir et à fuir ainsi en tous sens, vous avez répandu chez nos concitoyens le grondement de la lâcheté sans cœur. Et les forces de ceux qui sont à l’extérieur de nos portes se trouvent gonflées au plus haut point. […] Un vote funeste sera décidé contre eux, et pas de danger qu’il n’échappe à la mort par lapidation infligée par le peuple. […] Reste à l’intérieur et ne cause pas de dommage !
Le chœur. Cher enfant d’Œdipe, j’ai pris peur en entendant le fracas, oui, le fracas sonore des chars, le grincement que les moyeux qui font tourner les roues ont fait retentir et celui du mors des chevaux qui jamais ne s’endort dans leur bouche, frein forgé dans le feu.
Étéocle. Eh quoi ! est-ce par hasard en fuyant de la poupe qu’un marin trouve le moyen de se sauver, quand le navire peine en se heurtant au flot marin ?
Le chœur. […] quand le grondement de la chute d’une funeste neige se fit entendre à nos portes ; c’est alors que l’effroi m’a poussée à prier les Bienheureux, afin qu’ils couvrent la cité de leur force protectrice.
Étéocle. Priez pour que nos tours repoussent la lance ennemie ! […] En tout cas, on dit que les dieux d’une cité prise l’abandonnent.
Le chœur. Ah ! que jamais, tant que je vivrai, ne nous abandonnent tous ces dieux ici réunis, que je n’assiste pas au spectacle de notre cité parcourue en tous sens par les ennemis ni à celui de son peuple atteint par un feu destructeur !
Étéocle. Je t’en prie, invoque les dieux, sans former de mauvaises résolutions ! Car l’obéissance est la mère du succès qui sauve, femme. Voilà la vérité/Voilà ce qu’on dit.
Version latine
Tite Live,
Histoire romaine, XXXI, 48
Corrigé proposé par le jury
Auprès d’une grande partie du sénat, il avait de l’influence à la fois par l’importance de ses actions et par la faveur dont il jouissait. Si les plus âgés lui refusaient le triomphe, c’est qu’il avait combattu avec l’armée d’un autre et qu’il avait abandonné sa province par désir d’arracher le triomphe en profitant de l’occasion – façon d’agir sans précédent. Les anciens consuls surtout pensaient qu’il aurait fallu attendre le consul – il aurait pu en effet, après avoir établi son camp près de la ville et tout en protégeant la colonie sans livrer bataille, faire traîner l’affaire en longueur jusqu’à l’arrivée du consul – et le sénat devait faire ce que n’avait pas fait le préteur, attendre le consul : quand ils auraient entendu le consul et le préteur débattre devant tous, ils jugeraient plus exactement de l’affaire. Une grande partie du sénat était d’avis que le sénat ne devait prendre en considération que les actions accomplies et voir si on avait agi, dans sa magistrature, sous ses propres auspices ; des deux colonies qui avaient été établies comme des verrous pour contenir les soulèvements des Gaulois, alors que l’une avait été pillée et incendiée et que l’incendie allait passer à l’autre colonie si proche, comme entre des maisons mitoyennes, qu’aurait dû faire enfin le préteur ? Si rien en effet ne pouvait se faire sans le consul, ou il y avait eu faute du sénat qui avait donné une année au préteur (ou : pour avoir donné une armée au préteur) – il aurait pu de fait, de la même façon qu’il voulait que l’affaire fût menée non par l’armée du préteur mais par celle du consul, spécifier de même par sénatus-consulte qu’elle ne fût pas menée par le préteur mais par le consul – ou il y avait eu faute du consul qui, alors _qu’il avait fait passer son armée d’Étrurie en Gaule, ne s’était pas présenté lui-même à Ariminum pour participer à une guerre qu’il était impie de mener sans lui. Il y a des circonstances dans les guerres qui ne souffrent pas les retards et les délais des généraux, et il fallait parfois combattre, non parce qu’on le voulait mais parce que l’ennemi nous y forçait. On devait prendre en considération le combat lui-même et l’issue du combat : les ennemis avaient été battus et massacrés, leur camp pris et saccagé, une colonie libérée de son siège, les prisonniers de l’autre colonie repris et rendus aux leurs, en un seul combat on avait mis fin à la guerre. Ce n’étaient pas seulement les hommes qui s’étaient réjouis de cette victoire : les dieux immortels aussi s’étaient vu attribuer trois jours d’actions de grâces, parce que le préteur Lucius Furius avait mené les affaires de l’état avec compétence et bonheur, et non avec incompétence et légèreté. Ajoutons que les guerres contre les Gaulois avaient été attribuées par une sorte de fatalité à la famille Furia.
Session 2004
Thème latin
Jacques-Bénigne Bossuet,
Discours sur l’Histoire universelle, III, 5
Corrigé proposé par le jury
Quam ut aliqui deus obseruatus Alexander Babylona redierit
Formidandum uero illud imperium, quod armis parauerat, non longius perductum est quam uita eius, quae fuit ualde breuis. Natus enim triginta tres annos, cum ei essent consilia quibus nemo umquam ampliora molitus esset meritissimoque speraret fore ut res sibi prospere succederent, decessit neque illi regi licuit res suas firmiter constituere relinquenti imbecilli animi fratrem puerosque infantes tanto oneri sustinendo impares. Sed, quod maxime fuit exitio et domui eius et imperio, duces relinquebat quos ita assuefecerat ut nulla re praeter dominationem et bellum arderent. Qui prospexit quo licentiae, se mortuo, procederent ; itaque, ut eos coerceret neue improbarent quae constituisset, neque successorem sibi neque tutorem liberis suis instituere ausus est ; sed praedixit fore ut amici exsequias cruentis proeliis celebrarent, et florenti aetate extremum spiritum effudit, tristes futuri post mortem suam tumultus imagines animo concipiens. Vidisti enim ut eius imperium diuisum esset euersaque domus horribili ruina. Nam Macedonia, quod regnum primum habuerat maioresque eius per tot saecula tenuerant, tamquam uacua hereditas undique obsessa est atque, cum diu in praedam potentissimi cuiusque cessisset, tandem ad aliam domum translata est. Itaque magnus ille gentium uictor, quo nemo umquam nobilior uel praeclarior exstitit, ultimus rex suae gentis fuit. Quod si quietus in Macedonia mansisset, magnitudine imperii eius duces non incitati essent et licuisset illi tradere liberis suis regnum quod a maioribus acceperat. Nunc autem, quoniam nimio potentior fuerat, omnibus suis exitio fuit ; illustrem uidelicet fructum tot domitarum nationum !
Version grecque
Plutarque, Sur le démon de Socrate
Corrigé proposé par le jury
Lui-même disait que, ayant un jour interrogé Socrate à ce sujet, il n’avait pas obtenu de réponse – et que c’était la raison pour laquelle il ne l’avait plus interrogé de nouveau mais que souvent il s’était trouvé à ses côtés tandis que celui-ci considérait que ceux qui prétendent avoir rencontré une divinité par l’intermédiaire d’une vision étaient des imposteurs, mais en revanche, prêtait attention à ceux qui disent avoir entendu une voix et les interrogeait avec beaucoup de sérieux. De là, il nous vint à l’esprit, tandis que nous examinions la question en privé entre nous, de supposer que le démon de Socrate n’était peut-être pas une vision mais la perception de quelque voix ou la compréhension d’une parole qui s’attachait à lui de manière extraordinaire. Mais pour la plupart des hommes, une telle compréhension ne se produit véritablement qu’en rêve à cause de la tranquillité et du calme du corps — lorsqu’on dort, on entend mieux —, alors qu’à l’état de veille leur âme a bien de la peine à se tenir à l’écoute des êtres supérieurs, et, étouffés assurément par le tumulte de leurs passions et le tourbillon de leurs besoins, ils ne peuvent entendre ni prêter leur attention à ce qui leur est révélé. Mais dans le cas de Socrate, son esprit, comme il était pur et exempt de passions, parce qu’il ne se mélangeait au corps que pour les strictes nécessités, était facile à toucher et subtil au point de se transformer vivement sous l’effet de ce qui lui parvenait et l’on pourrait se figurer que ce qui lui parvenait était non un son, mais la parole d’un démon qui, sans avoir recours à la voix, entrait en relation avec celui qui pense par l’intermédiaire de cela même qui était montré. La voix ressemble en effet à un choc, lorsque l’âme reçoit le discours de force par les oreilles/parce que l’âme reçoit le discours par les oreilles ; mais l’esprit de l’être supérieur guide l’âme douée d’une nature bonne en l’effleurant, par l’intermédiaire de ce qui a été pensé, sans que celle-ci ait besoin d’un choc, tandis que celle-ci s’abandonne à l’esprit qui détend et tend ses élans, des élans que ne rendent pas violents des passions opposant une tension inverse, mais souples et doux, pareils à des rênes que l’on a relâchées. Or il ne faut pas s’en étonner, lorsqu’on voit d’un côté les tours effectués par de grands vaisseaux sous l’action de petits gouvernails, de l’autre, la rotation des tous de potiers qui tournent en cercles réguliers quand on les effleure du bout des doigts.
Version latine
Properce,
Élégies, II, 14, v. 17-58
Corrigé proposé par le jury
Attention : le jour du concours, il faut traduire le texte en prose et non en stiques !
Quand viendra la mort un jour fermer mes yeux,
souviens-toi d’observer ces dispositions pour les funérailles.
Je ne veux pas d’un cortège promenant la longue suite des masques,
ni de la trompette qui pleurera en vain ma destinée (1),
Que sur des montants d’ivoire on ne dresse pas mon lit funèbre,
et que mon cadavre ne repose pas sur les coussins d’Attale.
Loin de moi la file des vases parfumés ! Je ne veux que
les simples obsèques d’un convoi plébéien.
Pour tout cortège, il me suffit de trois petits livres,
ma plus riche offrande, qu’à Perséphone je porterai.
Toi, lacérant tes seins nus (2), tu suivras,
et, sans te lasser, tu invoqueras mon nom.
Et sur mes lèvres glacées tu poseras tes derniers baisers,
quand on répandra un vase d’onyx plein du présent syrien.
Puis, quand la flamme sous mon corps m’aura fait cendre,
qu’une petite urne accueille mes Mânes,
Et que sur ma tombe étroite on plante un laurier
dont l’ombre couvrira la place du bûcher éteint.
Que l’on grave aussi ces deux vers : « Celui qui maintenant gît ici, poussière affreuse,
autrefois d’un unique amour était l’esclave ».
Et de mon tombeau le renom ne sera pas moins renommé
que du héros de Phthie le fameux tombeau sanglant.
Toi aussi, quand tu toucheras à ton destin, rappelle-toi
ce chemin : les cheveux blancs, viens jusqu’aux pierres du souvenir.
Garde-toi de me dédaigner quand je serai enseveli :
ce qui est vrai, la terre en sa conscience le sent.
Ah ! si l’une des trois Sœurs, n’importe laquelle,
avait voulu que dès le berceau je dépose mon âme !
À quoi bon préserver la vie pour une heure si incertaine ?
On n’a vu qu’après trois générations les cendres de Nestor :
Mais si un soldat gallique, sous les remparts d’Ilion,
d’une si longue vieillesse avait abrégé le destin,
Il n’aurait pas vu mettre en terre le corps d’Antiloque,
et n’aurait pas dit : « Ô mort, pourquoi viens-tu si tard ? »
Mais toi tu pleureras souvent ton amant perdu :
les dieux veulent qu’on aime à jamais les amants trépassés.
Je prends à témoin la déesse à qui le sauvage sanglier
frappa le neigeux Adonis qui chassait sur les sommets de l’Idalie :
c’est dans ces marais que tu l’as appelé ce beau jeune homme, et c’est là
que tu es venue, dit-on, Vénus, les cheveux défaits.
Mais toi, Cynthia, en vain tu crieras à mes Mânes muets de revenir :
mes os réduits en poussière, comment parleront-ils ?
(1) Litt. : “Que la trompette ne soit pas (n’émette pas) vaine plainte sur ma destinée !”.
(2) Litt. : “Lacérée quant à ton sein nu” (accusatif de relation).
Session 2005
Thème latin
Albert Camus,
La Peste, III
Corrigé proposé par le jury
Quomodo homines desiderare suos consuescant
Num ciues nostri, ii quidem qui eo desiderio maxime doluerant, ista condicione sua consuescebant ? Quod non admodum recte affirmetur, sed verius sit dicere eos ut corpore ita animo macie corruptos esse. Incipiente quidem pestilentia, clarissime illius quem amiserant meminerant eiusque desiderio mouebantur. Qui, etiamsi distincte meminerant carae faciei ac eius modi ridendi et cuiusdam diei quem felicem fuisse post tempus agnoscebant, uix tamen animo concipiebant quidnam alter faceret ea ipsa hora qua eum memoria repeterent atque in locis iam tam longinquis. Ad summam uero illo tempore cum memoria uigebant tum tamen cogitatio rerum eos deficiebat. Cum autem pestilentia secundum tempus ingressa est, memoriam etiam deposuerunt. Non enim quod illius faciei obliti essent sed, quod eodem pertinet, quia illa suam carnem amiserat, ideo eam intus in animis iam non percipiebant. Cum autem primis temporibus proni essent ad querendum sibi rem iam esse cum nullo nisi cum umbris in iis rebus quae ad amorem suum adtinerent, deinde intellexerunt eas umbras magis etiam macie corruptas fieri posse, cum amitterent uel infimos colores ipsos quos illis recordatio sua seruaret. Itaque extremo huius diuturnae separationis tempore, non iam animo concipiebant in qua intima familiaritate uersari soliti essent neque quomodo posset fieri ut apud se uitam egisset quidam quem quolibet tempore manu tangere possent.
Ergo si res ita considerantur illi in ordinem ipsum rerum pestilentiae quasi ingressi erant qui eo magis ualebat quo magis mediocris erat. Nec quisquam apud nos magnis animi sensibus iam adficiebatur, sed omnes odiose aequabilia sentiebant. « Tempus est istis rebus finem fieri ! » ita loquebantur cives nostri.
Version grecque
Platon, Les Lois, VII, 805d-806d
Corrigé proposé par le jury
‘‘Eh bien, parmi celles qui ont été maintenant mises au jour, quelle organisation pourrions-nous préférer à cette communauté que nous sommes en train de leur prescrire ? Sera- ce celle que les Thraces et beaucoup d’autres peuples appliquent à leurs femmes : travailler la terre, mener paître les bœufs ou les moutons, et servir exactement comme les esclaves ? Ou bien une organisation comme celle que nous avons chez nous et chez tous les peuples de cette contrée ? De fait, aujourd’hui, chez nous, voici ce qui se passe en ce matières/concernant les femmes. Nous rassemblons, comme on dit, en une seule pièce toutes nos richesses, nous confions aux femmes le soin d’en assurer l’intendance et de diriger le tissage et tout le travail de la laine. Ou bien, Mégille, devons-nous parler du régime intermédiaire, l’organisation lacédémonienne ? Les jeunes filles doivent vivre en participant aux exercices corporels et à l’art des Muses, tandis que les femmes, déchargées du travail de la laine, ne se tissent pas moins en quelque sorte [qui rend τινα, utilisé pour atténuer une expression, comme quasi en latin] une vie laborieuse mais qui n’est nullement vile ni basse. elles arrivent d’un autre côté à tenir la balance entre les services domestiques, l’intendance de la maison, et l’éducation des enfants, mais sans participer aux exercices guerriers, comme des Amazones/comme si c’étaient de Amazones, de sorte que même si un jour le sort les contraignait à combattre pour la défense de leur cité et de leurs enfants, elles ne pourraient recourir ni à l’arc, comme les Amazones, ni à aucune autre arme de jet, ni saisir bouclier et javelot pour imiter la déesse [Pallas Athéna : il fallait bien regarder l’article !] de façon à résister noblement si leur patrie était ravagée, et à pouvoir inspirer aux ennemis au moins de la crainte, si ce n’est davantage, par le spectacle qu’elles offrent, en bon ordre de bataille.’’
Version latine
Cicéron,
Paradoxes des stoïciens, V, 33-36
Corrigé proposé par le jury
33. « Qu’on loue ce commandant en chef, ou qu’on l’appelle même ainsi ou qu’on le juge digne de ce titre ? Commandant en chef, comment cela ? Ou à quel homme libre, enfin, commandera cet homme, qui ne peut commander à ses propres passions ? Qu’il réprime d’abord ses envies effrénées, qu’il rejette les plaisirs, que sa colère, il la maîtrise, qu’il contienne son avidité, que toutes les autres noirceurs de son âme, il les repousse ! Qu’il commence alors à commander aux autres quand lui-même aura cessé d’obéir à ces maîtres d’une parfaite indignité que sont le déshonneur et la turpitude ; mais en vérité, tant qu’il leur obéira, on ne devra absolument pas le considérer comme un commandant en chef, pas même comme un homme libre. Voici, en effet, ce qui a été clairement développé par les gens les plus instruits, dont je ne convoquerais pas l’autorité si je devais tenir ces propos devant des rustres ; mais puisque je m’adresse à des hommes éminemment compétents, qui ne sont pas sans avoir entendu parler de ces idées, pourquoi feindrais-je, si j’ai consacré tant soit peu de peine à ces études, de l’avoir dépensée en pure perte ? Les hommes les plus savants ont donc dit que nul n’est libre sinon le sage.
34. Qu’est-ce en effet que la liberté ? Le pouvoir de vivre selon son libre-arbitre. Qui donc vit selon son libre-arbitre si ce n’est celui qui suit le droit chemin, qui se réjouit d’accomplir son devoir, qui a examiné et prévu le cours de sa vie, qui, pas même aux lois, n’obéit par crainte, mais qui les suit et les respecte parce qu’il juge que c’est l’attitude la plus salutaire, qui ne dit rien, ne fait rien, ne pense rien enfin, sinon de son plein gré et librement, dont toutes les décisions et toutes les entreprises trouvent en lui-même sa source et son aboutissement, sur qui rien n’a plus de poids que sa propre volonté et son propre jugement, et qui plus est, devant qui s’incline aussi la Fortune même, elle qui passe pour détenir un très grand pouvoir, s’il est vrai, comme l’a dit le poète dans sa sagesse, que « ce sont ses propres mœurs qui façonnent à chacun sa fortune » ? C’est donc au sage seul qu’iléchoit de ne rien faire malgré lui, rien dans l’affliction, rien par contrainte.
35. Qu’il en soit ainsi, il faudrait assurément le développer en plus de mots ; cependant, voici une affirmation brève, et il faut l’admettre : personne n’est libre si ce n’est l’homme qui est ainsi disposé. Esclaves donc, tous les gens sans vertu, oui esclaves ! Et c’est moins l’idée que la formulation qui est déroutante et étonnante. En effet, on ne dit pas qu’ils sont esclaves au même titre que des choses acquises en toute propriété, devenues biens des maîtres par contrat de vente ou par quelque acte de droit civil ; mais si la servitude est, comme elle l’est, la soumission d’une âme brisée, ravalée et privée de son libre-arbitre, qui pourrait nier que tous les hommes frivoles, tous les hommes cupides, bref tous les hommes sans vertu sont esclaves ?
36. Est-il vraiment libre, dites-le moi, celui à qui une femme commande, impose ses lois, prescrit, ordonne, défend ce qui lui chante, celui qui, si elle lui donne des ordres, ne peut rien refuser, qui n’ose rien repousser ? Elle exige, il faut donner, elle appelle, il faut venir ; elle chasse, il faut s’en aller ; elle menace, il faut être dans la crainte. Pour moi, ce triste personnage, c’est non seulement le titre d’esclave qu’il faut lui donner, mais d’esclave de la plus basse engeance, même s’il est né dans une très grande famille. »
Session 2006
Thème latin
François-René de Chateaubriand,
Mémoires d’outre-tombe, IV, 10
Corrigé proposé par le jury
Cur vitae meae memoriam repetierim
Supereritne mihi liber cujus consilium e cineribus meis cepi, quique ad cineres meos pertinet ? Fortasse autem hoc opus omni arte caret, fortasse hi Commentarii, ut primum editi erunt, evanescent ; rebus quidem gestis sic mihi narratis, taedium adlevatum erit earum ultimarum horarum, quae nemini placeant, nec quibus quisquam sciat quomodo utatur. Extrema enim vita, acerbum tempus agitur : nihil libet ei qui nulla re dignus sibi videtur cum nullis grato, tum omnibus gravi, tam propinquo ultimae sedi, ut satis sit ad eam petendam unum gradum facere; tum quid prodesset animo vagari in cujusdam litoris solitudine? quae jucundae imagines in futuro conspicerentur ? quam pro nihilo hae nubes quae nunc super caput meum volitant ! Hoc autem mihi in mentem venire ac commovere solet : mihi sum conscius me esse incertum an nocuerim cum quid elucubrarem; timeo ne ipse erraverim, neve culpis suis quisque indulgeat. An justitiae quod scribo vere congruit ? An officia caritasque recte observantur? an jure de ceteris sententias dixi ? quid mihi prodesset me paenitere, si hi Commentarii aliquid nocerent ? O vos, hominibus ignoti atque abditi, quorum moribus altaria delectantur prodigiaque efficiuntur, occultas virtutes vestras collaudo ! Nam ille pauper vir, quamvis scientiae inops sit, cui numquam ulla opera dabitur, nullo alio modo nisi moribus suis docendis, habuit in eos qui eadem passi sunt divinam auctoritatem quae e Christi virtutibus emanaret. Itaque omnium praeclarissimus liber non est instar ullius incognitae rei quam gesserunt illi ignobiles martyres, quorum cruorem Herodes eorum sacrificiis miscuerat.
Version grecque
CONTRE LES SYCOPHANTES
Démosthène, Épicharès contre Théocrine
Corrigé proposé par le jury
Puisque donc nous sommes engagés dans un procès de cette nature, nous vous demandons de nous venir en aide, et de montrer à tous qu’enfant, vieillard, à tout âge, celui qui a les lois pour lui quand il arrive devant vous, celui-là obtiendra toute justice. Car ce qui est bon, messieurs les juges, ce n’est pas de soumettre les lois ni vous-mêmes au pouvoir de ceux qui prennent la parole, mais de les soumettre eux à vous, et de faire la distinction entre ceux qui parlent bien et ceux qui parlent selon la justice : car c’est sur ce point que vous avez juré de porter votre vote. Car vraiment, non, personne en tout cas ne vous convaincra que des orateurs de ce genre viendront à manquer, ni que la cité en sera moins bien gouvernée pour autant : c’est le contraire, comme, pour ma part, je l’entends dire par les plus âgés. Ils disent, en effet, que c’est au moment où des hommes sages et mesurés l’administraient que la cité se portait le mieux. A moins que par hasard on ne trouve qu’ils sont de bons conseillers ? Mais au lieu de prendre la parole à l’Assemblée du peuple, ils s’enrichissent en citant en justice ceux qui en reviennent. Et ce qui est même étonnant/admirable, c’est que, tout en vivant de leur activité de sycophantes, ils disent ne rien recevoir de la cité : et alors qu’ils n’avaient rien avant de se présenter à vous, et que maintenant ils sont dans l’aisance, ils n’ont même pas de reconnaissance pour vous, mais vont colportant partout que le peuple est instable, qu’il est d’humeur difficile, qu’il est ingrat, comme si c’était vous qui étiez dans l’aisance grâce à ces gens-là et non ces gens-là grâce au peuple. Mais d’ailleurs, il n’est pas étonnant que ces gens-là tiennent de tels propos, quand ils voient votre négligence à vous. Car on ne vous a jamais vus châtier aucun d’entre eux comme le méritait sa perversité, et vous les laissez dire que le salut du peuple se fait par ceux qui intentent des procès et qui font le métier de sycophantes : alors qu’il n’existe engeance plus pernicieuse que la leur. En quoi pourrait-on leur trouver, en effet, une utilité pour la cité ? – Par Zeus, ils assurent le châtiment de ceux qui contreviennent à la justice, et grâce à eux, ces gens-là sont moins nombreux – Certainement pas, Messieurs les juges : ils sont même plus nombreux. Car ceux qui veulent commettre un méfait, sachant qu’il leur faut donner à ces gens-là leur part sur le butin, préfèrent, par nécessité, spolier davantage les autres, afin d’avoir assez, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour ces gens-là. Les autres malfaiteurs, qui nuisent à ceux qui se trouvent sur leur chemin, on peut s’en préserver en mettant une garde pour les biens de sa maison, ou encore ne pas subir de tort de leur part en restant la nuit chez soi, ou encore, il est possible en se gardant d’eux d’une manière ou d’une autre de repousser les attaques des gens mal intentionnés : mais des sycophantes comme ceux dont je parle, où faut-il s’en aller pour se trouver à l’abri de ces gens-là ?
Version latine
Cicéron,
Sur son consulat, frg. 2, v. 1-41
Corrigé proposé par le jury
Attention : le jour du concours, il faut traduire le texte en prose et non en stiques !
Au début, de son feu éthéré, Jupiter enflammé
Tourne et de sa lumière balaie le monde entier,
Recherche ciel et terres de son esprit divin,
Qui garde en profondeur les sens et vies des hommes,
Enclos et entouré des antres de l’éternel éther.
Et si tu veux connaître mouvements, courses errantes
Des étoiles, lesquelles sont placées dans le séjour des signes,
Qui sont censées errer, selon les termes grecs,
À tort, mais sont portées au vrai d’un mouvement, d’une durée donnés,
Tu verras déjà tout marqué d’esprit divin.
Car d’abord, toi consul, mouvements ailés des astres,
Conjonctions fâcheuses d’étoiles au feu brillant,
Quand tu as purifié les tertres enneigés
Sur la montagne albaine, célébré les Féries
De lait d’heureux augure, toi aussi tu l’as vu
Et les comètes tremblantes à la flamme éclatante ;
Tu crus à bien des confusions, une nuit de carnage,
Car les féries tombèrent à peu près au sinistre moment
Où la Lune cacha, sa lumière obscurcie,
Son bel éclat et disparut soudain dans la nuit étoilée.
Que dire de la torche de Phébus, annonçant une sinistre guerre,
Volant en vaste colonne avec l’éclat du feu,
Pour gagner le déclin et le couchant du ciel ?
Ou quand un citoyen, frappé d’une terrible foudre
Quitta la lumière de la vie dans une clarté sereine ?
Ou quand la Terre trembla de tout son corps gravide ?
Mais déjà terrifiantes, aux diverses couleurs,
Des formes vues de nuit annonçaient guerre et troubles ;
Les devins par le monde, la poitrine en fureur,
Rendaient nombre d’oracles, menaçants de sinistres malheurs ;
Ce qui arriva enfin, à l’issue d’un long cours,
Le père des dieux lui-même prédisait sa venue
Au ciel et à la terre, répétant par des signes permanents et bien clairs.
Et maintenant, ce qu’avait jadis annoncé l’haruspice lydien
De la nation étrusque, Torquatus et Cotta étant consuls,
Groupant tous ces arrêts, ton année en marque l’échéance.
Car le père tonnant appuyé sur l’Olympe étoilé
Jadis frappa lui-même ses collines et temples,
Et jeta ses feux sur sa demeure, le Capitole.
Ancienne et vénérée, la statue de Natta
En bronze s’écroula ; lors les lois disparurent, à l’antique puissance,
Et le feu de la foudre détruisit les images des dieux.
Session 2007
Thème latin
Fénelon,
Les Aventures de Télémaque, VI
Corrigé proposé par le jury
Quales sint cupiditatis impetus furiosi
Mentor, cum libenter adtenderet quantum Calypsus animum inuidentia perturbaret, ideo non plura dixit quod timebat ne ei suspectus fieret, et tristis adflictique hominis uultum tantummodo ei praebebat. Cui dea molestias patefaciebat captas de omnibus rebus quas uidebat et nouos gemitus etiam atque etiam edebat. Ista uenatio, de qua Mentor eam monuerat, eius iracundiam cumulauit. Comperit enim Telemachum operam solum dedisse ut ab aliarum Nympharum conspectu se subtraheret ad loquendum cum Nympha. Et iam proponebatur quidem altera uenatio in qua prouidebat eum eodem modo se gesturum esse atque in priore. Itaque, ut Telemachi consilia confringeret, professa est se uenationi adesse cupere. Deinde repente, quippe quae pertinacem iram comprimere non iam posset, eum ita adlocuta est :
Ea igitur mente, o audax adulescens, in insulam meam uenisti ut iustum naufragium quod Neptunus tibi appararet et deorum ultionem effugeres ? Num intrauisti in hanc insulam, quae nulli mortali aperta est, modo ut potestatem meam contemneres et amorem quo te prosecuta sim ? O dei deaeque in Olympo et Styge uersantes, infelicem deam audite et properate perdere hunc et perfidum et ingratum et impium. Quoniam es etiam durior et iniustior quam pater tuus, utinam mala etiam longiora et acerbiora patiaris quam ille ! Vtinam immo uero patriam tuam ne unquam iterum uideas, istam pauperem et infortunatam Ithacam quam immortalitati anteferre te non puduerit. Vel potius ita pereas ut eam medio in mari positus intuearis e longinquo, et corpus tuum, quod fluctuum ludibrium factum sit, deiciatur in illius litoris arenam sine ulla sepulturae spe.
Version latine
Tacite,
Annales, XIV, 43-45
Corrigé proposé par le jury
43. « Souvent, pères conscrits, j’ai assisté ici à des séances où l’on réclamait de vous des sénatusconsultes qui innovaient et qui étaient contraires aux traditions et aux lois de nos ancêtres, et je ne les ai pas combattus. Non que je doutasse qu’en toutes choses la prévoyance des anciens n’eût étémeilleure et plus juste que la nôtre, et que ce que l’on modifiait était changé en mal ; mais je craignais, par trop d’attachement aux coutumes antiques, de sembler vouloir prôner la science que je cultive. En même temps, je ne voulais pas affaiblir, par une opposition habituelle, l’autorité que je puis avoir, afin de la maintenir entière au moment où la république aurait eu besoin de conseils. Ce moment est venu, aujourd’hui qu’un consulaire a été assassiné dans sa maison, par la trahison d’un esclave, trahison que personne n’a ni prévenue ni révélée, quoique aucune attaque n’eût encore ébranlé le sénatusconsulte qui menaçait tous les esclaves du dernier supplice. Décrétez, par Hercule, l’impunité : qui de nous trouvera dans sa dignité une sauvegarde, alors qu’au préfet de Rome la sienne n’a servi à rien ? Qui s’assurera en de nombreux serviteurs, lorsque que quatre cents n’ont pas sauvé Pédanius ? À qui porteront secours des esclaves que même la crainte de la mort n’intéresse pas à nos dangers ? Dira-t-on, ce que plusieurs ne rougissent pas de feindre, que le meurtrier avait des injures à venger ? Apparemment, c’est l’argent de son père qui lui avait servi pour sa transaction, ou l’esclave qu’on lui enlevait lui venait de ses aïeux ! Faisons plus : prononçons que, s’il a tué son maître, il en avait le droit !
44. « Veut-on argumenter sur des questions examinées par de plus sages que nous ? Mais même si nous avions celle-ci à décider pour la première fois, croyez-vous qu’un esclave ait conçu le dessein d’assassiner son maître, sans qu’il lui échappât quelque parole menaçante, sans qu’il ait prononcéd’avance quelque mot irréfléchi ? Je veux bien qu’il ait caché son projet, préparé son arme sans que personne le vît ; mais pouvait-il passer à travers les veilleurs de nuit, ouvrir la chambre, y porter de la lumière, consommer le meurtre à l’insu de tout le monde ? Mille indices toujours précèdent le crime. Si nos esclaves doivent mourir s’ils ne le révèlent, nous pouvons vivre seuls au milieu d’un grand nombre, tranquilles, entourés de coupables, enfin sûrs de notre vengeance parmi des gens inquiets. Nos ancêtres redoutèrent toujours le caractère des esclaves, alors même que, nés dans le champ ou sous le toit de leur maître, ils apprennent immédiatement à le chérir. Mais, depuis que nous comptons nos esclaves par peuplades, qui ont des mœurs opposées, des dieux exotiques, ou aucun dieu, non, ce ramas ne sera jamais contenu que par la crainte. Quelques innocents périront. Eh ! Lorsqu’on décime une armée qui a fui, le sort ne peut-il pas condamner même un brave à expier sous le bâton ? Tout grand exemple comporte une part d’injustice, mais le tort fait aux individus a comme contrepartie l’avantage de tous. ».
45. À cet avis de Cassius, que personne n’osa combattre individuellement, des voix confuses répondaient en plaignant le nombre, l’âge, le sexe de ces malheureux, et, pour la plupart, leur incontestable innocence. Le parti qui voulait le supplice prévalut cependant. Mais on ne pouvait exécuter l’arrêt, à cause de la multitude attroupée et qui menaçait, armée de pierres et de torches. Alors César réprimanda le peuple par un édit et borda de troupes tout le chemin par où les condamnés étaient conduits à la mort. Cingonius Varro avait proposé que même les affranchis demeurant sous le même toit fussent déportés hors de l’Italie. Le prince s’y opposa, pour ne pas aggraver, par des mesures de cruauté, un usage ancien que la pitié n’avait pas adouci.
Session 2008
Thème latin
Montesquieu,
Dialogue de Sylla et d’Eucrate
Corrigé proposé par le jury
Quomodo Sulla perniciosam exempli imitationem prodiderit
— Dum hominum admirationem excitaui, rem magnam effeci. Tecum enim animo reputa (in memoriam tuam reduc) quas res in mea uita gesserim et senties me omnem uitam ad hanc rationis normam direxisse et quicquid agerem hanc normam tamquam ducem secutum esse. Meorum autem cum Mario certaminum memoriam redintegra, equidem indignatus sum hominem ignobilem, qui gloriaretur quod humili loco natus esset, sibi proponere ut nobilissimas Romanorum gentes in infimam multitudinem (in plebeiorum multitudinem, uolgus) reduceret.
— Eodem modo quo tu, domine, inquam (aiebam), Marius ratiocinabatur, cum suorum inimicorum et Romanorum sanguine cruentus audaciam illam prae se tulit quam uindicauisti. Hoc quidem ei praestas, quod paulo plures uictorias consecutus es et truculentius te gessisti sed, cum dictaturam occupauisti, tu quoque eiusdem sceleris exemplum prodidisti quod uindicaueras. Cuius rei exemplum alii homines sequentur , non tuae illius modestiae quam tantummodo admirabuntur. Dei igitur, cum Sullam Romae impune rerum potitum esse dictatura occupanda passi sunt, ex Vrbe libertatem in perpetuum exterminauerunt. Etenim nisi pluribus quam ut fieri possint prodigiis regnandi cupiditatem iam exstirpare nequeant ex animis omnium Romanorum imperatorum. Nam his ostendisti uiam esse quamdam multo certiorem qua tyrannis occupari et sine ullo periculo retineri posset. Ita (praeterea) in lucem hanc rem arcanam et perniciosam protulisti et hoc sustulisti quo uno in libera ciuitate opulentiore ac potentiore ciues in officio contineri solent, desperationem dico eius ui opprimendae.
Tum ille uultum mutauit et paulisper siluit, mox uero animo permotus :
— Neminem, inquit, metuo, nisi uirum quemdam qui mihi unus est pro compluribus Mariis (in quo complures Marios conspicere mihi uideor). Tamen siue casu siue fati alicuius ui coactus manus ab eo abstinui: sine ulla tamen intermissione in eum specto (eum intueor) mentemque eius perspicio: plena quidem acuminis consilia in ea recondita habet sed, si quando hoc consilium capere ausus erit ut eis hominibus imperet quos mihi iure pares fecerim, per deos (omnes) iuro me eius impudentiam (arrogantiam) puniturum esse (uindicaturum esse).
Version grecque
TOURMENTS AMOUREUX DE MÉDÉE
Apollonios de Rhodes,
Argonautiques, III
Corrigé proposé par le jury
Puis la nuit amenait l’obscurité sur la terre. Depuis les navires les marins en haute mer fixèrent leurs yeux sur la Grande Ourse et les étoiles d’Orion ; le voyageur déjà et le gardien des portes désiraient le sommeil ; une profonde torpeur enveloppait la mère dont les enfants étaient morts. Il n’y avait plus d’aboiement de chiens par la ville, plus de rumeur sonore. Le silence régnait sur la nuit noircissante. Mais le doux sommeil ne s’empara aucunement de Médée, car, dans son désir pour l’Aisonide, de nombreuses inquiétudes la tenaient éveillée : elle craignait l’ardeur puissante des taureaux, sous les coups desquels il devait subir un sort indigne et périr dans la jachère d’Arès. Son cœur bondissait avec véhémence dans sa poitrine. De même qu’un éclat du soleil tressaute dans une maison, rejaillissant de l’eau qui vient d’être versée dans un chaudron ou bien dans un seau, et s’agite çà et là, s’élançant sous l’impulsion d’un tourbillon rapide ; de même le cœur de la jeune fille tournoyait dans sa poitrine. Ses yeux versaient des larmes de pitié. La douleur la rongeait sans cesse de l’intérieur, la consumant à travers sa chair, le long de ses nerfs déliés, et jusqu’à la base même de la nuque, où pénètre l’affliction la plus cruelle lorsque les Amours infatigables décochent les peines dans l’âme. Elle pensait tantôt lui donner un philtre pour charmer les taureaux, tantôt ne pas le faire, mais périr elle aussi ; l’instant d’après, elle ne pensait plus mourir elle-même ni lui donner un philtre, mais endurer son malheur calmement, sans rien faire. Puis elle s’assit, et dit, hésitante : « Malheureuse que je suis, où que j’en vienne maintenant de mes maux, de toutes parts mon esprit est impuissant, et il n’y a pas moyen de chasser la souffrance ; celle-ci me brûle continuellement, sans relâche. Que n’ai-je succombé sous les traits soudains d’Artémis avant de poser les yeux sur lui, avant que les fils de Chalciopé n’eussent atteint la terre achéenne ! Ceux-ci, c’est un dieu ou quelque Érinye qui les a ramenés ici de là-bas, pour nous causer peines et pleurs infinis. Qu’il périsse dans l’épreuve, si c’est son sort que de mourir dans la jachère. Comment, en effet, pourrais-je préparer le philtre à l’insu de mes parents ? Quelle histoire raconterai-je pour leur répondre ? Quelle ruse, quel artifice dissimuleront le secours que je lui porterai ? Irai-je le voir seul, à l’écart de ses compagnons, pour m’entretenir avec lui ? Infortunée, quand même il mourrait, je ne m’attends pas à voir la fin de mes afflictions. C’est alors que cet homme ferait notre malheur, s’il devait perdre la vie. »
Version latine
Juvénal,
Satires, 3, v. 268-308
Corrigé proposé par le jury
Considère maintenant les autres dangers de la nuit et leur diversité : vois quelle est la distance jusqu’en haut des toits d’où une tuile vient heurter le crâne, vois combien de fois des vases fendus et ébréchés tombent des fenêtres, vois de quelle masse ils marquent et entament le pavé qu’ils ont heurté. Tu pourrais être tenu pour insouciant et incapable d’anticiper un accident imprévu, si tu allais dîner sans avoir fait ton testament : et de fait il y a autant de destins tragiques que de fenêtres ouvertes, éclairées dans la nuit, quand tu passes dessous. Fais donc une prière – et que ce pauvre petit souhait t’accompagne – pour qu’elles se satisfassent de renverser de larges bassines ! Éméché, cherchant la bagarre, celui qui par hasard n’a frappé personne en paie le prix, il endure la nuit qu’a endurée le fils de Pélée pleurant son ami, il se couche sur le ventre, puis bientôt sur le dos : c’est clair, pas moyen de dormir autrement : il y a des hommes à qui une querelle apporte le sommeil. Mais même avec l’audace de la jeunesse et l’échauffement provoqué par le vin pur, il s’écarte de celui que lui conseillent d’éviter un manteau écarlate, la très longue file de ses compagnons, ainsi que le flambeau de bronze et ses flammes abondantes. Mais de moi, que reconduit d’ordinaire la lune ou la lumière vacillante d’une chandelle dont je règle et économise la mèche, il ne fait pas cas. Apprends comment s’engage une pitoyable bagarre, si on peut appeler ça une bagarre quand c’est toi qui frappes et moi qui encaisse. Il se plante face à moi et m’ordonne de faire face : il faut bien obéir ; car que faire quand un fou te contraint et que c’est lui le plus fort ? « D’où viens-tu ? », crie-t-il ; « à qui est la piquette, à qui est la potée dont tu as le ventre gonflé ? Quel pauvre type a mangé avec toi des rondelles de poireau et du museau de mouton bouilli ? Pas de réponse ? Parle ! Ou gare au coup de pied ! Avoue où tu crèches, dans quelle synagogue je peux te trouver ? » Que tu essaies de dire quelque chose ou que tu recules en silence, c’est le même tarif : ils frappent pareil, et puis, en colère, ils parlent de procès. La liberté du pauvre, la voici : quand on l’a frappé, quand on l’a tabassé à coups de poings, il demande et supplie qu’on le laisse repartir de là avec encore quelques dents. Et pourtant les motifs de crainte ne s’arrêtent pas là. Car il ne manquera pas d’individus pour te dépouiller quand les maisons sont fermées, après que, partout, chaque verrou tiré de la taverne cadenassée a fait silence. Parfois aussi, un rôdeur inattendu expédie son affaire à coup de poignard ; chaque fois que sont placés sous le contrôle d’un garde armé les Marais Pontins et la pinède Gallinaire, alors tous en partent pour courir ici, comme vers des garde-manger.
Session 2009
Thème latin
Alfred de Vigny,
Stello, XXXVIII
Corrigé proposé par le jury
Quae Plato de poetis scripserit
Meministisne Platonis cuiusdam qui poetas imaginum imitatores uocabat atque de ea quam sibi finxit ciuitate expellebat ? At diuinos quoque eosdem uocabat. Recte quidem ille fecisset si quos reuerebatur eos a publicis negotiis amouisset. In tali autem dubitatione haeret rei (neque id conficit) decidendae atque admirationis suae cum exilio coniungendae ut plane appareat ad quas inopias iniuriasque diligens mens, ubi omnia uniuersae legi subicere uelit, deducatur. Plato enim utilitatem omnium in singulis hominibus inesse uult ; ecce autem repente inuenit in uiis uiros inutiles eosdemque sublimes, ut Homerum, nec scit quid agat cum eis. Omnes enim qui artibus student ei impedimento sunt. Norma apposita, eos metiri nequit idque dolet. Cunctos ergo et poetas et pictores et fictores et musicos in imitatorum numero locat pronuntiatque omnem artem nihil aliud esse nisi puerile oblectamentum ; artes autem ad eam animi partem infirmissimam, quae hominis miseriis commoueatur, pertinere ; expertes rationis, ignauas, timidas, a ratione auersas esse artes ; poetas uero ipsos, dum turbidae multitudini placere uelint, id contendere ut ingenia cupiditate incensa depingant, quae propter uarietatem facilius perspiciantur ; eosdem uel sapientissimorum hominum mentes corrupturos esse nisi condemnentur effecturosque ut uoluptates ac dolores legum rationisque loco in ciuitate dominentur. Dicit etiam homines, si Homerus idoneus fuisset qui eos doceret emendaretque, et non cantor inutilis, non passuros fuisse illum pedibus nudis mendicum ire, sed tantum probaturos et adiuturos et honoribus ornaturos fuisse quantum Protagoram Abderitam Prodicumque Ceum, sapientes et philosophos, qui per omnes locos in triumpho ducantur.
Version grecque
Corrigé proposé par le jury
Et qu’ils ne récitent pas de vains éloges de nos ancêtres et de notre terre, en disant que les dieux y sont venus et se sont battus pour elle. Demandez-leur, en effet, quel avantage la cité d’Athènes, lors de la bataille de Chéronée, a tiré du fait qu’Arès, opposé à Poséidon, fut jugé à propos d’Halirrothios sur l’Aréopage. Non, ce qu’il faut examiner, c’est si nous sommes capables de nous battre contre Antipater ou n’importe quel autre roi macédonien. Et si nous en sommes capables, prenons les armes et avec l’aide de la bonne fortune entreprenons immédiatement de libérer les Grecs. Mais si nous négligeons cela et que nous prenions plaisir à la flatterie, comment éviterons-nous l’échec et n’aurons-nous pas en outre l’impression d’être responsables de nos propres malheurs — seule chose qui rende inconsolables ceux qui sont dans une mauvaise passe ? C’est agir avec bon sens, pour une cité comme pour un homme, que de toujours tenir compte des ressources présentes quand on délibère au sujet de la situation présente. Tirer de sa force passée l’audace pour les affaires que l’on entreprend, longtemps après que cette force a été grande, c’est certes agir comme quelqu’un qui, de nombreuses fois vainqueur aux jeux Olympiques, devenu plus tard vieillard, s’inscrirait encore et défierait ses adversaires en ayant à l’esprit la puissance qu’il a eue et non celle qu’il a. Il vaut aussi la peine de considérer avec vous les propos que j’apprends qu’ils tiennent, en pensant qu’ils sont tout nouveaux et incroyablement propres à contribuer à ce qu’ils veulent accomplir : ils clament que vous devez être unis, comme si vous ne saviez pas que c’est là ce qu’il y a de mieux pour toute cité, qu’elle veuille faire la guerre ou vivre en paix. Il ne faut pas examiner s’il faut que vous soyez unis quand vous faites la guerre pour les Grecs — car, pour toutes sortes de raisons, il faut l’être qu’on soit en guerre ou non —, mais si, alors que, nous le savons tous, vous voulez faire la guerre et être unis, votre puissance est suffisante. Tant qu’ils ne montreront ni les armées avec lesquelles vous ferez la guerre, ni vos sources de financement, mais qu’ils placeront la guerre entre les mains d’Athéna, ne pensez pas un seul instant qu’ils diffèrent en rien de Démosthène. Cet homme, vous l’avez destitué à juste titre, comme il le méritait puisqu’il avait l’esprit dérangé. Mais eux, qu’il leur suffise de ne subir aucune misère, eux qui déclament des discours absurdes, et, dans la conduite des affaires, ne nous laissent même pas des miettes, et nous disputent même celles-ci : ils veulent toujours être aux affaires, jusqu’à ce qu’ils aient mené à bien la politique des Thébains et contraint notre terre à devenir pâture de moutons et notre cité à être rasée. En effet, si la situation est mauvaise, ce n’est pas une raison pour ne pas du tout réfléchir à un moyen d’éviter qu’elle n’empire.
Version latine
Tite Live,
Histoire romaine, III, 17, 1-11
Corrigé proposé par le jury
Après l’annonce qu’on déposait les armes et que les hommes quittaient leurs postes, Publius Valerius, laissant le Sénat à la garde de son collègue, se précipite hors de la curie et, de là, vient au temple s’adresser aux tribuns. « Qu’est ceci ? », dit-il, « tribuns ? Voilà que vous vous apprêtez à renverser l’État sous la conduite et les auspices d’Appius Herdonius ? Il a été assez chanceux pour vous pervertir, lui qui n’a pas réussi à soulever les esclaves ? Alors que nos ennemis nous menacent, il vous semble bon de quitter les armes et de proposer des lois ? » Puis, s’étant tourné vers la foule, il déclara : « si nulle inquiétude ne vous touche, citoyens, ni pour Rome ni pour vous, respectez du moins vos dieux que les ennemis ont pris. Jupiter très bon très grand, Junon reine, Minerve et d’autres dieux et déesses sont assiégés. Le parti des esclaves occupe les pénates de votre Etat ; cela vous semble-t-il la forme d’une cité en bonne santé ? Une masse considérable d’ennemis est présente non seulement dans nos murailles mais même dans la citadelle au-dessus du forum et de la curie ; et pendant ce temps, les comices se tiennent au forum, le sénat se tient dans la curie ; comme quand règne la paix, les sénateurs délibèrent, les autres citoyens votent ! N’aurait-il pas été du devoir de tout ce que comptent les pères et la plèbe, des consuls, des tribuns, des dieux et des hommes, tous armés, d’apporter leur aide, de courir au Capitole, de libérer et de pacifier cette très sainte demeure de Jupiter très bon très grand ? Vénérable Romulus, donne à ta descendance le courage qui t’est propre, grâce auquel jadis tu as repris la citadelle gagnée à prix d’or par ces mêmes Sabins. Donne l’ordre qu’on suive cette route que tu as prise en tant que chef, que ton armée a prise. Et moi le premier, moi qui suis consul, autant que je peux, étant mortel, suivre un dieu, je te suivrai, je marcherai dans tes traces ». À la fin de son discours, il déclara qu’il prenait les armes et appelait tous les citoyens aux armes ; si quelqu’un si opposait, alors lui-même, conscient du pouvoir des consuls, faisant fi de la puissance tribunicienne et des lois sacrées, le considérerait comme un ennemi, qui qu’il fût, ou qu’il fût, sur le Capitole ou au forum. Que les tribuns ordonnent donc de prendre les armes contre le consul Publius Valerius, puisqu’ils ont refusé de le faire contre Appius Herdonius. Pour sa part, il oserait faire face aux tribuns ce que l’ancêtre de sa famille avait osé faire face aux rois. Il était clair que la violence allait être extrême et qu’une sédition romaine allait être donnée en spectacle aux ennemis. La loi ne put être proposée et le consul ne put aller au Capitole ; la nuit mit un terme au début des combats ; les tribuns cédèrent devant la nuit, craignant les armes des consuls. Une fois les auteurs de la sédition écartés, les pères entreprirent de se mêler à la plèbe et, en se glissant parmi les groupes, de glisser des discours adaptés aux circonstances ; ils leur conseillaient de voir à quel danger ils conduisaient la république : ce n’était pas entre les pères et la plèbe qu’il y avait combat, mais c’était ensemble que les pères et la plèbe, la citadelle de la ville, les temples des dieux, les pénates de l’État et des individus étaient exposés aux ennemis.
Session 2010
Thème latin
Ernest Renan,
Histoire des origines du christianisme
Corrigé proposé par le jury
Ut Marcus Aurelius imperator cum Christianis egerit
A diebus ipsis postquam id inciderat, haec fama vagata est procellam, Romanis secundam, christianorum precibus partam esse. Ita, genua flectendo, sicut mos esset ecclesiasticus, pios milites a caelesti numine talem tutelae significationem impetravisse : quae christianas spes ob has duas causas fovebat, primum quod ostenderet quantum perpauci fideles apud caeleste numen valerent, deinde quod testaretur Deum christianorum imperio Romano aliquantum indulgere. Desinerent tandem imperatoriae potestates sanctos vexare, omnes visuros esse quid commodi illi a caelesti numine imperio impetraturi essent. Nam Deum, ut imperium ad barbaros tueretur solum exspectare dum imperatoriae potestates desinerent se acerbissimas praebere in robur hominum quod semen esset omnis beneficii inter mortales.
Verum talis eventorum narrandorum modus celerrime gratus fuit et Ecclesias peragravit. Sic in omni judicio vel in omni iniqua lite, hoc egregium responsum in promptu erat quod magistratibus daretur : « Nos vobis saluti fuimus ». Quin etiam hoc responsum novis viribus auctum est cum Marcus Aurelius, aestivis confectis, septimum imperator salutatus est, et illa columna, quae etiam nunc Romae stans videtur et in ea, inter ceteras caelatas figuras, miraculum effictum est, jussu Senatus Populique erecta est. Quod occasionem etiam praebuit confingendi Marcum Aurelium epistula quadam ad Senatum scripsisse se et vetare Christianos per jus ipsum in judicium vocari et eorum indices morte multare. Tantum autem abest ut credendum sit talem epistulam scriptam esse, ut sine ullo dubio conjectare possimus Marcum Aurelium eam spem a Christianis positam in miraculo, cujus auctor ipse haberetur, ignoravisse.
Version grecque
Lycurgue, Contre Léocrate
Corrigé proposé par le jury
Ce qui m’indigne le plus, Messieurs les juges, c’est d’entendre un certain membre de son entourage dire que ce n’est pas de la trahison d’avoir quitté la cité, arguant du fait que vos ancêtres, en guerre contre Xerxès, ont autrefois abandonné la cité et se sont réfugiés à Salamine. Il est si sot, ou il manifeste à votre égard un mépris si complet qu’il a osé comparer la plus belle des actions au plus vil des comportements. Car jusqu’où le renom de ces braves ne s’est-il pas étendu ? Quel est l’homme assez jaloux, assez indifférent à toute noble ambition pour ne pas souhaiter avoir eu part aux actions héroïques de ces hommes ? Non, ils n’ont pas abandonné leur cité, mais en ont transporté le siège ailleurs, prenant une décision judicieuse devant l’imminence du danger. Le Lacédémonien Etéonicos, le Corinthien Adeimantos et la flotte d’Egine s’apprêtaient, sous le couvert de la nuit, à assurer leur propre salut : vos ancêtres, abandonnés de tous les Hellènes, libérèrent malgré eux le reste des Grecs, les contraignant à combattre sur mer, à leurs côtés, les barbares à Salamine. Fait unique, ils l’ont emporté sur les deux camps, sur les ennemis comme sur les alliés, de la façon appropriée à chacun des deux : en rendant service aux uns, en vainquant les autres dans un combat. Est-ce comparable avec cet homme qui fuit sa patrie jusqu’à Rhodes, à quatre jours de navigation ? Certes, l’un de ces braves aurait sans hésitation toléré un tel comportement, n’est-ce pas ? et n’aurait pas plutôt lapidé celui qui déshonorait leur vaillance. En tout cas, ils chérissaient tous à ce point leur patrie qu’il s’en fallut de peu qu’ils ne lapidassent Alexandros, l’envoyé de Xerxès, autrefois leur ami, pour leur avoir demandé la terre et l’eau. Eux qui croyaient bon de punir cette simple parole, n’auraient-ils pas condamné à de terribles châtiments celui qui, dans les faits, avait trahi la cité et l’avait remise entre les mains des ennemis ? Ainsi donc, c’est grâce à de tels sentiments qu’ils eurent l’hégémonie en Grèce pendant soixante-dix ans, qu’ils saccagèrent la Phénicie et la Cilicie, qu’ils furent vainqueurs à l’Eurymédon sur terre et sur mer, qu’ils prirent comme butin de guerre une centaine de trières aux barbares, qu’ils firent le tour de toute l’Asie en lui causant du tort. Et, couronnement de leur victoire, ils ne se contentèrent pas d’élever le trophée de Salamine, mais fixèrent aussi aux barbares les bornes permettant d’assurer l’indépendance de la Grèce et les empêchèrent de les franchir : ils conclurent un traité qui interdisait de naviguer sur un navire de guerre en deçà des Roches Cyanées et de Phasélis et assurait l’autonomie aux Hellènes, non seulement à ceux d’Europe, mais aussi à ceux qui habitaient l’Asie.
Version latine
Virgile,
Énéide, XI, v. 59-99
Corrigé proposé par le jury
Après avoir ainsi pleuré, il ordonne la levée du corps pitoyable, choisit dans toute l’armée mille hommes qu’il envoie escorter le convoi funèbre pour un dernier hommage et pour mêler leurs larmes à celles de son père, faible consolation pour un deuil immense, mais due à un père malheureux. D’autres s’empressent de tisser les claies d’un souple brancard avec des tiges d’arbousier et des jeunes pousses de chêne, et ombragent le lit ainsi construit en lui faisant un dais de feuillage. C’est là qu’ils déposent le jeune homme sur une haute jonchée de feuillage : telle, cueillie par une main virginale, la fleur de la tendre violette ou de la languissante hyacinthe : elle n’a pas encore perdu son éclat ni sa beauté, mais la terre maternelle ne la nourrit plus et ne soutient plus ses forces. Énée fait alors apporter deux draps, roidis d’or et de pourpre, que Didon la Sidonienne lui avait naguère fabriqués de ses propres mains, heureuse de ce travail, et dont elle avait broché le tissu d’un mince fil doré. Le cœur endeuillé, il recouvre le jeune homme de l’un d’entre eux pour lui rendre un dernier hommage, et enveloppe d’un voile ses cheveux promis aux flammes ; il entasse en outre en grand nombre les dépouilles gagnées dans les combats contre les Laurentes et ordonne que le butin soit conduit dans une longue procession ; il ajoute des chevaux et les armes qu’il avait pris à l’ennemi. Il avait aussi lié les mains derrière le dos de ceux qu’il voulait offrir aux ombres en offrande funèbre, entendant asperger les flammes du sang des suppliciés, et ordonne que les chefs portent pour leur part les troncs revêtus des armes prises aux ennemis, et que leurs noms détestés y soient inscrits. On conduit l’infortuné Acétès, accablé par l’âge, tantôt meurtrissant sa poitrine de ses poings, tantôt de ses ongles son visage, qui se prosterne de tout son corps à terre ; on conduit encore les chars arrosés du sang des Rutules. Après eux, Æthon, le cheval de guerre [de Pallas], dépouillé de ses ornements, s’avance ; il pleure et mouille sa face de grosses larmes. Les uns portent la lance et le casque du guerrier, car Turnus vainqueur détient le reste. Arrive ensuite la phalange endeuillée réunissant l’ensemble des Troyens, des Tyrrhéniens et des Arcadiens, avec leurs armes retournées vers le sol. Quand la longue file des compagnons eut ouvert la marche, Énée s’arrêta et ajouta ces mots en gémissant profondément : « Les mêmes affreux destins de la guerre nous invitent à partir d’ici pour verser d’autres larmes : pour toujours, salut, ô noble Pallas, pour toujours, adieu ». Et sans dire davantage, il se dirigeait vers les hautes murailles et portait ses pas vers le camp.
Session 2011
Thème latin
Marcel Proust,
À la recherche du temps perdu, Du côté de chez Swann
Corrigé proposé par le jury
De inueterato amatore quodam
Si, iter faciens, in familiam quamdam incidebat quacum consuetudinem iungere magis decebat non studere, sed in ea mulier aliqua oculis eius proponebatur, illecebris ornata quas nondum nouerat, uisus esset sibi, uerecundiam seruando cupidinemque ex illa natam decipiendo, atque aliam uoluptatem pro uoluptate quam cum illa capere potuisset substituendo dum scriberet ad pristinam dominam ut ad se ueniret, tam abiecte uitae commoda abiudicare uel tam stulte nouam felicitatem abnuere quam si, potius quam regionem uiseret, in cubiculo se continuisset, Lutetiae urbis picturas contemplans. Nam in aedificium necessitudinum suarum, ut ita dicam, se non concludebat, sed eas instruxerat ut ab integro, in opere ineundo, eas iterum statueret ubicumque ab aliqua muliere delectatus erat, sicut tabernaculum quoddam, quod detendi potest, quale secumferre solent ei qui orbem terrarum explorant. E quibus istas quas transportare uel cum alia noua uoluptate commutare non poterat, pro nihilo dedisset, quamuis dignae cupidinis uiderentur. Quotiens enim ducis uxoris cuiusdam gratiam, quae concreuerat post multos annos, ubi illa occasionem ei placendi, quamquam cupiens, nacta non erat, semel exuerat cum, indecora epistula usus, cito scriptam commendationem ab illa poposcisset ut commercium ex tempore haberet cum aliquo ex illius uilicis, cujus filiam ruri animaduerterat, quasi homo fame confectus gemmam cum panis offa mutaret !
Version grecque
Praxithéa, épouse d’Érechthée, justifie auprès de ce dernier la sacrifice d’une de leurs filles pour le salut d’Athènes.
Euripide, Érechthée
cité par Lycurgue dans le Contre Léocrate (§100)
et, pour quatre vers, par Plutarque dans le De l’exil, 604d
Corrigé proposé par le jury
Quant à moi, je vais donner ma fille pour qu’on la tue. J’ai pour cela de nombreuses raisons. Premièrement, on ne saurait trouver de meilleure cité que celle-ci. Car, tout d’abord, son peuple n’a pas été amené d’ailleurs ; nous sommes autochtones. Les autres cités, dispersées çà et là comme par les coups déplaçant des pions, sont chacune importées d’une cité différente. Celui qui part d’une cité pour s’établir dans une autre cité, comme une mauvaise cheville fichée dans une pièce de bois, est citoyen de nom, mais pas de fait. Ensuite, voici pourquoi nous mettons au monde des enfants : pour protéger les autels des dieux et la patrie. Le nom de la cité tout entière est un, mais nombreux sont ceux qui l’habitent. Ces hommes, comment puis-je les faire périr, alors que je peux donner une seule de mes filles pour qu’elle meure à la place de tous ? En effet, s’il est vrai que je sais compter et que je distingue le plus grand du plus petit, la maison d’un seul, dans sa chute, ne vaut pas plus que la cité tout entière, ni n’a le même poids. S’il y avait dans notre maison, au lieu de filles, un rejeton mâle, et que la flamme de la guerre s’abattît sur la cité, je ne l’enverrais pas au combat, au devant des lances, redoutant sa mort ? Ah ! que je voudrais avoir des fils qui combattent et se distinguent au milieu des guerriers, et non de simples figures nées dans la cité pour rien. Lorsque les larmes des mères accompagnent leurs enfants, elles efféminent nombre d’entre eux alors qu’ils s’élancent au combat. Je hais les femmes qui, plutôt que l’honneur, préfèrent que leurs enfants vivent ou leur donnent de lâches conseils. Or, en mourant au combat avec beaucoup d’autres, ils obtiennent une tombe commune et une renommée égale, tandis qu’à ma fille sera donnée une couronne unique, parce qu’elle mourra seule, unique, pour cette cité. Et puis elle va sauver celle qui l’a enfantée, toi et ses deux sœurs issues de la même semence. Qu’y a-t-il là qu’il ne soit beau d’accepter ? Cette jeune fille, qui n’est mienne que par la nature, je vais la donner en sacrifice pour notre terre. Car, si jamais la cité est prise, que me reste-t-il de mes enfants ? Ne ferai-je donc pas ce qui est en mon pouvoir pour tout sauver ? D’autres commanderont ; moi, je sauverai cette cité.
Version latine
Sénèque,
Lettres à Lucilius, XVI, 97
Corrigé proposé par le jury
Tu fais erreur, mon cher Lucilius, si tu considères comme des vices propres à notre siècle le goût du luxe, le mépris des principes moraux et les autres vices que chacun a reprochés à sa propre époque. Ces vices sont propres aux hommes, non aux époques ; aucune génération n’a été exempte de faute. Et si on veut considérer la corruption propre à chaque siècle, j’ai honte de le dire, mais jamais on n’a commis de faute plus ouvertement que du vivant de Caton. Croirait-on que de l’argent avait circulé lors du procès où Clodius était l’accusé pour l’adultère qu’il avait commis avec la femme de César dans la salle des Mystères, profanant ainsi les rites de ce sacrifice qu’on offre, dit-on, au nom du peuple, alors que tous les hommes sont si soigneusement écartés de cette enceinte qu’on y recouvre même les tableaux représentant des êtres mâles ? Et pourtant des sommes furent offertes aux juges et, ce qui est encore plus honteux que cette transaction, des relations sexuelles ont été exigées en outre avec des matrones et des petits jeunes gens de bonne famille, en guise de pot-de-vin. La faute fut moins grave que l’acquittement : lui qui était coupable d’adultère se fit dispensateur d’adultère et ne se sentit pas assuré de son salut avant d’avoir rendu ses juges semblables à lui-même. Et cela se produisit dans le cadre précisément de ce procès dans lequel Caton avait apporté son témoignage, sans parler du reste. Je présenterai les paroles mêmes de Cicéron parce que la réalité dépasse l’imagination : Livre 1 des lettres de Cicéron à Atticus : « il fit venir à lui les juges, leur fit des promesses, donna des garanties, fit des cadeaux. Et en outre – Grands dieux, quelle infamie ! – des nuits passées avec certaines femmes et des entrevues organisées avec de petits jeunes gens de bonne famille tinrent lieu, pour quelques juges, de cadeau supplémentaire. » Inutile de se récrier sur le prix payé, le pire fut dans les clauses annexes. « Tu veux la femme de cet homme austère ? Je te la donnerai. Veux-tu celle de ce richard ? Je te ferai coucher aussi avec elle. Si tu n’as pas commis d’adultère, prononce la condamnation. Cette belle femme que tu convoites viendra ; je te promets une nuit avec elle, et je n’y mets point de délai : avant le prononcé du jugement, j’aurai tenu ma promesse. » Ces juges, dignes de Clodius, avaient demandé au sénat une protection, qui n’était pas nécessaire, sauf pour des juges prêts à condamner, et ils l’avaient obtenue. C’est pourquoi Catulus leur demanda avec finesse, quand l’accusé fut acquitté :
« Pourquoi donc nous aviez-vous demandé une protection ? Était-ce de peur qu’on ne vous arrachât vos sous ? » Au milieu de ces plaisanteries, Clodius resta impuni, lui qui fut adultère avant le procès et proxénète pendant le procès, et qui, en agissant de manière pire encore, échappa à la condamnation qu’il méritait. Peux-tu concevoir qu’il ait existé quoi que ce soit de plus corrompu que les mœurs de cette époque où ni la religion ni les tribunaux ne pouvaient réfréner la débauche, où, pendant une enquête qui était menée sur l’autorité d’un sénatus-consulte selon une procédure extraordinaire, on commit des fautes plus graves que ce qui était l’objet de l’enquête ?
Session 2012
Thème latin
Numa Denis Fustel de Coulanges,
La Cité antique, III, 16
Corrigé proposé par le jury
Num Romani religionibus suis fidem adjunxerint
Quamquam fuerunt qui dicerent illam religionem ideo inuentam esse ut ordini amplissimo conduceret, quis tamen crediderit senatores trecentos numero, vel patricios tria milia numero una mente consentire ad plebem rudem decipiendam, eosque id ita fecisse per complura saecula ut, inter tot simultates, tot contentiones, tot inimicitias, nemo umquam exstiterit qui clamaret illud mendacium esse ? Nam si quis e patriciis ordinis sui occulta prodidisset, si, adloquens plebeios, qui istius religionis uincula aegre ferebant, repente eos illis auspiciis sacerdotiisque levavisset et liberavisset, ille uir profecto statim tantam gratiam adeptus esset ut mox rerum potitus esset. An credas nisi fidem patricii adjunxissent religionibus quas colerent, ejusmodi cupiditatem tam parvo momento futuram fuisse ut ne unus quidem ad rem prodendam induceretur ? Valde quidem errat de hominum natura, qui credit religionem per pactum condi et per fraudem permanere posse. Nam si quis in Livii scriptis numeraverit quam saepe illae religiones patriciis ipsis offecerint, quam saepe senatoribus incommodo impedimentoque fuerint, tunc utrum eae ad illorum qui rem publicam gerebant commoditatem inventae sint necne judicare poterit. Ciceronis vero memoria tunc primum ad rem publicam administrandam utilem esse religionem homines crediderunt ; quae tamen jam ex animis exstincta erat. Quin etiam, ut prisci Romani exemplum proponatur, Camilli dico, quo pauci laude bellica clariores fuerunt, qui dictator quinquies fuit devicitque hostes amplius decem proeliis, si vero quaeris qui tantus vir fuerit, ille non minus sacerdos quam imperator haberi debet.
Version grecque
DÉLIBÉRATION DES GÉNÉRAUX ATHÉNIENS
Thucydide, Guerre du Péloponnèse, VII
Corrigé proposé par le jury
Pendant ce temps, du côté des Athéniens, les généraux délibéraient sur les décisions à prendre concernant à la fois le désastre qu’ils avaient subi et la démoralisation totale où se trouvaient maintenant les troupes. Ils voyaient en effet qu’ils ne réussissaient pas dans leurs entreprises et que les soldats souffraient d’être immobilisés. En effet, ils étaient éprouvés par la maladie, pour deux raisons : c’était la période de l’année où les hommes ont le moins de résistance, et le lieu où ils étaient établis était à la fois marécageux et malsain ; et, plus généralement, la situation leur paraissait on ne peut plus désespérée. En conséquence, Démosthène estimait qu’il ne fallait plus rester là, mais, comme il l’avait déjà envisagé quand il avait risqué l’opération aux Epipoles, il voulait, comme on avait échoué, voter le départ, et sans délai, tant qu’il était encore possible de traverser la mer et d’avoir l’avantage dans cette expédition tout du moins grâce aux navires qui venaient d’arriver. Et il disait qu’Athènes avait plus d’intérêt à faire la guerre contre ceux qui se retranchaient sur son propre sol que contre les Syracusains, dont il était désormais difficile de venir à bout, et que, d’un autre côté, il n’était pas sensé qu’on prolonge le siège en dépensant vainement de grosses sommes.
Tel était le point de vue de Démosthène. Nicias, lui, estimait également que leurs affaires allaient mal, mais il ne voulait pas qu’une déclaration publique en révèle la faiblesse, ni qu’en votant ouvertement la retraite au milieu d’une assemblée nombreuse on mette l’ennemi au courant : on aurait plus de difficultés, quand on voudrait partir, à le faire à l’insu des ennemis. Dans une certaine mesure aussi, les affaires des ennemis, d’après ce qu’il connaissait de plus que les autres, lui donnaient encore quelque espoir qu’elles iraient plus mal que les leurs si l’on s’obstinait à poursuivre le siège : on épuiserait l’adversaire en le mettant à bout de ressources, d’autant plus que l’on avait maintenant une plus grande maîtrise de la mer grâce aux vaisseaux dont on disposait. De surcroît, il y avait dans Syracuse même, un parti qui voulait livrer la cité aux Athéniens et qui lui envoyait des messagers et ne voulait pas qu’il lève le siège. Sachant tout cela, il était en fait encore partagé et observait sans se décider, mais dans la déclaration qu’il fit alors ouvertement, il affirma qu’il ne ramènerait pas l’armée. Il savait bien en effet qu’Athènes n’admettrait pas qu’ils aient pris cette initiative sans qu’elle ait voté elle-même la retraite.
Version latine
Lucain,
La Pharsale, VI, v. 619-661
Corrigé proposé par le jury
« Mais, puisqu’il y a une telle abondance de morts nouvelles, il est aisé de relever des champs émathiens un corps afin que la bouche d’un être à peine mort et tiède résonne à pleine voix et que son ombre funèbre ne produise pas aux oreilles un sifflement inintelligible venant d’un corps brûlé par le soleil. » Elle dit et, après avoir redoublé par un sortilège les ténèbres de la nuit, après avoir recouvert sa lugubre tête d’un sombre nuage, elle erre parmi les cadavres jetés là sans sépulture. Aussitôt s’enfuirent les loups, s’enfuirent, serres rentrées, les oiseaux affamés, cependant que la Thessalienne choisissait son prophète et que, fouillant les entrailles gelées par la mort, elle trouvait les fibres d’un poumon encore solide, sans blessure, et qu’elle cherchait une voix dans un corps mort. Déjà les nombreuses destinées des héros morts se demandent avec anxiété lequel elle souhaite rappeler sur la terre. Si elle avait essayé de relever du champ de bataille des armées entières et de les rendre à la guerre, les lois de l’Érèbe se seraient soumises et, par ce prodige puissant, un peuple arraché à l’Averne stygien aurait combattu. Enfin elle choisit et tire à elle un corps à la gorge transpercée, et, enfilant un crochet dans un sinistre nœud coulant, elle traîne à travers les pierres et les rochers le malheureux cadavre appelé à revivre et elle le place sous la roche en saillie d’un creux de montagne que la sombre Érichtho avait condamné à ces cérémonies. Non loin de la caverne obscure de Dis le sol s’enfonce dans un abîme et y disparaît sous le poids d’une livide forêt à la chevelure pendante et sous l’ombre de l’if, impénétrable à Phébus, dont la cime se détourne du ciel. À l’intérieur, les ténèbres croupissantes et la moisissure, que la longue nuit sous les antres rend verdâtre, ne sont jamais éclairées que de lumière magique. L’air n’est pas plus pesant dans les gorges du Ténare ; sinistre frontière entre le monde obscur et le nôtre, les rois du Tartare ne craindraient pas d’y envoyer les mânes. Aussi, quoique la prophétesse thessalienne fasse violence aux destins, on ne sait si elle voit les ombres stygiennes parce qu’elle les a attirées là ou parce qu’elle y est descendue. Elle est bigarrée et vêtue d’un manteau chamarré de la tenue que portent les Furies, ses cheveux ayant été dégagés, elle découvre son visage et sa chevelure hérissée de guirlandes de vipères est nouée. Quand elle voit les compagnons du jeune homme saisis d’effroi et qu’elle le voit lui-même tremblant, les yeux fixés sur le visage du mort, elle dit : « Oubliez les craintes que vos esprits agités font naître. Dans un instant, oui, dans un instant, une vie nouvelle, sa figure véritable lui seront rendues, afin que les gens puissent l’entendre quel que soit leur effroi. »
Session 2013
Thème latin
Antoine-François Prévost,
Manon Lescaut, Première partie
Corrigé proposé par le jury
Quam ardens in uoluptatibus quaerendis Mano fuerit
Vt Manonem adspicerem, de caelo me deiecissem ; et cum rursus ei aderam, miratus sum quod tam rectam tam iucundae puellae caritatem probrosam parumper habere potuissem. Mano uero mira indole puella praedita fuit. Quae quidem pecuniae minime omnium studuit, eadem, si timebat ne ea careret, ne paulisper quidem aequo animo esse poterat. Nam uoluptates oblectationesque requirebat neque umquam nummum unum accipere uoluisset si delectatio nulla impensa parari posset. Quin etiam, dummodo diem iucunde degere posset, ne percontabatur quidem quanta pecunia nobis relicta esset ut, cum ea nec nimis dedita aleae esset nec magnificis amplisque sumptibus capi posset, iis delectamentis quae ei grata essent cotidie excitandis nihil negotii esset eam satiare. Cuius modi tamen uoluptatibus quin se totam daret ita facere non poterat ut, his remotis, eius animo aut studiis nequaquam confidi posset. Quamquam enim carissimum me habebat et per me unum amoris deliciis frui se confitebatur, mihi satis ferme constabat eam, si quaedam timeret, in suo erga me amore non perseueraturam esse. Cum enim illa me quidem mediocriter fortunatum omnibus uiris antetulisset, minime tamen dubitabam quin, si quando nihil iam nisi constantiam aut fidem meam ei praestare possem, me desereret ut ad aliquem alium B… iret. Animum igitur induxi meos proprios sumptus ita curare ut ad eius impendia suppeditanda semper paratus essem, et ducentis rebus mihi necessariis potius abstinere quam eius impensis, etiam superuacaneis, ullum modum facerem.
Version grecque
POUR FONDER UNE CITÉ, QUE FAUT-IL AVOIR EN COMMUN ?
Corrigé proposé par le jury
Nécessairement, c’est un fait, ou bien tous les citoyens ont tout en commun, ou bien ils n’ont rien, ou encore ils ont certaines choses et pas d’autres. Bien sûr, ne rien avoir en commun est, manifestement, impossible, car la vie en cité est une forme de communauté, et il est nécessaire, en premier lieu, d’avoir en commun le territoire. Car pour une seule et même cité, il n’existe qu’un seul et même territoire, et les concitoyens n’ont en partage qu’une seule et même cité. Mais vaut-il mieux que la cité ayant vocation à bien s’administrer ait en commun tout ce qu’il est envisageable d’avoir en commun, ou bien certaines choses, et pas d’autres ? Il est envisageable, en effet, que les citoyens aient en commun entre eux enfants, femmes et biens, comme dans La République de Platon : Socrate y dit que doivent être communs les enfants, les femmes et les richesses ; à ce propos, justement, vaut-il mieux s’en tenir à l’état actuel des choses, ou suivre la loi décrite dans La République ? La communauté universelle des femmes comporte, il est vrai, bien des difficultés, et, en particulier, le motif pour lequel Socrate dit qu’il faut ériger en loi cette manière de faire ne découle manifestement pas des raisonnements qu’il tient. En outre, concernant le but qui, selon lui, doit être au fondement de la cité, tel qu’il est formulé effectivement, il est impossible à atteindre, et, sur la manière dont il faut le définir précisément, aucune explication n’est donnée – je veux parler de l’unité, aussi complète que possible, de la cité, envisagée comme ce qu’il y a de mieux ; c’est en effet l’hypothèse sur laquelle Socrate se fonde. Cependant, il est manifeste que, si elle poursuit le renforcement de son unité, elle ne sera pas même une cité, car une cité est, par nature, une multitude ; si elle renforce son unité, de cité, elle deviendra famille, et de famille, individu. En effet, nous pouvons dire que l’unité de la famille est supérieure à celle de la cité, et celle d’une personne, supérieure à celle de la famille ; aussi, même si on avait la possibilité de réaliser cette unité, on ne devrait pas le faire, car on détruirait à coup sûr la cité. La cité est faite d’individus non seulement en nombre assez conséquent, mais, de plus, différents par leurs caractéristiques ; car une cité ne naît pas d’éléments semblables. En effet, ce sont deux choses différentes qu’une alliance militaire et qu’une cité ; la première tire son utilité de la quantité, même quand elle est identique par ses caractéristiques (car une alliance militaire a pour but naturel l’entraide), tout comme un poids fait pencher la balance.
Version latine
Cicéron,
Tusculanes, III, 26-27
Corrigé proposé par le jury
Mais, lorsqu’à l’idée que l’on a un grand malheur s’ajoute encore l’idée qu’il faut, qu’il est juste, qu’il est de notre devoir de supporter dans l’affliction ce qui est arrivé, c’est alors, enfin, que l’affliction nous bouleverse de tout son poids. De cette idée naissent les manifestations diverses et détestables du deuil : être sale, se déchirer les joues, la poitrine, les cuisses, comme le font les femmes, se frapper la tête ; de là la description d’Agamemnon que nous offre Homère, et aussi Accius : sous le coup de la douleur s’arrachant sans cesse sa chevelure qu’il ne coupe pas, au sujet duquel Bion fait cette plaisanterie : « il est bien stupide, le roi, de s’arracher les cheveux sous le coup du deuil, comme si la calvitie pouvait soulager sa tristesse ! ». Mais, tout cela, ils le font parce qu’ils considèrent qu’il faut se comporter ainsi. C’est pourquoi Eschine aussi s’emporte contre Démosthène sous prétexte qu’il avait immolé des victimes le septième jour après la mort de sa fille. Et avec quelle éloquence, avec quelle abondance s’exprime-t-il! Quelles idées rassemble-t-il ! Quels traits lance-t-il ! A quoi l’on voit que tout est permis à un rhéteur. Or personne n’approuverait de telles manifestations si nous n’avions pas, fourrée dans notre esprit, l’idée que la mort de leurs proches doit plonger les gens de bien dans la plus extrême affliction. De là vient que, lorsqu’ils ont le cœur affligé, d’autres recherchent les déserts, comme le dit Homère au sujet de Bellérophon :
Lui, le malheureux, errait, affligé, dans les plaines d’Alé,
Se rongeant le cœur et évitant les traces des hommes.
Et Niobé est représentée changée en pierre, à cause, je pense, du silence éternel dans lequel elle s’enferma durant son deuil. Par ailleurs, on pense que Hécube est représentée métamorphosée en chienne à cause de l’aigreur de son cœur et de sa rage. Il y en a d’autres qui aiment parler souvent avec le désert lui-même, quand ils sont dans le deuil. Ainsi, la nourrice chez Ennius :
Le désir de parler au ciel et à la terre des malheurs de Médée
M’a prise, moi, la malheureuse !
Ils se livrent à toutes ces manifestations quand ils souffrent parce qu’ils pensent qu’elles sont droites, authentiques, obligatoires, et, que l’on agit de la sorte comme par sens du devoir, ce qui le montre bien c’est que, si certains, qui voulaient mener le deuil, se sont d’aventure un peu trop détendus ou ont parlé avec trop de légèreté, ils se replongent dans la tristesse et s’accusent d’avoir commis une faute sous prétexte qu’ils ont mis en sourdine leur douleur. Quant aux enfants, les mères et les maîtres d’école ont l’habitude également de les punir, et, s’ils ont fait ou dit quelque chose de trop léger lors d’un deuil dans la famille, ils les obligent à pleurer non seulement en les réprimandant mais aussi en les frappant. Eh quoi ? Quand le deuil s’est adouci de lui-même et que l’on a compris que rien ne sert de manifester son chagrin, est-ce que cette réalité ne montre pas que ces démonstrations ont été entièrement mises en scène ?
Session 2014
Thème latin
Prosper Mérimée,
Études sur l’histoire romaine
Corrigé proposé par le jury
Quo et qua Catilina et Antonius copias suas duxerint
Postquam cognouit coniurationem patefactam esse et Lentulum miserabili morte periisse, Catilina statim intellexit Antonium uictoris in causam descensurum esse, eumque paenituit se non prius quo se reciperet cogitauisse. Namque simul atque exercitus consularis e castris eductus est, plures ex hostibus ita signa relinquere coeperunt, ut ista ingens multitudo, cuius uires maiores quam re uera erant uideri poterant, si procul conspiceretur, paucis solum diebus funderetur. Breui autem tempore Catilinae haud plura quam tria uel quattuor milia militum fuerunt. Qui milites quidem pauciores erant quam ut iter per Alpes sibi patefacerent, attamen iam ei nullum aliud auxilium erat. Itaque, ad hoc consilium perficiendum, subito castra mouet celeriusque contendit per montes Pistorium, quippe cum in eam spem uenisset se Metellum Celerem, qui eum exspectabat tribus cum legionibus ultra Apenninum montem, celaturum esse. At quamuis diligens esset ad iter faciendum sic ut non aspiceretur, per desertores quos relinquebat quacumque ibat certior de ea re factus est praetor, qui statim se uexit cum maiore parte copiarum suarum in eam partem qua Catilina sperabat se montes transiturum esse. Simul autem Antonii exercitus Faesulas progrediebatur ; quae copiae Catilinam fugientem sequebantur et ita eum claudebant in uallibus quarum colles a Metello tenebantur. Tunc, postquam Capuae animos placauerat, Sextius missus erat cum manu militum ad Antonium qui stimularet eius studium, quod maxime dubium erat. Proconsul enim dicebat se magnis podagrae doloribus affici, quam causam aliquamdiu interponens exercitum suum e castris non eduxerat. At cum aduentu Sextii uideret cunctationes suas sibi crimini fore, non recusauit quin daret imperium in copias suas M. Petreio, militi ueteri, et fido et bello maxime perito.
Version grecque
Théocrite, Idylles, XXII
Corrigé proposé par le jury
Ils trouvèrent, au pied d’une roche lisse, une source pérenne, abondant en eau pure ; sous sa surface, les galets tapissant son lit ressemblaient à du cristal et à de l’argent. Près de là avaient poussé des pins de grande taille, des peupliers blancs, des platanes, des cyprès à la cime chevelue et des fleurs au doux parfum – travaux chers aux abeilles duveteuses – qui, à la fin du printemps, foisonnent sur les prairies. C’est là, en plein air, qu’avait élu domicile un homme fier de sa force, terrible à voir, les oreilles meurtries par de violents coups de poing ; sa poitrine prodigieuse et son dos large étaient bombés sous l’effet d’une chair de fer, semblables à ceux d’une statue colossale allongée au marteau. Sur ses bras vigoureux, à la naissance de la pointe de ses épaules, saillaient des muscles semblables à des pierres roulant sur elles-mêmes qu’un fleuve, grossi par les pluies, a charriées et polies sur toutes leurs faces grâce à ses puissants remous. Enfin, à son dos et à son cou était suspendue une peau de lion attachée par l’extrémité des pattes. C’est Pollux, athlète vainqueur, qui, le premier, lui adressa la parole.
Pollux — Bonjour, étranger, qui que tu sois. À quels mortels appartient la contrée que voici ?
Amycos — Comment serait-ce un bon jour, quand je vois des hommes que je n’ai encore jamais vus ?
Pollux — Sois tranquille ; dis-toi que tu n’as sous les yeux ni des fauteurs d’injustices, ni des rejetons de fauteurs d’injustices.
Amycos — Je suis tranquille et, de toi, je n’ai pas de leçon à recevoir.
Pollux — Tu es un rustre, agressif et méprisant envers tout un chacun.
Amycos — Je suis tel que tu me vois ; moi, en tout cas, je ne mets pas le pied sur ta terre.
Pollux — Puisses-tu y aller ! Tu reviendrais chez toi pourvu de présents d’hospitalité.
Amycos — Ne me traite pas en hôte, de ton côté ; car, du mien, les présents sont loin d’être prêts !
Pollux — Homme extraordinaire ! Est-ce que, toi, tu ne me donnerais même pas à boire de cette eau que voici ?
Amycos — Tu le sauras, si la soif dessèche tes lèvres entrouvertes.
Pollux — Le diras-tu ? Est-ce avec de l’argent, ou bien avec quelle autre rétribution, que nous pourrions te convaincre ?
Amycos — Campe-toi face à ton adversaire, à un contre un, et lève les mains.
Pollux — Comme au pugilat, ou bien en donnant aussi des coups de pieds dans la jambe ? Je ne baisse pas les yeux.
Amycos — Avec les poings, de toutes tes forces, et montre ce que tu sais faire.
Pollux — Qui est-il donc, celui que je frapperai de mes mains et de mes gants (ou : de mes cestes) ?
Amycos — Tu le vois, tout près de toi ; et le lutteur ne sera pas traité de femmelette, car il n’en est pas une.
Pollux — Est-il également prévu un prix, pour lequel nous nous battrons tous les deux ?
Amycos — On dira que je suis à toi, ou que tu es à moi, si je l’emporte.
Pollux — Ce sont là des combats d’oiseaux à crête écarlate !
Amycos — Que nous soyons semblables à des oiseaux ou à des lions, nous ne saurions combattre pour un autre prix.
Version latine
Lucrèce,
De la nature, IV, v. 1089-1104 et 1121-1145
Corrigé proposé par le jury
C’est là un cas unique : plus nous en possédons, plus notre cœur s’enflamme d’un désir funeste. En effet, les aliments solides et liquides s’incorporent aux membres du corps, à l’intérieur de celui-ci ; et puisqu’ils peuvent y occuper des places déterminées, par ce fait, le désir de boissons et d’aliments se trouve aisément assouvi. En revanche, rien de ce qui compose le visage et le teint charmant d’un individu ne se transmet à notre corps, si ce n’est la jouissance de simulacres ténus; encore cet espoir, chétif, est-il souvent emporté par le vent. De même que, dans l’expérience du sommeil, un homme, assoiffé, lorsqu’il cherche à boire, n’obtient certes pas de liquide susceptible d’éteindre le feu qui embrase ses membres, mais se jette sur des simulacres de boissons et peine en vain, et demeure assoiffé alors qu’il boit au milieu d’un fleuve impétueux ; de même, dans l’expérience de l’amour, Vénus trompe les amants au moyen de simulacres, et ils ne peuvent se satisfaire par le spectacle du corps qui se trouve face à eux, ni ne peuvent, de leurs mains, arracher quoi que ce soit à ces membres délicats, s’égarant, à l’aventure, sur le corps tout entier. Ajoute à cela qu’ils épuisent leurs forces et succombent à cette peine, ajoute que leur vie se consume sous la volonté d’un autre. Entre-temps leur bien s’écoule et ce ne sont que babioles de Babylone, leurs devoirs sont délaissés et leur réputation, vacillante, chancelle. Les parfums et les élégantes chaussures de Sicyone luisent sur leurs pieds, on peut en être sûr, et d’imposantes émeraudes à l’éclat vert sont serties dans l’or, le vêtement vert de mer est usé avec constance et, porté sans relâche, il boit la sueur causée par Vénus. Il n’est pas jusqu’à l’héritage honnêtement acquis par les pères qui ne soit converti en bandeaux, en diadèmes, qui, parfois, se mue en manteau et en étoffes d’Alindes et de Céos. Dans une débauche de parures et de victuailles, banquets, jeux, coupes en rangs serrés, onguents, couronnes et guirlandes sont préparés. Mais c’est en vain, puisque, du milieu de cette source de plaisirs, surgit une pointe d’amertume, de nature à nous tourmenter jusqu’au cœur de la floraison. Tantôt il advient que l’esprit lui-même, lucide, soit pris de remords parce qu’il passe sa vie dans l’oisiveté et dépérit en débauches. Tantôt c’est qu’elle a lancé une parole qui l’a laissé dans le doute ; et cette parole, fichée dans un cœur qui désire, s’avive comme un feu. Tantôt c’est parce qu’il estime qu’elle dispense trop ses regards, ou qu’elle en regarde un autre et, sur son visage, il voit l’ombre fugace d’un sourire. Des souffrances de cette sorte, on en trouve même dans le cas d’un amour stable et au plus haut point heureux ; mais dans celui d’un amour malheureux et auquel son objet échappe, on pourrait les percevoir les yeux fermés, elles sont innombrables. Aussi vaut-il mieux par avance être sur ses gardes, de la manière que j’ai montrée, et veiller à ne pas se laisser séduire.
Session 2015
Thème latin
Jean-Jacques Rousseau, La Nouvelle Héloïse,
Première partie, Lettre XII à Julie
Corrigé proposé par le jury
Cur homines libris legendis minus doceantur quam consultatione sui
Qui litteris student hoc maxime errant quod libris suis nimis confidunt nec satis cognitionis ex se promunt. Non enim cogitant inter sophistas ferme rationem nostram nos minime fallere. Cum autem unusquisque nostrum, ubi primum in se introspicere ei propositum est, quid bonum sit sentiat cernatque quid pulchrum sit, tum non opus est aliquem nos utrumque docere, sed tantum de ea re fallimur quantum falli nobis placet. At optimarum et honestissimarum rerum exempla, quippe quae rariora et minus nota sint, procul a nobis quaeranda sunt. Accedit huc quod, propter adrogantiam nostram quantum natura possit ex imbecillitate nostra ponderantes, pro commenticiis eas uirtutes habemus quas haud inesse in nobis ipsis sentimus. Praeterae dum propter pigritiam uitiumque nostrum hoc magno argumento nobis est ut illae uirtutes constare non possint, quae non cottidie uidentur, ea imbecilli homines negamus umquam uideri posse. Hic igitur error delendus est, illa sentire intuerique nobis consuescendum est, ne iam ullam causam habeamus cur non ea imitemur. Etenim illis diuinis exemplis contemplandis animus se effert et pectus ardescit ; quae ut quisque diutissime considerat, ita maximam operam dat ut ea aequet nec quicquam iam mediocre patitur nisi cum grauissimo fastidio.
Ne igitur in libris disciplinam praeceptaque quaeramus quae certius in animis nostris inuenimus. Immo omnes istas disputationes dimittamus quas philosophi frustra habent de beata uita uirtuteque.
Version grecque
Corrigé proposé par le jury
Des malheurs plus terribles ou plus grands que ceux-ci, Athéniens, il n’y en a pas eu à notre époque en Grèce, ni même, je pense, dans le passé. De fait, des problèmes de cette gravité et de cette nature, un seul homme, Philippe, est responsable, à cause de ces individus, alors qu’existe la cité d’Athènes qui, traditionnellement, prend la tête des Grecs et ne laisse rien de semblable se produire. Quant à la manière dont les malheureux Phocidiens ont été perdus, il est possible de la voir non seulement d’après ces décisions, mais également d’après les actes qui ont été perpétrés — spectacle qui est terrible, Athéniens, et invite à la pitié. En effet, tout récemment, lorsque nous nous rendions à Delphes, nous ne pouvions pas ne pas voir tout cela : des maisons en ruine, des murailles abattues, un pays vidé de ses hommes en âge de combattre, et, en revanche, de faibles femmes et de petits enfants en nombre réduit ainsi que des vieillards — êtres dignes de pitié. Nul ne pourrait trouver les mots à la hauteur des malheurs1 qui accablent aujourd’hui cette région. Et pourtant, que les Phocidiens ont un jour voté à l’opposé des Thébains, quand on proposait de nous asservir, moi, je vous entends tous les dire. À votre avis, Athéniens, comment vos ancêtres, s’ils revenaient à la vie, voteraient-ils, quelle opinion auraient-ils, concernant les responsables de la ruine de ce gens ? Eh bien ! pour ma part, je crois que, même s’ils les lapidaient de leurs propres mains, ils penseraient qu’ils seraient purs à l’avenir. Comment, en effet, ne serait-ce pas une honte — et pire encore, s’il existe un terme plus fort que celui-ci — que nos sauveurs d’alors, ceux qui ont déposé, à notre endroit, le vote salvateur, que ces gens-là obtiennent le vote contraire à cause de ces individus, et qu’on les laisse, sans réagir, subir un traitement tel qu’aucun autre peuple n’en a subi ? Qui donc est responsable de cela ? Qui, celui qui a manigancé cela ? N’est-ce pas cet individu ?
C’est vrai, Athéniens : il y a bien des raisons pour lesquelles on pourrait, à juste titre, féliciter Philippe de son sort, mais, plus que tout, on le féliciterait de cci — et, à propos, par les dieux et les déesses, je ne peux citer personne d’autre qui ait eu ce bonheur à notre époque. En effet, prendre de grandes cités, mettre sous sa coupe un vaste territoire et toutes les actions de ce genre sont bien des choses enviables, je pense, et remarquables : comment en irait-il autrement ? Mais on pourrait dire que cela a été accompli par bien d’autres que lui. En revanche, voici un succès qui lui est propre et qui n’est advenu à nul autre sur terre. Lequel ? Le fait que, lorsqu’il a eu besoin d’hommes sans scrupules/sans foi ni loi pour ses affaires, il en ait trouvé de pires que ce(ux) qu’il voulait.
Version latine
Properce,
Élégies, II, 3, v. 3-46
Corrigé proposé par le jury
À peine peux-tu, infortuné, rester en paix un seul mois, que déjà paraîtra un nouveau livre te couvrant de honte. Je me demandais si un poisson pourrait vivre sur le sable sec, et si le farouche sanglier, dont ce n’est pas la nature, pourrait vivre en haute mer, autrement dit, si je pourrais, moi, consacrer mes nuits à d’austères études… L’amour peut être un temps écarté, mais aucun, jamais, ne peut être effacé. Et c’est pas tant son visage, si éclatant soit-il, qui s’est emparé de moi (les lys ne sauraient être plus blancs que ma maîtresse, comme la neige méotique qui contrasterait avec le vermillon d’Hibérie, et comme des pétales de rose flottant sur le lait immaculé), ce n’est pas tant sa chevelure ondoyant avec naturel sur ses délicates épaules, ce ne sont pas tant ses yeux, flambeaux jumeaux, mes astres, ni une jeune folle si elle rayonne dans des soies d’Arabie — je ne suis pas, moi, amant à complimenter sans objet ! ; c’est bien davantage le fait que, une fois le vin servi, elle danse avec grâce comme Ariane, à leur tête, mène ses chœurs de bacchantes, et que, lorsqu’elle entame des chants de son plectre éolien, elle soit habile à jouer, rivalisant ave la lyre des Muses. Ces présents célestes, ce sont les dieux qui les ont rassemblés pour toi, ces présents, ne va pas croire que c’est ta mère qui te les a donnés. Non, de tels dons ne sont pas créations humaines : ces qualités qui sont tiennes, dix mois ne suffisent pas à les engendre. Toi, tu es née comme unique objet de gloire pour les jeunes filles romaines, tu seras la première fille romaine à te coucher au côté de Jupiter, et tu ne fréquenteras pas éternellement avec moi les lits des humains ; après Hélène, voilà une seconde beauté qui descend sur terre. Et moi, maintenant, je m’étonnerais que notre jeunesse s’enflamme pour cette femme ? Il eût été plus beau encore pour toi, Troie, d’être détruite à cause d’elle ! Je m’étonnais autrefois de ce qu’une si grande guerre opposant, sous les murs de Pergame, l’Europe et l’Asie, eût pour cause une jeune fille ; mais je vois bien maintenant que tu as eu raison, Pâris, et toi aussi, Ménélas, toi de la réclamer, toi de rechigner à la rendre. C’est un visage qui eût méritéassurément qu’Achille allât jusqu’à mourir pour lui ; il eût été une cause de guerre que même Priam eût approuvée. Si quelqu’un veut surpasser en renommée les tableaux du passé, qu’il prenne ma maîtresse pour modèle dans son art : qu’il l’expose aux peuples d’Occident ou qu’il l’expose aux peuples d’Orient, il embrasera les peuples d’Orient, tout comme les peuples d’Occident il embrasera. Que du moins je demeure en son empire ! Ou que je meure dans de très violentes souffrances si un nouvel amour me gagne !
Session 2016
Thème latin
Jean de La Fontaine,
Fables, VII, 7
Corrigé proposé par le jury
Quae in aula Leonis evenerint
Leo Rex, cum ei placuisset cognoscere quarum gentium dei se dominum fecissent, in omnes partes legationes circummisit quae, epistula publico signo obsignata circum regni provincias dimissa, quicumque Regi subjecti erant eos accirent : illum per totum mensem sollemnem conventum acturum esse, cujus initio amplissimae epulae darentur, post quas praestigiae a simia quadam scurram agente ederentur. Rex autem, cum eis qui illi serviebant, dum se ita magnificum praebet, quam potens esset ostentaret, in regiam suam eos vocavit. Qualis vero regia erat ! Immo hic erat locus strage completus, cujus foetor statim ad omnium nasos pervenit. Etenim Ursus, cum sibi nares compressisset, statim secum reputavit se melius facturum fuisse nisi ita os duxisset. Qua oris depravatione adeo molestus visus est ut Rex iratus apud Plutonem eum mitteret* qui ibi se fastidiosum praeberet. Simia autem illam duritiam maxime probavit atque, ut quae nimiis blanditiis uti soleret, et Principis iram et saevitiam et stragem et illum odorem laudavit : prae quo nullum unguentum, nullum florem esse quin quasi foetidum alium esset. Stulta igitur blanditia Simiae male processit, quae et ipsa punita sit. Etenim augustissimus ille Leo novus Caligula fuit. Tum Vulpi, quae aderat, Rex : « Age vero, inquit, quid olfacis ? Hoc dic mihi nec quicquam dissimulaveris. » Illa autem statim precata est ut reticeret et magnam gravedinem excusavit qua adfecta, cum odoratu careret, non haberet quid diceret. Ne plura dicam, e periculo evadit.
Hoc igitur vobis est documento ne, si in regis aula placere volueritis, ibi insulsi adsentatores sitis neve nimis simpliciter loquamini, sed interdum ambigua respondere conemini.
*Le subjonctif parfait miserit est possible également, pour insister sur la réalité du fait passé que constitue la conséquence.
Version grecque
Julien, Lettre LXXXIX
Corrigé proposé par le jury
Il faut que les prêtres s’abstiennent non seulement d’activités impures et de pratiques licencieuses, mais aussi de proférer et d’écouter des propos de ce genre. Il nous faut donc chasser toutes les plaisanteries grossières, ainsi que touteconversation obscène. Ainsi, pour que tu puisses saisir ce que je veux dire, un prêtre ne doit lire ni Archiloque, ni Hipponax ni aucun autre de ceux qui produisent des écrits de la même espèce. Qu’il se détourne également de tout ce qui, dans la Comédie Ancienne, est du même ordre : pour tout dire, il est préférable de se détourner de tout ce qui s’y rapporte. Seule la philosophie pourrait nous convenir et, parmi les philosophes, ceux qui ont choisi les dieux comme guides pour leur propre éducation, comme Pythagore, Platon, Aristote et l’école de Chrysippe et de Zénon. Il ne faut s’intéresser, en effet, ni à tous les philosophes, ni aux doctrines de tous, mais seulement à ceux que je viens d’évoquer et, chez ces derniers, à tout ce qui peut inspirer de la piété, et qui enseigne à propos des dieux en premier lieu qu’ils existent,puis qu’ils prennent soin des choses sur cette terre, et qu’ils ne commettent pas même le moindre mal, que ce soit envers les hommes ou les uns envers les autres, par jalousie, envie ou inimitié. Pour les avoir peints de la sorte, nos poètes ont étél’objet de mépris, alors que les prophètes des Juifs, qui diffusent obstinément de telles fariboles, sont admirés par ces malheureux qui embrassent le parti des Galiléens. Pourrait nous convenir de lire toutes les histoires qui ont été rédigées àpartir de faits réels ; en revanche, toutes les fictions qui ont été rapportées sous forme d’histoires chez les Anciens, il faut les repousser, je veux parler des récits amoureux et absolument tous les écrits de ce genre. De la même façon, en effet, que toutes les voies ne sont pas adaptées aux prêtres, et qu’il est nécessaire qu’elles soient bien encadrées, de même toute lecture ne convient pas non plus à un prêtre. Une disposition dans l’âme se produit en effet sous l’influence des discours, qui peu à peu excite les passions, puis allume brutalement une flamme dangereuse contre laquelle, à mon avis, il faut se prémunir de loin. Ne laissons entrer ni les traités d’Épicure ni ceux de Pyrrhon : certes, les dieux ont déjà bien agi en les détruisant, au point que la plupart de leurs ouvrages n’existent plus. Cependant, rien n’empêche de mentionner, à titre d’exemple, ce genre de discours dont il faut que les prêtres se gardent tout particulièrement ; et ce qui est vrai des discours l’est à plus forte raison des pensées. Car, à mon sens, le péché de langue diffère de celui de l’esprit, et il fautavant tout prendre soin de ce dernier, attendu que la langue commet aussi une faute en même temps que l’esprit.
Version latine
Juvénal, Satires,
13, v. 192-235
Corrigé proposé par le jury
Pourquoi cependant vas-tu t’imaginer qu’ils ont échappé au châtiment ceux que la conscience de l’acte abominable qu’ils ont commis tient interdits et que frappe d’un coup sourd le fouet invisible agité par la pensée qui les torture ? C’est un châtiment violent et bien plus cruel que ceux qu’inventèrent le sévère Caedicius et Rhadamanthe que de porter en son cœur, de nuit comme de jour, son propre témoin. À un habitant de Sparte, la Pythie inspirée répondit que ne resterait pas un jour sans punition le fait d’avoir eu l’intention de garder un dépôt et de masquer son forfait sous le parjure ; il cherchait en effet à savoir quelle était la volonté de la divinité et si Apollon lui conseillait ce forfait. Il restitua donc le dépôt, par peur, non par principes, et fit la preuve que toute parole du sanctuaire est digne du temple et véridique car il périt et avec lui également toute sa descendance, sa famille et sa parenté si loin qu’elle remontât. Tels sont les châtiments qu’endure la seule intention de commettre une faute. Car celui qui médite en son for intérieur quelque forfait sans en parler se voit incriminer de l’avoir commis. Qu’est-ce donc s’il a été jusqu’au bout de son projet ! Son angoisse est alors perpétuelle et elle ne cesse pas même à l’heure du repas : dans son gosier sec comme sous l’effet de la maladie et entre ses molaires la nourriture difficile à avaler s’accumule ; mais le pauvre diable recrache les gorgées de vin ; la précieuse vieillesse d’un antique vin d’Albe lui répugne ; qu’on lui présente un vin meilleur, une ride très profonde se creuse sur son front comme si elle avait été amenée par un Falerne piqué. La nuit, si par chance le tracas lui a concédé un bref assoupissement et si ses membres, après s’être retournés à travers tout le lit, trouvent enfin le repos, aussitôt dans ses songes, c’est le temps, les autels de la divinité outragée et, ce qui accable sa conscience avec des sueurs abondantes, c’est toi qu’il voit ; ton fantôme sacré et d’une taille surhumaine le trouble, épouvanté qu’il est, et le force à avouer. Tels sont ceux qui tremblent et pâlissent devant tous les éclairs quand il tonne, qui sont sans vie à chaque grondement du ciel comme s’il s’agissait d’un feu produit par le hasard ni par la rage des vents, mais d’un feu provoqué par la colère qui s’abat sur les terres et fait justice. Cet orage ne leur a causé aucun mal : c’est en revanche avec une peur plus grande qu’on craint le prochain orage comme s’il était différé par ce ciel serein. En outre, s’ils ont commencé à souffrir d’une douleur au côté avec une fièvre tenace, ils croient que la maladie a été envoyée à leur corps par la divinité, ils imaginent que ce sont là les projectiles et les traits des dieux. Faire vœu d’une brebis bêlante à un petit sanctuaire, promettre aux Lares la crête d’un coq, ils ne l’osent : qu’est-il permis aux criminels malades ?
Session 2017
Thème latin
Gérard de Nerval,
Les Filles du feu, Octavie
Corrigé proposé par le jury
Quantam ad desperationem amore adductus sim
O di immortales ! Nescio quo graui maerore animus meus tenebatur ; nulla uero alia re cruciabar nisi acerba cogitatione me non amari. Cum enim uidissem tamquam imaginem felicitatis et essem sub pulcherrima caeli parte omnium et adspicerem perfectissima opera naturae idque maxime ingens spectaculum quod hominibus uidere liceret, tamen aberam spatio quadringentorum milium passuum a sola muliere quae mihi alicuius pretii esset – at ea ignorabat etiam me esse. Me non amari ab illa nec sperare me unquam amari posse ! Tunc autem mihi in mentem uenit ut a Deo rationem reposcerem de mea singulari uita. Mihi enim unum gradum facere satis erat. Namque ubi eram, ibi mons rupis modo praeruptus erat et mare ab imo caeruleum liquidumque murmurabat, ita ut mihi dolendum esset per breuissimum tantum tempus. Heu ! quam uehementer ista cogitatione permotus sum ! Tum bis decurri, at nescio quod numen me uiuum in terram, quam osculatus sum, reiecit. Non enim me creauisti, o Domine, non me creauisti, inquam, ut perpetuo torquerer ! Te autem laedere mea morte nolo, sed da mihi uires, da mihi potentiam, da mihi imprimis eam uoluntatem qua alii regnum, alii gloriam, alii amorem adipiscantur.
Verum per hanc insolitam noctem, res inusitatior acciderat : nam nocte prope confecta, per omnes portas fenestrasque domus in qua eram lux fuerat et calido sulfureoque puluere impediebar ne respirarem : quam ob rem, postquam puellam quam facile ad me pellexeram dormientem in solario reliqui, uias angustas quibus in arcem itur ingressus sum.
Version latine
Ammien Marcellin,
La Moselle, XV, 8, 3-10
Corrigé proposé par le jury
Après qu’au fil de délibérations indécises on eut plaidé à plusieurs reprises pour nombre d’options, on arrêta une résolution ferme, et laissant là les discussions stériles, on décida d’associer Julien à l’empire. Comme il était venu à la suite du mandat qu’il avait reçu, on convoqua au jour déjà fixé toute l’armée en présence, on dressa une estrade pourélever davantage la tribune que les aigles entourèrent ainsi que les enseignes, et Auguste y prenant place, tenant Julien de sa main droite, développa sur un ton calme le discours suivant : « Nous nous tenons devant vous, parfaits défenseurs de l’Etat, pour soutenir la cause commune d’un cœur unique et unanime si l’on peut dire, cause que, disposé à plaider comme devant des juges équitables, j’exposerai de manière assez concise. Depuis la mort des usurpateurs rebelles que la rage et la fureur ont poussés aux tentatives bien connues qu’ils mirent en œuvre, les Barbares, comme s’ils sacrifiaient par le sang romain aux mânes impies de ceux-là, paradent d’un bout à l’autre des Gaules et ont rompu la paix de nos frontières, forts de cette conviction que de pénibles obligations nous retiennent en des régions extrêmement éloignées. Dès lors, si à ce mal qui se propage déjà aux territoires voisins vient s’opposer, tant que l’occasion le permet, un accord issu de notre décision et de la vôtre, d’un côté les fronts des nations superbes cesseront de se dresser fièrement et de l’autre les frontières de l’empire seront inviolables. Il suffit que vous donniez corps à l’espoir que je nourris pour les événements à venir par un acte qui aille dans son sens. Julien que voici, mon cousin germain, comme vous le savez, jeune homme estimé à bon droit pour sa réserve qui autant que le lien parental lui vaut notre affection, doué aussi d’un goût de l’effort qui s’est déjà illustré, je souhaite l’appeler au rang de César, desseins qui doivent encore, s’ils vous paraissent utiles, se trouver confirmés par votre assentiment. »
Il cherchait à en ajouter davantage mais l’assemblée l’en empêchait l’interrompant avec assez de modération : cela traduisait la décision de la divinité suprême et non d’un esprit humain, déclarait-elle, comme instruite par avance de ce qui allait arriver. Alors l’empereur, debout immobile le temps qu’ils se tussent, acheva ses explications avec plus de confiance : « Maintenant, puisque le frémissement collectif indique que votre approbation est également acquise, que cet heureux garçon à la force tranquille, dont il vaut mieux imiter qu’énoncer en public les mœurs mesurées, s’élève vers un honneur qui était presque attendu. Son naturel remarquable, accompli par une éducation libérale, je crois l’avoir pleinement exposé par le fait même que je l’ai choisi. Dès lors, avec le consentement du dieu du ciel, je vais le couvrir du manteau impérial. »
Session 2018
Thème latin
Madeleine de Scudéry, Clélie, histoire romaine
Corrigé proposé par le jury
Quam inhumana Tullia fuerit
Inter haec Tullia, mulier ferox, quae iusserat sibi in singula diei tempora nuntiari quicquid accideret, ubi primum cognouit quid Tarquinius, uir saeuus, egisset, in raedam celeriter escendit ut eo iret ubi senatus habebatur et postquam maritum suum arcessiuit, ei dixit se uenire eo consilio ut ei primum honorem tribueret eumque regem Romanorum salutaret. Cum autem illi res maioris momenti agendae essent, ei dixit se ei suadere ne diutius in turba moraretur quae nondum plac ata esset, ita ut Tullia in raedam suam rursus escenderit. Vbi uero is qui eam ducebat ad summum Cyprium uicum peruenit et ad dexteram currum flectere uoluit ut per decliue Esquilini montis radices peteret, Se ruium Tullium toto corpore cruore et puluere oblitum aspexit. Itaque cum tristissimum spectaculum uideret, frenos equorum suorum et reuerentia et humanitate retinuit, respexit saeuam mulierem regio genere natam quam deducebat eique corpus regis qui pater eius erat ostendit, quasi ei ostendere uellet quare consiste re coactus esset. Qui uir incipere regredi raedamque alia uia flectere uoluit ; at Tullia, immisericors mulier, quae saeuitia ipsa mouebatur, eius reuerentiam irrisit et loqui exordiens cum inhumanitate quae concipi non potest, magna uoce talia fere irata ei dixit : « Procede, procede neque constiteris ; nam nullum est iter quod non honestum sit ad regnum occupandum.
Version latine
Cicéron,
De la vieillesse, 83-85
Corrigé proposé par le jury
Pour ma part je suis transporté par le vif désir de voir vos pères que j’ai honorés et aimés, et je n’aspire pas à rencontrer ceux seuls que j’ai personnellement connus, mais aussi les grands hommes dont j’ai entendu parler, sur lesquels j’ai lu et moi-même écrit. Assurément, quand je prends ce chemin, nul ne saurait me faire revenir en arrière, ni recuire comme Pélias Et si un dieu m’accordait la larges se de redevenir enfant dep uis mon âge et de brailler dans mes langes, je refuserais fermement, et vraiment je ne voudrais pas, pour ainsi dire après avoir couru la longueur, être rappelé de la ligne d’arrivée à la ligne de départ Quel profit a-t-on en effet à vivre ? N’est-ce pas plutôt de la peine ? Mais admettons qu’on en ait bien, ce qui est vrai c’est qu’elle a à coup sûr ou satiété ou limite. A dire vrai, je n’aime pas me plaindre de la vie, ce que beaucoup d’hommes même doctes ont fait fréquemment, et je ne regrette pas d’avoir vécu, puisque j’ai vécu de façon à estimer que je ne suis pas né pour rien, et que je sors de la vie comme on sort d’une auberge, non comme de chez soi. La nature en effet nous a donné un lieu pour séjourner et non pour demeurer. O glorieux jour, lorsque je prendrai le chemin de cette divine réunion des esprits et leur rassemblement et lorsque je sortirai de cette masse et de cette fange ! Je m’acheminerai en vérité non seulement vers les hommes dont j’ai parlé auparavant, mais aussi vers mon cher Caton, l’homme le meilleur qui jamais ne fût né, la personne de toutes qui eut le plus grand sens du devoir ; or j’ai brûlé son corps, quand il aurait conve nu qu’il brûlât le mien, et son esprit, loin de m’abandonner mais regardant vers moi, est parti d ans ces lieux mêmes où lui comprenait que je devais venir. Et moi j’ai donné l’impression de supporter avec courage ce malheur qui est le mien, mais ce n’est pas que je l’aie supporté avec constance, je me consolais de moi-même à la pensée que nous ne serions pas longtemps éloignés et séparés. Voilà pourquoi, Scipion, (car, de cela, as-tu dit, tu t’ es souvent étonné avec Laelius), pour moi légère est la vieillesse, et elle n’est pas seulement sans gravité, elle est même douce. Et si je me trompe en croyant que les esprits des hommes sont immortels, je me trompe volontiers, et cette erreur, qui me charme, tant que je vis, je ne veux pas qu’ on me l’extirpe ; mais si une fois mort je n‘ai aucun sentiment, comme de petits philosophes l’imaginent, je n’ai pas peur que des philosophes morts se moquent de cette erreur qui fut mienne. Et si nous ne sommes pas voués à être immortels, il est toutefois souhaitable pour l’homme de s’éteindre au bon moment. Ainsi donc la nature, comme elle a en elle la limite de t outes les autres choses, a aussi la limite de la vie. En ce qui concerne la vieillesse, elle est le dernier acte de la vie, comme d’une pièce, dont nous devons fuir la lassitude, surtout quand la satiété s’est ajoutée.
Session 2019
Thème latin
Jean-Jacques Rousseau,
Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes,
Dédicace à la République de Genève.
Corrigé proposé par le jury
Sedem in re publica nuper instituta noluissem collocar e, quamuis bonis legibus regi posset, ne quod rei publicae administratio aliter fortasse constituta esse t atque ad hoc tempus oporteret nec haec uel nouis ciuibus uel ciues nouae rei publicae administrationi conducerent, idcirco res publica ipsa ab origine paene perturbari ac deleri posset. Nam eadem per libertatem agi solent ac per hunc cibum firmum eximiumque gustatu aut haec generosa uina quae ut eorum corporum robustorum quae eis uti solent ad naturam alendam firmandamque idonea sunt, ita opprimunt, perdunt ebriaque faciunt ea mollissima ac tenuissima quae eis non assuefacta sunt. Gentes igitur postquam in dominorum consuetudinem inductae sunt, ab eis abstinere non iam possunt. Sin autem a se eorum iugum deicere temptant, de libertate eo longius decedunt quod, dum ei modo effrenato ac contrario student, re publica commotata, se mper fere fallacibus oratoribus subiciuntur qui tantum uincula eorum grauiora faciunt. psa autem gens Romana, dico illud omnium liberarum gentium exemplum, cum a Tarquiniorum dominatione discessit, tum se regere nequiit. Seruitute enim deformata ac foedis laboribus quos isti ei imposuerant, nihil aliud primum fuit nisi imbecilla turba quae sapientissime et commodissime regenda fuit ut, quasi salubrem libertatis spiritum paulatim captare consuescentes, isti animi eneruati uel potius regum dominatione obtusi, hanc morum seueritatem atque hanc cum fortitudine magnanimitatem sensim susciperent quibus tandem omnibus e gentibus honestissimi euaderent. Beatam ergo et tranquillam rem publicam patriae meae conquisiuissem, quae ab ultima antiquitate quodam modo repeteretur.
Version latine
Claudien,
Le Rapt de Proserpine, III, v. 19-62
Corrigé proposé par le jury
Les affaires des mortels, que j’ai négligées depuis longtemps, ont accaparé une nouvelle fois mes pensées après que nous avons connu l’oisiveté propre à Saturne et la décrépitude d’une époque d’inertie, et qu’il fut décidé de mettre en mouvement, grâce aux aiguillons d’une vie ponctuée d’in quiétudes, les peuples longtemps endormis par la torpeur qu’a provoquée mon père, afin que la moisson ne grandît pas spontanément dans les champs incultes, que la forêt ne ruisselât pas de miel, et que les vignes, gorgées de sources, et que les rives entières ne retentissent pas jusqu’aux coupes. Je ne suis pas mal intentionné, évidemment (et, de fait, les dieux n’ont le droit ni d’être jaloux ni d’avoir mal agi), mais, parce que l’excès est ce qui détourne de la beauté morale et que l’abondance embourbe les âmes humaines, je veux que / mon but est que / j’agis pour que / (c’est pour que) l’inventive priv ation provoque les esprits indolents et fasse explorer petit à petit les voies du monde tenues à l’écart, et que l’habileté engendre les arts, que la pratique les nourrisse. Et voici qu’à grand renfort de lamentations Nature me demande instamment de soulager le genre humain, qu’elle me nomme « tyran dur et cruel », qu’elle me rappelle les siècles où régnait mon père et clame que Jupiter est pingre alors qu’elle est riche, moi qui voudrais que les plaines se hérissent en friche, que les campagnes soient couvertes de ronces, et qui n’embellirais l’année d’aucune récolte. Désormais, dit-elle, elle qui avait été auparavant une mère pour les mortels est passée d’un coup dans les manières d’une terrible marâtre : « À quoi a-t-il servi d’avoir extrait leur âme du ciel, à quoi a-t-il servi d’avoir redressé leur tête haute, si à la manière des bêtes ils errent à travers des terres impraticables et brisent des glands en guise de commune pitance ? Cette existence les réjouit-elle, attachée aux bourbiers des bois, mêlée aux bêtes sauvages ? » Après avoir souvent supporté ces plaintes de ma parente, particulièrement clément envers le monde, je finis par décider d’écarter les nations de la nourriture de Chaonie ; et c’est pourquoi il a été décrété que Cérès, qui en ce moment, ignorant ses malheurs, frappe les lions de l’Ida avec sa mère farouche, parcoure en tous sens mer et terres sous l’effet d’un chagrin dévorant, jusqu’à ce que, rendue heureuse par la preuve que sa fille a été retrouvée, elle offre les céréales, qu’un char soit porté par les nuées pour répandre aux peuples des épis inconnus et que les dragons bleu azur passent sous le joug de l’Attique. Mais si l’un des dieux osait (ose) révéler le ravisseur à Cérès – j’invoque la charge de mon pouvoir et la paix profonde des choses –, fût-il (qu’il soit) mon fils, ma sœur, ou mon épouse ou l’une de la troupe de mes filles, prétendît-elle qu’elle ait été conçue de ma tête, il (il ou elle) sentira de loin mon égide en colère, il sentira le coup de mon foudre, et il5 regrettera d’être né de race divine, et souhaitera mourir.
Session 2020
Dissertation française
Vous analyserez et discuterez ces propos de Bérangère Bonvoisin, à la lumière de votre lecture des deux pièces de Robert Garnier, Hippolyte et La Troade :
« On ne se touchait pas, mais on avait des corps très violents. Pendant les répétitions, Antoine nous demandait de nous forcer à trembler. Avec les mots de Garnier, ce jeu dessinait une architecture magnifique, car nous ne nous touchions pas, et en même temps nous étions reliés par un fil invisible. Il me semble que le premier mot que j’ai entendu d’Antoine à propos de ce spectacle, c’était qu’il fallait être barbare et précieux. Pour moi, ce qu’il y avait de ‘précieux’, c’était le langage, et le ‘barbare’, c’était le corps. »
[« ‘Barbare et précieux’, entretien avec Bérangère Bonvoisin et Jean-Yves Dubois sur la mise en scène d’Hippolyte par Antoine Vitez » (1982, Théâtre National de Chaillot), Lectures de Robert Garnier : Hippolyte, Les Juifves, dir. E. Buron, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2000, p. 76.]
Thème latin
Les peintres de la Renaissance, redécouvrant la grâce de l’Antique, avaient peuplé les lieux où ils vivaient de nymphes, de temples en ruine, de satyres et de dieux. J’étais sensible au pouvoir troublant de leurs Bacchanales, à la sérénité de leurs Parnasses : on aurait dit qu’à travers ces œuvres, nos rêves les plus tendres et les plus ardents prenaient une force et un charme accrus en se rattachant à ces images déposées au fond du souvenir ; et le même pouvoir était dévolu aux noms anciens dans la prose et la poésie des écrivains de ce même temps. C’étaient les éternelles figures du Désir qui, au lieu de surgir fragiles, perdues, spectrales, dans l’isolement du présent, s’étaient ornées de parures en apparence seulement étrangères, enveloppées ou nourries de mémoire, paradoxalement rajeunies de s’être baignées dans les plus antiques fontaines. La douloureuse distance du Temps, ces figures l’enjambaient comme une arche irisée ; ou plutôt, la changeaient en profondeur brillante et familière ; d’une rupture, elles faisaient un lien…
Néanmoins, je ne pouvais m’empêcher, devant ces œuvres, de ressentir toujours une impression, fût-elle légère, de théâtre : parce que la vérité qu’elles exprimaient avait cessé d’être la nôtre. Et quand je regardais les paysages de Cézanne, où je pouvais retrouver ceux qui m’entouraient, je me disais […] qu’en eux, où il n’y avait que montagnes, maisons, arbres et rochers, d’où les figures s’étaient enfuies, la grâce de l’Origine était encore plus présente ; et que, s’il avait essayé quelquefois d’y situer des baigneuses, ce pouvait être, sans qu’il le sût, pour exprimer plus explicitement ce qui, en fait, n’avait nul besoin de l’être autrement que par un certain ordre de la lumière.
Philippe Jaccottet (1925-2021),
Paysages avec figures absentes (1970)
(299 mots)
Corrigé proposé par le jury
Illo litterarum artiumque renatarum aeuo, pictores, qui rursus rerum Graecarum uel Romanarum leporem inuenirent, locos ubi uitam agebant nymphis, templis euersis, satyris deisque frequentauerant. Ipse autem sentiebam quanta ui Bacchanalium eorum animi perturbari possent, quam sereni essent eorum Parnassi. Operibus enim illis diceres somnia nostra mollissima feruentissimaque uim ac suauitatem maiorem suscipere dum cum eis penitus in memoria depositis imaginibus congruunt. Atque eamdem consecutionem ea prisca nomina afferebant quae apud illius eiusdem aetatis scriptores in oratione soluta uel in uersibus inueniuntur. Quae sempiternas libidinis ipsius effigies notabant quippe quae cum fragiles, errantes, simulacrorum similes solitudineque quam tempus praesens gignit seclusae exsurgere potuissent, ornamentis specie quidem ipsa alienis, memoria offusae uel instructae se decorauissent, sed idcirco mirabiliter renouatae euasissent quod antiquissimis in fontibus essent lotae. Itaque eae effigies, quamquam saecula graue spatium intermiserant, sicut arcus uersicolor ita id trangrediebantur uel potius, magnitudine quadam adiecta, in rem nitidam familiaremque mutabant. Quarum auxilio e rebus disiunctis quasi uinculo coniunctae fiebant…
Teneri tamen non poteram quin, illis operibus conspectis, quasi ex theatro aliquem sensum, etsi leuem, semper perciperem, quia quam ueritatem exprimebant, ea iam nostra esse desierat. Atque ubi rura ab illo Apelle Gallico picta conspiciebam, in quibus ea rursus inuenire poteram quibus circumdari solebam, mecum reputabam originis ipsius rerum leporem in eis, ubi nihil aliud uersaretur nisi montes, uillae, arbores saxaque, unde effigies effugissent, etiam uehementius inesse ; atque illum ibi aliquando uirgines nantes collocare ea causa fortasse temptauisse, quo, quamquam hoc nesciret, explicatiore modo ea exprimere uellet, quae re uera nihil aliter nisi qua lucis compositione exprimenda essent.
Thème grec
LES SCIENCES NUISENT AUX QUALITÉS MORALES (1)
Vos enfants ignoreront leur propre langue, mais ils en parleront d’autres qui ne sont en usage nulle part ; ils sauront composer des vers qu’à peine ils pourront comprendre ; sans savoir démêler l’erreur de la vérité, ils posséderont l’art de les rendre méconnaissables aux autres par des arguments spécieux ; mais ces mots de magnanimité, de tempérance, d’humanité, de courage, ils ne sauront ce que c’est ; ce doux nom de patrie ne frappera jamais leur oreille ; et s’ils entendent parler de Dieu, ce sera moins pour le craindre que pour en avoir peur. J’aimerais autant, disait un sage, que mon écolier eût passé le temps dans un jeu de paume, au moins le corps en serait plus dispos. Je sais qu’il faut occuper les enfants, et que l’oisiveté est pour eux le danger le plus à craindre. Que faut-il donc qu’ils apprennent ? Voilà certes une belle question ! Qu’ils apprennent ce qu’ils doivent faire étant hommes, et non ce qu’ils doivent oublier. Telle était l’éducation des Spartiates, au rapport du plus grand de leurs rois. « C’est, dit Montaigne (2), chose digne de très grande considération, qu’en cette excellente police de Lycurgue, et à la vérité monstrueuse par sa perfection, si soigneuse pourtant de la nourriture des enfants, comme de sa principale charge, et au gîte même des Muses, il s’y fasse si peu mention de la doctrine : comme si, cette généreuse jeunesse dédaignant tout autre joug, on lui ait dû fournir, au lieu de nos maîtres de science, seulement des maîtres de vaillance, prudence et justice. »
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778),
Discours sur les sciences et les arts (1750), Seconde partie
(268 mots)
(1) Traduire le titre.
(2) Traduire par un indéfini.
Corrigé proposé par le jury
Ὅτι τὰ μαθήματα βλάπτει τὰς τῶν ἠθῶν ἀρετάς
Οἱ ὑμέτεροι παῖδες τὴν μὲν σφετέραν αὐτῶν γλῶτταν ἀγνοήσουσιν, ἄλλαις δέ τισι χρήσονται ταῖς οὐδαμοῦ νομιζομέναις· μέτρα δὲ ποιεῖν μὲν εἴσονται, συνιέναι δὲ μόλις οἷοί τ’ ἔσονται· τὸ δὲ ψεῦδος τῆς ἀληθείας οὐκ εἰδότες διακρῖναι τεχνικοί γ’ ἔσονται περὶ τὸ ταῦτα συγχεῖν πρὸς ἄλλους λόγοις εὐπρεπέσι χρώμενοι· οὐ μέντοι τὰ ὀνόματα ταῦτα, μεγαλοφροσύνην τε καὶ σωφροσύνην καὶ φιλανθρωπίαν καὶ ἀνδρείαν, ἅττα ἐστὶν εἴσονται· οὐδὲ τόδε τὸ ἡδὺ ὄνομα πατρίδα ἀκούσονταί ποτε, ἀλλ’ ἐὰν ἀκούσωσι περὶ θεοῦ, ἧττον αὐτὸν αἰδέσονται ἢ φοβήσονται. Καὶ μὲν δὴ σοφός τις ἔλεγεν· Ἐβουλόμην γ’ ἂν μᾶλλον, ἔφη, τὸν ἐμὸν μαθητὴν σφαιρίζοντα διατρῖψαι· ταύτῃ γοῦν ὑγιεινότερον ἂν εἶχε τὸ σῶμα. Ἀλλὰ γὰρ εὖ οἶδα ὅτι δεῖ ἀσχόλους ποιεῖν τοὺς παῖδας καὶ πάντων τῶν κινδύνων τὴν ἀργίαν μάλιστα αὐτοῖς φοβητέον ἐστίν. Τί οὖν χρὴ αὐτοὺς μανθάνειν ; Καλόν γε τὸ ἐρώτημα. Μανθανόντων δὴ τὰ προσήκοντα αὐτοῖς πράττειν ὡς ἀνθρώποις οὖσιν ἀλλὰ μὴ τὰ μνήμης ἀνάξια. Καὶ δὴ τοῖς Λακεδαιμονίοις τοιαύτη ἦν ἡ ἀγωγὴ ὥσπερ καὶ διηγεῖται ὁ μέγιστος τῶν παρ’ αὐτοῖς βασιλέων. Καὶ γὰρ λέγει τις· Τόδε γε ἀξιολογώτατόν τί ἐστιν, ὅτι ἔν τε ἐκείνῃ τῇ τοῦ Λυκούργου πολιτείᾳ τῇ καλλίστῃ καὶ ἅτε τελείᾳ οὔσῃ ὡς ἀληθῶς τερατώδει, καίπερ ἐπιμελεστάτῃ οὔσῃ τῆς τῶν παίδων τροφῆς ὡς τοῦ κυρίου ἔργου τοῦ ἑαυτῆς, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ τῶν Μουσῶν οἰκήσει, ἥκιστα λέγεται περὶ μαθήσεως ὡς δεῆσαν ἐκείνοις τοῖς γενναίοις νεανίαις, ἅτε παντὸς ἄλλου ζυγοῦ καταφρονοῦσιν, ἀντὶ τῶν παρ’ ἡμῖν ἐπιστήμης διδασκάλων μηδενὸς ἄλλου διδασκάλους παρέχειν εἰ μὴ ἀνδρείας τε καὶ φρονήσεως καὶ δικαιοσύνης.
Version grecque
Après qu’Achille a vivement réagi en apprenant la décision d’Agamemnon de sacrifier Iphigénie, Clytemnestre l’implore de sauver sa fille.
ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ
Φεῦ·
πῶς ἄν σ’ ἐπαινέσαιμι μὴ λίαν λόγοις,
μηδ’ ἐνδεὴς τοῦδ’ ἀπολέσαιμι τὴν χάριν ;
Αἰνούμενοι γὰρ ἁγαθοὶ τρόπον τινὰ
μισοῦσι τοὺς αἰνοῦντας, ἢν αἰνῶσ’ ἄγαν.
Αἰσχύνομαι δὲ παραφέρουσ’ οἰκτροὺς λόγους,
ἰδίᾳ νοσοῦσα· σὺ δ’ ἄνοσος κακῶν γ’ ἐμῶν.
Ἀλλ’ οὖν ἔχει τι σχῆμα, κἂν ἄπωθεν ᾖ
ἀνὴρ ὁ χρηστός, δυστυχοῦντας ὠφελεῖν.
Οἴκτιρε δ’ ἡμᾶς· οἰκτρὰ γὰρ πεπόνθαμεν.
Ἣ πρῶτα μέν σε γαμβρὸν οἰηθεῖσ’ ἔχειν,
κενὴν κατέσχον ἐλπίδ’· εἶτά σοι τάχα
ὄρνις γένοιτ’ ἂν τοῖσι μέλλουσιν γάμοις
θανοῦσ’ ἐμὴ παῖς, ὅ σε φυλάξασθαι χρεών.
Ἀλλ’ εὖ μὲν ἀρχὰς εἶπας, εὖ δὲ καὶ τέλη·
σοῦ γὰρ θέλοντος παῖς ἐμὴ σωθήσεται.
Βούλῃ νιν ἱκέτιν σὸν περιπτύξαι γόνυ ;
Ἀπαρθένευτα μὲν τάδ’· εἰ δέ σοι δοκεῖ,
ἥξει, δι’ αἰδοῦς ὄμμ’ ἔχουσ’ ἐλεύθερον.
Εἰ δ’ οὐ παρούσης ταὐτὰ τεύξομαι σέθεν,
μενέτω κατ’ οἴκους· σεμνὰ γὰρ σεμνύνεται.
Ὅμως δ’, ὅσον γε δυνατόν, αἰδεῖσθαι χρεών.
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
Σὺ μήτε σὴν παῖδ’ ἔξαγ’ ὄψιν εἰς ἐμήν,
μήτ’ εἰς ὄνειδος ἀμαθὲς ἔλθωμεν, γύναι·
στρατὸς γὰρ ἀθρόος, ἀργὸς ὢν τῶν οἴκοθεν,
λέσχας πονηρὰς καὶ κακοστόμους φιλεῖ.
Πάντως δέ μ’ ἱκετεύοντέ θ’ ἥξετ’ εἰς ἴσον,
ἐπ’ ἀνικετεύτοις θ’· εἷς ἐμοὶ γάρ ἐστ’ ἀγὼν
μέγιστος, ὑμᾶς ἐξαπαλλάξαι κακῶν.
Ὡς ἕν γ’ ἀκούσασ’ ἴσθι, μὴ ψευδῶς μ’ ἐρεῖν·
ψευδῆ λέγων δὲ καὶ μάτην ἐγκερτομῶν,
θάνοιμι· μὴ θάνοιμι δ’ ἢν σώσω κόρην.
ΚΛ. Ὄναιο συνεχῶς δυστυχοῦντας ὠφελῶν.
ΑΧ. Ἄκουε δή νυν ἵνα τὸ πρᾶγμ’ ἔχῃ καλῶς.
ΚΛ. Τί τοῦτ’ ἔλεξας ; Ὡς ἀκουστέον γέ σου.
ΑΧ. Πείθωμεν αὖθις πατέρα βέλτιον φρονεῖν.
ΚΛ. Κακός τίς ἐστι καὶ λίαν ταρβεῖ στρατόν.
ΑΧ. Ἀλλ’ οὖν λόγοι γε καταπαλαίουσιν λόγους.
ΚΛ. Ψυχρὰ μὲν ἐλπίς· ὅ τι δὲ χρή με δρᾶν φράσον.
ΑΧ. Ἱκέτευ’ ἐκεῖνον πρῶτα μὴ κτείνειν τέκνα·
ἢν δ’ ἀντιβαίνῃ, πρὸς ἐμέ σοι πορευτέον.
Euripide,
Iphigénie à Aulis, v. 977-1016
(278 mots)
Corrigé proposé par le jury
CLYTEMNESTRE – Comment pourrais-je te louer avec des paroles qui ne soient pas excessives et ne pas perdre ta faveur (bienveillance) parce que je manquerais de talent oratoire ? Les hommes de bien, en effet, quand ils sont loués, haïssent d’une certaine façon ceux qui les louent s’ils les louent à l’excès. Or, j’éprouve quelque honte à me voir t’adresser ainsi des paroles de pitié, alors que je suis frappée d’un mal qui n’affecte que moi : toi, en revanche, tu n’es atteint d’aucun mal, en tout cas pas par mes malheurs. C’est en tout cas la marque pour l’homme de bien d’une certaine noblesse (d’âme) que de venir en aide à des gens en proie au malheur même s’il n’est pas (directement) concerné. Aie pitié de nous, car nous avons subi une épreuve digne de pitié / nous sommes plongés dans des tourments dignes de pitié. Moi, tout d’abord, alors que je m’étais imaginé que j’allais t’avoir pour gendre, je n’ai conçu là qu’un vain espoir. Quant à toi, ensuite, il se pourrait peut-être que ce soit un mauvais présage pour tes futures noces que ma fille ait été mise à mort (= peut-être l’immolation de ma fille pourrait-elle être un mauvais présage… ) – une funeste perspective dont tu dois (devrais) te garder ! Toutefois, si tu as bien parlé au début, tu as également bien parlé à la fin : si, de fait, tu le veux (c’est ce que tu veux), ma fille sera sauvée. Désires-tu qu’elle enserre ton genou (de ses bras) pour te supplier/ en suppliante ? Voilà une attitude qui ne sied guère à une jeune fille ; toutefois, si c’est ce que tu souhaites, elle se présentera devant toi en arborant le noble regard, empreint de pudeur, d’une femme libre. Mais, si je puis obtenir de toi les mêmes faveurs sans qu’elle ne soit présente, qu’elle reste au palais, car elle respecte les bienséances. Quoi qu’il en soit, elle se doit – dans la mesure du possible, en tout cas – de montrer de la pudeur (réserve).
ACHILLE – Toi, ne fais pas sortir ta fille (du palais) pour que je la voie et n’allons pas nous exposer, femme, aux quolibets des ignorants. C’est qu’une armée rassemblée en masse, quand elle est déchargée de ses soucis domestiques, aime à répandre des commérages remplis de calomnies et d’injures. Vous parviendrez (de toute façon) à un résultat (absolument) identique, que vous me suppliiez toutes deux ou que ce soit sans aucune supplication. Car je n’ai qu’un seul et immense défi à remporter : vous délivrer de vos malheurs. Car sois en tout cas assurée que tu n’auras entendu qu’une seule promesse sortir de ma bouche : c’est que je ne m’exprimerai pas par mensonges. Si je profère des mensonges ou ne cherche qu’à te berner de fallacieuses paroles, pourvu que je meure ! Puissé-je toutefois ne pas mourir si je parviens à sauver cette jeune fille !
CL. – Puisses-tu réussir à aider sans relâche des gens (qui sont) dans le malheur !
ACH. – Écoute-moi donc, (afin) que notre affaire puisse connaître une issue favorable !
CL. – Pourquoi as-tu dit cela/ me dis-tu cela ? Car je me dois de t’écouter, bien sûr !
ACH. – Tâchons de persuader son père de revenir à de meilleurs sentiments !
CL. – Ce n’est rien moins qu’un lâche, et il a trop (terriblement) peur de son armée.
ACH. – Pourtant, des arguments peuvent terrasser des (d’autres) arguments.
CL. – Vaine espérance ! Explique-moi plutôt ce que je dois faire !
ACH. – Commence par supplier cet homme de ne pas sacrifier son enfant ! Mais, s’il s’y refuse, tu devras venir me voir.
Version latine
INSTITUTION DES QUINQUENNALES :
L’OPINION PUBLIQUE SE DIVISE SUR L’INSTAURATION DE NOUVEAUX JEUX
Nerone quartum Cornelio Cosso consulibus, quinquennale ludicrum Romae institutum est ad morem Graeci certaminis, uaria fama, ut cuncta ferme noua. Quippe erant qui Cn. quoque Pompeium incusatum a senioribus ferrent, quod mansuram theatri sedem posuisset. Nam antea subitariis gradibus et scaena in tempus structa ludos edi solitos, uel si uetustiora repetas, stantem populum spectauisse, ne, si consideret theatro, dies totos ignauia continuaret. Spectaculorum quidem antiquitas seruaretur, quoties praetores ederent, nulla cuiquam ciuium necessitate certandi. Ceterum abolitos paulatim patrios mores funditus euerti per accitam lasciuiam, ut quod usquam corrumpi et corrumpere queat, in urbe uisatur, degeneretque studiis externis iuuentus, gymnasia et otia et turpis amores exercendo, principe et senatu auctoribus, qui non modo licentiam uitiis permiserint, sed uim adhibeant ut proceres Romani specie orationum et carminum scaena polluantur. Quid superesse, nisi ut corpora quoque nudent et caestus adsumant easque pugnas pro militia et armis meditentur ? An iustitiam auctum iri et decurias equitum egregium iudicandi munus expleturos, si fractos sonos et dulcedinem uocum perite audissent ? Noctes quoque dedecori adiectas, ne quod tempus pudori relinquatur, sed coetu promisco, quod perditissimus quisque per diem concupiuerit, per tenebras audeat.
Pluribus ipsa licentia placebat, ac tamen honesta nomina praetendebant. Maiores quoque non abhorruisse spectaculorum oblectamentis pro fortuna, quae tum erat, eoque a Tuscis accitos histriones, a Thuriis equorum certamina ; et possessa Achaia Asiaque ludos curatius editos, nec quemquam Romae honesto loco ortum ad theatralis artes degenerauisse, ducentis iam annis a L. Mummi triumpho, qui primus id genus spectaculi in urbe praebuerit. Sed et consultum parsimoniae, quod perpetua sedes theatro locata sit potius quam immenso sumptu singulos per annos consurgeret ac destrueretur.
Tacite,
Annales, XIV, 20-21
(265 mots)
Corrigé proposé par le jury
Sous le consulat de Néron, consul pour la quatrième fois, et de Cornelius Nepos, des jeux quinquennaux furent institués à Rome à la manière du concours grec, suscitant des divergences d’opinion, comme à peu près toutes les nouveautés. Il se trouvait en effet des gens pour dire que Cnaeus Pompée lui aussi avait été accusé par les plus âgés parce qu’il avait installé un bâtiment de théâtre fait pour durer ; qu’auparavant, en effet, on avait l’habitude de donner les jeux avec des gradins improvisés et une scène construite pour l’occasion et même, si l’on remonte plus haut dans le temps, c’était debout que le peuple avait regardé les spectacles, par crainte que, s’il s’asseyait au théâtre, il n’y passât des jours entiers dans la paresse. Au moins fallait-il conserver le caractère antique des spectacles, disaient-ils, chaque fois que les prêteurs donnaient des jeux, sans aucune obligation pour un citoyen de concourir. En tout cas, les mœurs des ancêtres, peu à peu effacées, étaient / allaient être totalement balayées par cette mollesse venue de l’étranger, si bien que, tout ce qui peut / pouvait au monde corrompre et être corrompu, se verrait dans la ville et que la jeunesse dégénèrerait sous l’effet de passions importées, en pratiquant sans relâche les gymnases, l’oisiveté et les amours honteuses, et cela à l’instigation du prince et du sénat, qui non seulement avaient permis la licence aux vices, mais qui forçaient en plus les nobles romains à s’avilir sur scène, sous prétexte d’éloquence et de poésie. Que restait-il à faire, sinon qu’ils dénudent aussi leur corps, qu’ils prennent des cestes et qu’ils s’adonnent à ces luttes à la place du service militaire et des armées ? La justice en serait-elle renforcée et les décuries de chevaliers rempliraient-elles mieux la noble fonction de juger / de juges après avoir écouté en expertes des sons faibles et des voix douces ? On avait même adjoint les nuits à la honte afin qu’il n’y ait point un moment laissé à la pudeur, mais qu’à la faveur d’un rassemblement pêle-mêle, tous les plus dépravés osent à travers les ténèbres ce qu’ils avaient ardemment désiré pendant le jour.
Cependant, c’est cette licence même qui plaisait au plus grand nombre bien qu’il mît en avant d’honnêtes prétextes. Les Ancêtres, disaient-ils, n’avaient pas non plus eu en horreur les divertissements tirés des spectacles, en fonction de la fortune de leur temps, et ainsi on avait fait venir les comédiens de chez les Étrusques et on avait emprunté les courses de chevaux aux gens de Thurium ; de plus, une fois l’Achaïe et l’Asie conquises, on avait mis plus de soin à donner des jeux et personne à Rome issu de noble origine n’avait dégénéré en se livrant aux arts du théâtre, en deux cents ans déjà depuis le triomphe de L. Mummius qui le premier avait offert ce genre de spectacle dans la ville. Mais encore, on avait veillé à l’économie en ayant établi un bâtiment permanent pour le théâtre plutôt qu’il ne soit construit et détruit année après année à très grands frais.
Session 2021
Dissertation française
Vous analyserez et discuterez ce propos de Georges Poulet à la lumière de votre lecture de Histoire de ma vie de Casanova :
Casanova « est l’homme de son siècle par excellence. Toutefois, alors que chez la plupart des esprits de son temps, la recherche diversifiée du plaisir est un calcul raffiné et une démarche pleine d’élégance, il y a quelque chose de grossier, de heurté, même de spasmodique, dans la façon dont Casanova varie les objets de ses passions. Il faut bien le dire, cette vie révèle à qui la regarde ou s’efforce de la regarder dans son ensemble, une déplorable absence de “fondu”. Vie qui passe incessamment de la mascarade à l’orgie et de l’orgie à la catastrophe. » (Georges Poulet, Études sur le temps humain, « De l’instant éphémère à l’instant éternel », « Mesure de l’instant », chapitre V, « Casanova », Paris, réédition dans la collection Pocket, 2017, p. 452.)
Thème latin
CLÉOPÂTRE ET SES ENFANTS (1)
Mes enfants, prenez place. Enfin voici le jour
Si doux à mes souhaits, si cher à mon amour,
Où je puis voir briller sur une de vos têtes
Ce que j’ai conservé parmi tant de tempêtes,
Et vous remettre un bien, après tant de malheurs,
Qui m’a coûté pour vous tant de soins et de pleurs.
Il peut vous souvenir quelles furent mes larmes,
Quand Tryphon me donna de si rudes alarmes,
Que, pour ne pas vous voir exposés à ses coups,
Il fallut me résoudre à me priver de vous.
Quelles peines depuis, grands dieux, n’ai-je souffertes !
Chaque jour redoubla mes douleurs et mes pertes.
Je vis votre royaume entre ces murs réduit,
Je crus mort votre père, et sur un si faux bruit
Le peuple mutiné voulut avoir un maître.
J’eus beau le nommer lâche, ingrat, parjure, traître,
Il fallut satisfaire à son brutal désir,
Et, de peur qu’il n’en prît, il m’en fallut choisir.
Pour vous sauver l’État que n’eussé-je pu faire ?
Je choisis un époux avec des yeux de mère,
Votre oncle Antiochus, et j’espérai qu’en lui
Votre trône tombant trouverait un appui.
Mais à peine son bras en relève la chute,
Que par lui de nouveau le Sort me persécute :
Maître de votre État par sa valeur sauvé,
Il s’obstine à remplir ce trône relevé.
Qui lui parle de vous attire sa menace,
Il n’a défait Tryphon que pour prendre sa place,
Et, de dépositaire et de libérateur
Il s’érige en Tyran, et lâche usurpateur.
Sa main l’en a puni, pardonnons à son Ombre,
Aussi bien en un seul voici des maux sans nombre.
Pierre Corneille (1606-1684),
Rodogune, princesse des Parthes, Acte II, scène 3 (1647)
(286 mots)
(1) Traduire le titre.
Corrigé proposé par le jury
QVID CLEOPATRA LIBERIS DIXERIT
Considite, liberi mei. Nam hic tandem adest dies mihi talia optanti dulcissimus carissimusque mihi uos amanti, quo non solum quod inter tot tempestates conseruaui, id in uno e capitibus uestris elucens uidere possum, sed etiam post tot miserias uobis id bonum tradere mihi licet quod uestra causa tot lacrimas curasque mihi attulit. Meminisse enim potestis quam multas lacrimas profuderim cum Trypho me tam uehementer sollicitauisset ut mihi decernendum esset, ne imperio eius infesti fieretis, a uobis abesse. Quanta autem, di magni, iam inde moleste tuli ! Nam dolores damnaque mihi in dies creuerunt, regnum uestrum in his muris uidi circumclusum, patrem uestrum credidi cecidisse, populusque quem ista tam falsa fama seditiosum reddiderat dominum sibi suscipere uoluit. Quem cum conclamarem esse et ignauum et ingratum et periurum et perfidum, tamen uoluntati eius uehementi satisfacere ita coacta sum ut rex mihi eligendus esset, uerita ne quem iste ultro crearet. Quid enim agere non potuissem ut uobis regnum integrum tenerem ? Nam Antiochum, patruum uestrum, dum eum maternis cum oculis conspicio, conjugem delegi atque quamquam speraui eum, regno praecipitante, uobis auxilio fore, uix tamen imperium uestrum dum lababat manu sua restituerat cum Fortuna eo ministro me iterum uexauit. Nam postquam ciuitatis uestrae potitus est quam uirtute sua seruauerat, id regnum cum restitutum esset deponere non uult sed eis minitatur qui ante eum de uobis uerba faciunt. Nullam enim ob aliam causam Tryphonem a regno expulit nisi ut locum eius occuparet. Itaque ut regni custos uindexque factus est, sic non solum tyrannum sed etiam hominem ignauum ac regni rapacem se praebet. Cuius rei poenas manu sua persoluit, ergo ignoscamus umbrae eius ; ita cum malum unum ferimus, simul permulta patimur.
Thème grec
LORENZO (1) — Je suis, en effet, précieux pour vous, car je tuerai Alexandre.
PHILIPPE — Toi ?
LORENZO — Moi, demain ou après-demain. Rentrez chez vous, tâchez de délivrer vos enfants ; si vous ne le pouvez pas, laissez-leur subir une légère punition ; je sais pertinemment qu’il n’y a pas d’autres dangers pour eux, et je vous répète que d’ici à quelques jours il n’y aura pas plus d’Alexandre de Médicis (2) à Florence (3) qu’il n’y a de soleil à minuit.
PHILIPPE — Quand cela serait vrai, pourquoi aurais-je tort de penser à la liberté ? Ne viendra-t-elle pas quand tu auras fait ton coup, si tu le fais ?
LORENZO — Philippe, Philippe, prends garde à toi. Tu as soixante ans de vertu sur ta tête grise ; c’est un enjeu trop cher pour le jouer aux dés.
PHILIPPE — Si tu caches sous ces sombres paroles quelque chose que je puisse entendre, parle ; tu m’irrites singulièrement.
LORENZO — Tel que tu me vois, Philippe, j’ai été honnête. J’ai cru à la vertu, à la grandeur humaine, comme un martyr croit à son dieu. J’ai versé plus de larmes sur la pauvre Italie que Niobé sur ses filles.
PHILIPPE — Eh bien, Lorenzo ?
LORENZO — Ma jeunesse a été pure comme l’or. Pendant vingt ans de silence, la foudre s’est amoncelée dans ma poitrine ; et il faut que je sois réellement une étincelle du tonnerre, car tout à coup, une certaine nuit que j’étais assis dans les ruines du colisée antique, je ne sais pourquoi, je me levai ; je tendis vers le ciel mes bras trempés de rosée, et je jurai qu’un des tyrans de ma patrie mourrait de ma main.
Alfred de Musset (1810-1857),
Lorenzaccio (1834)
(1) Traduire par « le jeune homme ».
(2) Ne pas traduire « de Médicis ».
(3) « à Florence » : traduire par « dans la cité ».
Corrigé proposé par le jury
ΝΕΑΝΙΑΣ — Πολλοῦ γάρ σοι ἄξιός εἰμι ὡς ἀποκτενῶ τὸν Ἀλέξανδρον.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ — Σύ ;
ΝΕ. — Ἔγωγε, τῇ αὔριον ἢ τρίτῃ ἡμέρᾳ. Οἴκαδ’ οὖν ἐπάνελθε, καὶ ὅπως λύσεις τοὺς σεαυτοῦ παῖδας· ἐὰν δὲ μὴ δύνῃ, ἔασον αὐτοὺς σμικρόν τι κολάζεσθαι. Εὖ γὰρ οἶδα αὐτοὺς οὐδέν’ ἄλλον κίνδυνον κινδυνεύοντας καὶ πάλιν σοι λέγω ὅτι ἡμερῶν ὀλίγων ὥσπερ οὐ φαίνεται ὁ ἥλιος ἐν μέσῳ νυκτῶν, οὕτως οὐκέτι ἔσται Ἀλέξανδρος ἐν τῇ πόλει.
ΦΙ. — Εἰ καὶ τοῦτο ἀληθὲς εἴη, τί κακῶς ποιοίην ἂν ἐπινοῶν τὴν ἐλευθερίαν ; Οὔκουν αὕτη γενήσεται ὅταν τὸ ἔργον πράξῃς, ἐὰν ἄρα τοῦτο πράξῃς ;
ΝΕ. — Ὦ Φίλιππε, Φίλιππε, φύλαξαι. Σὺ γὰρ ἑξήκοντα ἔτη γεγονὼς καὶ πόλιος ὢν ἤσκηκας ἀρετήν · τιμιώτερον οὖν πρᾶγμά ἐστιν ἢ ὥστε κυβεύειν σε περὶ τούτῳ.
ΦΙ. — Εἴ τι τούτοις τοῖς αἰνίγμασιν ἀποκρύπτει συνετόν μοι, εἰπέ· θαυμασίως γὰρ ὡς κινεῖς με.
ΝΕ. — Τοιοῦτος ὢν οἷον ὁρᾷς, ὦ Φίλιππε, χρηστὸς ἐγενόμην. Ἐπίστευον γὰρ τῇ ἀρετῇ καὶ τῇ τῶν ἀνθρώπων μεγαλοφροσύνῃ ὥσπερ καὶ μάρτυς τις τῷ ἑαυτοῦ θεῷ πιστεύει. Πλέον δ’ ἐδάκρυον τὴν ἀθλίαν Ἰταλίαν ἢ Νιόβη τὰς θυγατέρας.
ΦΙ. — Τί οὖν, ὦ νεανία ;
ΝΕ. — Νέος ὢν καθαρὸς ἦν ὥσπερ χρυσός. Ἐν δ’ ᾧ εἴκοσιν ἔτη ἐσίγων, ἡθροίζετό μοι ὁ κεραυνὸς ἐν τῷ στήθει· καὶ, ὡς ἔοικε, τῷ ὄντι σπινθὴρ τῆς βροντῆς εἰμι, ἐπεὶ ἐξ ὑπογύου νυκτός τινος ἐν ᾗ ἐκαθήμην ἐν τοῖς τοῦ παλαιοῦ θεάτρου ἐρειπίοις οὐκ οἶδ’ ὅπως ἀνέστην· ἀνέτεινα δὲ τὰς δροσερὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανόν καὶ διόμωσά τινα τῶν τῆς πατρίδος τυραννευόντων ἀποκτενεῖν αὐτοχειρίᾳ.
Version grecque
Poursuivi pour meurtre, le défendeur, qui clame son innocence, réfute la thèse de ses accusateurs selon laquelle il aurait assassiné la victime pour le compte de l’un de ses amis, Lycinos.
Ἔπειτα δ’, εἰ καὶ ὡς μάλιστα ἐϐούλετο αὐτὸν ὁ Λυκῖνος τεθνάναι (εἶμι γὰρ καὶ ἐπὶ τὸν τῶν κατηγόρων λόγον), οὗ αὐτὸς οὐκ ἠξίου αὐτόχειρ γενέσθαι, τοῦτο τὸ ἔργον ἐγώ ποτ’ ἂν ἐπείσθην ἀντ’ ἐκείνου ποιῆσαι ; Πότερα ὡς ἐγὼ μὲν ἦ τῷ σώματι ἐπιτήδειος διακινδυνεύειν, ἐκεῖνος δὲ χρήμασι τὸν ἐμὸν κίνδυνον ἐκπρίασθαι ; Οὐ δῆτα· τῷ μὲν γὰρ οὐκ ἦν χρήματα, ἐμοὶ δὲ ἦν. ᾿Αλλ’ αὖ τοὐναντίον ἐκεῖνος τοῦτο θᾶσσον ἂν ὑπ’ ἐμοῦ ἐπείσθη κατά γε τὸ εἰκὸς ἢ ἐγὼ ὑπὸ τούτου, ἐπεὶ ἐκεῖνός γ’ ἑαυτὸν οὐδ’ ὑπερήμερον γενόμενον ἑπτὰ μνῶν δυνατὸς ἦν λύσασθαι, ἀλλ’ οἱ φίλοι αὐτὸν ἐλύσαντο. Καὶ μὲν δὴ καὶ τῆς χρείας τῆς ἐμῆς καὶ τῆς Λυκίνου τοῦτο ὑμῖν μέγιστον τεκμήριόν ἐστιν, ὅτι οὐ σφόδρα ἐχρώμην ἐγὼ Λυκίνῳ φίλῳ ὡς πάντα ποιῆσαι ἂν τὰ ἐκείνῳ δοκοῦντα· οὐ γὰρ δή που ἑπτὰ μὲν μνᾶς οὐκ ἀπέτεισα ὑπὲρ αὐτοῦ δεδεμένου καὶ λυμαινομένου, κίνδυνον δὲ τοσοῦτον ἀράμενος ἄνδρα ἀπέκτεινα δι’ ἐκεῖνον.
Ὡς μὲν οὖν οὐκ αὐτὸς αἴτιός εἰμι τοῦ πράγματος οὐδὲ ἐκεῖνος, ἀποδέδεικται καθ’ ὅσον ἐγὼ δύναμαι μάλιστα. Τούτῳ δὲ χρῶνται πλείστῳ λόγῳ οἱ κατήγοροι, ὅτι ἀφανής ἐστιν ὁ ἀνήρ (1), καὶ ὑμεῖς ἴσως περὶ τούτου αὐτοῦ ποθεῖτε ἀκοῦσαι. Εἰ μὲν οὖν τοῦτο εἰκάζειν με δεῖ, ἐξ ἴσου τοῦτό ἐστι καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοί· οὔτε γὰρ ὑμεῖς αἴτιοι τοῦ ἔργου ἐστὲ οὔτε ἐγώ· εἰ δὲ δεῖ τοῖς ἀληθέσι χρῆσθαι, τῶν εἰργασμένων τινὰ ἐρωτώντων· ἐκείνου γὰρ ἄριστ’ ἂν πύθοιντο. ᾿Εμοὶ μὲν γὰρ τῷ μὴ εἰργασμένῳ τοσοῦτον τὸ μακρότατον τῆς ἀποκρίσεώς ἐστιν, ὅτι οὐκ εἴργασμαι· τῷ δὲ ποιήσαντι ῥᾳδία ἐστὶν ἡ ἀπόδειξις, καὶ μὴ ἀποδείξαντι εὖ εἰκάσαι. Οἱ μὲν γὰρ πανουργοῦντες ἅμα τε πανουργοῦσι καὶ πρόφασιν εὑρίσκουσι τοῦ ἀδικήματος, τῷ δὲ μὴ εἰργασμένῳ χαλεπὸν περὶ τῶν ἀφανῶν εἰκάζειν. Οἶμαι δ’ ἂν καὶ ὑμῶν ἕκαστον, εἴ τίς τινα ἔροιτο ὅ τι μὴ τύχοι εἰδώς, τοσοῦτον ἂν εἰπεῖν, ὅτι οὐκ οἶδεν· εἰ δέ τις περαιτέρω τι κελεύοι λέγειν, ἐν πολλῇ ἂν ἔχεσθαι ὑμᾶς ἀπορίᾳ δοκῶ. Μὴ τοίνυν ἐμοὶ νείμητε τὸ ἄπορον τοῦτο, ἐν ᾧ μηδ’ ἂν αὐτοὶ εὐποροῖτε· μηδὲ ἐὰν εὖ εἰκάζω, ἐν τούτῳ μοι ἀξιοῦτε τὴν ἀπόφευξιν εἶναι, ἀλλ’ ἐξαρκείτω μοι ἐμαυτὸν ἀναίτιον ἀποδεῖξαι τοῦ πράγματος.
Antiphon, Plaidoyer sur le meurtre d’Hérode,§ 62-66
(342 mots)
(1) Désigne la victime, dont le corps n’a jamais été retrouvé.
Corrigé proposé par le jury
Ensuite, quand même Lycinos aurait, par-dessus tout, voulu le voir mort (car je vais passer à l’argument même de mes accusateurs), me serais-je donc laissé persuader, moi, de perpétrer à sa place ce crime qu’il n’aurait pas consenti à commettre lui-même ? Serait-ce donc que j’étais, moi, disposé à prendre ce risque au péril de ma vie, et lui à acheter à prix d’argent le risque que je courais ? Mais bien au contraire, ce dernier – selon toute vraisemblance, du moins – se serait plutôt laissé persuader par moi de commettre ce crime que je ne l’aurais été, moi, par lui, puisque justement, alors qu’il avait pris du retard pour honorer un paiement de sept mines, il n’avait même pas été capable de se libérer de prison, mais c’étaient ses amis qui l’en avaient libéré. Voilà d’ailleurs qui constitue aussi pour vous une excellente preuve de la nature de la relation que j’entretenais avec Lycinos, à savoir que nous n’étions pas amis au point que j’aurais pu faire tout ce qu’il eût décidé ; car que je sache, il n’est pas concevable que j’aie d’abord refusé de débourser sept mines pour le sauver quand il était déjà en prison et victime de mauvais traitements, puis assassiné un homme à sa demande en assumant un si grand danger !
Ni moi-même, ni lui non plus ne sommes donc responsables de ce meurtre ; c’est un fait désormais démontré du mieux que je le peux. Toutefois, mes accusateurs avancent comme argument principal le fait que la victime ait disparu, et peut-être souhaitez-vous, de votre côté, en entendre davantage sur ce point précis. Si l’on veut donc que j’élabore des conjectures à ce sujet, nous sommes vous et moi à égalité sur ce point, car ni vous, ni moi ne sommes responsables de ce crime ; mais si l’on veut atteindre la vérité, que l’on interroge l’un des coupables ; car c’est par cet homme-là que l’on serait le mieux informé. Car quant à moi, qui ne suis pas coupable, la réponse la plus longue que je puisse faire est : je ne suis pas coupable, et rien de plus ; tandis qu’à celui qui a perpétré un crime, il est aisé de faire une démonstration ou, même sans en avoir fait, d’élaborer des conjectures satisfaisantes. Car les délinquants, en même temps qu’ils commettent un délit, trouvent une justification à leur forfait, tandis qu’il est difficile pour celui qui n’est pas coupable d’élaborer des conjectures sur les faits qui lui sont obscurs. Or, je pense que si l’on demandait à l’un d’entre vous quelque chose que d’aventure il ignorât, chacun de vous dirait qu’il l’ignore, sans plus ; et si l’on vous poussait à en dire un peu plus, vous seriez, me semble-t-il, en grande difficulté. Par conséquent, ne m’imposez pas cette difficulté dont vous-mêmes ne sauriez non plus vous tirer ; et n’exigez pas que mon acquittement repose sur ma capacité à élaborer des conjectures satisfaisantes, mais qu’il me suffise de démontrer que je ne suis pas responsable de ce meurtre.
Version latine
MŒURS ET DEVOIRS DU RHÉTEUR
Ergo cum ad eas in studiis uires peruenerit puer ut quae prima esse praecepta rhetorum diximus mente consequi possit, tradendus eius artis magistris erit. Quorum in primis inspici mores oportebit : quod ego non idcirco potissimum in hac parte tractare sum adgressus, quia non in ceteris quoque doctoribus idem hoc examinandum quam diligentissime putem, sicut testatus sum libro priore, sed quod magis necessariam eius rei mentionem facit aetas ipsa discentium. Nam et adulti fere pueri ad hos praeceptores transferuntur et apud eos iuuenes etiam facti perseuerant ; ideoque maior adhibenda tum cura est, ut et teneriores annos ab iniuria sanctitas docentis custodiat et ferociores a licentia grauitas deterreat. Neque uero sat est summam praestare abstinentiam, nisi disciplinae seueritate conuenientium quoque ad se mores adstrinxerit.
Sumat igitur ante omnia parentis erga discipulos suos animum, ac succedere se in eorum locum a quibus sibi liberi tradantur existimet. Ipse nec habeat uitia nec ferat. Non austeritas eius tristis, non dissoluta sit comitas, ne inde odium, hinc contemptus oriatur. Plurimus ei de honesto ac bono sermo sit : nam quo saepius monuerit, hoc rarius castigabit ; minime iracundus, nec tamen eorum quae emendanda erunt dissimulator, simplex in docendo, patiens laboris, adsiduus potius quam immodicus. Interrogantibus libenter respondeat, non interrogantes percontetur ultro. In laudandis discipulorum dictionibus nec malignus nec effusus, quia res altera taedium laboris, altera securitatem parit. In emendando quae corrigenda erunt non acerbus minimeque contumeliosus ; nam id quidem multos a proposito studendi fugat, quod quidam sic obiurgant quasi oderint. Ipse aliquid, immo multa cotidie dicat quae secum auditores referant. Licet enim satis exemplorum ad imitandum ex lectione suppeditet, tamen uiua illa, ut dicitur, uox alit plenius, praecipueque praeceptoris quem discipuli, si modo recte sunt instituti, et amant et uerentur.
Quintilien,
Institution oratoire, II, 2, 1-8
(282 mots)
Corrigé proposé par le jury
Donc, quand l’enfant sera parvenu dans ses études à des capacités telles qu’il puisse suivre intellectuellement ce que nous avons appelé les premiers préceptes des rhéteurs, il devra être confié aux maîtres de cet art. Et avant tout, il conviendra d’examiner leurs mœurs : or si j’ai, pour ma part, entrepris de traiter cette question de préférence dans cette partie, ce n’est pas parce que je pense que ce même point ne doive pas être considéré avec la plus grande attention possible dans le cas de tous les autres enseignants aussi, comme je l’ai montré dans le livre précédent, mais parce la mention de cet élément est rendue plus nécessaire par l’âge même des élèves. En effet, les enfants sont presque arrivés à l’âge adulte quand ils sont amenés à ces professeurs, et ils restent auprès d’eux même une fois devenus jeunes hommes ; c’est pourquoi il faut alors veiller avec un plus grand soin à ce que, d’une part, l’intégrité de l’enseignant protège les plus jeunes et fragiles de toute offense et que, d’autre part, sa gravité détourne les plus fougueux de toute licence. Et au vrai, il ne lui suffit pas de montrer la plus grande retenue si, par la sévérité de sa discipline, il ne bride pas aussi les mœurs de ceux qui se rassemblent autour de lui.
Qu’il adopte donc avant tout l’attitude d’un père envers ses disciples, et qu’il considère qu’il prend la place de ceux qui lui confient leurs enfants. Que lui-même n’ait pas de vices ni ne les tolère. Que sa gravité ne soit pas austère ni relâchée sa bienveillance, pour éviter que la première n’engendre la haine, la seconde le mépris. Que la plupart de ses entretiens portent sur ce qui est honnête et bon ; car plus les avertissements auront été fréquents, plus les réprimandes seront rares ; qu’il ne soit nullement irritable, sans toutefois fermer les yeux sur (ou sans négliger pour autant) ce qui devra être corrigé, simple dans son enseignement, résistant au travail, assidu plutôt qu’excessif. Qu’il réponde volontiers à ceux qui lui posent des questions ; quant à ceux qui ne lui en posent pas, qu’il les interroge de sa propre initiative. En louant les exercices oratoires de ses disciples, qu’il ne soit ni mesquin ni prodigue car la première attitude engendre le dégoût du travail, la seconde, la suffisance. En corrigeant ce qu’il faudra rectifier, qu’il ne soit pas acerbe et nullement méprisant ; car ce qui en détourne vraiment beaucoup de leur projet d’étude, c’est le fait que d’aucuns les blâment comme s’ils les haïssaient. Qu’il parle lui-même chaque jour une voire plusieurs fois, afin que ses auditeurs emportent ses mots avec eux. De fait, bien que la lecture offre un nombre suffisamment important d’exemples à imiter, c’est toutefois la parole vivante, comme on dit, qui offre une nourriture plus riche, et tout particulièrement celle du professeur que ses disciples, si du moins ils sont bien formés, et aiment et révèrent.
Session 2022
Dissertation française
À la lumière de votre lecture personnelle de l’œuvre, vous analyserez et discuterez cette citation à propos de Cyrano de Bergerac :
« L’artifice ou le brio ‒ quelque nom que l’on donne à ce qui nous séduit ou repousse d’abord chez Rostand ‒ ne peut faire oublier à quel point est fragile le monde représenté. Fragile d’abord parce qu’il contient sa propre négation. Dans la mesure où il entre en conflit avec le réel, le mal, la guerre, le vieillissement, la mort, c’est le fonctionnement même de la fiction qui fragilise cet univers où se confondent le beau, le bien et le vrai » (D. Degott, O. Goetz et H. Laplace-Claverie, « Avant-propos » à Edmond Rostand. Poète de théâtre. Actes du centenaire et du cent cinquantenaire d’Edmond Rostand (1868-1918, 2018), Presses Universitaires de Franche-Comté, 2020, p. 12).
Thème latin
NOUS DEVONS LA PLUPART DE NOS PLAISIRS À L’ILLUSION (1)
L’amour de la gloire, qui est la source de tant de plaisir et de tant d’efforts en tout genre qui contribuent au bonheur, à l’instruction et à la perfection de la société, est entièrement fondé sur l’illusion ; rien n’est si aisé que de faire disparaître le fantôme après lequel courent toutes les âmes élevées ; mais qu’il y auroit à perdre pour elles et pour les autres ! Je sais qu’il est quelque réalité dans l’amour de la gloire dont on peut jouir de son vivant ; mais il n’y a guères de héros, en quelque genre que ce soit, qui voulût se détacher entièrement des applaudissemens de la postérité, dont on attend même plus de justice que de ses contemporains. On ne savoure* pas toujours le désir vague de faire parler de soi quand on ne sera plus ; mais il est toujours au fond de notre cœur. La philosophie voudrait en faire sentir la vanité ; mais le sentiment prend le dessus et ce plaisir n’est point une illusion, car il nous prouve le bien réel de jouir de notre réputation future ; si le présent était notre unique bien, nos plaisirs seroient plus bornés qu’ils ne le sont. Nous sommes heureux dans le moment présent, non seulement par nos jouissances actuelles, mais par nos espérances, par nos réminiscences. Le présent s’enrichit du passé et de l’avenir. Qui travaillerait pour ses enfants, pour la grandeur de sa maison, si on ne jouissait pas de l’avenir ? Nous avons beau faire, l’amour-propre est toujours le mobile plus ou moins caché de nos actions ; c’est le vent qui enfle les voiles et sans lequel le vaisseau n’irait pas.
Émilie du Châtelet (1707-1749)
(299 mots)
(1) Traduire le titre.
*Le jury a choisi cette leçon ; d’autres éditions, anciennes ou modernes, donne la leçon s’avoue.
Corrigé proposé par le jury
CVR PLERASQVE VOLVPTATES AB ERRORE MENTIS ACCIPIAMVS
Studium gloriae, quod tantam delectationem et tam multos conatus omnis generis adfert qui adiuuant ad beate uiuendum, ad homines docendos societatemque perficiendam, totum in mentis errore consistit ; itaque nihil est tam facile quam eam uanam speciem tollere quam omnes excelsi animi expetunt ; at quantum eis ceterisque amittendum sit ! Studium equidem gloriae scio quodam modo uerum esse quo uiui frui possimus sed paucissimi uiri fortissimi sunt cuiusuis generis qui toti a plausibus posterorum desciscere uellent, quos etiam iustiores fore speramus quam homines huius memoriae. Vt enim cupiditate quadam nominis magni habendi cum mortui erimus non semper fruimur, ita semper in medullis haeret. Philosophi uero quam ea uana sit docere student ; atqui adfectus uincit ; uoluptas igitur ea commentum non est, quae ostendit fama nostra futura frui bonum uerum esse ; si enim res praesentes solum bonum nobis essent, uoluptates multo angustiores caperemus quam capimus. Nam in hoc tempore beati sumus, non solum eis rebus quibus nunc fruimur, sed etiam eis quas speramus et eis quas recordamur. Quod tempus rebus praeteritis futurisque augetur. Quis tandem pro salute liberorum suorum uel in genere suo illustrando laboraret nisi rebus futuris frueretur ? Quoquo enim modo agimus, gloria capidenda ad agendum magis minusue ignari semper incitamur ; quae est uentus qui uela inflat nec sine eo nauis ferri potest.
Thème grec
LA LÉGENDE DU SPARTIATE PHALANTE (1)
Celui-ci, en raison de la famine régnant à Sparte, avait décidé de partir avec sa famille et de nombreux compagnons pour fonder une colonie en Italie du Sud. L’oracle, consulté, lui répond : « Pars sans crainte. Tu fonderas une riche et prospère colonie. Mais tu ne pourras prendre la ville de Tarente que le jour où tu recevras la pluie d’un ciel aethra (2), un ciel clair et serein. » Phalanthe trouva bizarres ces derniers mots mais comme la réponse était favorable, il partit sans plus y penser. Ses compagnons et lui débarquèrent en Italie, s’établirent sans difficultés sur la côte mais ne purent s’emparer de Tarente. Tous leurs efforts échouèrent et un beau jour, désespéré, Phalanthe se dit que l’oracle s’était moqué de lui. Il alla s’asseoir sur le rivage, en proie à ces sombres pensées, ne sachant plus que faire. Pendant ce temps, sa femme, pour le consoler, se mit à lui chercher les poux sur la tête. Ce faisant, en voyant la douleur de son époux, elle se mit à pleurer elle-même à chaudes larmes. Phalanthe, sentant couler de l’eau lui couler sur la tête, se redressa et comprit aussitôt le sens de l’oracle. Car sa femme avait comme prénom Aethra, c’est-à-dire Ciel serein. Ainsi, il avait bien reçu la « pluie » venue d’un ciel serein ! Et de fait, dès le lendemain, ses compagnons et lui purent prendre la ville.
Jean Lacarrière,
L’Été grec, XI, « Les oliviers de Delphes »
(249 mots)
(1) Traduire le titre.
(2) Traduire par ce mot grec.
Corrigé proposé par le jury
Τίνα μῦθον λέγουσι περὶ Φαλάνθου τοῦ Σπαρτιάτου
Ἐκεῖνος διὰ τὸν παρὰ τοῖς Λακεδαιμονίοις ὑπάρχοντα λιμὸν ἐβεβούλευτο μετὰ τῶν συγγενῶν καὶ πολλῶν ἀκολούθων ἀπελθεῖν ἵνα ἀποικίαν κτίσειεν ἐν τῇ μεσημβρινῇ Ἰταλίᾳ. (Autre traduction : Τούτῳ μὲν δὴ ἅτε τῶν Σπαρτιατῶν λιμῷ πιεζομένων ἔδοξεν ἄγοντι τὸν οἶκον καὶ πολλοὺς ἑταίρους ἀπιέναι ἀποικιοῦντι τὴν Ἰταλίαν τὴν πρὸς μεσημβρίαν.) Μαντευσαμένῳ δ’ αὐτῷ ἐχρήσθη τάδε· Ἀδεῶς ἐλθέ. Πλουσίαν γὰρ καὶ θάλλουσαν ἀποικίαν ποιήσει. Οὐ μέντοι πρότερον τὴν τῶν Ταραντίνων πόλιν ἐξέσται σοι ἑλεῖν πρὶν ἂν λάβῃς τὸ ἀπ’ αἴθρας ὕδωρ, τοῦτ’ ἔστι φαιδροῦ καὶ εὐδίου οὐρανοῦ. Φαλάνθῳ δὲ ἄτοπα μὲν εἶναι ἔδοξεν ταῦτα τὰ ἐπὶ τελευτῆς ῥηθέντα, τοῦ δὲ χρησμοῦ ὄντος εὐφήμου, ᾤχετο οὐκέτι προσέχων τούτῳ. Τότε δ’ οἱ περὶ αὐτὸν ἀποβάντες εἰς Ἰταλίαν ῥᾳδίως μὲν εἰς τὴν παραλίαν κατῳκίσαντο, τὸν δὲ Τάραντα οὐκ ἐξεγένετο αὐτοῖς καταλαβεῖν. Πολλὰ γὰρ πονήσαντες διήμαρτον καὶ ὁ Φάλανθός ποτε ἀπονενοημένος ἐνεθυμήθη ὡς σφαλείη ὑπὸ τοῦ χρηστηρίου. Ἐλθὼν δ’ ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν καθῖσεν, ἀδημονῶν τὴν ψυχὴν διὰ ταῦτα τὰ λυπηρὰ φρονήματα καὶ οὐκέτι ἔχων ὅ τι ποιοίη. Ἐν δὲ τούτῳ ἡ γυνὴ αὐτοῦ παραψυχῆς ἕνεκα φθεῖρας ἐζήτησεν ἐπὶ τῆς τούτου κεφαλῆς. Ἅμα δὲ ποιοῦσα τοῦτο, ὡς ἐλυπεῖτο ὁ ἀνὴρ ἰδοῦσα, ἔπεσεν αὐτὴ εἰς πολλὰ δάκρυα. Φάλανθος δ’ αἰσθόμενος ὕδωρ ῥέον ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀνέστη καὶ εὐθὺς ἔμαθε τί αὐτῷ βούλοιτο ὁ χρησμός. Τῇ γὰρ γυναικὶ Αἴθρα ὄνομα ἦν, ὅπερ εὔδιον οὐρανὸν δύναται. Οὕτω δὲ δὴ τοῦτ’ ἐκεῖνο ἦν τὸ ἀπ’ αἴθρας ὕδωρ ὅπερ ἔλαβεν. Καὶ γὰρ ἅμα τῇ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ οὗτος καὶ οἱ ἑταῖροι εὐτυχοῦντες εἷλον τὴν πόλιν.
Version grecque
QUAND UN BOUFFON S’INVITE À DÎNER…
Callias a invité le jeune Autolycos dont il est épris, Socrate, Critobule et quelques autres personnes. Les convives, fortement impressionnés par la beauté du jeune homme, dînent en silence lorsqu’arrive un parasite qui espère bien dérider les convives…
Φίλιππος δ’ ὁ γελωτοποιὸς, κρούσας τὴν θύραν, εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη καὶ διότι κατάγεσθαι βούλοιτο, συνεσκευασμένος τε παρεῖναι ἔφη πάντα τὰ ἐπιτήδεια ὥστε δειπνεῖν τἀλλότρια, καὶ τὸν παῖδα δὲ ἔφη πάνυ πιέζεσθαι διά τε τὸ φέρειν μηδὲν καὶ διὰ τὸ ἀνάριστον εἶναι. Ὁ οὖν Καλλίας ἀκούσας ταῦτα εἶπεν· « Ἀλλὰ μέντοι, ὦ ἄνδρες, αἰσχρὸν στέγης γε φθονῆσαι· εἰσίτω οὖν ». Καὶ ἅμα ἀπέβλεψεν εἰς τὸν Αὐτόλυκον, δῆλον ὅτι ἐπισκοπῶν τί ἐκείνῳ δόξειε τὸ σκῶμμα εἶναι. Ὁ δὲ, στὰς ἐπὶ τῷ ἀνδρῶνι ἔνθα τὸ δεῖπνον ἦν, εἶπεν· « Ὅτι μὲν γελωτοποιός εἰμι ἴστε πάντες· ἥκω δὲ προθύμως νομίσας γελοιότερον εἶναι τὸ ἄκλητον ἢ τὸ κεκλημένον ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ δεῖπνον. — Κατακλίνου τοίνυν », ἔφη ὁ Καλλίας. « Καὶ γὰρ οἱ παρόντες σπουδῆς μέν, ὡς ὁρᾷς, μεστοί, γέλωτος δὲ ἴσως ἐνδεέστεροι ». Δειπνούντων δὲ αὐτῶν, ὁ Φίλιππος γελοῖόν τι εὐθὺς ἐπεχείρει λέγειν, ἵνα δὴ ἐπιτελοίη ὧνπερ ἕνεκα ἐκαλεῖτο ἑκάστοτε ἐπὶ τὰ δεῖπνα. Ὡς δ ̓ οὐκ ἐκίνησε γέλωτα, τότε μὲν ἀχθεσθεὶς φανερὸς ἐγένετο. Αὖθις δ’ ὀλίγον ὕστερον ἄλλο τι γελοῖον ἐβούλετο λέγειν. Ὡς δὲ οὐδὲ τότε ἐγέλασαν ἐπ ̓ αὐτῷ, ἐν τῷ μεταξὺ παυσάμενος τοῦ δείπνου, συγκαλυψάμενος κατέκειτο. Καὶ ὁ Καλλίας, « Τί τοῦτ’ », ἔφη, « ὦ Φίλιππε ; Ἀλλ ̓ ἡ ὀδύνη σε εἴληφε ; » Καὶ ὃς ἀναστενάξας εἶπε· « Ναὶ μὰ Δί’ », ἔφη, « ὦ Καλλία, μεγάλη γε· ἐπεὶ γὰρ γέλως ἐξ ἀνθρώπων ἀπόλωλεν, ἔρρει τὰ ἐμὰ πράγματα. Πρόσθεν μὲν γὰρ τούτου ἕνεκα ἐκαλούμην ἐπὶ τὰ δεῖπνα, ἵνα εὐφραίνοιντο οἱ συνόντες δι ̓ ἐμὲ γελῶντες· νῦν δὲ τίνος ἕνεκα καὶ καλεῖ μέ τις ; Οὔτε γὰρ ἔγωγε σπουδάσαι ἂν δυναίμην μᾶλλον ἤπερ ἀθάνατος γενέσθαι, οὔτε μὴν ὡς ἀντικληθησόμενος καλεῖ μέ τις, ἐπεὶ πάντες ἴσασιν ὅτι ἀρχὴν οὐδὲ νομίζεται εἰς τὴν ἐμὴν οἰκίαν δεῖπνον προσφέρεσθαι ». Καὶ ἅμα λέγων ταῦτα, ἀπεμύττετό τε καὶ τῇ φωνῇ σαφῶς κλαίειν ἐφαίνετο. Πάντες μὲν οὖν παρεμυθοῦντό τε αὐτὸν ὡς αὖθις γελασόμενοι καὶ δειπνεῖν ἐκέλευον, Κριτόβουλος δὲ καὶ ἐξεκάγχασεν ἐπὶ τῷ οἰκτισμῷ αὐτοῦ· ὁ δ’ ὡς ᾔσθετο τοῦ γέλωτος, ἀνεκαλύψατό τε καὶ τῇ ψυχῇ παρακελευσάμενος θαρρεῖν, ὅτι ἔσονται συμβολαί, πάλιν ἐδείπνει.
Xénophon,
Le Banquet, I, 11-16
(343 mots)
Corrigé proposé par le jury
Philippe, le bouffon, frappa à la porte et demanda au portier d’annoncer qui il était et pourquoi il voulait descendre ici ; il était là, affirmait-il, équipé de tout le nécessaire pour dîner aux frais d’autrui, et son esclave, disait-il, était tout fourbu de porter rien du tout et d’avoir le ventre vide. À ces mots, donc, Callias dit : « Eh bien, oui, vraiment, mes amis, il serait honteux de ne pas lui accorder au moins le gîte ; qu’il entre donc ! » Et il regarda en même temps Autolycos, observant de toute évidence ce que celui-ci avait pensé de sa plaisanterie. Philippe, se tenant au seuil de l’appartement des hommes où avait lieu le dîner, déclara : « Que je suis un bouffon, vous le savez tous, et je me suis empressé de venir dans la pensée qu’il était plus drôle de venir dîner sans être invité qu’en l’ayant été. — Eh bien, allonge-toi, dit Callias. Car les convives, comme tu le vois, sont pleins de sérieux, mais le rire leur fait peut-être un peu trop défaut. » Tandis qu’ils dînaient, aussitôt Philippe tenta à plusieurs reprises de dire une plaisanterie, pour s’acquitter manifestement de ce pour quoi il était à chaque fois invité à dîner. Mais comme de nouveau il ne provoqua aucun rire, il en fut alors visiblement navré. Derechef, il voulut peu de temps après lancer une autre plaisanterie. Comme alors elle ne les fit pas rire non plus, il s’arrêta au milieu du dîner et, s’étant couvert la tête, s’étendit tout du long. Alors Callias dit : « Qu’est-ce que cela, Philippe ? Eh quoi ? Est-ce la douleur qui t’affecte ? » Ce dernier poussa un gémissement et dit : « Oui, par Zeus, Callias, et une grande ; car, puisque le rire a disparu de chez les hommes, c’est la ruine de mes affaires. » Jusqu’à présent, en effet, j’étais invité à dîner pour mettre les convives de bonne humeur en les faisant rire ; mais maintenant pour quelle raison m’invitera-t-on encore ? Car pour ma part je serais moins capable d’être sérieux que de devenir immortel, et on ne m’invitera certainement pas dans l’espoir d’être invité en retour, puisque tout le monde sait qu’il n’est absolument pas d’usage qu’un repas soit servi dans ma maison. » Et tout en parlant ainsi il se mouchait et sa voix donnait clairement l’impression qu’il pleurait. Tous alors tâchaient de le consoler en lui promettant qu’ils riraient à l’avenir et l’exhortaient à manger ; Critobule, lui, alla jusqu’à éclater de rire en entendant sa lamentation. Et lui, aussitôt qu’il perçut ce rire, se découvrit, et ayant exhorté son âme à reprendre courage, puisqu’il aurait encore à attaquer des plats, il se remit à manger. [François Ollier, qui a traduit le Banquet pour la C.U.F., propose quant à lui : … ayant exhorté son âme à reprendre courage, puisqu’il aurait encore à combattre avec les dents, il se remit à manger.]
Version latine
Le dieu Janus se présente au poète, intrigué par sa figure.
Me Chaos antiqui (nam sum res prisca) uocabant ;
aspice quam longi temporis acta canam.
Lucidus hic aer et quae tria corpora restant,
ignis, aquae, tellus, unus aceruus erat.
Vt semel haec rerum secessit lite suarum
inque nouas abiit massa soluta domos,
flamma petit altum, propior locus aera cepit,
sederunt medio terra fretumque solo.
Tunc ego, qui fueram globus et sine imagine moles,
in faciem redii dignaque membra deo.
Nunc quoque, confusae quondam nota parua figurae,
ante quod est in me postque uidetur idem.
Accipe quaesitae quae causa sit altera formae,
hanc simul ut noris officiumque meum.
Quicquid ubique uides, caelum, mare, nubila, terras,
omnia sunt nostra clausa patentque manu.
Me penes est unum uasti custodia mundi
et ius uertendi cardinis omne meum est.
Cum libuit Pacem placidis emittere tectis,
libera perpetuas ambulat illa uias ;
sanguine letifero totus miscebitur orbis,
ni teneant rigidae condita bella serae.
Praesideo foribus caeli cum mitibus Horis :
it, redit officio Iuppiter ipse meo.
Inde uocor Ianus ; cui cum Cereale sacerdos
imponit libum farraque mixta sale,
nomina ridebis : modo namque Patulcius idem
et modo sacrifico Clusius ore uocor.
Scilicet alterno uoluit rudis illa uetustas
nomine diuersas significare uices.
Vis mea narrata est ; causam nunc disce figurae.
Iam tamen hanc aliqua tu quoque parte uides.
Omnis habet geminas, hinc atque hinc, ianua frontis,
e quibus haec populum spectat, at illa Larem.
Vtque sedens primi uester prope limina tecti
ianitor egressus introitusque uidet,
sic ego perspicio caelestis ianitor aulae
Eoas partes Hesperiasque simul.
Ovide,
Fastes, I, v. 103-140
(38 vers – 244 mots)
Corrigé proposé par le jury
Les anciens (de fait, je suis un être antique) m’appelaient Chaos ; vois d’un temps ô combien lointain sont les événements que je chante. À cette époque l’air lumineux et les trois éléments qui restent, le feu, l’eau et la terre, formaient un seul agglomérat. Une fois que cette masse, suite à un conflit de ses parties, se fut dissociée et que, désagrégée, elle s’en fut allée vers d’autres séjours, la flamme gagna les hauteurs, la zone toute proche accueillit l’air, les continents et les flots s’établirent à la place centrale. Alors moi qui avais été une boule et masse sans forme, je pris une figure et un corps (ou des membres) dignes d’un dieu. Maintenant encore, petit indice de ma configuration jadis confuse, ce qui est en moi l’avant et l’arrière apparaît le même. Apprends l’autre raison de cette forme sur laquelle tu m’as interrogée, afin de la connaître en même temps que ma fonction. Tout ce que tu vois partout, ciel, mer, nuages, terres, tout est fermé et ouvert par ma main. C’est à moi seul que revient la garde du vaste monde, et le droit de faire tourner son axe est entièrement mien. Quand j’ai jugé bon d’envoyer la Paix hors de sa paisible demeure, celle-ci se promène librement sur des routes sans obstacles ; mais l’univers entier serait bouleversé par de sanglantes tueries, si de solides verrous ne tenaient les guerres enfermées. Je garde les portes du ciel avec les douces Heures : même Jupiter s’en va et s’en revient grâce à mon office. C’est pourquoi je suis appelé Janus ; mais quand le prêtre m’offre un gâteau sacré et l’épeautre mêlé de sel, tu souriras de mes noms : de fait, bien que je sois le même, je suis appelé tantôt Patulcius, tantôt Clusius par la bouche du sacrificateur. À l’évidence, la fruste et lointaine antiquité voulut, par cette alternance de noms, signaler mes rôles opposés. Mon pouvoir t’a été exposé ; apprends maintenant la raison de ma configuration. Cependant, toi aussi tu la vois déjà en partie. Toute porte a deux faces, de part et d’autre, dont l’une regarde la rue et l’autre, le (dieu) Lare. De même que votre portier, assis près du seuil de votre entrée, voit les sorties et les entrées, ainsi moi, portier de la cour céleste, j’aperçois en même temps les régions de l’Aurore et de l’Hespérie.
(309 mots)
Session 2023
Dissertation française
À la lumière de votre lecture personnelle de l’œuvre, vous analyserez et discuterez cette citation à propos de La Religieuse :
« Diderot a composé un roman de la féminité, il se laisse fasciner par un monde qui exclut les hommes, sans pouvoir admettre que le plaisir lesbien se suffise à lui-même. Il suggère les atermoiements du désir, les incertitudes et les flous de la conscience. Une analogie s’établit entre séduction des corps, séduction des récits et des images, séduction de la religion, et la force du roman est de lier la présence la plus pathétique du corps et l’analyse la plus critique de l’illusion. »
Michel Delon, « Notice » sur La Religieuse in Diderot, Contes et romans,
NRF Gallimard, « La Pléiade », 2004, p. 988
Thème latin
Beaucoup de législations considèrent comme plus grave le crime prémédité que le crime de pure violence. Mais qu’est-ce donc que l’exécution capitale, sinon le plus prémédité des meurtres, auquel aucun forfait de criminel, si calculé soit-il, ne peut être comparé ? Pour qu’il y ait équivalence, il faudrait que la peine de mort châtiât un criminel qui aurait averti sa victime de l’époque où il lui donnerait une mort horrible et qui, à partir de cet instant, l’aurait séquestrée à merci pendant des mois. Un tel monstre ne se rencontre pas dans le privé.
Là encore, lorsque nos juristes officiels parlent de faire mourir sans faire souffrir, ils ne savent pas ce dont ils parlent et, surtout, ils manquent d’imagination. La peur dévastatrice, dégradante, qu’on impose pendant des mois ou des années au condamné, est une peine plus terrible que la mort, et qui n’a pas été imposée à la victime. Même dans l’épouvante de laviolence mortelle qui lui est faite, celle-ci, la plupart du temps, est précipitée dans la mort sans savoir ce qui lui arrive. Le temps de l’horreur lui est compté avec la vie et l’espoir d’échapper à la folie qui s’abat sur elle ne lui manque probablement jamais. L’horreur est, au contraire, détaillée au condamné à mort. La torture par l’espérance alterne avec les affres du désespoir animal. L’avocat et l’aumônier, par simple humanité, les gardiens, pour que le condamné reste tranquille, sont unanimes à l’assurer qu’il sera gracié. Il y croit de tout son être et puis il n’y croit plus. Il l’espère le jour, il en désespère la nuit. À mesure que les semaines passent, l’espoir et le désespoir grandissent et deviennent également insupportables.
Albert Camus,
Réflexions sur la guillotine
Corrigé proposé par le jury
In multorum populorum legibus scelus consulto cogitatum quam ui sola maius habetur. Quaenam autem est poena capitis nisi omnium maxime cogitata caedes, cui nullum scelus ullius scelesti uiri, quamuis meditatum, comparari potest ? Quae ut aequalia essent, capite damnandus esset (ou bien : poena enim sceleri aequalis esset, si capite damnaretur) scelestus uir qui admonuisset hominem quem occidere uellet quando eum morte horribili adfecturum esset et, ex eo tempore, eum menses multos in potestatem suam redactum conclusisset. Tam autem nefarius homo in uiris priuatis reperiri non potest. Cum etiam iuris consulti nostri publice dicunt necem ita inferendam esse ut dolor nullus accipiatur (ou bien : … inferendam esse alicui ut dolorem nullum accipiat), non solum de quo loquantur nesciunt sed etiam id parum cogitant. Nam perniciosus ignominiosusque metus menses uel annos multos iniectus ei qui damnatus est (ou bien : … metus qui menses uel annos damnato iniectus est) et terribilior est poena morte nec iniectus erat ei qui occisus est. Cum enim ei nex illata in terrorem coniciat, plerumque perit nesciens quid sibi accidat (ou bien : praeceps ad mortem mittitur nec scit quid sibi accidat). Cui spatium terroris tam longum quam uita reliqua est nec spes calamitatis uitandae quae ei incidit, ut mihi uidetur, umquam ei deest (ou bien : nec spem… umquam ei deesse ueri simile uidetur). At ei qui capite damnatus est terror enumeratur (ou bien : terrores singuli… imponuntur). Nam tormenta spei et desperationis dolor quasi bestiae alterna sunt (ou bien : ei qui… enumeratur, modo spe excruciato, uicissim quasi bestiae angore confecto). Cum uero patronus sacerdosque, propter humanitatem solam, tum custodes, ut damnatus quiescat, omnes (ei) adfirmant eum ueniam impetraturum esse (ou bien : uno ore pollicentur eum…). Cui modo maximam fidem, modo non iam ullam habet. Nam id luce sperat, nocte desperat. Itaque quo plures dies transeunt (ou : intercedunt), eo magis spes desperatioque ita crescunt ut neutra iam tolerari possit (ou bien : ut fiant aeque intolerabiles).
Thème grec
CONTRE CEUX QUI ONT LE GOÛT DIFFICILE
Quand j’aurais, en naissant, reçu de Calliope
Les dons qu’à ses amants cette Muse a promis,
Je les consacrerais aux mensonges d’Ésope :
Le mensonge et les vers de tout temps sont amis.
Mais je ne me crois pas si chéri du Parnasse
Que de savoir orner toutes ces fictions.
On peut donner du lustre à leurs inventions ;
On le peut, je l’essaie ; un plus savant le fasse.
Cependant jusqu’ici d’un langage nouveau
J’ai fait parler le Loup et répondre l’Agneau.
J’ai passé plus avant : les arbres et les plantes
Sont devenus chez moi créatures parlantes.
Qui ne prendrait ceci pour un enchantement ?
« Vraiment, me diront nos critiques,
Vous parlez magnifiquement
De cinq ou six contes d’enfant ».
Censeurs, en voulez-vous qui soient plus authentiques
Et d’un style plus haut ? En voici. Les Troyens,
Après dix ans de guerre autour de leurs murailles,
Avaient lassé les Grecs qui, par mille moyens,
Par mille assauts, par cent batailles,
N’avaient pu mettre à bout cette fière cité,
Quand un cheval de bois par Minerve inventé,
D’un rare et nouvel artifice,
Dans ses énormes flancs reçut le sage Ulysse,
Le vaillant Diomède, Ajax l’impétueux,
Que ce colosse monstrueux
Avec leurs escadrons devait porter dans Troie,
Livrant à leur fureur ses dieux mêmes en proie.
Stratagème inouï, qui des fabricateurs
Paya la constance et la peine.
Jean de La Fontaine,
Fables, II, 1, v. 1-31
Corrigé proposé par le jury
Κατὰ τῶν δυσαρέστων
Εἰ γενόμενος παρὰ Καλλιόπης τοιαῦτα ἐδεξάμην οἷα αὕτη ἡ Μοῦσα τοῖς ἐρῶσιν ὑπέσχετο δώσειν, τούτοις ἐχρώμην ἂν κατὰ τὰ τῷ Αἰσώπῳ ἐψευσμένα γράφων· ἀεὶ γὰρ οἱ ποιηταὶ ψευδόμενοι χαίρουσι. Νῦν δὲ οὐ δοκῶ ὑπὸ τῶν Παρνασὸν ἐχουσῶν θεῶν οὕτω φιληθῆναι ὥστε πάντας τούτους τοὺς μύθους κοσμῆσαι δεινὸς εἶναι. Ἔξεστι μὲν γὰρ τὰ τούτοις πεπλασμένα καλλίω ποιήσασθαι, ἔξεστί γε καὶ τούτῳ ἐπιχειρῶ· σοφώτερος δέ τις ποιησάσθω. Ὅμως δὲ μέχρι τοῦδε καινῷ λόγῳ χρώμενος ἐποίησα τόν τε λύκον λέγοντα καὶ τὸ ἀρνίον ἀποκρινόμενον. Οὕτω δὲ πόρρω προῆλθον ὥστε δι’ ἐμὲ τὰ δένδρα καὶ τὰ φυτὰ ἐγένετο ζῷα λέγειν δυνατά ὄντα. Τίς γὰρ οὐκ ἂν ταύτην νομίσειε ἐπῳδὴν εἶναι ; Οἱ δ’ἡμᾶς μεμφόμενοι πρὸς ἐμὲ ἐροῦσι· Σύ γε μεγαλοπρεπῶς λέγεις περὶ οὐδενὸς ἢ ὀλίγων μύθων παισὶ προσηκόντων. Ἆρ’ ὑμεῖς ἐμοὶ ἐπιτιμῶντες βούλεσθε ἀναγνῶναί τινας ἀληθεστέρους ὄντας καὶ τὴν λέξιν σεμνοτέρους ; Ἀκούετε δή. Οἱ μὲν Τρῶες πολέμου ὄντος περὶ τῶν τειχῶν δέκατον ἔτος ἤδη τοὺς Ἕλληνας εἰς ἀπορίαν κατέστησαν οἳ καίπερ μυρίοις μὲν μηχανήμασι χρησάμενοι, μυρίας δὲ μάχας μαχεσάμενοι, παμπόλλαις δὲ προσβολαῖς ποιησάμενοι τὴν μεγαλόφρονα ταύτην πόλιν οὐ καθελεῖν ἐδυνήθησαν, Αθηνᾶς δ’ ἵππον τινὰ ξύλινον εὑρούσης καὶ μηχανησαμένης καινόν τι καὶ θαυμάσιον, ὁ σοφὸς Ὀδυσσεὺς καὶ ὁ ἀνδρεῖος Διομήδης καὶ ὁ σφοδρὸς Αἴας ἐντὸς τοῦ μεγίστου καὶ κοίλου ἵππου ἐνέϐησαν, οὕσπερ τὸ ὑπερμέγεθες τοῦτο τέρας ἔμελλε εἴσω Τροίας οἴσειν, τῶν θεῶν αὐτῶν τούτοις προδοθέντων μαινομένοις ὡς ἁρπασθησομένων. Τὸ δὲ στρατήγημα νεώτατόν γ’ἐγένετο, δι’ὃ οἱ ἐργασάμενοι εὖ ἔπραξαν καρτερήσαντες καὶ πονήσαντες.
Version grecque
L’ORIGINE DES DIEUX SELON CRITIAS
Ἦν χρόνος ὅτ ̓ ἦν ἄτακτος ἀνθρώπων βίος
καὶ θηριώδης ἰσχύος θ ̓ ὑπηρέτης,
ὅτ ̓ οὐδὲν ἆθλον οὔτε τοῖς ἐσθλοῖσιν ἦν
οὔτ ̓ αὖ κόλασμα τοῖς κακοῖς ἐγίγνετο.
κἄπειτά μοι δοκοῦσιν ἄνθρωποι νόμους
θέσθαι κολαστάς, ἵνα δίκη τύραννος ᾖ
γένους βροτείου τήν θ ̓ ὕβριν δούλην ἔχῃ·
ἐζημιοῦτο δ ̓ εἴ τις ἐξαμαρτάνοι.
ἔπειτ ̓ ἐπειδὴ τἀμφανῆ μὲν οἱ νόμοι
ἀπεῖργον αὐτοὺς ἔργα μὴ πράσσειν βίᾳ,
λάθρᾳ δ ̓ ἔπρασσον, τηνικαῦτά μοι δοκεῖ
πρῶτον πυκνός τις καὶ σοφὸς γνώμην ἀνὴρ
θεῶν δέος θνητοῖσιν ἐξευρεῖν ὅπως
εἴη τι δεῖμα τοῖς κακοῖσι κἂν λάθρᾳ
πράσσωσιν ἢ λέγωσιν ἢ φρονῶσί τι.
ἐντεῦθεν οὖν τὸ θεῖον εἰσηγήσατο,
ὡς ἔστι δαίμων ἀφθίτῳ θάλλων βίῳ,
νόῳ τ ̓ ἀκούων καὶ βλέπων, φρονῶν τε καὶ
προσέχων τε ταῦτα, καὶ φύσιν θείαν φορῶν,
ὃς πᾶν τὸ λεχθὲν ἐν βροτοῖς ἀκούσεται,
τὸ δρώμενον δὲ πᾶν ἰδεῖν δυνήσεται.
ἐὰν δὲ σὺν σιγῇ τι βουλεύῃς κακόν,
τοῦτ ̓ οὐχὶ λήσει τοὺς θεούς· τὸ γὰρ φρονοῦν
αὐτοῖς ἔνεστι. τούσδε τοὺς λόγους λέγων
διδαγμάτων κέρδιστον εἰσηγήσατο,
ψευδεῖ καλύψας τὴν ἀλήθειαν λόγῳ.
ναίειν δ ̓ ἔφασκε τοὺς θεοὺς ἐνταῦθ ̓ ἵνα
μάλιστ ̓ ἂν ἐξέπληξεν ἀνθρώπους λέγων,
ὅθεν περ ἔγνω τοὺς φόβους ὄντας βροτοῖς
καὶ τὰς ὀνήσεις τῷ ταλαιπώρῳ βίῳ,
ἐκ τῆς ὕπερθε περιφορᾶς, ἵν ̓ ἀστραπὰς
κατεῖδεν οὔσας, δεινὰ δὲ κτυπήματα
βροντῆς, τό τ ̓ ἀστερωπὸν οὐρανοῦ δέμας,
χρόνου καλὸν ποίκιλμα, τέκτονος σοφοῦ,
ὅθεν τε λαμπρὸς ἀστέρος στείχει μύδρος,
ὅ θ ̓ ὑγρὸς εἰς γῆν ὄμβρος ἐκπορεύεται.
τοίους πέριξ ἔστησεν ἀνθρώποις φόβου
στοίχους, καλῶς τε τῷ λόγῳ κατῴκισεν
τὸν δαίμον ̓ οἰκεῖν ἐν πρέποντι χωρίῳ,
τὴν ἀνομίαν τε τοῖς νόμοις κατέσβεσεν.
Critias,
cité dans Sextus Empiricus
Corrigé proposé par le jury
[Notez que, le jour du concours, on évitera de traduire des vers « en stiques », comme ci-dessous, et on se gardera de proposer des traductions rimées en alexandrins !]
Il fut un temps où les hommes menaient une vie sans ordre,
bestiale et asservie à la force,
où nul prix n’existait pour les bons,
nulle punition non plus pour les méchants.
Puis des hommes, ce me semble, établirent
des lois punitives afin que la justice régnât en souveraine
sur la race mortelle et réduisît la démesure en servitude ;
était châtié quiconque commettait une faute.
Comme ensuite les lois
les empêchaient de commettre des actes de violence ouverte,
mais qu’ils les commettaient en secret,
alors, ce me semble, un homme au jugement astucieux et sage
inventa pour les mortels la crainte des dieux de manière
à effrayer les méchants même dans
leurs actions, paroles ou pensées secrètes.
Voilà donc ce qui lui fit enseigner que « la divinité
est un démon jouissant d’une vie impérissable
qui entend et voit par l’intellect, applique sa pensée et
son attention à tout ce qui se passe, se trouve doué d’une nature divine,
et qui écoutera tout ce qui se dit chez les mortels,
et pourra voir tout ce qui s’y fait.
Si tu ourdis en silence quelque méfait,
cela n’échappera pas aux dieux, car la faculté de penser
est en eux. » Parlant de cette manière,
il introduisit l’enseignement le plus avantageux,
dissimulant la vérité sous un discours mensonger.
Les dieux, affirmait-il, habitaient là où
il pouvait le mieux frapper les hommes par son discours,
là même d’où il savait que les peurs viennent aux mortels,
et ce qui soulage leur pénible vie :
de la voûte d’en haut, où il voyait
les éclairs, les terribles roulements
du tonnerre, le corps étoilé du ciel
– belle broderie du Temps, ce sage artisan –,
d’où s’avance la brillante masse incandescente de l’astre
et d’où la pluie s’achemine vers la terre pour l’abreuver.
D’un tel carcan de peur il circonvint les hommes,
et, par le discours, installa avec raison
le démon à demeure dans un séjour approprié,
et il éteignit par les lois l’absence de lois.
Version latine
DÉFENDRE LE MARIAGE N’EST PAS CHOSE AISÉE
Multis et eruditis uiris audientibus legebatur oratio Metelli Numidici, grauis ac diserti uiri, quam in censura dixit ad populum de ducendis uxoribus, cum eum ad matrimonia capessenda hortaretur. In ea oratione ita scriptum fuit : « Si sine uxore esse possemus, Quirites, omnes ea molestia careremus ; sed quoniam ita natura tradidit, ut nec cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo uiui possit, saluti perpetuae potius quam breui uoluptati consulendum est ».
Videbatur quibusdam, Q. Metellum censorem, cui consilium esset ad uxores ducendas populum hortari, non oportuisse de molestia incommodisque perpetuis rei uxoriae confiteri, neque id hortari magis esse quam dissuadere absterrereque ; sed contra in id potius orationem debuisse sumi dicebant, ut et nullas plerumque esse in matrimoniis molestias adseueraret et, si quae tamen accidere nonnumquam uiderentur, paruas et leues facilesque esse toleratu diceret maioribusque eas emolumentis et uoluptatibus oblitterari easdemque ipsas neque omnibus neque naturae uitio, sed quorundam maritorum culpa et iniustitia euenire. Titus autem Castricius recte atque condigne Metellum esse locutum existimabat. « Aliter, inquit, censor loqui debet, aliter rhetor. Rhetori concessum est sententiis uti falsis, audacibus, uersutis, subdolis, captiosis, si ueri modo similes sint et possint mouendos hominum animos qualicumque astu inrepere ». Praeterea turpe esse ait rhetori, si quid in mala causa destitutum atque inpropugnatum relinquat. « Sed enim Metellum, inquit, sanctum uirum, illa grauitate et fide praeditum cum tanta honorum atque uitae dignitate apud populum Romanum loquentem, nihil decuit aliud dicere quam quod uerum esse sibi atque omnibus uidebatur, praesertim cum super ea re diceret quae cotidiana intellegentia et communi peruolgatoque uitae usu comprenderetur. De molestia igitur cunctis hominibus notissima confessus, eaque confessione fidem sedulitatis ueritatisque commeritus, tum denique facile et procliuiter, quod fuit rerum omnium ualidissimum atque uerissimum, persuasit ciuitatem saluam esse sine matrimoniorum frequentia non posse. »
Aulu-Gelle,
Nuits attiques
Corrigé proposé par le jury
Devant un auditoire composé de nombreux hommes érudits, on lisait le discours que Metellus Numidicus, homme digne et éloquent, au cours de sa censure prononça au sujet du mariage devant le peuple, alors qu’il l’exhortait à contracter des unions. Dans ce discours, voici ce qui était écrit : « Si nous pouvions nous passer d’une épouse, Quirites, nous nous épargnerions tous ce désagrément ; mais puisque la nature a voulu qu’on ne puisse ni vivre avec elles dans d’assez bonnes conditions ni sans elles en aucune manière, il faut veiller au salut permanent plutôt qu’à un plaisir éphémère. »
Certains étaient d’avis que le censeur Quintus Metellus, puisque son dessein était d’exhorter le peuple au mariage, n’aurait pas dû avouer le désagrément et les inconvénients permanents inhérents à la vie conjugale et que cela était moins propre à l’y exhorter qu’à en dissuader et en détourner. ‒ [Proposition alternative : … les inconvénients permanents inhérents à la vie conjugale : ses propos étaient moins propres à exhorter au mariage qu’à en dissuader…]. Mais ils avançaient qu’au contraire, le discours aurait dû prendre plutôt cette direction, à savoir assurer que la plupart du temps il n’y avait aucun désagrément au sein des unions (= aucun désagrément n’était inhérent aux unions conjugales) et affirmer que, si quelques-uns semblaient néanmoins se produire, ils étaient peu nombreux, insignifiants et faciles à supporter, que des avantages et des plaisirs plus grands les faisaient oublier et que ces désagréments, en l’occurrence, ne survenaient ni à l’identique pour tous, ni en raison d’un vice de la nature, mais par la faute et l’injustice de certains maris. Or Titus Castricius estimait que Metellus s’était exprimé avec justesse et force gravité. « Un censeur, dit-il, doit s’exprimer différemment d’un orateur. Il est permis à l’orateur d’user d’affirmations fausses, hardies, rusées, trompeuses et perfides, pour peu qu’elles soient vraisemblables et puissent (capables de) s’insinuer par n’importe quel stratagème dans le coeur des hommes qu’il entend (cherche à) émouvoir ». En outre, ajoute-il, il est honteux pour un orateur de laisser dans une affaire délicate quelque point de côté sans l’avoir défendu. « Mais en effet, dit-il, il n’eût nullement été convenable que Metellus, homme irréprochable, empreint d’une telle dignité et inspirant une telle confiance grâce à l’immense prestige de ses honneurs et de son existence, alors qu’il s’exprimait devant le peuple romain, dît rien d’autre que ce qui semblait vrai à ses yeux comme aux yeux de tous, d’autant plus qu’il traitait d’un sujet qui pouvait être appréhendé par le bon sens et par l’expérience ordinaire et banale de la vie. Ayant donc avoué un désagrément bien connu de tous les hommes et, par cet aveu, gagné leur confiance dans son engagement et sa sincérité (loyauté), alors il démontra enfin avec aisance et facilité une évidence criante de vérité entre toutes : la cité ne pouvait être sauvée sans un grand nombre d’unions ».
Session 2024
Dissertation française
Vous analyserez et discuterez ce propos de Tony Gheeraert à la lumière de votre lecture de L’Astrée d’Honoré d’Urfé :
« Tout autant qu’une longue suite d’histoires d’amour, L’Astrée serait donc une interrogation ontologique sur la vérité et le mensonge, l’être et le paraître, dont le bâillement provoque la dérive de signes devenus illisibles et indéchiffrables. Les personnages rêvent de retrouver le paradis perdu du sens, sans s’apercevoir que c’est précisément cette dérive du signifié qui permet au roman, métaphore de la vie, de se dérouler : l’écriture de L’Astrée, quête indéfiniment reportée d’un sens à jamais inassignable, exige que les mots et les choses cessent de coïncider. »
(Tony Gheeraert, Saturne aux deux visages. Introduction à L’Astrée d’Honoré d’Urfé, Mont- Saint-Aignan, Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2006, p. 177.)
Thème latin
UN MERVEILLEUX CÉNABLE (1)
Tous discutaient sans disputer. Ils n’avaient point de vanité, étant eux-mêmes leur auditoire. Ils se communiquaient leurs travaux, et se consultaient avec l’adorable bonne foi de la jeunesse. S’agissait-il d’une affaire sérieuse ? l’opposant quittait son opinion pour entrer dans les idées de son ami, d’autant plus apte à l’aider, qu’il était impartial dans une cause ou dans une oeuvre en dehors de ses idées. Presque tous avaient l’esprit doux et tolérant, deux qualités qui prouvaient leur supériorité. L’Envie, cet horrible trésor de nos espérances trompées, de nos talents avortés, de nos succès manqués, de nos prétentions blessées, leur était inconnue. Tous marchaient d’ailleurs dans des voies différentes. Aussi, ceux qui furent admis, comme Lucien, dans leur société, se sentaient-ils à l’aise. Le vrai talent est toujours bon enfant et candide, ouvert, point gourmé ; chez lui, l’épigramme caresse l’esprit, et ne vise jamais l’amour-propre. Une fois la première émotion que cause le respect dissipée, on éprouvait des douceurs infinies auprès de ces jeunes gens d’élite. La familiarité n’excluait pas la conscience que chacun avait de sa valeur, chacun sentait une profonde estime pour son voisin ; enfin, chacun se sentant de force à être à son tour le bienfaiteur ou l’obligé, tout le monde acceptait sans façon. Les conversations pleines de charmes et sans fatigue embrassaient les sujets les plus variés. Légers à la manière des flèches, les mots allaient à fond tout en allant vite. La grande misère extérieure et la splendeur des richesses intellectuelles produisaient un singulier contraste. Là, personne ne pensait aux réalités de la vie que pour en tirer d’amicales plaisanteries.
Balzac, Illusions perdues
(1) Ne pas traduire le titre.
Thème grec
Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qu’il me souvienne l’horreur des tortures infligées aux bêtes.
J’aurais voulu que l’animal se vengeât, que le chien mordît celui qui l’assommait de coups, que le cheval saignant sous le fouet renversât son bourreau ; mais toujours la bête muette subit son sort avec la résignation des races domptées. Quelle pitié que la bête !
Depuis la grenouille que les paysans coupent en deux, laissant se traîner au soleil la moitié supérieure, les yeux horriblement sortis, les bras tremblants, cherchant à s’enfouir sous la terre, jusqu’à l’oie dont on cloue les pattes, jusqu’au cheval qu’on fait épuiser par les sangsues ou fouiller par les cornes des taureaux, la bête subit, lamentable, le supplice infligé par l’homme.
Et plus l’homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent.
Des cruautés que l’on voit dans les campagnes commettre sur les animaux, de l’aspect horrible de leur condition, date avec ma pitié pour eux la compréhension des crimes de la force.
C’est ainsi que ceux qui tiennent les peuples agissent envers eux ! Cette réflexion ne pouvait manquer de me venir. Pardonnez-moi, mes chers amis des provinces, si je m’appesantis sur les souffrances endurées chez vous par les animaux.
Dans le rude labeur qui vous courbe sur la terre marâtre, vous souffrez tant vous-mêmes que le dédain arrive pour toutes les souffrances.
Cela finira-t-il jamais ?
Louise Michel,
Mémoires
Version grecque
L’ORGUEIL D’AJAX
Un messager rapporte les propos du devin Calchas à propos d’Ajax.
Τοσοῦτον οἶδα καὶ παρὼν ἐτύγχανον·
ἐκ γὰρ συνέδρου καὶ τυραννικοῦ κύκλου
Κάλχας μεταστὰς οἶος Ἀτρειδῶν δίχα,
εἰς χεῖρα Τεύκρου δεξιὰν φιλοφρόνως
θεὶς εἶπε κἀπέσκηψε, παντοίᾳ τέχνῃ
εἶρξαι κατ᾽ ἦμαρ τοὐμφανὲς τὸ νῦν τόδε
Αἴανθ᾽ ὑπὸ σκηναῖσι μηδ᾽ ἀφέντ᾽ ἐᾶν,
εἰ ζῶντ᾽ ἐκεῖνον εἰσιδεῖν θέλοι ποτέ.
Ἐλᾷ γὰρ αὐτὸν τῇδε θἠμέρᾳ μόνῃ
δίας Ἀθάνας μῆνις, ὡς ἔφη λέγων.
Τὰ γὰρ περισσὰ κἀνόνητα σώματα
πίπτειν βαρείαις πρὸς θεῶν δυσπραξίαις
ἔφασχ᾽ ὁ μάντις, ὅστις ἀνθρώπου φύσιν
βλαστὼν ἔπειτα μὴ κατ᾽ ἄνθρωπον φρονῇ.
Κεῖνος δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων εὐθὺς ἐξορμώμενος
ἄνους καλῶς λέγοντος ηὑρέθη πατρός.
Ὁ μὲν γὰρ αὐτὸν ἐννέπει· « Τέκνον, δορὶ
βούλου κρατεῖν μέν, σὺν θεῷ δ᾽ ἀεὶ κρατεῖν ».
Ὁ δ᾽ ὑψικόμπως κἀφρόνως ἠμείψατο·
« Πάτερ, θεοῖς μὲν κἂν ὁ μηδὲν ὢν ὁμοῦ
κράτος κατακτήσαιτ᾽· ἐγὼ δὲ καὶ δίχα
κείνων πέποιθα τοῦτ᾽ ἐπισπάσειν κλέος ».
Τοσόνδ᾽ ἐκόμπει μῦθον. Εἶτα δεύτερον
δίας Ἀθάνας, ἡνίκ᾽ ὀτρύνουσά νιν
ηὐδᾶτ᾽ ἐπ᾽ ἐχθροῖς χεῖρα φοινίαν τρέπειν,
τότ᾽ ἀντιφωνεῖ δεινὸν ἄρρητόν τ᾽ ἔπος·
« Ἄνασσα, τοῖς ἄλλοισιν Ἀργείων πέλας
ἵστω, καθ᾽ ἡμᾶς δ᾽ οὔποτ᾽ ἐκρήξει μάχη ».
Τοιοῖσδέ τοι λόγοισιν ἀστεργῆ θεᾶς
ἐκτήσατ᾽ ὀργήν, οὐ κατ᾽ ἄνθρωπον φρονῶν.
Ἀλλ᾽ εἴπερ ἔστι τῇδε θἠμέρᾳ, τάχ᾽ ἂν
γενοίμεθ᾽ αὐτοῦ σὺν θεῷ σωτήριοι.
Τοσαῦθ᾽ ὁ μάντις εἶφ᾽· ὁ δ᾽ εὐθὺς ἐξ ἕδρας
πέμπει με σοὶ φέροντα τάσδ᾽ ἐπιστολὰς
Τεῦκρος φυλάσσειν. Εἰ δ᾽ ἀπεστερήμεθα,
οὐκ ἔστιν ἁνὴρ κεῖνος, εἰ Κάλχας σοφός.
Sophocle,
Ajax
Version latine
COMMENT DEVENIR L’AMANT D’UN BEAU JEUNE HOMME ?
C’est l’adulescens Eumolpe qui parle.
In Asiam cum a quaestore essem stipendio eductus, hospitium Pergami accepi. Vbi cum libenter habitarem non solum propter cultum aedicularum, sed etiam propter hospitis formosissimum filium, excogitaui rationem qua non essem patri familiae suspectus amator. Quotiescunque enim in conuiuio de usu formosorum mentio facta est, tam uehementer excandui, tam seuera tristitia uiolari aures meas obsceno sermone nolui, ut me mater praecipue tanquam unum ex philosophis intueretur. Iam ego coeperam ephebum in gymnasium deducere, ego studia eius ordinare, ego docere ac praecipere, ne quis praedator corporis admitteretur in domum.
Forte cum in triclinio iaceremus, quia dies sollemnis ludum artauerat pigritiamque recedendi imposuerat hilaritas longior, fere circa mediam noctem intellexi puerum uigilare. Itaque timidissimo murmure uotum feci et : « Domina, inquam, Venus, si ego hunc puerum basiauero, ita ut ille non sentiat, cras illi par columbarum donabo ». Audito uoluptatis pretio puer stertere coepit. Itaque aggressus simulantem aliquot basiolis inuasi. Contentus hoc principio bene mane surrexi electumque par columbarum attuli expectanti, ac me uoto exsolui.
Proxima nocte cum idem liceret, mutaui optionem et : « Si hunc, inquam, tractauero improba manu, et ille non senserit, gallos gallinaceos pugnacissimos duos donabo patienti ». Ad hoc uotum ephebus ultro se admouit et, puto, uereri coepit ne ego obdormissem. Indulsi ergo sollicito, totoque corpore citra summam uoluptatem me ingurgitaui. Deinde ut dies uenit, attuli gaudenti quicquid promiseram. Ut tertia nox licentiam dedit, consurrexi ad aurem male dormientis : « Dii, inquam, immortales, si ego huic dormienti abstulero coitum plenum et optabilem, pro hac felicitate cras puero asturconem Macedonicum optimum donabo, cum hac tamen exceptione, si ille non senserit ». Nunquam altiore somno ephebus obdormiuit. Itaque primum impleui lactentibus papillis manus, mox basio inhaesi, deinde in unum omnia uota coniunxi.
Pétrone,
Satiricon
Session 2025
Dissertation française
« La beauté d’un roman est d’autant plus grande qu’il sort plus d’ordre enfin d’une plus grande confusion apparente. Et ce serait même une faute dans la composition, si le lecteur en pouvait deviner trop tôt l’issue. »
(G. W. LEIBNIZ, « Méditation sur la notion commune de justice », 1702, cité par Christine de Buzon in « L’allure romanesque des Angoysses douloureuses d’Hélisenne de Crenne », in Le Roman français au XVIe siècle ou le renouveau d’un genre européen¸ dir. Michèle Clément et Pascale Mounier, Presses Universitaires de Strasbourg, 2005, p. 216.)
En quoi ce propos éclaire-t-il votre lecture du roman d’Hélisenne de Crenne Les Angoysses douloureuses qui procèdent d’amour ?
Thème latin
DISCOURS D’UN SOLITAIRE (1)
Comme un homme sauvé du naufrage sur un rocher, je contemple de ma solitude les orages qui frémissent dans le reste du monde ; mon repos même redouble par le bruit lointain de la tempête. Depuis que les hommes ne sont plus sur mon chemin, et que je ne suis plus sur le leur, je ne les hais plus ; je les plains. Si je rencontre quelque infortuné, je tâche de venir à son secours par mes conseils, comme un passant sur le bord d’un torrent tend la main à un malheureux qui s’y noie. Mais je n’ai guère trouvé que l’innocence attentive à ma voix. La nature appelle en vain à elle le reste des hommes ; chacun d’eux se fait d’elle une image qu’il revêt de ses propres passions. Il poursuit toute sa vie ce vain fantôme qui l’égare, et il se plaint ensuite au ciel de l’erreur qu’il s’est formée lui-même. Parmi un grand nombre d’infortunés que j’ai quelquefois essayé de ramener à la nature, je n’en ai pas trouvé un seul qui ne fût enivré de ses propres misères. Ils m’écoutaient d’abord avec attention, dans l’espérance que je les aiderais à acquérir de la gloire ou de la fortune ; mais voyant que je ne voulais leur apprendre qu’à s’en passer, ils me trouvaient moi-même misérable de ne pas courir après leur malheureux bonheur : ils blâmaient ma vie solitaire ; ils prétendaient qu’eux seuls étaient utiles aux hommes, et ils s’efforçaient de m’entraîner dans leur tourbillon.
Bernardin de Saint-Pierre,
Paul et Virginie
(1) Ne pas traduire le titre.
Thème grec
Il m’emmena donc sur une roche en promontoire dont la vague venait battre le pied.
« Je vais, dit le roi, jeter dans le flot ma couronne, pour vous prouver ma confiance que vous me la rapporterez du fond. »
La reine et les deux princesses étaient là, désireuses d’assister à l’épreuve ; de sorte que, enhardi par leur présence, je protestai :
« Suis-je un chien, pour rapporter à son maître un objet, fût-ce une couronne ? Laissez-moi plonger sans appât. Je vous rapporterai de ma plongée quoi que ce soit qui l’atteste et la prouve. »
Je poussai l’audace plus loin. Comme une brise assez forte s’élevait, il advint qu’une longue écharpe fut enlevée des épaules d’Ariane. Le souffle la dirigea vers moi. Je m’en saisis en souriant comme si la princesse ou quelque dieu me l’eût offerte. Aussitôt, me dépouillant du justaucorps qui m’engonçait, je ceignis autour de mes reins cette écharpe, la passai entre mes cuisses et, la ramenant par devant, l’assujettis. Il semblait que ce fût par pudeur et pour ne point exposer ma virilité devant ces dames ; mais ce faisant je pus dissimuler la ceinture de cuir que je conservais, à quoi pendait une escarcelle. Dans celle-ci, je n’avais pas de pièces de métal, mais bien quelques pierres de prix, emportées de Grèce, car je savais que ces pierreries gardent leur pleine valeur n’importe où.
Donc, ayant pris souffle, je plongeai. André Gide, Thésée
Version grecque
MÉNÉLAS DEMANDE POUR LA DERNIÈRE FOIS AUX TROYENS DE LUI RENDRE HÉLÈNE
Εἰ μὲν ἐβούλετο Ἀλέξανδρος, ὦ Τρῶες, καὶ κατὰ μικρὸν εἶναι δίκαιος, οὔτ’ ἐκκλησίας ἔδει νῦν οὔθ’ ὅπλων οὔτε πρεσβείας, ἀλλ’ ἡμεῖς τ’ ἂν οἴκοι διετρίβομεν ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς ὑμῖν τ’ ἂν ἔξω φόβων καθειστήκει τὰ πράγματα· ἐπειδὴ δὲ τὴν τοῦ δικαίου τάξιν δευτέραν πεποίηται τῆς ἡδονῆς, ἥκομεν, ὦ Τρῶες, ἀδικήσοντες μὲν οὐδένα, τὰ δὲ ἡμέτερα αὐτῶν κομιούμενοι, ἐάνπερ ἄρα ἐξῇ. τὸ μὲν οὖν στρατόπεδον τῶν Ἀχαιῶν ἀπὸ τῶν τειχῶν ὁρᾶτε δήπου καὶ τὸ πλῆθος ὅσον καὶ τῆς παρασκευῆς τὸ μέγεθος, ἡμεῖς δὲ τοσαύτῃ προνοίᾳ κεχρήμεθα τοῦ μηδὲν ἀνεπιεικὲς ποιεῖν, ὥστε τὰ ὅπλα παραστήσαντες προτέροις χρώμεθα τοῖς λόγοις, ἵν’, εἰ μὲν ἐκ πρεσβείας τῶν δικαίων τύχοιμεν, εὐθὺς ἀπίωμεν, εἰ δὲ μή, τά γε δεύτερα πράττωμεν. οὔτε γὰρ εἰς ἔργον παραχρῆμα καθίστασθαι τῶν ἡμετέρων τρόπων ἀπράκτου τε τῆς πρεσβείας ἀπελθούσης ἡσυχάζειν οὐκ ἔνεστιν. ἔστι τοίνυν ἐφ’ ὑμῖν ἢ περὶ πλείονος ποιήσασθαι τὴν ἡδονὴν Ἀλεξάνδρου τῆς ὑμετέρας αὐτῶν ἀσφαλείας ἢ μετὰ τῆς Ἑλένης ἀπηλλάχθαι καὶ τοῦ πολέμου.
Μέχρι μὲν οὖν τῆς παρούσης ἡμέρας Ἀλεξάνδρῳ μόνῳ τὴν ἁρπαγὴν λογιζόμεθα καὶ τῶν εἰς ἡμᾶς ἠσελγημένων οὐδὲν ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Τρώων πεποιῆσθαι νομίζομεν, τὸ δὲ τῆς νῦν ἐκκλησίας τέλος ἢ βεβαιώσει ταύτην τὴν δόξαν ἢ τὸ μὲν ἔργον ἐκείνου, τὸ δὲ βούλευμα κοινὸν ἁπάντων ἀποδείξει. ἐν μὲν γὰρ τῷ τὴν Ἀλεξάνδρου θεραπεύειν χάριν κοινωνεῖν ἐστι τῶν πεπραγμένων, ἐν δὲ τῷ καὶ παρὰ τὴν ἐκείνου γνώμην μέτριόν τι ποιεῖν ἐθέλειν ἐν ἐκείνῳ τὴν μέμψιν ὁρίζειν.
Libanios
Version latine
L’HYGIÈNE DE LA BOUCHE
Vidi ego dudum uix risum quosdam tenentis, cum munditias oris uidelicet orator ille aspere accusaret et dentifricium tanta indignatione pronuntiaret, quanta nemo quisquam uenenum. Quidni ? crimen haud contemnendum philosopho, nihil in se sordidum sinere, nihil uspiam corporis aperti immundum pati ac fetulentum, praesertim os, cuius in propatulo et conspicuo usus homini creberrimus, siue ille cuipiam osculum ferat seu cum quiquam sermocinetur siue in auditorio dissertet siue in templo preces alleget ; omnem quippe hominis actum sermo praeit, qui, ut ait poeta praecipuus, dentium muro proficiscitur. Dares nunc aliquem similiter grandiloquum : diceret suo more cum primis cui ulla fandi cura sit impensius cetero corpore os colendum, quod esset animi uestibulum et orationis ianua et cogitationum comitium. Ego certe pro meo captu dixerim nihil minus quam oris illuuiem libero et liberali uiro competere. Est enim ea pars hominis loco celsa, uisu prompta, usu facunda ; nam quidem feris et pecudibus os humile et deorsum ad pedes deiectum, uestigio et pabulo proximum, nunquam ferme nisi mortuis aut ad morsum exasperatis conspicitur ; hominis uero nihil prius tacentis, nihil saepius loquentis contemplere. Velim igitur censor meus Aemilianus respondeat, umquamne ipse soleat pedes lauare ; uel, si id non negat, contendat maiorem curam munditiarum pedibus quam dentibus impertiendam. Plane quidem, si quis ita ut tu, Aemiliane, nunquam ferme os suum nisi maledictis et calumniis aperiat, censeo ne ulla cura os percolat neque ille exotico puluere dentis emaculet, quos iustius carbone de rogo obteruerit, neque saltem communi aqua perluat : quin ei nocens lingua, mendaciorum et amaritudinum praeministra, semper in fetutinis et olenticetis suis iaceat. Nam quae, malum, ratio est linguam mundam et laetam, uocem contra spurcam et tetram possidere, uiperae ritu niueo denticulo atrum uenenum inspirare ? Ceterum qui sese sciat orationem prompturum neque inutilem neque iniucundam, eius merito os, ut bono potui poculum, praelauitur.
Apulée