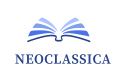Voir le Projet II.
Pour l’instant, seuls des sujets de composition française et de version latine (qui existait dans l’ancien certificat d’aptitude) sont disponibles. Les sujets de l’épreuve écrite disciplinaire appliquée sont disponibles grâce à des liens.
Les sujets de 1975 à 1999 ont fait l’objet d’une publication au format papier qui les regroupe tous.
Quelques copies de concours se trouvent sur cette page (voir le Projet I).
NOUVEAU CAPES (2022-2025)
À partir de la session 2022, les sujets de la première épreuve ne sont plus des sujets de littérature générale mais portent sur l’une des œuvres au programme. Voir, dans le menu, la page concernant le CAPES pour l’année en cours.
Dissertation
« Peut-être reconnaîtra-t-on ici la modernité du projet lérien en même temps que ses limites : la quête d’un savoir sur le monde, si familière aux auteurs de récits de voyage à la Renaissance, se voit ici concurrencée par le trésor d’une expérience qui ne saurait seulement servir à authentifier la connaissance des horizons lointains. L’écriture sur l’autre serait peut-être ici, déjà, une tentative d’écriture sur soi. » (Marie-Christine Gomez-Géraud, « Un colloque chez les Tououpinambaoults : mise en scène d’une dépossession », dans D’Encre de Brésil. Jean de Léry écrivain, textes réunis par Frank Lestringant et Marie-Christine Gomez-Géraud, Orléans, Paradigme, 1999, p.162).
Dans quelle mesure ce propos sur Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil de Jean de Léry éclaire-t-il votre lecture de ce récit ?
Épreuve écrite disciplinaire appliquée
Dissertation
Jean Rohou écrit à propos de Jean de La Bruyère :
« Ce style, plein de procédés, est celui qu’il fallait pour créer, mimer, dénoncer une humanité d’automates, un univers sans substance où il n’y a que des phénomènes (dans tous les sens du terme), des signes sans signification. Il convient à un esprit critique qui n’espère pas transformer le monde. » (Histoire de la littérature française du XVIIe siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2000 (2e éd.), p. 353)
Dans quelle mesure ce propos éclaire-t-il votre lecture des livres V à XI des Caractères de La Bruyère ?
Épreuve écrite disciplinaire appliquée
Dissertation
« Le roman dépeint un monde où toute vérité est devenue problématique. L’erreur est partout, la certitude nulle part. Les signes et le langage sombrent dans l’ambiguïté. Ils sont devenus trompeurs comme les apparences. » (Philippe Walter, Le Livre du Graal, Pléiade, tome III, 2009).
Dans quelle mesure ce propos sur La Mort du roi Arthur éclaire-t-il votre lecture de ce roman ?
Épreuve écrite disciplinaire appliquée
Dissertation
Le conte est-il un récit édifiant ?
Vous répondrez à cette question en vous fondant sur votre connaissance des Contes de Charles Perrault.
Épreuve écrite disciplinaire appliquée
COMPOSITION FRANÇAISE (1975-2021)
Session 2021
S’interrogeant sur ce qui fait l’essence de la comédie, Jean-Claude Ranger en propose cette définition :
« C’est avant tout, je crois, la claire conscience que rien d’essentiel n’est en jeu, ou, pour citer Aristote, que, quoi qu’en puissent penser à tel ou tel moment les personnages, “ni douleur ni destruction” ne sauraient résulter de la comédie — et c’est de cette certitude que naît le détachement du spectateur à l’égard des péripéties de l’action. »
Jean-Claude Ranger, « La comédie, ou l’esthétique de la rupture »,
dans Littératures classiques, n° 27, printemps 1996, p. 274-275.
Vous discuterez cette proposition en vous appuyant sur des exemples d’œuvres théâtrales précis et variés.
Session 2020
« Je laisse en moi continuer ce qui s’est toujours passé en littérature, et comment pourrait-il en être autrement ? La table rase est une bêtise, nous avons lu, nous sommes quand même informés, nous écrivons sur et avec la littérature universelle, nous ne passons pas par-dessus. Nous imitons, oui, comme on l’a fait depuis le début, nous imitons passionnément et en même temps passionnément nous n’imitons pas : chaque livre, à chaque fois, est un salut aux pères et une insulte aux pères, une reconnaissance et un déni. »
Pierre Michon, Le roi vient quand il veut, Propos sur la littérature,
Paris, Albin Michel, 2007, p. 110-111.
En vous appuyant sur des exemples précis et variés, vous commenterez et discuterez ces propos.
Session 2019
« La poésie, comme l’art, est inséparable de la merveille. Elle est domiciliée dans l’espace émotif et ne saurait vivre ailleurs. »
André Pieyre de Mandiargues, préface de L’Âge de craie (1961),
Paris, Gallimard, « Poésie », 1967, p. 8.
Vous commenterez ce propos d’André Pieyre de Mandiargues en vous appuyant sur des exemples précis.
Session 2018
« L’œuvre d’art, et singulièrement l’œuvre littéraire, ne s’impose pas seulement comme un objet de jouissance ou de connaissance ; elle s’offre à l’esprit comme objet d’interrogation, d’enquête, de perplexité. »
Gaëtan Picon, L’Écrivain et son ombre, Paris, Gallimard, 1953.
Quelles réflexions vous inspirent ces propos de Gaëtan Picon ?
Session 2017
« Jamais, moi vivant, on ne m’illustrera, parce que : la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin. Du moment qu’un type est fixé par le crayon, il perd ce caractère de généralité, cette concordance avec mille objets connus qui font dire au lecteur : « J’ai vu cela » ou « Cela doit être ». Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout. L’idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles, tandis qu’une femme écrite fait rêver à mille femmes. Donc, ceci étant une question d’esthétique, je refuse formellement toute espèce d’illustration. »
Gustave Flaubert, Lettre à Ernest Duplan, 12 juin 1862,
in Extraits de la correspondance ou Préface à la vie d’écrivain,
présentation et choix de Geneviève Bollème, Paris, Seuil, 1963, p. 223-224.
Vous commenterez ce propos de Gustave Flaubert en vous appuyant sur des exemples empruntés aux différents genres littéraires, ainsi qu’aux arts plastiques et au cinéma.
Session 2016
« Suspendre le jugement moral ce n’est pas l’immoralité du roman, c’est sa morale. La morale qui s’oppose à l’indéracinable pratique humaine de juger tout de suite, sans cesse, et tout le monde, de juger avant et sans comprendre. Cette fervente disponibilité à juger est, du point de vue de la sagesse du roman, la plus détestable bêtise, le plus pernicieux mal. Non que le romancier conteste, dans l’absolu, la légitimité du jugement moral, mais il le renvoie au-delà du roman. Là, si cela vous chante, accusez Panurge pour sa lâcheté, accusez Emma Bovary, accusez Rastignac, c’est votre affaire ; le romancier n’y peut rien. »
Milan Kundera, Les Testaments trahis, Paris, Gallimard, 1993.
Vous analyserez et discuterez ces propos en vous appuyant sur des exemples variés et précis.
Session 2015
« Un théâtre sans convention n’a pas d’espoir. La convention c’est cette pure entrée dans l’imaginaire, sans les antichambres de l’intelligence, les salons mondains de l’élégance, etc. Le public populaire se saisit toujours plus vite d’une convention que le public savant (lequel voudrait inlassablement de la vraisemblance, de la logique psychologique, de la profondeur, de la dialectique, du parlé vrai, tout ce qui tente de se soustraire à l’architecture des conventions théâtrales).
Le public enfantin des guignols joue avec les conventions du genre comme peu de critiques savent le faire. Car il s’agit non pas de juger l’œuvre mais de jouer avec, de se jouer, de faire jouer son imaginaire, d’utiliser les conventions théâtrales pour animer son jardin intérieur. »
Olivier Py, Les Mille et une définitions du théâtre, Arles, Actes Sud, 2013.
Vous analyserez et discuterez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis empruntés à votre culture théâtrale.
Depuis cette session, les sujets sont communs aux Lettres modernes et aux Lettres classiques, réunis dans un même CAPES de Lettres à options de 2014 à 2018, puis présentés en deux sections distinctes depuis 2019.
Session 2014 (session ordinaire)
Évoquant sa propre vie en utilisant une énonciation à la troisième personne, Annie Ernaux écrit :
« Ce que ce monde a imprimé en elle et ses contemporains, elle s’en servira pour reconstituer un temps commun, celui qui a glissé d’il y a si longtemps à aujourd’hui – pour, en retrouvant la mémoire de la mémoire collective dans une mémoire individuelle, rendre la dimension vécue de l’Histoire.
Ce ne sera pas un travail de remémoration, tel qu’on l’entend généralement, visant à la mise en récit d’une vie, à une explication de soi. Elle ne regardera en elle-même que pour y retrouver le monde […]. »
Annie Ernaux, Les Années, Paris, Gallimard, 2008, p. 239.
Vous analyserez et discuterez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis empruntés à vos lectures.
Rapport du jury 2014 (session ordinaire)
Session 2014 (session exceptionnelle)
« Je ne puis croire au nécessaire triomphe du Roman. Sa formule est grossière par excellence et sa transsubstantiation médiocre. Il réclame de se développer. Il a besoin du temps. Il lui faut aligner toute une série de causes et d’effets, et il n’est même pas réversible. Comme un long fil d’acier, il doit surtout faire preuve d’une ductilité grande (300 pages) et, pour ne pas se rompre, d’une considérable ténacité. »
Victor Segalen, Sur une forme nouvelle du roman
ou un nouveau contenu de l’essai, 1910.
Rapport du jury 2014 (session exceptionnelle)
Session 2013
« Un romancier […] ne peut donc se délivrer du mensonge qu’en exploitant les ressources multiples du mensonge. (De cette origine – accession à la vérité par le détour du mensonge – l’œuvre tire ses contradictions et ses ambiguïtés.) Quand il donne au mensonge un corps et s’approprie son langage, ce ne peut être qu’à seule fin d’instituer un monde de vérité. Autrement dit encore, le langage romanesque n’assure sa fonction qu’en recourant aux moyens dont se sert le mensonge, et c’est même, paradoxalement, la seule fonction qu’il puisse accomplir en toute vérité. »
Louis-René des Forêts, Voies et détours de la fiction, Paris, Fata Morgana, 1985.
Vous commenterez et discuterez ces propos à partir d’analyses précises de textes romanesques.
Session 2012
Le poète contemporain Christian Prigent écrit :
« Parce qu’elle embrasse passionnément le présent, la poésie affronte une in-signifiance : le sens du présent est dans cette in-signifiance, dans ce cadrage impossible des perspectives, dans ce flottement des savoirs, dans cette fuite des significations devant nos discours et nos croyances. »
Christian Prigent, À quoi bon encore des poètes ?, P.O.L., 1996, p. 36.
Commentez et éventuellement discutez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis et variés.
Session 2011
Dans son article « Expérience du théâtre » (1948), Eugène Ionesco affirme :
« […] le théâtre a une façon propre d’utiliser la parole, c’est le dialogue, c’est la parole de combat, de conflit. Si elle n’est que discussion chez certains auteurs, c’est une grande faute de leur part. Il existe d’autres moyens de théâtraliser la parole : en la portant à son paroxysme, pour donner au théâtre sa vraie mesure, qui est dans la démesure ; le verbe lui-même doit être tendu jusqu’à ses limites ultimes, le langage doit presque exploser, ou se détruire, dans son impossibilité de contenir les significations. »
Eugène Ionesco, article « Expérience du théâtre » N.R.F.,
février 1948, publié dans Notes et Contre-notes, Folio-Essais, 2003, p. 62-63.
Commentez et éventuellement discutez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis et variés.
Session 2010
S’appuyant sur une remarque de Paul Valéry, Pierre Bayard dans Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? déclare :
« Valéry incite à penser en termes de bibliothèque collective et non de livre seul. Pour un vrai lecteur, soucieux de réfléchir à la littérature, ce n’est pas tel livre qui compte, mais l’ensemble de tous les autres, et prêter une attention exclusive à un seul risque de faire perdre de vue cet ensemble et ce qui, en tout livre, participe à une organisation plus vaste qui permet de le comprendre en profondeur.
Mais Valéry nous permet aussi d’aller plus loin en nous invitant à adopter cette même attitude devant chaque livre et à en prendre une vue générale, laquelle a partie liée avec la vue sur l’ensemble des livres. »
Pierre Bayard, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?,
Paris, Éditions de Minuit, 2007, p. 42.
Vous analyserez et discuterez ces propos en vous appuyant sur des exemples variés et précis.
Session 2009
Réfléchissant sur l’histoire littéraire et sur la figure du grand écrivain, Chateaubriand déclare :
« On renie souvent ces maîtres suprêmes ; on se révolte contre eux ; on compte leurs défauts ; on les accuse d’ennui, de longueur, de bizarrerie, de mauvais goût, en les volant et en se parant de leurs dépouilles ; mais on se débat en vain sous leur joug. Tout se teint de leurs couleurs ; partout s’impriment leurs traces ; ils inventent des mots et des noms qui vont grossir le vocabulaire général des peuples ; leurs expressions deviennent proverbes, leurs personnages fictifs se changent en personnages réels, lesquels ont hoirs1 et lignée. Ils ouvrent des horizons d’où jaillissent des faisceaux de lumière ; ils sèment des idées, germes de mille autres ; ils fournissent des imaginations, des sujets, des styles à tous les arts : leurs œuvres sont les mines ou les entrailles de l’esprit humain. »
Chateaubriand (1768-1848), Mémoires d’outre-tombe
(1809-1841, publication posthume 1848), livre XII, chapitre 1.
Vous analyserez et discuterez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis.
1. Hoirs : terme juridique archaïque : héritiers, successeurs.
Session 2008
« … il n’y a poésie qu’autant qu’il y a méditation sur le langage, et à chaque pas réinvention de ce langage. Ce qui implique de briser les cadres fixes du langage, les règles de la grammaire, les lois du discours. C’est bien ce qui a mené les poètes si loin dans le chemin de la liberté, et c’est cette liberté qui me fait m’avancer dans la voie de la rigueur, cette liberté véritable. »
(Louis Aragon, « Arma virumque cano » [« Je chante les armes et l’homme »], préface du recueil Les Yeux d’Elsa, 1942 ; Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », Œuvres poétiques complètes, I, 2007, p. 747).
Vous analyserez et discuterez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis.
Session 2007
Dans En lisant en écrivant (1980) [José Corti, p. 178], Julien Gracq – s’adressant au critique littéraire – déclare :
« Un livre qui m’a séduit est comme une femme qui me fait tomber sous le charme : au diable ses ancêtres, son lieu de naissance, son milieu, ses relations, son éducation, ses amies d’enfance ! Ce que j’attends seulement de votre entretien critique, c’est l’inflexion de voix juste qui me fera sentir que vous êtes amoureux, et amoureux de la même manière que moi : je n’ai besoin que de la confirmation et de l’orgueil que procure à l’amoureux l’amour parallèle et lucide d’un tiers bien disant. »
Vous analyserez et discuterez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis.
Session 2006
« Les grandes œuvres du théâtre sont toujours des œuvres subversives qui mettent en cause l’ensemble des croyances, des idées, des modèles, l’image de l’homme, d’une société et d’une civilisation. Certes, avec le temps, les histoires de la littérature effacent ce conflit ou du moins feignent de l’ignorer, pressées qu’elles sont de tranquilliser le lecteur en présentant des œuvres dans la suite apaisante d’une histoire et d’un déroulement. Mais à l’origine, toute grande œuvre, même si elle ne s’affirme pas complètement, frappe, gêne, révolte. »
Jean Duvignaud et Jean Lagoutte, Le Théâtre contemporain,
Culture et contre-culture, Paris, Larousse, 1974.
En vous appuyant sur des exemples précis, vous analyserez et discuterez ces réflexions sur le genre théâtral.
Session 2005
« Avec des mots si j’essaie de recomposer mon attitude d’alors, le lecteur ne sera pas dupe plus que moi. Nous savons que notre langage est incapable de rappeler même le reflet de ces états défunts, étrangers. Il en serait de même pour tout ce journal s’il devait être la notation de qui je fus. Je préciserai donc qu’il doit renseigner sur qui je suis, aujourd’hui que je l’écris. Il n’est pas une recherche du temps passé, mais une œuvre d’art dont la matière-prétexte est ma vie d’autrefois. Il sera un présent fixé à l’aide du passé, non l’inverse. Qu’on sache donc que les faits furent ce que je les dis, mais l’interprétation que j’en tire c’est ce que je suis devenu. »
Jean Genet, Journal du voleur (1949)
[Gallimard, coll. Folio, 1982, pp. 79-80]
En vous appuyant sur des exemples précis, vous analyserez et discuterez ces réflexions sur l’écriture autobiographique.
Session 2004
« Si le romancier veut atteindre l’objectif de son art, qui est de peindre la vie, il devra s’efforcer de rendre cette symphonie humaine où nous sommes tous engagés, où toutes les destinées se prolongent dans les autres et se compénètrent. Hélas ! il est à craindre que ceux qui cèdent à cette ambition, quel que soit leur talent ou même leur génie, n’aboutissent à un échec. Il y a je ne sais quoi de désespéré dans la tentative d’un Joyce. Je ne crois pas qu’aucun artiste réussisse jamais à surmonter la contradiction qui est inhérente à l’art du roman. D’une part, il a la prétention d’être la science de l’homme, — de l’homme, monde fourmillant qui dure et qui s’écoule, — et il ne sait qu’isoler de ce fourmillement et que fixer sous sa lentille une passion, une vertu, un vice qu’il amplifie démesurément : le père Goriot ou l’amour paternel, la cousine Bette ou la jalousie, le père Grandet ou l’avarice. D’autre part, le roman a la prétention de nous peindre la vie sociale, et il n’atteint jamais que des individus après avoir coupé la plupart des racines qui les rattachent au groupe. En un mot, dans l’individu, le romancier isole et immobilise une passion, et dans le groupe il isole et immobilise un individu. Et, ce faisant, on peut dire que ce peintre de la vie exprime le contraire de ce qu’est la vie : l’art du romancier est une faillite. »
François Mauriac, Le romancier et ses personnages (1933), in Œuvres romanesques et théâtrales complètes, tome II, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1979, p. 847-848.
Session 2003
Examinant les rapports du texte et de la scène, Bernard Dort écrit :
« Aussi les plus grands textes de théâtre, ceux qui ont suscité, à travers les âges, le plus d’interprétations scéniques, et les plus différentes entre elles, sont-ils ceux qui, à la lecture, nous semblent les plus problématiques. Complexes au point de paraître presque incohérents. Foisonnants à la limite du désordre. Un texte clos sur lui-même, qui contient expressément une réponse aux questions qui y sont formulées, a peu de chance d’être jamais repris. C’est le sort des pièces à thèse. En revanche, un texte ouvert, qui ne répond aux questions que par de nouvelles questions et qui prend délibérément le parti de son propre inachèvement, a toutes les chances de durer. C’est qu’il fait appel à la scène, qu’il la provoque et a besoin d’elle pour prendre consistance. »
« Le texte et la scène : pour une nouvelle alliance », in Le Spectateur en dialogue, P.O.L. éditeur, 1995, page 263. Première édition en 1984 dans le « Supplément II » de l’Encyclopædia Universalis.
Session 2002
« On entend tous les jours, à propos de productions littéraires, parler de la dignité de tel genre, des convenances de tel autre, des limites de celui-ci, des latitudes de celui-là ; la tragédie interdit ce que le roman permet ; la chanson tolère ce que l’ode défend, etc. L’auteur de ce livre a le malheur de ne rien comprendre à tout cela ; il y cherche des choses et n’y voit que des mots ; il lui semble que ce qui est réellement beau et vrai est beau et vrai partout ; que ce qui est dramatique dans un roman sera dramatique sur la scène ; que ce qui est lyrique dans un couplet sera lyrique dans une strophe ; qu’enfin et toujours la seule distinction véritable dans les œuvres de l’esprit est celle du bon et du mauvais. »
Victor Hugo, Préface des Odes et Ballades (1826).
Session 2001
En vous appuyant sur des exemples précis, commentez et discutez cette affirmation de Jean-Paul Sartre :
« Les poètes sont des hommes qui refusent d’utiliser le langage. Or, comme c’est dans et par le langage conçu comme une espèce d’instrument que s’opère la recherche de la vérité, il ne faut pas s’imaginer qu’ils visent à discerner le vrai ni à l’exposer. Ils ne songent pas non plus à nommer le monde et, par le fait, ils ne nomment rien du tout, car la nomination implique un perpétuel sacrifice du nom à l’objet nommer ou pour parler comme Hegel, le nom s’y révèle l’inessentiel, en face de la chose qui est essentielle. Ils ne parlent pas ; ils ne se taisent pas non plus : c’est autre chose. […] En fait, le poète s’est retiré d’un seul coup du langage-instrument ; il a choisi une fois pour toutes l’attitude poétique qui considère les mots comme des choses et non comme des signes. »
Qu’est-ce que la littérature ?, Paris, Gallimard, 1948 ; rééd., Paris, Gallimard, 1999, coll. « Folio / Essais », p. 18-19.
Session 2000
Extrait de La Tentation d’exister de Cioran :
« Auprès du héros tragique, comblé par l’adversité, son bien de toujours, son patrimoine, le personnage romanesque apparaît comme un aspirant à la ruine, un gagne-petit de l’horreur, tout soucieux de se perdre, tout tremblant de n’y point réussir. Incertain de son désastre, il en souffre. Aucune nécessité dans sa mort. L’auteur, telle est notre impression, pourrait le sauver : ce qui donne un sentiment de malaise et nous gâche le plaisir de la lecture. La tragédie, elle, se déroule si j’ose dire, sur un plan absolu : l’auteur n’a aucune influence sur ses héros, il n’en est que le serviteur, l’instrument ; ce sont eux qui commandent et lui intiment de rédiger le procès-verbal de leurs faits et gestes. »
Vous analyserez et discuterez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis.
Session 1999
Dans l’Entretien des muses (Paris, Gallimard, 1968, p. 303-304), Philippe Jaccottet écrit :
« La poésie est elle-même non pas dans le maintien à tout prix de telle ou telle prosodie, mais dans l’usage de la comparaison, de la métaphore ou de toute autre mise en rapport ; elle est au plus près d’elle même dans la mise en rapport des contraires fondamentaux : dehors et dedans, haut et bas, lumière et obscurité, illimité et limite. Tout poète est au plus près de lui même dans sa façon singulière de les saisir. »
Vous analyserez et discuterez ce propos en fondant votre réflexion sur des exemples précis et d’époques diverses.
Session 1998
Michel Butor écrit dans Répertoire 2 (Paris, Éditions de Minuit, 1964, « Le roman et la poésie », p. 7) :
« Étudiant, comme beaucoup, j’ai écrit quantité de poèmes. Ce n’était pas seulement distraction ou exercice ; j’y jouais ma vie. Or, du jour où j’ai commencé mon premier roman, des années durant je n’ai plus rédigé un seul poème, parce que je voulais réserver, pour le livre auquel je travaillais, tout ce que je pouvais avoir de capacité poétique ; et si je me suis mis au roman, c’est parce que j’avais rencontré dans cet apprentissage nombre de difficultés et contradictions, et qu’en lisant divers grands romanciers, j’avais eu l’impression qu’il y avait là une charge poétique prodigieuse, donc que le roman, dans ses formes les plus hautes, pouvait être un moyen de résoudre, dépasser ces difficultés, qu’il était capable de recueillir tout l’héritage de l’ancienne poésie. »
En vous appuyant sur des exemples précis et empruntés à des époques variées, vous montrerez dans quelle mesure ce témoignage permet de caractériser le roman.
Session 1997
Dans En lisant en écrivant (éd. J. Corti, 1981), Julien Gracq déclare :
« Ce qui égare trop souvent la critique explicative, c’est le contraste entre la réalité matérielle de l’œuvre : étendue, articulée, faite de parties emboîtées et complexes, et même, si l’on veut, démontable jusque dans son détail, et le caractère rigidement global de l’impression de lecture qu’elle produit. Ne pas tenir compte de cet effet de l’œuvre, pour lequel elle est tout entière bâtie, c’est analyser selon les lois et par les moyens de la mécanique une construction dont le seul but est de produire un effet analogue à celui de l’électricité. »
En fondant votre réflexion sur des exemples littéraires précis, vous analyserez et discuterez ce propos.
Session 1996
Dans une séquence intitulée « Réalisme et fantaisie » et extraite de l’ouvrage L’Écriture comique (P.U.F. « écriture », 1984, p. 133), Jean Sareil écrit :
« Le réalisme est donc très répandu dans l’œuvre comique, mais il apparaît toujours bridé, limité à des détails secondaires, à des traits d’observation. Son rôle est très souvent celui d’un point de départ. Mais, chose étonnante, la fantaisie n’est pas mieux traitée et se voit contrôlée presque dans les mêmes proportions. Il serait faux de croire que l’écrivain comique cherche à donner libre cours à son imagination. À chaque instant, il doit toucher terre, revenir au réalisme, qui le relance. »
Commentez et discutez en vous référant à des exemples précis.
Session 1995
G. Gusdorf écrit dans Le Romantisme, éd. Payot et Rivages, 1982, rééd. 1993, p. 46 :
« Constante de culture, le romantisme apparaît comme une catégorie transhistorique, irradiant l’histoire culturelle dans l’ensemble de son devenir. Il ne s’agit pas d’une mode littéraire qui aurait régné dans la première partie du XIXe siècle ; conception absurde ; car il n’y a pas eu d’année zéro du romantisme, ni d’année terminale. Le romantisme a existé au présent, dans un moment historique ; mais il s’est projeté dans le passé médiéval et renaissant, et il n’a pas cessé de susciter dans le futur des hommes et des œuvres en lesquels revivait son esprit. »
Vous commenterez et discuterez cette prise de position, en appuyant votre réflexion sur des exemples précis.
Session 1994
« Au nom d’un « matérialisme » de la lettre, certains ont vidé la poésie de tout rapport avec l’être et avec la matière. Ils se sont adonnés aux glissements intensifs de la « chaîne signifiante », où se perdent de vue les signifiés. Moyennant quoi, leur écriture est devenue parfois illisible, et ils ont contribué à détourner les lecteurs de la poésie. La lisibilité d’un poème se fonde en effet sur un double rapport des mots qui le composent avec l’horizon interne du texte et avec l’horizon externe du monde. Se priver de l’un de ces deux horizons, c’est s’exposer soit au réalisme, soit à l’hermétisme. »
(Michel Collot, L’Horizon fabuleux, Librairie José Corti, 1988, p. 214).
En vous référant à des exemples précis, vous commenterez et discuterez ces réflexions.
Session 1993
Dans un ouvrage publié en 1979, Vers l’Inconscient du texte (P.U.F., p. 194-195), J. Bellemin-Noël écrit :
« Je ne puis fantasmer n’importe quoi à propos d’un texte. Je ne brode pas sur un canevas aux couleurs prémarquées : ce discours et moi, nous devenons ensemble cette tapisserie. Ma main doit passer par des points obligés, choisir des fils de nuances déterminées, meubler les entours d’une ornementation. Le motif existe. Imposé par le titre, il ne faut pas l’oublier ; le dessin, la couleur et le cadre sont aménagés. Mon inconscient de lecteur ne s’impose pas, il se prête aux possibles du texte ; le sens secret du texte ne s’expose pas, même à force de (mauvais ou bons) traitements, il s’offre aux connivences de mon écoute. Car c’est moi qui suis le maître du relief, des intensités : j’accentue ici ou là, je marque plus ou moins le contraste, je crée la tonalité, je fais voir ce qui n’était pas remarqué, remarquer ce qui autrement n’eût pas été vu, mon rôle est de mettre en vue — je suis metteur en scène du sens, et dès lors c’est mon sens. »
Vous commenterez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis.
Session 1992
C. Grivel écrit dans Production de l’intérêt romanesque (La Haye, Mouton, 1973, p. 318) :
« Roman signifie exemplarisation. Le roman prouve. Il constitue un discours parabolique, illustratif, donne à souscrire à un sens. Raconter suppose la volonté d’enseigner, implique l’intention de dispenser une leçon, comme aussi celle de la rendre évidente. »
Vous commenterez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis.
Session 1991
H. Godard écrit dans L’autre face de la littérature. Essai sur André Malraux et la littérature (Paris, Gallimard, 1990, p. 42-43) :
« Toute œuvre est un système de formes qui n’existent pas telles quelles dans le monde réel. Nous n’éprouvons jamais celui-ci que comme une totalité et comme une confusion. Il nous déborde de toute part. Il est sans limite, à chaque instant il se dérobe à notre prise. Tout s’y tient, et la diversité des plans de notre expérience y multiplie à l’infini les liens de tout avec tout. Les formes que nous percevons dans l’œuvre ne peuvent donc résulter que du découpage et des choix que l’artiste y a opérés. Or l’idée même d’un découpage et de choix de ce genre, chaque nouvel artiste ne peut la tenir que des œuvres de ses prédécesseurs. « Un poète ne se conquiert pas sur l’informe, mais sur les formes qu’il admire. » Il s’ensuit que la création passe nécessairement d’abord par l’imitation, quand ce n’est pas par le pastiche. »
Vous commenterez cette définition de l’œuvre littéraire sans vous en tenir à la poésie et en vous appuyant sur des exemples précis.
Session 1990
Pierre Larthomas écrit dans Le Langage dramatique (Paris, P.U.F., 1972, p. 433-434) :
« L’erreur fondamentale à nos yeux a consisté surtout à distinguer au cours des siècles, tout au moins en France, la comédie et la tragédie, ou, de façon plus large, les pièces qui font rire et celles qui font pleurer. Non que cette distinction ne soit pas, dans une certaine mesure, naturelle, puisqu’elle tient compte avant tout des réactions du public et différencie, à partir d’elles, les procédés qui les provoquent ; non qu’elle ne soit pas pardonnable, puisque vénérable et appuyée par une tradition mythologique (Thalie et Melpomène), l’autorité d’Aristote et de combien d’autres. Mais enfin elle n’est pas essentielle, et n’étant pas essentielle, elle s’est révélée dangereuse : on a plus été préoccupé de marquer entre la tragédie et la comédie des oppositions qui allaient de soi, que de souligner les points communs qui font que toutes les œuvres dramatiques, qu’il s’agisse d’Athalie ou des Fourberies de Scapin, ont les mêmes caractères fondamentaux. »
En vous référant à des exemples précis, vous commenterez et discuterez ces réflexions.
Session 1989
Saint-John Perse dit à propos de la poésie :
« L’obscurité qu’on lui reproche ne tient pas à sa nature propre, qui est d’éclairer, mais à la nuit même qu’elle explore, et qu’elle se doit d’explorer : celle de l’âme elle-même et du mystère où baigne l’être humain. Son expression toujours s’est interdit l’obscur, et cette expression n’est pas moins exigeante que celle de la science. »
(« Allocution au Banquet Nobel du 10 décembre 1960 », Paris, Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1972, p. 445-446)
En vous appuyant sur l’analyse d’exemples précis, vous direz dans quelle mesure vous partagez cette conception de la poésie.
Session 1988
Commentez et discutez ce jugement de Marthe Robert : « Ce qui importe d’abord dans la vie, selon un rabbin du Talmud (1) : transformer son miroir en une fenêtre ouverte sur la rue. C’est aussi la loi de toute littérature vraie, la fausse étant celle où l’auteur se contente de se contempler, en prétendant de surcroît que le lecteur y trouvera autant de joie qu’il en a pris lui-même à sa propre image. »
La Tyrannie de l’imprimé, Paris Grasset, 1984, p. 49
1. Talmud : « Compilation de commentaires sur la Loi de Moïse fixant l’enseignement des grandes écoles rabbiniques […]. Le Talmud est un des ouvrages les plus importants du Judaïsme. » (Larousse)
Session 1987
Francis Ponge écrit le
29 janvier 1954
À partir du moment où l’on considère les mots (et les expressions verbales) comme une matière, il est très agréable de s’en occuper. Tout autant qu’il peut l’être pour un peintre de s’occuper des couleurs et des formes.
Très plaisant d’en jouer.
Et pourquoi n’y aurait-il pas un public, une clientèle pour goûter ces jeux ?
Par ailleurs, c’est seulement (peut-être) à partir des propriétés particulières à la matière verbale que peuvent être exprimées certaines choses – ou plutôt les choses.
On me dira que telle n’est pas la fin de la parole. C’est possible. Et qu’on préfère aussi d’autres écrits, cela peut certes se concevoir.
Mais s’agissant de rendre le rapport de l’homme au monde, c’est seulement de cette façon qu’on peut espérer réussir à sortir du manège ennuyeux des sentiments, des idées, des théories, etc.
Pratiques d’écriture ou l’inachèvement perpétuel,
p. 89, Hermann édit., collection « L’Esprit et la Main », 1984.
Vous commenterez, en vous appuyant sur l’analyse d’exemples précis, ces propos de Francis Ponge et direz dans quelle mesure vous partagez la conception de la littérature qu’ils impliquent.
Session 1986
Roland Barthes, au cours d’une réflexion sur l’inanité et la valeur de l’écriture, exprime son hésitation à tenir un journal :
« Inessentiel, peu sûr, le Journal est de plus inauthentique. Je ne veux pas dire par là que celui qui s’y exprime n’est pas sincère. Je veux dire que sa forme même ne peut être empruntée qu’à une Forme antécédente et immobile (celle précisément du Journal intime), qu’on ne peut subvertir. Écrivant mon Journal, je suis, par statut, condamné à la simulation. Double simulation, même : car toute émotion étant copie de la même émotion qu’on a lue quelque part, rapporter une humeur dans le langage codé du Relevé d’Humeurs, c’est copier une copie ; même si le texte était « original », il serait déjà copie ; à plus forte raison s’il est usé : « L’écrivain, de ses maux, dragons qu’il a choyés, ou d’une allégresse, doit s’instituer, au texte, spirituel histrion » (Mallarmé). Quel paradoxe ! En choisissant la forme d’écriture la plus « directe », la plus « spontanée », je me le plus grossier des histrions. »
Roland Barthes,
Le Bruissement de la langue (1984).
En réfléchissant précisément sur la forme du journal que vous situerez par rapport à d’autres formes d’écriture, vous direz quels commentaires vous semblent appeler ces réflexions de Roland Barthes.
Session 1985
Jean-Claude Renard, rendant compte de son expérience de poète, analyse dans les lignes qui suivent la relation qu’il entretient avec son propre langage :
« Il a ses racines en moi comme j’ai mes racines en lui. Il est un miroir à double réflexion où je reconnais ce que je suis et ce que je ne suis pas. Par suite, c’est un miroir qui me trahit – aux deux sens de ce verbe. Car il donne de moi une image à la fois plus vraie et plus fausse que celle que je puis, consciemment ou inconsciemment, en donner moi-même. Plus vraie : parce qu’il m’explore et me dénude. Plus fausse : parce qu’il me dissimule et me change en sa fable. Mais c’est néanmoins un miroir où se dévoile ce que je fonde et ce qu’il fonde. Bref, ce que je crée me crée à son tour tout en se créant soi-même. De sorte que si le poème me parle et parle de moi sous un mode que ne saurait remplacer aucun autre langage, ne serait-ce point parce qu’il me récupère, tout entier ? »
Jean-Claude Renard, Une autre parole, 1981.
En vous appuyant sur des exemples précis, vous direz ce que vous pensez de cette réflexion contemporaine sur la poésie.
Session 1984
Parlant du « regard critique » porté sur les œuvres littéraires, Jean Starobinski écrit dans L’Œil vivant (1961) :
« Mieux vaut, en mainte circonstance, s’oublier soi-même et se laisser surprendre. En récompense, je sentirai, dans l’œuvre, naître un regard qui se dirige vers moi : ce regard n’est pas un reflet de mon interrogation. C’est une conscience étrangère, radicalement autre, qui me cherche, qui me fixe, et qui me somme de répondre. Je me sens exposé à cette question qui vient ainsi à ma rencontre. L’œuvre m’interroge. Avant de parler pour mon compte, je dois prêter ma propre voix à cette étrange puissance qui m’interpelle ; or, si docile que je sois, je risque toujours de lui préférer les musiques rassurantes que j’invente. Il n’est pas facile de garder les yeux ouverts pour accueillir le regard qui nous cherche. Sans doute n’est-ce pas seulement pour la critique, mais pour toute entreprise de connaissance qu’il faut affirmer :
« Regarde, afin que tu sois regardé. »
En vous référant à des exemples précis, vous direz ce que vous pensez de ces réflexions.
Session 1983
« … Le théâtre se définit par la relation triangulaire qu’il met en œuvre entre le personnage, l’auteur et le spectateur. De l’imaginaire à son inscription dans l’espace charnel de la scène, du champ de la mémoire collective à l’empire des signes, le chemin passe par la médiation du comédien, pris en charge à son tour par l’ordre général de la représentation : c’est là que le triangle se referme et que trouve son sens le cérémonial complexe du jeu. À la scène seulement le personnage rencontre sa matérialité, le signe sa signification et la parole son destinataire. »
R. Abirached, La Crise du théâtre dans le théâtre moderne,
p. 8-9, Grasset, 1978.
Vous analyserez et commenterez ces réflexions en vous appuyant sur des exemples précis.
Session 1982
« Il n’y a qu’un seul sujet de roman : l’existence de l’homme dans la cité et la conscience qu’il prend des servitudes entraînées par le caractère social de cette existence. La nature et la portée d’un roman dépendent alors des rapports qu’il institue entre l’auteur, les personnages et le public. (…) Le roman se dégage sans doute du milieu collectif où il a pris naissance, dans la mesure où, œuvre d’art, il aspire à trouver une forme. Comme récit au contraire, il y appartient profondément et y rentre pour ainsi dire. Il est un élément actif et vivant de la société, l’exprime pour une part et pour l’autre contribue à la transformer, indissolublement, mais en proportions variables, aveu et appel, représentation et volonté, peinture et dramaturgie, en un mot puissance qui modifie continuellement ses propres causes. »
Roger Caillois, Puissances du roman (1941).
En vous appuyant sur des exemples précis, vous direz ce que vous pensez de ces réflexions.
Session 1981
L’artiste selon Balzac ou selon Cézanne ne se contente pas d’être un animal cultivé : il assume la culture depuis son début et la fonde à nouveau, il parle comme le premier homme a parlé et peint comme si l’on n’avait jamais peint.
Merleau-Ponty, Sens et non-sens, p. 32, Nagel, 1966.
En recourant à des exemples précis, choisis de préférence dans le domaine littéraire, vous direz ce que vous pensez de ces réflexions sur le grand artiste.
Session 1980
Julien Gracq, dans Lettrines, met en valeur l’intérêt du « discontinu » dans l’œuvre d’art :
« On se préoccupe toujours trop dans le roman de la cohérence, des transitions. La fonction de l’esprit est entre autres d’enfanter à l’infini des passages plausibles d’une forme à une autre. C’est un liant inépuisable. Le cinéma au reste nous a appris depuis longtemps que l’œil ne fait pas autre chose pour les images. L’esprit fabrique du cohérent à perte de vue. C’est d’ailleurs la foi dans cette vertu de l’esprit qui fonde chez Reverdy la fameuse formule : « Plus les termes mis en contact sont éloignés dans la réalité, plus l’image est belle ».
Vous étudierez ces remarques, en vous appuyant sur des exemples que vous pourrez puiser dans l’ensemble du domaine littéraire.
Session 1979
Il apparaît… que la fonction littéraire ne peut être précisée que pour chaque époque ; dans la nôtre, le besoin d’évasion, le goût d’idéaliser, le talent de décrire, de peindre et d’informer, se sont effacés devant l’exigence de remâcher et de méditer les problèmes fondamentaux du sens de la vie.
On conçoit alors que le mot « littéraire » ne puisse être défini par le rôle et la fonction de l’activité qu’il désigne, puisque cette fonction change incessamment. Elle n’est jamais que l’accent que prend l’homme lorsque, dans son effort pour s’exprimer… il grave des signes conventionnels et intelligibles qui transcrivent intellectuellement sa voix profonde.
R.-M. Albérès, Bilan littéraire du XXe siècle,
p. 232, 233, Aubier, 1962.
Commentez et discutez cette opinion en vous efforçant de préciser par des exemples ce que recouvre la notion d’œuvre « littéraire ».
Session 1978
Lors d’un colloque à Cerisy-la-Salle, en septembre 1966, consacré aux « Tendances actuelles de la Critique », Jean-Pierre Richard achevait ainsi sa communication, Sainte-Beuve et l’expérience critique :
« Il faut se poser pour terminer la question suivante : quel est, au juste, le rapport du langage critique au langage qu’il critique ?…
La réponse que Sainte-Beuve lui-même fournit à cette question est simple : ce rapport est simplement de « filiation »… Le discours critique prolongerait en lui la parole de l’œuvre… Il formerait comme une couche de littérature seconde, indéfiniment continuée à partir de la littérature première…
Mais peut-être cela ne suffit-il pas encore à l’ambition critique, du moins à une ambition moderne. Non content de développer en lui à sa manière tout l’implicite des œuvres qu’il commente, le langage critique, ce langage-au-long-de, disons, si l’on veut, ce paralangage, prétend sans doute aussi d’une certaine manière se retourner « vers », « contre » le langage premier duquel il se voudrait si fidèlement issu… Voilà, je pense, l’autre fonction de la critique : c’est d’engager le sens à se maintenir dans l’œuvre à l’état d’éveil, c’est de l’appeler à s’y recommencer d’époque en époque, et d’individu en individu, sous le langage et devant l’exigence d’une sensibilité, d’une culture toujours autres. Si bien que, parallèle à la parole créatrice, il me semble que la parole critique entre aussi avec elle d’une certaine manière en concurrence…
Prolongement, provocation : voilà la double face du Janus critique… Fidélité médiatrice, infidélité provocante : c’est sans doute le double ressort de la fonction critique… »
Vous commenterez et apprécierez ce jugement, en étayant votre opinion d’exemples très précis.
Session 1977
« Entrer dans une œuvre, c’est changer d’univers, c’est ouvrir un horizon. L’œuvre véritable se donne à la fois comme révélation d’un seuil infranchissable et comme pont jeté sur ce seuil interdit. Un monde clos se construit devant moi, mais une porte s’ouvre, qui fait partie de la construction. L’œuvre est tout ensemble une fermeture et un accès, un secret et la clé de son secret. Mais l’expérience première demeure celle du « Nouveau Monde » et de l’écart ; qu’elle soit récente ou classique, l’œuvre impose l’avènement d’un ordre en rupture avec l’état existant, l’affirmation d’un règne qui obéit à ses lois et à sa logique propres. Lecteur, auditeur, contemplateur, je me sens instauré, mais aussi nié : en présence de l’œuvre, je cesse de sentir et de vivre comme on sent et vit habituellement. Entraîné dans une métamorphose, j’assiste à une destruction préludant à une création. »
Jean Rousset,
Forme et Signification, Introduction.
En vous appuyant sur votre expérience personnelle, votre expérience de lecteur en particulier, vous exposerez les réflexions que vous suggère ce texte.
Session 1976
Quelles réflexions vous suggèrent ces remarques d’un écrivain du XIXe siècle ? Vous exposerez votre opinion en l’étayant d’exemples précis.
« Il est difficile de devenir un bon prosateur si l’on n’a pas été poète – ce qui ne signifie pas que tout poète puisse devenir un prosateur. Mais comment s’explique la séparation qui s’établit presque toujours entre ces deux talents ? Il est rare qu’on les accorde tous les deux au même écrivain : du moins, l’un prédomine l’autre. »
Session 1975
Dans son livre Dionysos, apologie pour le théâtre paru en 1949, P. A. Touchard étudie successivement : I. les origines ; II. les genres ; III. l’atmosphère tragique.
Le chapitre IV, consacré à « l’atmosphère comique », commence ainsi :
« Nous n’aimons spontanément que nous-même et ne pouvons aimer les autres que comme nous-même. Ce mouvement par lequel je dois, pour l’aimer, me substituer à autrui, est le mouvement propre de la tragédie : s’il ne se produit pas, la seule condition essentielle à la naissance de l’atmosphère comique est réalisée. Dès le moment où le personnage sur scène ne me représente plus moi-même à l’instant que je vis, dès qu’il devient l’autre (et cet autre même qui est moi dans le passé ou dans l’avenir), la comédie peut s’épanouir. Son domaine est sans limite tant que je reste spectateur, tant que je ne me laisse pas prendre aux pièges de la charité, de la pitié ou de la crainte : elle ne court de dangers que par ses excès. Elle doit demeurer toujours en deçà de la frontière subtile et changeante qui sépare la cruauté de l’amour. Ces horizons sont étroitement soumis aux fluctuations de l’opinion ; c’est ainsi qu’aux régimes différents coïncident tour à tour, selon leur violence ou leur libéralisme, la comédie de caractère (la moins périlleuse), la comédie de mœurs, la comédie politique.
Dans la comédie, il s’agit donc toujours d’un autre que moi ou d’un moi que je rejette. Le seul engagement possible y est celui qu’implique toute volonté de rupture. De ce caractère fondamental de l’atmosphère comique découlent tous les autres. »
Quelles réflexions vous inspire ce texte ?
VERSION LATINE
La version latine n’est plus une épreuve du CAPES/CAFEP actuel.
Session 1975
En 133 av. J.-C., Rome reçoit en héritage les états d’Eumène, roi de Pergame, et en distribue quelques miettes aux roitelets locaux. La Phrygie est revendiquée simultanément par Mithridate et Nicomède, qui envoient chacun une ambassade pour faire valoir leurs prétentions. Auféius propose que la Phrygie soit donnée à Mithridate. Au cours de la discussion du projet de loi, C. Gracchus, qui voudrait que Rome conserve cette province, ouvre une parenthèse sur la vénalité de certains politiciens.
Nam uos, Quirites, si uelitis sapientia atque uirtute uti, et si quaeritis, neminem nostrum inuenietis sine pretio huc prodire. Omnes nos, qui uerba facimus, aliquid petimus, neque ullius rei causa quisquam ad uos prodit, nisi ut aliquid auferat. Ego ipse, qui apud uos uerba facio ut uectigalia uestra augeatis, quo facilius uestra commoda et rempublicam administrare possitis, non gratis prodeo : uerum peto a uobis non pecuniam, sed bonam existimationem atque honorem. Qui prodeunt dissuasuri ne hanc legem accipiatis, petunt non honorem a uobis, uerum a Nicomede pecuniam. Qui suadent ut accipiatis, hi quoque petunt non a uobis bonam existimationem, uerum a Mitridate rei familiari suae pretium et praemium. Qui autem ex eodem loco atque ordine tacent, hi uel acerrimi sunt ; nam ab omnibus pretium accipiunt et omnis fallunt : uos, cum putatis eos ab his rebus remotos esse, impertitis bonam existimationem ; legationes autem a regibus, cum putant eos sua causa reticere, sumptus atque pecunias maximas praebent, item ut in terra Graecia, quo in tempore Graecus tragoedus gloriae sibi ducebat talentum magnum ob unam fabulam datum esse, homo eloquentissimus ciuitatis suae Demades ei respondisse dicitur : « Mirum tibi uidetur si tu loquendo talentum quaesisti ? Ego, ut tacerem, decem talenta a rege accepi. » Idem nunc isti pretia maxima ob tacendum accipiunt.
Fragment d’un dicours de Caïus Gracchus,
recueilli et transmis par Aulu-Gelle,
Nuits attiques, XI, 10, 2-6
(207 mots)