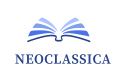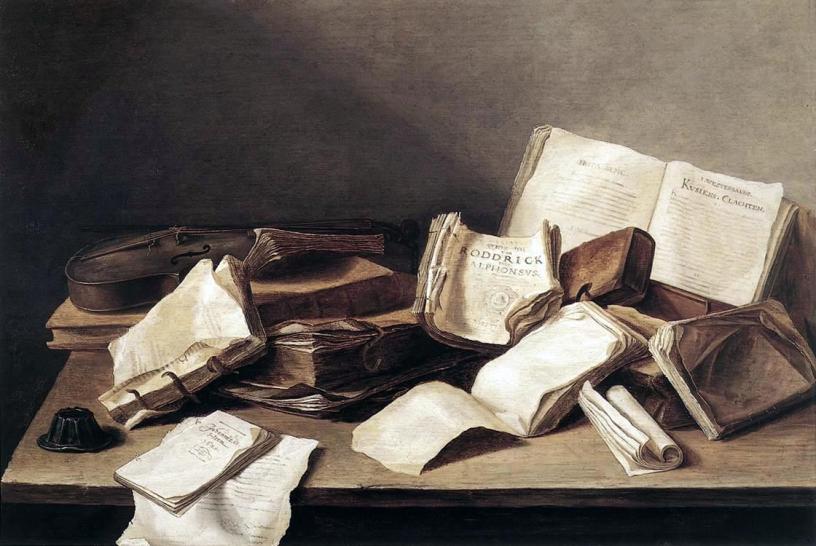Voir le Projet II.
L’instauration des concours internes de l’Agrégation a eu lieu en 1986.
Cette page consacrée à l’Agrégation interne de Lettres modernes regroupe les sujets de composition à partir d’un ou plusieurs textes d’auteurs (cliquez sur les liens ci-dessous) et ceux des compositions françaises, reproduits in extenso. Les rapports du jury sont également disponibles grâce à des liens.
Les sujets et les rapports des quelques dernières années se trouvent aussi, au format PDF, sur le site du ministère de l’Éducation nationale, de même que le descriptif des épreuves. Les programmes sont disponibles sur le site de l’Éducation nationale et dans les Bulletins officiels de l’Éducation nationale.
Les synopsis des sujets au début de chaque section permettent de voir les auteurs et les siècles qui sont tombés.
RAPPORTS DU JURY
COPIES
Retrouvez des exemples de réelles copies de concours sur cette page.
COMPOSITION À PARTIR
D’UN OU PLUSIEURS TEXTES D’AUTEURS
Session 2026
(Seconde – Littérature d’idées)
Session 2025
(Seconde – Roman)
COMPOSITION FRANÇAISE
2026 : Roubaud (poésie – XXe)
2025 : Koltès (théâtre – XXe)
2024 : Labé (poésie – XVIe)
2023 : Proust (roman – XXe)
2022 : Rousseau (roman – XVIIIe)
2021 : Sand (roman – XIXe)
2020 : Corbière (poésie – XIXe)
2019 : Marivaux (théâtre – XVIIIe)
2018 : Racine (théâtre – XVIIe)
2017 : Hugo (poésie – XIXe)
2016 : Yourcenar (roman – XXe)
2015 : Baudelaire (poésie – XIXe)
2014 : Sévigné (prose épistolaire – XVIIe)
2013 : Musset (théâtre – XIXe)
2012 : La Fontaine (poésie didactique – XVIIe)
2011 : Montaigne (littérature d’idées – XVIe)
Session 2026
Michèle Monte écrit dans un article consacré à Quelque chose noir :
« L’élégie selon Jacques Roubaud apparaît alors comme un parcours où fragmentation et répétition s’allient pour traduire la déstructuration apportée par la mort, l’arrêt du temps, le ressassement infini de la douleur, le chaos des souvenirs éparpillés et vains, mais où s’opère aussi la lente reconquête d’un ordre poétique qui redevient acceptable lorsqu’il s’est incorporé la douleur et la faille, lorsqu’il n’empêche pas la conscience de la ruine. »
Michèle Monte, « Quelque chose noir : de la critique de l’élégie
à la réinvention du rythme », dans Textuel n° 55, 2008, p. 86.
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture de Quelque chose noir de Jacques Roubaud ?
Session 2025
Marie-Françoise Benhamou écrit dans Koltès dramaturge :
« Sur fond d’“assombrissement” délibéré des causes et des finalités, chaque fragment de pièce éblouit par sa densité concrète, sa construction autonome, la netteté des enjeux apparents, et la multiplicité de ses résonances. Cet agencement singulier de la clarté et de l’opacité est un des traits les plus constants de la dramaturgie de Koltès ; elle fait toute la séduction de l’oeuvre : des constellations de langage d’une précision parfois presque maniaque détachent leur éclat sur les gouffres obscurs de la fiction. »
Marie-Françoise Benhamou, Koltès dramaturge,
Besançon, Les Solitaires intempestifs, 2014, p. 119.
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des oeuvres de Bernard-Marie Koltès au programme ?
Session 2024
Guy Demerson écrit dans Louise Labé. Les voix du lyrisme :
« La parole de Louise Labé est une parole lyrique, jouant des répétitions et des silences, écartant et réévoquant du même geste savant les motifs sonores, jouant des dissonances subtiles dans la régularité de la musique, agençant avec une précision mathématique les effets typiques de l’écho renversé. Elle soumet son univers lyrique à une structure sonore en faisant alterner les contraires ; se souvenir est une façon d’entrer en harmonie avec les rythmes cosmiques, c’est donc finalement se raccorder avec soi-même. »
Guy Demerson, Louise Labé. Les voix du lyrisme, Publications de l’Université de Saint-Étienne
et Éditions du CNRS, 1990, p. 11
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des Œuvres de Louise Labé ?
Session 2023
Évoquant l’expérience que fait le lecteur du Temps retrouvé, Bernard de Fallois écrit :
« Le lecteur de Proust est brusquement exposé à une double déconvenue : il découvre à la fois que le temps retrouvé ne l’a pas été, puisque la révélation triomphale qui clôt le livre consiste moins à retrouver le temps qu’à le supprimer, à la dépasser, à le dissoudre, et que la joie qu’il nous propose est aussi irréelle, aussi sublime et peu attirante qu’une vie éternelle où nous n’aurions plus ni cœur, ni visage, ni personnalité. Et il découvre en même temps que le salut cherché par Proust n’était valable que pour lui, qu’il a accompagné en vain l’auteur jusqu’à une vocation dont il est le seul à entendre l’appel. La dernière porte, qui s’était enfin ouverte après tant de tentatives infructueuses, s’est aussitôt refermée sur Proust. Il y a quelque chose de funèbre, et qui ne tient pas seulement à ce que la vieillesse et la mort en sont le décor extérieur, dans la magnifique musique du Temps retrouvé. »
Bernard de Fallois, « Lecteurs de Proust », 1959,
repris dans Sept conférences sur Marcel Proust, 2019, p. 291.
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture du Temps retrouvé ?
Session 2022
Commentant la « préface dialoguée » de La Nouvelle Héloïse à la lumière du courrier des premiers lecteurs du roman, Robert Darnton écrit :
« Comme la musique, [les lettres de Julie et de Saint-Preux] communiquent une émotion pure d’une âme à l’autre. « Ce ne sont plus des lettres… ce sont des hymnes. » Rousseau promet au lecteur qu’il accédera à cette sorte de vérité, mais seulement s’il veut se mettre à la place des correspondants et devenir en esprit un provincial, un reclus, un étranger et un enfant. À cette fin, le lecteur devra se délester du bagage culturel du monde des adultes et réapprendre à lire comme l’a fait Jean-Jacques avec son père qui a su devenir « plus enfant » que lui. »
Robert Darnton, Le Grand Massacre des chats,
Paris, Les Belles Lettres, 2011 [1985], p. 308.
Vous commenterez et discuterez ce propos à partir de votre lecture de Julie ou La Nouvelle Héloïse.
Session 2021
Dans « Le long chemin des retrouvailles », dernier chapitre de Les Aveux du roman, le XIXe siècle entre Ancien Régime et Révolution (édition Gallimard, collection Tel, 2004, p. 347), Mona Ozouf déclare à propos de « la muse romanesque » :
« Son talent récupérateur est celui du chiffonnier, du brocanteur : elle recueille tout ce que la pensée systématique néglige, ou dédaigne.
Jamais donc d’unité, mais une variété inépuisable. Jamais de fusion, mais des accommodements laborieux. Pas de pureté, mais une impureté féconde. Pas de perfection réalisée, mais un bricolage sans fin. Pas de raison à l’œuvre dans les destinées. C’est de ce désordre que les romans instruisent leurs lecteurs, et tout autrement que ne le fait l’histoire. Ils leur montrent le fossé qui sépare les faits et les
espérances, les lentes transformations des êtres, le pouvoir silencieux du temps. »
En quoi ces propos de Mona Ozouf éclairent-ils votre lecture de Mauprat de George Sand ?
Session 2020
Dans Tristan le Dépossédé (Gallimard, 1972, p. 21), Henri Thomas écrit :
« Pour Corbière, à qui la notion de poète comme être supérieur, vates, voyant, est aussi étrangère qu’elle le fut à Villon ou à Chaucer, les poèmes sont des chants, voire des chansons. […]
Un “poème”, plutôt écrit que parlé, lu, plutôt qu’écouté, reste loin de l’homme ; le chant, la chanson seulement murmurée, sont la parole vivante, qui faiblit ou s’exalte selon ce qui l’anime ; elle seule peut dire la vie, parce que son langage n’est pas celui de la raison, de la démonstration, aussi suspecte à Corbière que “l’Art”, mais celui des images et des rythmes qui s’appellent l’un l’autre dans une profonde cohérence, portés, bousculés par des rythmes auxquels on reconnaît immédiatement Corbière : ses trébuchements, ses repos, ses élans brisés et repris. »
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des Amours jaunes ?
Session 2019
Dans « Marivaux ou la structure du double registre » (Forme et signification, éditions José Corti, 1963, p. 57), Jean Rousset écrit :
« À cette composition volontaire et géométrique des ensembles qui trahit la main d’un ouvrier très conscient, très maître de ses situations et de ses personnages, s’oppose le cheminement imprévu, vagabond, capricieux du dialogue à l’intérieur des scènes, d’où tout plan paraît absent ; ici, les personnages semblent échapper à l’auteur et improviser en toute liberté ; la scène, à la différence de la pièce, est livrée à des êtres qui ne savent où ils vont et suivent toutes les impulsions de l’instant ; c’est la revanche du hasard. »
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture des œuvres de Marivaux au programme ?
Session 2018
« L’inscription de discours sentencieux dans le texte tragique constitue en réalité un moyen d’instruire le spectateur bien moins efficace que la représentation de passions et leur incarnation par des personnages engagés dans des actions. En fait, l’efficacité morale de la tragédie va de pair, tout d’abord, avec une conception du dénouement qui doit montrer le vice châtié et la vertu récompensée, et justifier la mort des personnages par quelque faute. Reste que cette conception providentialiste et idéale du dénouement ne permet pas de rendre compte de tous les dénouements tragiques […] »
Bénédicte Louvat, La Poétique de la tragédie classique, 1997, SEDES, p. 53.
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture d’Esther et d’Athalie ?
Session 2017
Dans un article intitulé « Hugo, ou le Je éclaté », paru dans la revue Romantisme, n° 1-2 (1971), Pierre Albouy écrit :
« Le moi, c’est-à-dire, encore un coup, le moi dans le poème, le moi qui parle et qui parle de lui, se fonde perpétuellement sur sa propre impossibilité. Dans cette béance de moi à je, se produit la voix ».
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture de l’œuvre de Victor Hugo Les Contemplations ?
Session 2016
« […] la compréhension de soi est une interprétation ; l’interprétation de soi, à son tour, trouve dans le récit, parmi d’autres signes et symboles, une médiation privilégiée ; cette dernière emprunte à l’histoire autant qu’à la fiction, faisant de l’histoire d’une vie une histoire fictive, ou, si l’on préfère, une fiction historique, entrecroisant le style historiographique des biographies au style romanesque des autobiographies imaginaires. »
Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, 1990, Seuil, p.138.
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture de Mémoires d’Hadrien ?
Session 2015
« Le poème en prose est une répétition de la poésie, à travers laquelle la poésie se
différencie rétrospectivement d’elle-même. En subvertissant l’opposition binaire « prose ou poésie » par une indétermination qui n’est ni tout à fait « ni poésie ni prose » ni tout à fait « à la fois poésie et prose », le poème en prose n’est ni extérieur ni intérieur à la poésie : tout en parlant de la poésie, il la parle et la déparle, la déplace précisément en la répétant. »
Barbara Johnson, Défigurations du langage poétique, 1979, Flammarion, p. 55.
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture du Spleen de Paris ?
Session 2014
Alain Viala note dans un article de la revue Europe « Un jeu d’images : amateur, mondaine, écrivain ? » (1996) :
« Femme du monde et de « bon goût », Mme de Sévigné n’écrit que ce que doit écrire une personne de ce statut : des lettres. Une femme du monde se devait de savoir bien tourner une lettre : de quel genre ? Non pas des lettres « pseudo privées » (comme faisait Guez de Balzac par exemple, qui « publiait »), mais de vraies lettres, qui ont de vrais destinataires, et donc une vraie pragmatique immédiate, de vrais relais de la conversation. »
Dans quelle mesure un tel jugement vous permet-il de rendre compte de votre lecture des Lettres de Mme de Sévigné ? Vous vous appuierez sur les lettres de l’année 1671.
Session 2013
Dans sa préface à l’édition de Comédies et Proverbes (Gallimard, 2010), Franck Lestringant déclare :
« Dans ce théâtre, le caprice tient lieu de fatalité. L’antique Nécessité de la tragédie grecque, cette force aveugle qui courbe les destins et brise les héros, est remplacée, dans les Comédies et proverbes, par son contraire, le hasard. Il n’y a plus chez Musset ni dieux ni fatalité. Le ciel habité d’autrefois s’est dépeuplé au-dessus de la tête des protagonistes. La Révolution est passée par là, avec son cortège de profanations et de Christs décloués. Le vide surplombe désormais le tourbillon des actions humaines. Le hasard est donc le principe de désordre et de liberté qui s’impose à tous les personnages, et avec lequel ceux-ci doivent constamment négocier. »
Dans quelle mesure ces propos éclairent-ils votre lecture de On ne badine pas avec l’amour, Il ne faut jurer de rien, Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée d’Alfred de Musset ?
Session 2012
« L’expérience par procuration que fait le lecteur de la Fable n’en est pas moins une expérience authentique : La Fontaine en a conscience, lui qui, dans la lignée des idéaux galants, bâtit à son tour une Arcadie grâce aux prestiges de la parole poétique. Tout le problème des rapports entre mensonge et vérité qu’il évoque souvent renvoie en fait à cette double réalité : le monde de la Fable est l’analogon (1) du nôtre, mais rendu plus lisible par la cristallisation des phénomènes en des figures allégoriques à la fois complexes et si semblables à l’homme, et surtout rendu plus euphorique par l’euphémisation d’une réalité souvent amère ou trop cynique ».
Emmanuel Bury, L’esthétique de La Fontaine, collection « Esthétique », SEDES, 1996, p. 47.
Commentez et éventuellement discutez ces propos en vous appuyant sur des exemples précis et variés.
(1) L’analogue.
Session 2011
« Dans l’ordre de l’analyse et de la saisie par le langage, l’essai est la formule qui se rapproche le plus de l’inconsistance des chimères, des divagations de la psyché. À peine Montaigne a-t-il atteint un équilibre ou esquissé une forme, qu’il les altère pour en chercher d’autres, et ainsi de suite. C’est la toile de Pénélope : il défait ce qu’il a tissé et, dans les trous du filet, dans le bougé de l’étoffe, laisse transparaître les inquiétudes de l’ouvrier, les surprises d’un esprit aux aguets. »
Dans quelle mesure ces remarques formulées par Michel Jeanneret en 1991 éclairent-t-elles votre lecture du livre I des Essais ?