Marie Nizet, Pour Axel, Paris, L’Harmattan, « Poésie(s) », juin 2023, 240 p., 16,50 €. Nouvelle édition réalisée par Raphaël Lucchini et Jérémie Pinguet. EAN13 : 9782140345814. Disponible en version numérique : 11, 99 €. EAN13 : 9782140345821.
BIBLIOTHÈQUE POÉTIQUE DES FEMMES, 3

Retrouvez ces informations sur le site des éditions L’Harmattan. Vous pouvez également y feuilleter les premières pages de l’ouvrage. Découvrez Marie Nizet grâce au podcast Poétesses.
Illustration de couverture :
Antoon Van Dyck (1599-1641), Autoportrait (vers 1620-1621),
huile sur toile (119,7 × 87,9 cm), The Metropolitan Museum of Art.
Pour Axel
La femme de lettres belge Marie Nizet, épouse Mercier (1859-1922), est l’autrice d’un livre à nul autre pareil : publié posthumément, son recueil de 1923 constitue un vibrant tombeau poétique dédié à la mémoire de son amant, l’officier de marine Cecil-Axel Veneglia, qu’elle présente comme le sosie du peintre flamand Van Dyck. Dès 1921, sous le pseudonyme de Missie, l’amoureuse endeuillée avait publié plusieurs poèmes, repris ensuite au sein de Pour Axel. Dans ce parcours émouvant mis en vers, elle offrit une vision plus vaste de cette intense passion : avec sincérité et simplicité, s’y mêlent en effet évocation douce-amère des souvenirs heureux, profonde sensualité, déchirement causé par le deuil, rêve d’une nouvelle union, vive conscience de la mort et ardente dévotion. Cent ans après la première parution de l’ouvrage, de récentes découvertes ainsi que deux cahiers manuscrits enrichissent cette nouvelle édition et éclairent la genèse de cette œuvre d’une étonnante modernité.
Après les recueils de Louisa Siefert et de Malvina Blanchecotte, le présent volume est le troisième du projet collectif de la « Bibliothèque poétique des femmes », qui a pour but de rendre à nouveau accessibles des recueils de poétesses des siècles passés.
Raphaël Lucchini (né en 1993) est professeur de Lettres modernes.
Jérémie Pinguet (né en 1993) est normalien et agrégé de Lettres classiques. Il est à l’origine de la « Bibliothèque poétique des femmes » (et anime aussi Neoclassica !).
Ils ont étudié ensemble à Lyon au sein des classes préparatoires littéraires du lycée Édouard Herriot et ont écrit, avec trois autres amis et collègues, 50 couples mythiques de la littérature, de l’Odyssée à Harry Potter.
Table des matières
Introduction, par Raphaël Lucchini et Jérémie Pinguet
Dévoiler les mystères d’une vie
Un contexte familial propice à l’écriture
Le cycle roumain ou l’éveil littéraire et politique
Vie de famille
Le cycle des nouvelles ou l’inspiration belge
Le silence et le tonnerre
Jusqu’au dernier souffle
Le cycle amoureux ou le chef-d’œuvre d’un cœur en émoi
Pour Axel, de Missie : brève étude littéraire d’un tombeau poétique d’exception
Heurs et malheurs d’une passion absolue
Sensualités à vif
Physique et métaphysique de l’amour
Le face-à-face de l’Amour et de la Mort et le triomphe de l’Art
Pour ne pas conclure : perspectives nizettiennes
Œuvres de Marie Nizet, épouse Mercier
Bibliographie indicative
Pour Axel
I. Sosie
II. Está mimoso !
III. Confession
IV. Le Jardin
V. La Voix
VI. Le Verre et la Tasse
VII. Vieille Légende
VIII. Sous un portrait de Gladys Mac Allen
IX. Le Printemps
X. L’Été
XI. L’Automne
XII. L’Hiver
XIII. Plus Haut
XIV. Les Errants
XV. À Melati
XVI. La Bouche
XVII. La Chanson de Mahéli
XVIII. Le Pétale
XIX. Dédaignée
XX. Le Gris et le Bleu
XXI. Ramasseurs de rayons de lune
XXII. Une Histoire
XXIII. Le Swastika
XXIV. L’Arbre
XXV. L’Insulinde
XXVI. Lettre sans adresse
XXVII. Fins dernières
XXVIII. Obsession
XXIX. Le Bouquet
XXX. Confidence
XXXI. Oubli
XXXII. Les Mains
XXXIII. La Torche
XXXIV. Amour posthume
XXXV. Offrande
XXXVI. Résurrection
XXXVII. La Mémoire
XXXVIII. Adieu
XXXIX. Trois Étapes
I. – Impression
II. – À Celui de Nazareth
III. – La Prière de Missie
XL. L’Insomnie
Notes sur l’établissement du texte
La Bibliothèque poétique des femmes
Bibliographie sur la poésie des femmes
Remerciements
Table des matières


Trois poèmes extraits
de Pour Axel
X
L’Été
Nous rôdons par les blés roussis que midi brûle.
Une fièvre amoureuse en nos veines circule.
Nous nous sommes couchés aux pentes des talus,
Sous le ciel bleu, moins bleu que le bleu de nos âmes,
Sous un soleil moins fort, moins ardent que la flamme
Qui consume nos sens… Et nous n’en pouvons plus.
Puis nous avons cherché les étangs et les saules.
J’ai posé mes deux mains, ainsi, sur vos épaules,
Afin de m’absorber mieux en votre beauté…
Et d’elle j’ai joui plus que je ne puis le dire
Et de vous je me suis grisée, et j’ai vu rire,
Dans vos yeux clairs, le rire immense de l’Été.
XXXIII
La Torche
Je vous aime, mon corps, qui fûtes son désir,
Son champ de jouissance et son jardin d’extase
Où se retrouve encor le goût de son plaisir
Comme un rare parfum dans un précieux vase.
Je vous aime, mes yeux, qui restiez éblouis
Dans l’émerveillement qu’il traînait à sa suite
Et qui gardez au fond de vous, comme en deux puits,
Le reflet persistant de sa beauté détruite.
Je vous aime, mes bras, qui mettiez à son cou
Le souple enlacement des languides tendresses.
Je vous aime, mes doigts experts, qui saviez où
Prodiguer mieux le lent frôlement des caresses.
Je vous aime, mon front, où bouillonne sans fin
Ma pensée à la sienne à jamais enchaînée.
Et pour avoir saigné sous sa morsure, enfin,
Je vous aime surtout, ô ma bouche fanée.
Je vous aime, mon cœur, qui scandiez à grands coups
Le rythme exaspéré des amoureuses fièvres,
Et mes pieds nus noués aux siens et mes genoux
Rivés à ses genoux et ma peau sous ses lèvres…
Je vous aime, ma chair, qui faisiez à sa chair
Un tabernacle ardent de volupté parfaite
Et qui preniez de lui le meilleur, le plus cher,
Toujours rassasiée et jamais satisfaite.
Et je t’aime, ô mon âme avide, toi qui pars
– Nouvelle Isis – tentant la recherche éperdue
Des atomes dissous, des effluves épars
De son être où toi-même as soif d’être perdue.
Je suis le temple vide où tout culte a cessé
Sur l’inutile autel déserté par l’idole ;
Je suis le feu qui danse à l’âtre délaissé,
Le brasier qui n’échauffe rien, la torche folle…
Et ce besoin d’aimer qui n’a plus son emploi
Dans la mort à présent retombe sur moi-même.
Et puisque, ô mon amour, vous êtes tout en moi
Résorbé, c’est bien vous que j’aime si je m’aime.
Une belle analyse de ce poème par Bruno Doucey se trouve sur France Radio dans une série intitulée « L’amour par cœur » (dixième épisode).
XXXVI
Résurrection
Et la Mort est entrée. Elle a dit : « C’est assez !
Je le veux à mon tour. Toi, viens, et toi, demeure ! » —
Puis sur le corps raidi, sur les membres glacés,
Elle a parachevé son œuvre, heure par heure.
Avec méthode, elle a d’abord terni les yeux ;
Elle a scellé la bouche, effacé le sourire.
Aux cheveux elle a pris leurs beaux reflets soyeux ;
Elle a changé la face en un masque de cire.
Rongeant sans cesse, enfin, elle a détruit la chair,
Évidé la poitrine et dénudé les hanches…
Ne laissant subsister de ce qui me fut cher
Qu’un squelette qui rit de toutes ses dents blanches…
Elle m’a dit alors : « Regarde ton amant.
À le voir sans dégoût oserais-tu prétendre ?
Il est semblable à moi sous ce déguisement,
Et, tel que le voilà, voudrais-tu le reprendre ?… »
Comme le peintre fixe avec de la couleur
Sur la toile un visage où l’âme se rallume,
Avec mon cœur ardent et ma sainte douleur
– Mais sans art – je l’ai fait revivre sous ma plume.
Entre les plus doux mots j’ai fait encore un choix
Pour recomposer mieux la radieuse image :
Ils ont brillé, ses yeux, elle a sonné, sa voix…
Et, tout entier, il a surgi de chaque page.
Et j’ai dit à la Mort : « Il est ressuscité !
Aussi beau qu’autrefois il renaît de sa cendre.
Il vit par mon amour et par ma volonté
Et, tel que le voilà, tu ne peux plus le prendre ! »

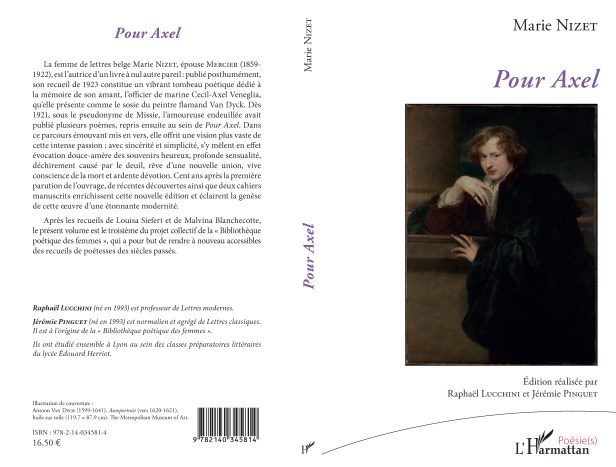
Œuvres de Marie Nizet,
épouse Mercier
Nizet Marie, Moscou et Bucharest, Versailles, E. Aubert, 1877. Poésie Google Books • KBR (avec la signature de l’autrice !) • voir infra sur cette page de Neoclassica
—, Pierre le Grand à Iassi, Paris, Auguste Ghio, 1878. Poésie Gallica • KBR (avec la signature de l’autrice !) • voir infra sur cette page de Neoclassica
—, România (Chants de la Roumanie), Paris, Auguste Ghio, 1878. Poésie Gallica • DONum (avec la signature de l’autrice !) • Google Books • voir infra sur cette page de Neoclassica
—, Le Capitaine Vampire. Nouvelle roumaine, Paris, Auguste Ghio, 1879 ; réédité à la suite de Dracula de Matei Cazacu, Paris, Tallandier, 2004, p. 499-632 ; traduit en roumain sous le titre de Căpitanul Vampir par Geangineta Daneş, Bucarest, Sigma, 2003 ; traduit en anglais sous le titre de Captain Vampire par Brian M. Stableford, Encino (Californie), Black Coat Press, 2007 ; réédité avec une postface de Laurent Thérer, Bruxelles, Espace Nord, 2025 (dossier pédagogique disponible sur le site de l’éditeur). Roman DONum • Wikisource • Espace Nord • Critique littéraire sur le site Le Carnet et les Instants
—, « Le Bonheur. Vers lus au banquet de l’Union littéraire, le 1er mars 1879 », in Revue de Belgique, 11e année, t. 31, 15 mars 1879, p. 333-335. Poésie Google Books • voir infra sur cette page
Anonymement, Le Scopit. Histoire d’un eunuque européen. Mœurs russo-bulgares, Bruxelles, Henry Kistemaeckers, 1880. Roman
Mercier Marie, « Le soufflet de la grand’mère », in Revue de Belgique, 15e année, t. 43, 15 avril 1883, p. 469-480. Google Books
—, « Histoire d’une fille de ferme », in Revue de Belgique, 15e année, t. 45, 15 septembre 1883, p. 49-56. Google Books
—, « Ceux des campagnes », in Revue de Belgique, 15e année, t. 45, 15 décembre 1883, p. 368-377. Google Books
—, « Une agonie », in Revue de Belgique, 16e année, t. 46, 15 février 1884, p. 135-146. Google Books
—, « La déconvenue de Monsieur Boniface », in Revue de Belgique, 16e année, t. 48, 15 septembre 1884, p. 26-45. Google Books
—, « Comment on oublie », in Revue de Belgique, 16e année, t. 49, 15 mars 1885, p. 263-279. Google Books
—, « Une vie d’enfant », in Revue de Belgique, 18e année, t. 54, 15 octobre 1886, p. 148-178 ; et 15 novembre 1886, p. 305-334. Google Books
Nouvelles
Nizal Missie, « Axel », in Le Flambeau. Revue belge des questions politiques et littéraires, Bruxelles – Paris, Lamertin – Berger-Levrault, 4e année, t. 2, no 6, 30 juin 1921, p. 251-256. Poésie Internet Archive
Mercier-Nizet Marie, Pour Axel, Bruxelles, La Vie intellectuelle, 1923. Poésie Gallica • KBR (édition imprimée de 1923) • Archives et Musée de la Littérature de Bruxelles (Manuscrit autographe 1 et Manuscrit autographe 2)
On en parle
• Jean Hartweg, compte rendu / recension de l’ouvrage dans L’Archicube, n° 36, juin 2024, p.

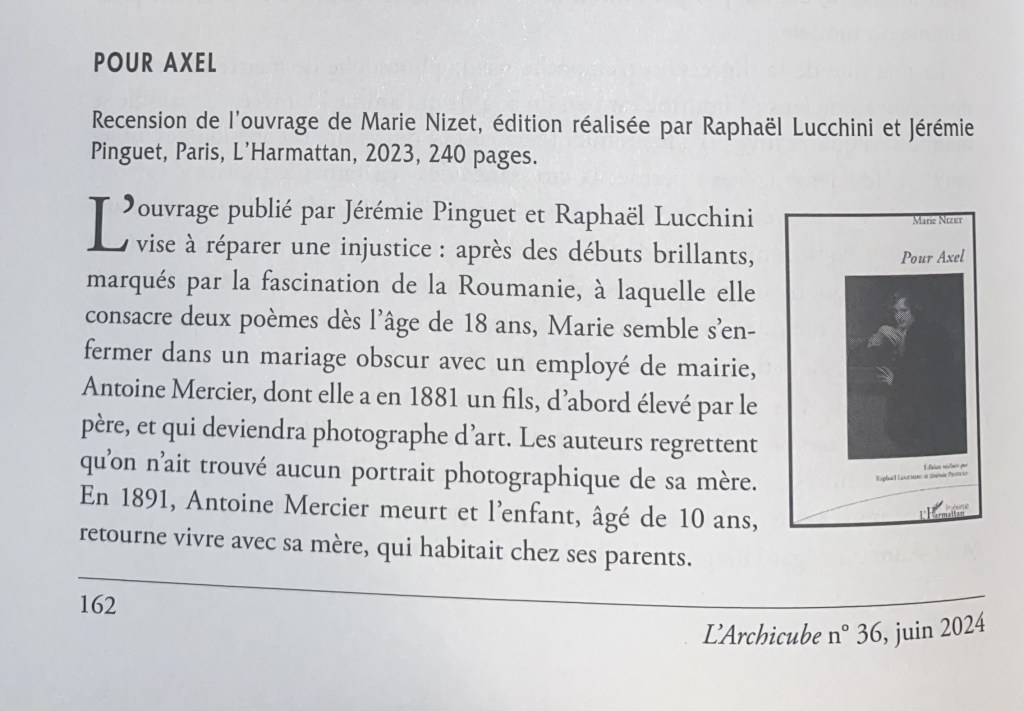
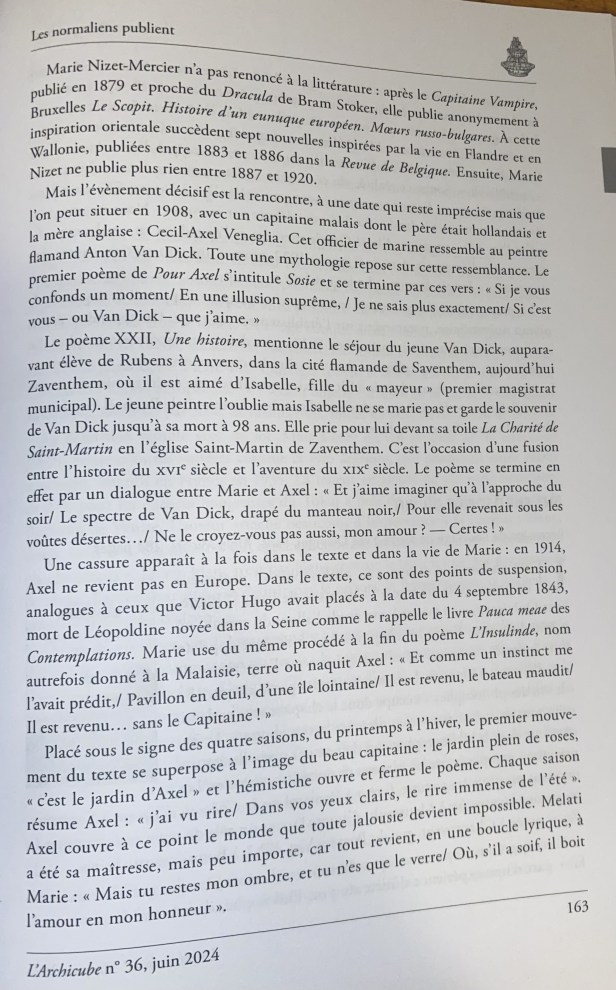
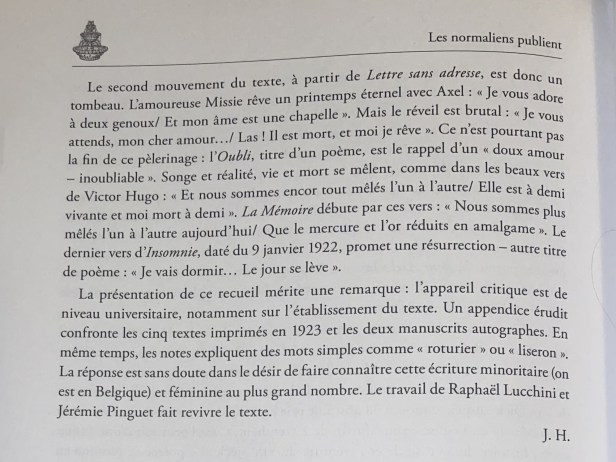
Documents sur la vie
et les œuvres de Marie Mercier-Nizet
Nous proposons ici une sélection de textes et de documents.
Bibliographie et documents littéraires
Une bibliographie plus complète se trouve dans notre édition ainsi que dans les deux contributions majeures de Maëlle De Brouwer.
DE BROUWER Maëlle, Pour Axel de Missie par Marie Nizet (1923). Étude et réinsertion d’une œuvre littéraire, mémoire de master, sous la direction de Lau-rence Brogniez, soutenu à l’Université libre de Bruxelles, 2017. Disponible en ligne sur Academia.
—, « Pour Axel de Missie (1923) par Marie Nizet. L’œuvre d’une Sapho “Fin de siècle” belge ? », in Textyles, revue des lettres belges de langue française, no 55, Nicole Malinconi, Laurent Demoulin et Pierre Piret (dir.), 2019, p. 179-194. Disponible en ligne sur OpenEdition Journals.
De très nombreux éléments biographiques et généalogiques ont été découverts par Luc Andries, que nous ne remercierons jamais assez, et sont consultables sur la généalogie « Andries-Mercier » sur Geneanet. La page Marie Nizet permet de retrouver tous les autres membres de sa famille grâce aux divers liens.
RENCY Georges (pseudonyme d’Albert Stassart), « Pour Axel, par Marie Mercier-Nizet », in L’Indépendance belge, 94e année, no 133, 13 mai 1923, p. 2. Disponible en ligne sur KBR. Georges Rency est l’éditeur de Pour Axel.
Voici un livre de vers qui échappe à la commune mesure et qui est aussi peu que possible ce que Verlaine abhorrait, c’est-à-dire de la littérature. Mais, pour me comprendre, il faut que le lecteur connaisse l’histoire de ces vers et celle de leur auteur.
Mme Mercier-Nizet est morte l’an dernier, au seuil de la vieillesse, après avoir longtemps et terriblement souffert d’un de ces maux qui ne pardonnent pas et consument la vie avant de l’éteindre. Elle garda auprès d’elle, jusqu’à la fin, le manuscrit de « Pour Axel », qui était le miroir fidèle de son existence et le testament de son esprit. Mme Cécile Gilson, elle aussi disparue, hélas ! prenait soin de l’agonisante, et lui promettait d’assurer, après elle, la publication de son livre. C’est ainsi que ce dernier fut présenté au Jury officiel chargé d’allouer des primes d’édition aux meilleurs ouvrages inédits d’auteurs belges. L’étonnement des membres de cette commission fut immense quand ils prirent connaissance de ces poèmes, où, pour la première fois peut-être, une femme amoureuse parle de son amant, comme un amant parle de sa maîtresse. L’audace est grande, aussi grande qu’ingénue, car, certes, Marie Mercier-Nizet ne crut pas être audacieuse en le faisant. Poussée par une force invincible à dessiner l’image fidèle et complète de son amour, elle s’est tout simplement laissée aller aux confidences, comme si elle n’écrivait que pour elle-même et pour elle seule. Mais, ayant du goût naturel et sachant écrire, elle a inscrit ces confidences dans une forme qui, toute dépourvue d’« art » qu’elle soit (c’est elle qui l’affirme, et c’est vrai), donne une impression plus vive, plus profonde et plus inoubliable que les vers les plus savants et les plus subtilement préparés. Je ne veux point dire que « Pour Axel » ait, d’un bout à l’autre, jailli du cœur de son auteur et soit demeuré ensuite sans retouche et sans correction. Je crois, au contraire, que le poète a beaucoup « travaillé » ses poèmes et les a maintes fois remis sur le métier. Mais son but, en les corrigeant, ne fut pas d’atteindre à des effets « littéraires ». Elle voulut seulement réaliser plénièrement la perfection de la ressemblance et rendre, sans aucune fausse note, le son authentique de son âme.
*
J’ai eu l’occasion de lire un long manuscrit en prose, dans lequel Mme Mercier-Nizet a fait le récit détaillé de sa grande aventure amoureuse. Il est regrettable vraiment que l’on ne puisse donner le jour à cette œuvre étonnante qui dit tout, sans ménagement aucun, sans pudeur, sans réserve, mais aussi sans intention vicieuse, sans libertinage, avec une gravité joyeuse, avec une ardeur presque religieuse. Il semble que ce soit l’unique fois, depuis le commencement du monde, qu’une femme ait écrit la vérité, la vérité nue sur ses sentiments et sur ses sensations. Je sais bien qu’il y a Mme de Noailles et, dans un autre ordre d’idées, Renée Vivien. Mais la « sincérité » de ces deux-ci apparaît comme voulue, et on dirait qu’elles ont l’une et l’autre le désir d’étonner, voire de scandaliser. Mme Marie Mercier-Nizet n’appartient à aucune école : elle se raconte, sans penser le moins du monde au jugement, moral ou littéraire, qu’on portera sur sa confession.
Donc, après une jeunesse triste, tourmentée d’aspirations vers l’inconnu qui délivre du réel et du lamentable joug quotidien, elle rencontre, par hasard, chez des amis, un officier de marine hollandais, et c’est, à la lettre, le coup de foudre. Dès le premier regard, elle est prise, conquise, envoûtée. Elle l’a vu et elle l’a trouvé beau. Tout de suite elle a eu, impérieux, irrésistible, le désir d’être serrée dans ses bras, d’être sa chose pour la vie et pour l’éternité. Cet appétit de volupté, comme la femme, d’ordinaire, le dissimule ! Avec quel soin hypocrite elle le dérobe sous de belles phrases, où il est question d’élan des âmes et de communion des esprits ! Il s’agit ici de tout autre chose. C’est une chair ardente qui appelle une autre chair, et qui réclame le plaisir, mais un plaisir dont l’acuité formidable aura déjà l’avant-goût des voluptés de l’Au-delà. On ne confondra pas l’amour de Missie pour Axel (Missie est le nom d’amour du poète) avec ces éphémères liaisons qui se dénouent dans l’indifférence réciproque. La mort même n’a pu en avoir raison. Les nœuds qu’il a serrés, la force divine elle-même serait impuissante à les trancher.
Né par hasard aux îles de la Sonde, d’un père hollandais et d’une mère anglaise, Axel était le vivant portrait de Van Dyck et l’amour le Missie pour le bel officier parait celui-ci de tout le prestige de son sosie immortel. Il semble bien qu’Axel fut celui des deux qui aima le moins. En tout cas, la passion de sa maîtresse ne fut pas assez forte pour le déterminer à renoncer à la mer. Périodiquement, il partait pour les Indes et ne lui revenait qu’après de longs mois de séparation. Un jour, il ne revint pas. Une mort soudaine l’avait terrassé, à Java. Missie était en Europe quand elle apprit la nouvelle. Elle partit aussitôt pour aller baiser la pierre sous laquelle dormait à jamais son ami. Et elle s’occupa de faire revivre celui-ci en deux confessions, l’une en prose, l’autre en vers, de façon à ce que le mort vécût tout d’abord avec elle jusqu’à sa propre fin, et continuât de vivre après, peut-être, si elle était capable de donner à sa figure un suffisant relief. Sent-on, à présent, la qualité exceptionnelle de cette poésie et qu’elle ne peut être jugée d’après le critère habituel ? Lamartine dans le « Lac », Victor Hugo, dans les poèmes où il évoque le fantôme adoré de sa fille, ont seuls fait un effort aussi émouvant pour sauver un être de la destruction totale et de l’impitoyable oubli.
*
Mais il faut ouvrir ce livre avec le respect effrayé qui soulève un linceul. Dès le seuil se superposent les deux visages, celui d’Axel et celui de Van Dyck, et s’affirment cette beauté, ce charme, ces « larges yeux doux », cette « bouche sensible et tendre » qu’ils possédaient tous deux, ainsi que par l’effet d’une mystérieuse réincarnation. L’admiration de Missie pour Van Dyck, admiration remontant à son âge le plus tendre, la préparait à aimer cet homme qui ressemblait si extraordinairement au génial artiste. Et c’est la peinture des troubles, des vertiges, des divines pâmoisons de l’amour. Tout n’est que parfums, couleurs, musique, enchantement. Tel verre de Varin – admirable – et telle tasse de Sèvres – merveilleuse – ne valent que parce qu’Axel les a « consacrés au contact de ses lèvres ». Tout est beau, émouvant, pathétique, de tout ce qu’il touche ou qui le touche. Et Missie effleure à peine sa joue de son baiser, tant elle craint de ternir sa délicate fraîcheur. Jamais un homme ne fut aimé de la sorte. Jamais, jamais ! Axel incarne en lui toutes les saisons : la grâce limpide du Printemps, le rire immense de l’Été, l’ardeur morbide de l’Automne, les présages de mort de l’Hiver. Il est toute la nature et toute la vie. Jamais un homme ne fut pour une femme ce qu’il fut pour Missie, jamais, jamais !
Il est pour elle la vie, et aussi l’au-delà de la vie :
PLUS HAUT !
Ami, quand nous avons escaladé les cieux,
Que notre amour a fait de nous presque des dieux,
Quand nous avons franchi les limites sublimes,
Que nous ne pouvons descendre encor des cimes
Et que nous palpitons au plus haut des sommets
Que nos sens révulsés puissent joindre jamais,
Ne sens-tu pas qu’il est encore d’autres sphères,
Et d’autres régions et d’autres atmosphères ?
Si haut que nous soyons, nous contemplons d’en bas
Cet Éden interdit où nous n’atteindrons pas.
Et vois-tu alors, par une grâce insigne,
La radieuse Mort qui de loin nous fait signe ?
Ils s’aiment à tel point qu’ils voudraient secouer toute civilisation et ressusciter en eux les amants des premiers jours du monde. À tout le moins, ils s’en iront dans les grands bois imiter les amours vagabondes de ceux qui n’ont pour s’unir que les fourrés et dont les caresses sont pimentées par l’inquiétude d’être surpris. Quand Axel est aux Indes, il a une maîtresse indigène. Missie ne l’ignore pas. Est-elle jalouse de cette femme ? Non, puisqu’en l’étreignant, c’est elle, l’amante lointaine, qu’Axel étreindra.
Tout lui rappelle l’amant : un pétale de rose qu’elle ramasse et baise lui rappelle des voluptés interdites. Elle n’a jamais dit assez sa soumission, sa joie de s’offrir, son besoin de sacrifice et d’humiliation.
Maître, je voudrais consacrer ma vie
À baiser le sol que foulent tes pas.
Même, tu peux bien, si c’est ton envie,
Marcher sur mon corps dont tu ne veux pas.
Et puis, c’est l’effroyable chose, c’est le grand navire qui revient de là-bas sans son capitaine, c’est le deuil éternel qui commence pour Missie. Tout d’abord, elle ne se rend pas à l’évidence. Elle l’attend comme s’il pouvait venir encore. Et elle évoque les caresses qu’ils échangeront. Rien n’égale l’ardeur et la passion farouche des vers où elle dit cette attente et cette fièvre funèbre. Puisqu’il ne vient pas, c’est elle qui s’en va vers lui et qui s’imagine, morte, venant implorer une place à son côté :
Notre chair, lambeau par lambeau,
Va se dissoudre en pourriture.
Reprise, à travers le tombeau,
Par le creuset de la nature :
Nos os, par un beau soir d’été,
Tomberont les uns sur les autres…
Ne plus savoir – ô volupté ! –
Quels sont les miens, quels sont les vôtres !…
Connaissez-vous des accents plus directs, plus magnifiques que l’amour ait inspirés ?
De son ami mort, elle parle à tout le monde. Mais ses confidences n’intéressent pas ces gens qui ne l’ont point connu. Alors elle les crie à la nature. Elle dit à la nuit, aux nuages, à la forêt, aux oiseaux, aux fleurs qu’il était beau, qu’il était bon et qu’elle l’aimait… Et la nature l’écoute. Et elle a ce cri superbe :
Bois obscurs, cieux illuminés,
Ah ! comme je comprends que vous me comprenez !
En vain veut-elle écouter ceux qui lui conseillent d’oublier. Partout une invisible main l’effleure : c’est la sienne. Partout un regard voilé la suit et brille doucement dans la nuit : c’est son regard inoubliable.
Ses mains, que la mort pour jamais a croisées, ses mains dont elle a conservé sur elle l’empreinte, comme elle s’en souvient impérissablement ! Elle leur consacre quelques-uns de ses vers les plus pénétrants. Et ne pouvant plus les presser contre ses lèvres, c’est elle-même, son corps, ses bras, ses doigts experts aux caresses, c’est son cœur qu’elle aime puisqu’en s’aimant, c’est encore lui, résorbé tout en elle, qu’elle chérit.
Elle l’évoque aussi tel que, dans le sépulcre, la mort l’a transformé. Et elle rêve l’impossible étreinte de ses bras d’ossements se refermant sur elle.
Et je donnerais tout, espoirs et lendemains,
– Tant ce désir affreux de vous me met en fièvre –
Pour tenir votre tête morte entre mes mains
Et baiser longuement votre bouche sans lèvres…
Au surplus, est-il mort ? Et la mort a-t-elle réussi à le lui prendre tout entier ? Non, puisqu’elle l’a fait revivre sous sa plume, qu’elle a recomposé son visage, qu’il vit à présent par son amour et par sa volonté et que, tel que le voilà, la mort ne peut plus le ravir.
Le temps passe sans pouvoir les séparer :
Nous sommes plus mêlés l’un à l’autre aujourd’hui
Que le mercure et l’or réduits en amalgame ;
Et l’on ne peut pas plus me séparer de lui
Que l’arbre de l’écorce et que l’air de la flamme.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Son cœur mort et le mien tiennent au même fil.
Il est ma longue nuit, ma ténébreuse aurore…
Mon cerveau défaillant même l’oubliât-il
Que mon sang et ma chair s’en souviendraient encore.
L’oublier ! Si je peux, âme usée et corps las,
Commettre enfin la faute indigne et sans seconde,
Je sais que, pour la perte effroyable du monde,
Le soleil de demain ne se lèvera pas !
Mais l’âge est venu, l’âge et la maladie, et avec eux l’imminence du grand départ. Dans cette âme païenne, que la douleur a si longtemps tourmentée, se réveille tout à coup le désir de la prière. La Croix du Golgotha se dresse au tournant du chemin. Et la main de Jésus se pose doucement sur ce front brûlant. Croit-elle derechef au Nazaréen ? Elle s’efforcera du moins de croire qu’elle croit en celui qu’on recloua si souvent sur la croix, mais elle ne franchira pas les portes du temple où l’on prêche de bouche et non d’exemple. Elle rentre, brisée, au sein du Dieu de son enfance :
Mais, quand j’aurai suivi jusqu’au bout votre voie
– Ainsi que vous l’avez promis en vérité –
Dans la splendeur d’amour de votre Éternité,
Faites qu’il me retrouve et que je le revoie !…
C’est sur cette note d’apaisement et de spiritualité que s’achève cet hymne de douleur et de volupté, certes l’un des plus beaux qui soient sortis de la bouche d’une femme. On y a joint une dernière pièce : « L’Insomnie », trouvée sur le lit de mort du poète : Prière suprême du pauvre être moribond qui souffre et appelle en vain le sommeil, sorte de litanies balbutiées, vision macabre, défilé hallucinant de tout ce qui le hante et l’oppresse. Il est là aussi, lui, le cher visage…
Hélas, je n’ai plus de visage !
Dit la voix qui sort du chaos…
Des os, des os, rien que des os !
Où sont les yeux, le nez, la bouche ?
Ce que je sens, ce que je touche,
Rien que des os ! Grâce, mon Dieu !
Peu à peu la fantasmagorie horrible s’efface :
Je vais dormir… Le jour se lève.
Il est levé pour elle, à présent, le jour éternel. Mais, jusqu’à la fin, elle a lutté pour sauver l’image de son amour. Et cet effort pour vaincre le néant lui a donné quelque chose du sombre génie de François Villon.
Georges Rency.
Autour de Pour Axel
Enregistrement vocal de quelques poèmes du recueil
Raphaël Lucchini et Éléonore Rambaud, qui ont respectivement édité Pour Axel de Marie Nizet et Nouvelles poésies de Malvina Blanchecotte et qui ont tous les deux fait des études de littérature (avec moi) mais aussi de théâtre, m’ont fait l’amitié d’enregistrer quelques-uns des plus beaux poèmes du recueil. Christine Vulliard, Guilhem Dedoyard et moi-même nous sommes également prêtés à l’exercice.
Il faut parfois recharger la page pour que les fichiers audio s’affichent correctement
Bonne écoute !
Lus par Raphaël Lucchini :
Lus par Éléonore Rambaud :
Lus par Guilhem Dedoyard :
Lus par Christine Vulliard :
Iconographie
Ces deux tableaux sont cités dans le premier poème de Pour Axel, « Sosie ».

Autre représentation au Musée de Strasbourg

Ce tableau est cité dans le vingt-deuxième poème de Pour Axel, « Une Histoire ».

La Charité de Saint Martin ou Saint Martin et le mendiant, église de Zaventem
Éléments biographiques
Sélection
Marie Nizet, épouse Mercier (1859-1922)
Acte de naissance

Acte de mariage
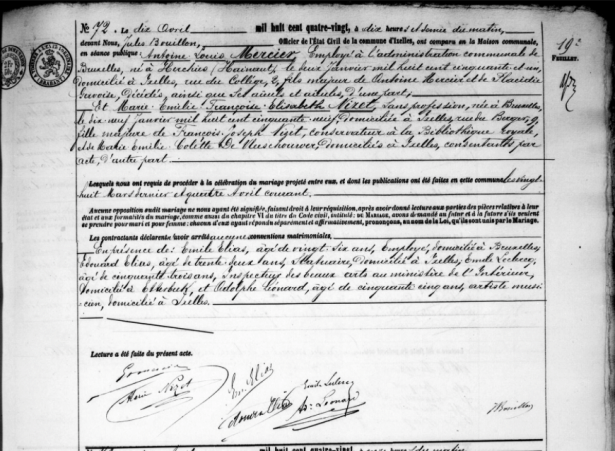
Acte de décès
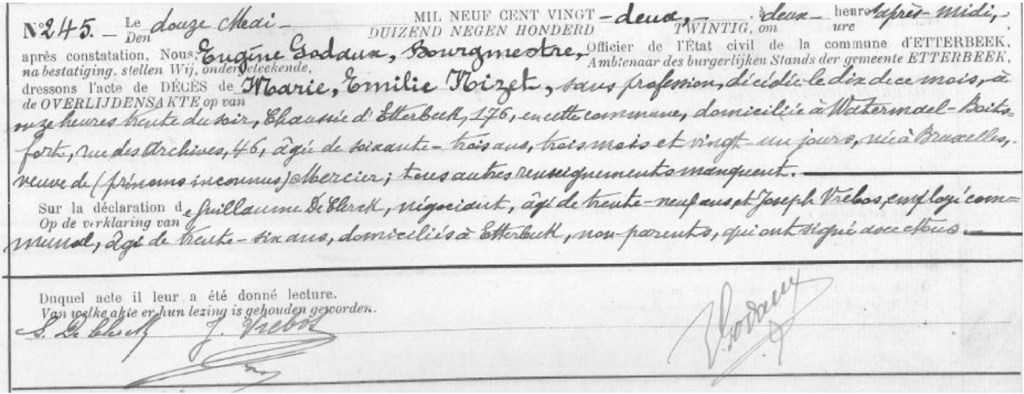
Henri Nizet (1863-1925)
Acte de naissance
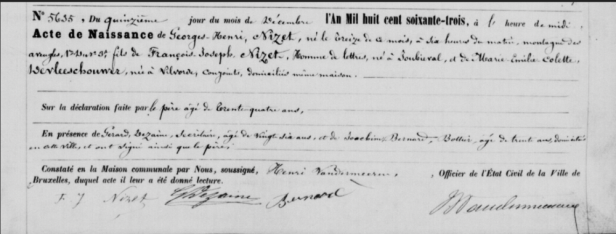
Acte de décès
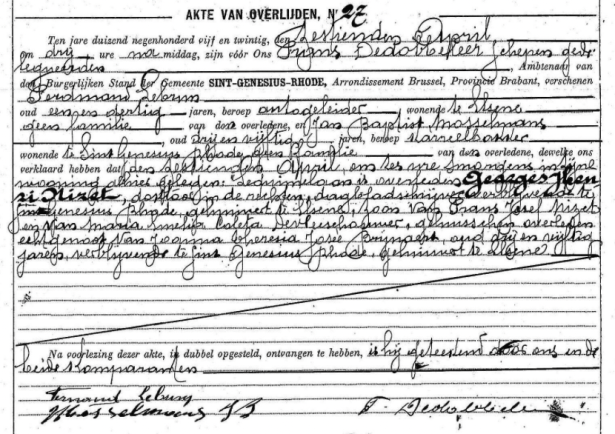
Le frère de Marie fut également un auteur, mais aussi un journaliste.
Bruxelles rigole… Mœurs exotiques (1883) Gallica • Google Books
Suggestion… (1891) Gallica
Antoine Mercier (1851-1891)
Acte de naissance
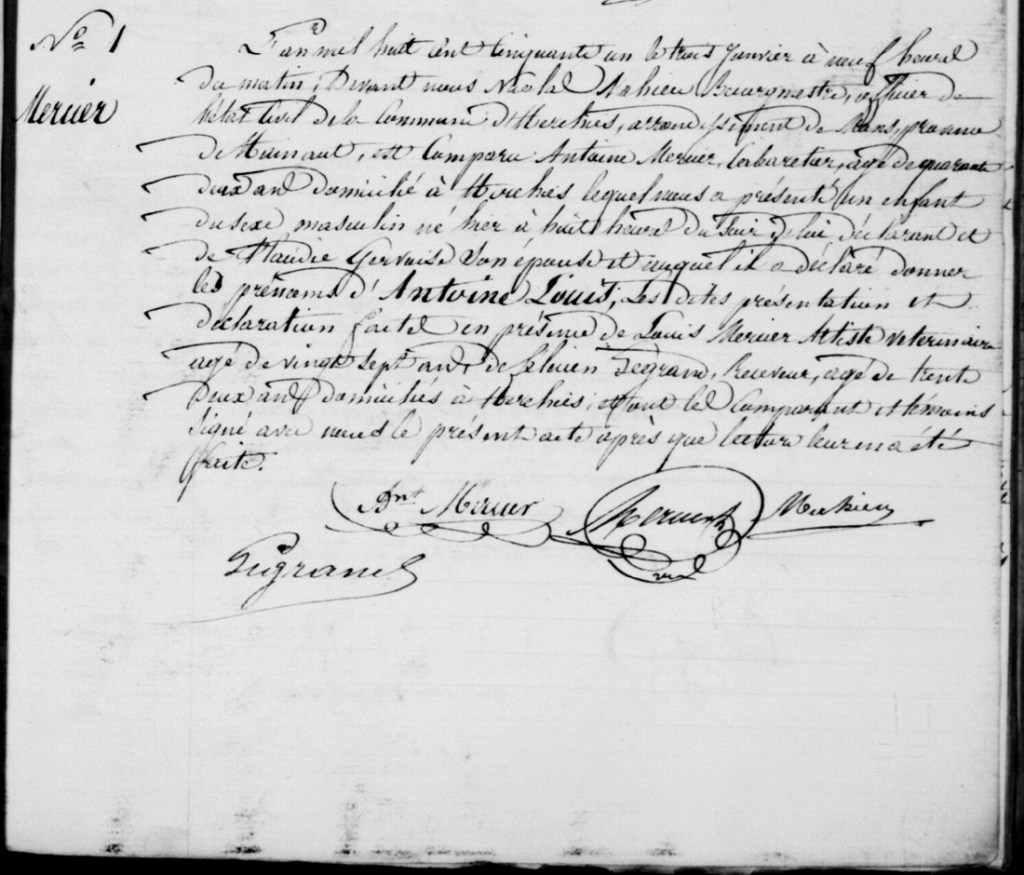
Acte de mariage (cf. supra)
Acte de décès
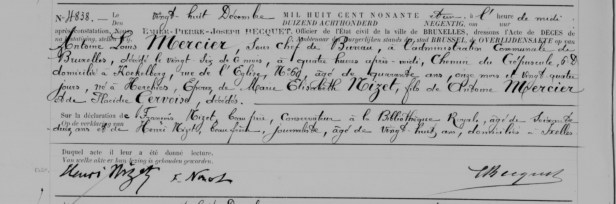
Émile Mercier (né en 1881)
Acte de naissance
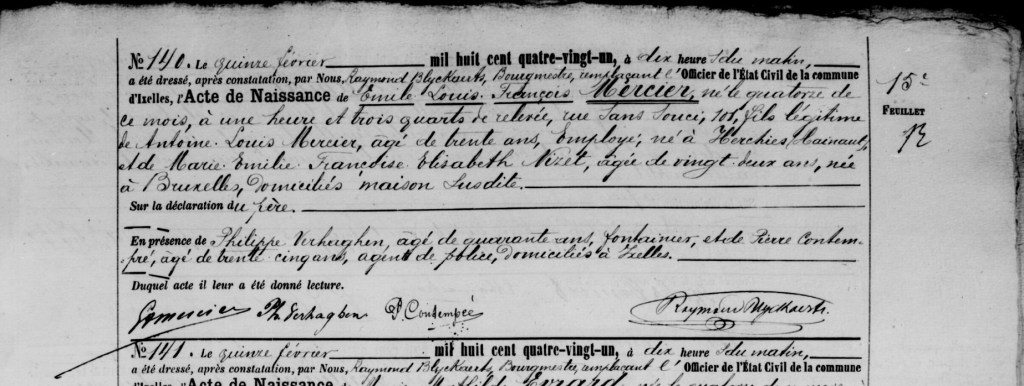
Louis Mercier (né en 1904)
Acte de naissance
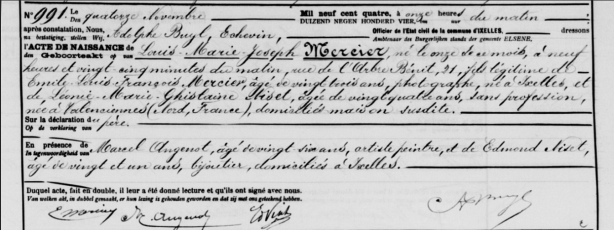
Cécile Dupont, épouse Gilson de Rouvreux,
Cécile Gilson en lettres (1880-1923)
Celles qui sont restées, Bruxelles, Oscar Lamberty, 1919, avec une préface d’Albert Giraud Wikisource
Ressources diverses
Archives de l’État en Belgique
Archives de la ville de Bruxelles
La Digithèque des bibliothèques de l’Université libre de Belgique — Périodiques numérisés dans le cadre de l’Action de Recherche Concertée
Poésies de Marie Nizet
Marie Nizet, Moscou et Bucharest, Versailles, E. Aubert, 1877. Google Books • KBR (avec la signature de l’autrice !)
Moscou et Bucharest
Unul o face, altul o pate.
(L’un l’a fait, l’autre en souffre.)
Proverbe roumain
I
La nuit était bien longue, et, pour tromper l’attente,
Deux soldats étaient là qui causaient sous la tente.
Le sort, en tête à tête, ainsi les avait mis.
Ils n’étaient cependant pas nés pour être amis.
L’un avait la pâleur, la chevelure blonde
D’un Barbare et les yeux verdâtres comme l’onde.
L’autre était tout bronzé des rayons du soleil,
Et son regard brillait, à l’étoile pareil.
Ni le cœur, ni l’esprit, ni le fond, ni la forme,
Rien n’était identique en eux que l’uniforme
Et l’âge : tous les deux venaient d’avoir vingt ans.
Ils se fussent haïs sans doute en d’autres temps,
Chacun dans leurs foyers, loin des cieux de la Thrace,
Car tout les divisait, le rang comme la race ;
Ils suivaient dans la vie un différent chemin,
L’un était Moscovite et l’autre était Roumain.
Dans ses États alors, Hohenzollern lui-même
Ne régnait plus de fait et le maître suprême
Était le Czar, qui seul, les avait conduits là.
Le Roumain se taisait et le Russe parla.
Il descendait, dit-il, d’une illustre famille,
Étant de ces boyards dont le pays fourmille,
Vampires tout repus du sang des paysans,
Tyrans cruels chez eux et lâches courtisans
Courbés aux pieds du Czar devant lequel ils tremblent,
Sous les murs du Kremlin, où parfois ils s’assemblent.
Il portait un grand nom : Fratief ou Vasilief,
Un de ces noms maudits au sinistre relief
Qui rappellent de loin la Pologne asservie
Et ces mots trop fameux : L’ordre est à Varsovie !
Les terres, qu’en mourant, son aïeul lui légua,
S’étendaient du Niémen aux sources du Volga ;
Et c’était par milliers qu’il comptait les esclaves
Gémissant sous son joug affreux : malheureux Slaves
Que presse le bâton d’un Cosaque endurci,
Qui n’osent ni pleurer, ni demander merci,
Quand la charge est trop lourde et que le fardeau crie ;
Tant ils ont peur du knout et de la Sibérie !
— De même que le fauve au fond de son réduit,
Il sommeillait le jour, n’agissait que la nuit ;
Il fuyait le soleil, recherchait les ténèbres ;
L’ombre favorisait ses débauches funèbres.
Il n’aimait que lui-même et se raillait de tout ;
Il ne craignait personne, on le craignait partout.
Associant le meurtre aux ignobles orgies,
Du sang de ses moujiks (1) ses mains étaient rougies
Plus encor que de vin, au sortir des repas.
Il frappait pour frapper et ne distinguait pas
Le juste de l’injuste. Au bruit de ses scandales
Moscou se réveillait. Il traînait sur les dalles
Ce que l’on révérait comme grand et sacré.
Son œil glauque et vitreux n’avait jamais pleuré.
Il dépensait sa vie en des bouges infâmes
Et ne respectait rien ; rien, pas même les femmes
De ses propres amis qui laissaient faire, car
Ils savaient l’offenseur en crédit près du Czar.
Menacés, s’ils parlaient, d’une disgrâce prompte,
Ils souriaient à qui les abreuvait de honte.
L’autre, de leur affront n’éprouvait nul plaisir,
Dans son cœur gangrené n’ayant plus un désir.
Lentement à son front montait la lassitude.
Il faisait seulement le mal par habitude.
Jadis, il s’égayait encor aux maux d’autrui,
Mais rien ne pouvait plus distraire son ennui
Maintenant. Il disait avec effronterie
Qu’il ne comprenait pas qu’on aimât sa patrie,
Et trouvait fort stupide et fort inconvenant
Qu’on l’envoyât ici, comme un simple manant,
Se battre, lui boyard, qui détestait la guerre
Et qui d’être tué ne se souciait guère.
Sanguinaire, mais lâche, il faisait bon marché
Des tortures du serf à la glèbe attaché,
Et lui-même n’osait affronter la souffrance.
Athée, il n’avait point la sublime espérance
D’une nouvelle vie au-delà du trépas ;
Il allait proclamant que Dieu n’existe pas,
Que la mort, c’est la fin ; que l’homme n’a point d’âme,
Et que le néant seul l’attend et le réclame !
Puis ayant achevé son récit odieux,
Il éclata de rire.
Alors, levant les yeux
Sur cet étrange fou dont le rire cynique
Prolongeait dans la nuit un écho sardonique,
Le Roumain secoua la tête tristement
Et, sans un mot de blâme, il reprit lentement :
Je n’ai point, comme vous, dans un palais splendide,
Vu s’écouler les jours d’une enfance rapide.
Un tronc d’arbre creusé fut mon humble berceau (2),
Tout jeune, le travail me marqua de son sceau,
On m’apprit de bonne heure à marcher dans la vie,
Et je pus contempler sans haine, sans envie,
Vos titres, vos trésors. Car notre nom obscur,
S’il n’était point illustre, au moins se trouvait pur
Du stigmate infamant et de la tache immonde
Qui souillent trop souvent les noms des grands du monde.
De simples paysans ont été mes aïeux ;
Moi, j’ai voulu rester un paysan comme eux :
Ainsi qu’ils l’avaient fait, j’ai cultivé la terre.
— Mon père étant fermier d’un riche monastère (3)
Voyait tout son labeur chèrement acheté ;
L’Igoumène était moins un maître redouté (4)
Qu’un ami bienveillant à l’aspect vénérable ;
Et c’est à sa bonté que je suis redevable
Du modeste savoir qui faisait mon orgueil
Lorsque j’étais enfant. À notre pauvre seuil
Le bonheur semblait s’être arrêté dans sa course.
La moisson n’était pas notre unique ressource,
Nous possédions encor nous-mêmes quelque bien,
Et, satisfaits de peu, nous ne manquions de rien.
— Dans nos jours fortunés, le malheur nous épie,
Il est, à nos foyers, comme une hydre accroupie,
Et nos yeux éblouis ne l’aperçoivent pas.
Quand la vie est en fleur songe-t-on au trépas ?
Spectre affreux, qui déjà dans l’ombre nous regarde !
… Et mon père mourut, remettant à ma garde
Ma mère avec ma sœur, une enfant de six ans.
Pour moi vinrent alors et les soucis pesants
Et les mille tracas qu’en silence l’on brave.
Mon bras était bien faible et la tâche bien grave ;
Ceux en qui j’avais foi me trahissaient toujours ;
De mornes lendemains suivaient les sombres jours…
Mais il ne me fallait qu’un regard de ma mère,
Sa voix reconnaissante et son accent sincère,
Pour qu’en mon cœur troublé se ranimât l’espoir :
Et je me sentais calme, ayant fait mon devoir.
Le sourire revint à ses lèvres glacées,
Mais, sur mon front mûri par d’austères pensées,
Ne reparut jamais la gaîté d’autrefois.
— C’est alors que je vis pour la première fois
Kiva, l’ange béni que le Seigneur sans doute
Pour soutenir mes pas a placé sur ma route !
Ah ! si je vous disais qu’il me faut son amour,
Comme il faut à la fleur la rosée et le jour ;
Que mon bonheur plus grand est fait de son sourire ;
Que les pleurs de ses yeux font ma tristesse pire ;
Que les maux endurés pour elle me sont doux…
Si je vous le disais, me comprendriez-vous ?
Vous, sinistre railleur, dont l’esprit insensible
Fait d’une chose sainte une chose risible ;
Vous, qui reniez Dieu, la vertu, le printemps ;
Vous, dont le cœur aride est mort avant le temps ;
Vous enfin, qui prenez Don Juan comme modèle !
Ah ! je crois l’offenser quand je vous parle d’elle ;
Car votre seul regard souillerait sa beauté ;
Car vous êtes la nuit et Kiva la clarté !
— Je ressentis dans l’âme une douleur amère
Lorsque je dus quitter ma pauvre vieille mère,
Et ma petite sœur, qui souriait encor,
Naïve, en admirant ces lourds ornements d’or (5),
Et Kiva, qui disait à Dieu dans sa prière :
« Écarte de son front la balle meurtrière,
Le fer obéissant ne frappe qu’où tu veux.
Et, s’il ne te plaît pas de le rendre à nos vœux,
Épargne-lui du moins la souffrance inutile,
La mort lente à venir, le poignard qui mutile,
Et l’outrage des Turcs aux sabres recourbés,
Qui ne respectent pas leurs ennemis tombés ! »
— Je partis, rappelant un reste de courage,
Ayant pour compagnons des conscrits de notre âge
Qui, tous, portaient au cœur un même désespoir.
Et tant qu’à l’horizon, je pus apercevoir
Dans les champs de maïs les sillons des charrues,
Les sommets de nos toits avec les nids des grues (6),
L’église supportant la double croix d’airain (7),
La vieille tour, bâtie au temps de Séverin… (8)
J’eus un rayon de jour au sein de ma nuit sombre.
Mais, lorsque tout cela se fut perdu dans l’ombre,
Que l’absence entre nous eut jeté son linceul,
Et que, parmi les rangs, je me sentis bien seul…
De ma propre douleur je perdis conscience,
Et, presque sans regrets comme sans confiance,
Je marchai comme on marche en songe. — Bien souvent,
Pendant la halte, au soir, je reste là rêvant.
J’évite des soldats le bruyant entourage :
Leurs rires me font mal. Ainsi qu’en un mirage,
Il me semble revoir, étendu dans mon coin,
Mon bonheur qui n’est plus, mes anges qui sont loin !
Et parfois, oublieux de l’endroit et de l’heure,
J’ai de vagues espoirs d’existence meilleure ;
L’avenir m’apparaît plus beau que le passé,
J’ébauche des projets… Misérable insensé !
Puis-je rien espérer, puis-je rien entreprendre,
Moi, qu’au premier combat, la mort peut venir prendre,
Moi, qui ne puis compter sur un seul lendemain !
— Je suis, ne riez pas, fier d’être né Roumain,
Et j’aime, Dieu le sait, d’une amour infinie,
Mon malheureux pays, ma douce Roumanie.
Pour la voir libre enfin du joug mahométan,
Pour la voir arrachée au pouvoir du Sultan,
Sans que mon œil se trouble où que mon front pâlisse,
Je pourrais, de ma vie, offrir le sacrifice,
Si je n’avais, hélas ! attachés à mon sort,
Ces trois êtres aimés qui mourraient de ma mort !
— Pour vous parler ici je laisse la prudence. —
Vous nous assurerez, dit-on, l’indépendance
Pour prix de notre sang, le Prince sera Roi !
Mais, quel est le garant de votre bonne foi ?
On sait ce que vous pèse un serment, et peut-être
N’avons-nous combattu que pour changer de maître.
Vos aïeux, comme vous, sont venus en amis,
Mais nous ont-ils donné ce qu’ils nous ont promis ?
Ils disaient que du droit le Czar était l’apôtre,
Que Dieu les envoyait ! Mais, pour croire à la vôtre,
De leur feinte amitié nous nous souvenons trop !
Les chevaux dans les blés élancés au galop ;
Les récoltes en feu, les fermes ruinées ;
Le progrès suspendu pour de longues années ;
Le Cosaque odieux qui pratique le vol,
Et les monceaux de morts, partout, couvrant le sol,
Et pour finir, la faim, la misère et la peste !
Voilà quels sont les dons moscovites ! Au reste,
La chance vous trahit maintenant, et déjà
Des remparts de Widin à l’âpre Dobroudja
Devant le croissant turc la croix grecque recule.
Parmi vos bataillons la discorde circule,
Les officiers sont las, les soldats mécontents,
Et nous aurons l’hiver avant qu’il soit longtemps.
Les vivres sont tombés aux mains des adversaires ;
Faute de nourriture et de soins nécessaires,
La moitié des blessés à peine a survécu !
Mais le Czar à Moscou ne peut rentrer vaincu !
Au-dessus du Kremlin l’orage s’amoncelle ;
Des superbes Gottorp le prestige chancelle,
Votre gloire s’éteint ! Et l’Europe applaudit,
Car l’Europe vous hait, l’Europe vous maudit !
— Avant d’abandonner ce fatal territoire,
Il vous faut remporter un semblant de victoire ;
Il le faut, pour sauver l’honneur de votre nom…
Et vous faites de nous de la chair à canon !
Oui ! ce sont les Roumains qui prennent la redoute ;
Oui ! s’il est quelque endroit dont un général doute,
Quelque poste peu sûr, on y voit les Roumains.
Les premiers à l’assaut, nous ouvrons vos chemins,
Et lorsque la fortune avec rigueur vous traite,
C’est nous qui protégeons encor votre retraite !
Oui ! quand les Osmanlis, plus forts ou plus nombreux,
Ont fait ployer nos rangs, vos Cosaques affreux
Opposent à nos pas fléchissant en arrière
De canons alignés une horrible barrière !
Nous avançons ; le fer, le feu pleuvent sur nous,
Et nous mourons alors, assassinés par vous !
Mais Bucharest s’émeut, Bucharest se soulève ;
Le peuple ne veut pas qu’un tel crime s’achève ;
C’est son sang qu’on répand, c’est sa chair qu’on meurtrit ;
Et la rébellion germe dans son esprit.
Il déteste le Turc, mais vous, il vous abhorre ;
Car vous l’avez trompé, vous le trompez encore ;
Il vient de le comprendre et son courroux est né !
Vous n’avez jamais vu le peuple déchaîné,
Vous ne pouvez savoir ce qu’il brise en sa rage,
À quels sombres excès le porte son courage !
Comme il sera cruel lorsqu’il se vengera !…
Le serf s’enivre et dort… il se réveillera !
Pour redevenir homme, il suffira qu’il pense,
Et de ses longs malheurs, tenant la récompense,
Il foulera du pied les maîtres confondus.
Ah ! que nos maux vous soient au centuple rendus !
Que tout le sang versé, sur vos têtes retombe,
Et que, pour vous, flétrir s’élancent de leur tombe
Les spectres des Roumains qui sont morts à Plevna !
Le boyard, en baillant, alors se retourna
Et d’une voix moqueuse :
— Or çà, mon camarade,
Ma patience est lasse et ton histoire est fade.
Vois ; rien qu’à t’écouter, je sommeille debout,
Et tes prédictions ne sont point de mon goût.
« On assimilerait, dans la Sainte-Russie (9),
La populace vile à l’aristocratie !
Les moujiks aux seigneurs imposeraient leur loi !
Nous serions les égaux de rustres comme toi ! »
— Ah ! si dans mon palais ton Dieu t’avait fait naître,
(Puisque tu crois en Dieu !) si tu pouvais connaître
De mon seul déplaisir les terribles effets…
Tu ne parlerais pas, certe, ainsi que tu fais !
Dans l’azur s’effaçaient les dernières étoiles,
La brise du matin se jouait dans les toiles
Des tentes, blanchissant à l’approche du jour ;
Et soudain retentit un appel de tambour.
À retourner au camp tous deux se préparèrent
Et, l’éclair de la haine aux yeux, se séparèrent.
(1) Serviteurs en Russie.
(2) En Roumanie, comme en Grèce, les berceaux des enfants du peuple sont ordinairement faits d’un tronc d’arbre évidé.
(3) Les couvents romains possèdent presque tous des terres assez étendues que les moines cultivent en partie eux-mêmes, ou qu’ils louent à ferme aux paysans.
(4) L’Igoumène est le supérieur d’un monastère du rite grec-orthodoxe, lequel est pratique par la majorité de la population roumaine.
(5) On sait que l’uniforme du moindre officier moldo-valaque est, pour ainsi dire, couvert d’or.
(6) En Roumanie, les cigognes et les grues font leurs nids aux toits des maisons ; le peuple prétend que leur présence préserve de l’incendie les habitations où elles se retirent.
(7) La croix grecque est doublement barrée.
(8) Cette tour, construite sous Septime-Sévère, subsiste encore à Turnul-Severinului ; elle a donné son nom au village même.
(9) C’est ainsi que les Russes appellent leur patrie : Agia-Rossia.
II
Tandis que la Néva traîne ses flots sans bruit,
Au palais Vasilief on danse cette nuit.
Les vitraux éclairés des fenêtres sans nombre
Se découpent en feu dans la muraille sombre,
Et les échos du bal arrivent affaiblis
Aux passants attardés, aux moujiks avilis
Que l’on voit étendus, ivres-morts, dans la neige.
Serge-Alexandrovitch que l’Empereur protège,
Serge, qui l’an dernier partit de Stavropol
Pour détruire l’Islam et soumettre Istambol (1),
Est enfin revenu dans son vaste domaine.
On célèbre l’instant heureux qui le ramène ;
Les plus nobles seigneurs, les plus anciens boyards
Vont quêtant son sourire et cherchant ses regards,
Et pour mieux déguiser leur dépit, leur envie,
Prodiguent lâchement la louange asservie.
Les dames de haut rang, qui l’acclament en chœur,
Pressent leurs pas légers sur les pas du vainqueur ;
Plus que leurs diamants leur œil pâle étincelle.
Mais, sans que sur ses traits le plaisir se décèle,
Sans qu’il paraisse ému d’un si brillant accueil,
La démarche insolente et le front lourd d’orgueil,
Dans la foule empressée, Alexandrovitch passe
Et sur son uniforme étale avec audace
Les ordres de Saint-George et de Saint-Vladimir !
Quel mémorable exploit les lui fit obtenir,
Quelle noble action ? Nul ne le sait. Qu’importe !
Qu’il en soit digne ou non, c’est assez qu’il les porte ;
Le Czar l’ordonne ainsi – ce qu’il fait est bien fait. –
Les boyards ont tremblé ; mais Serge est satisfait ;
Sous leurs masques riants il devine la rage,
Et pour chaque bassesse il leur rend un outrage.
De ses vaines splendeurs lui-même s’enivrant,
Il marche dans sa gloire, il triomphe, il est grand !
Et là-bas, c’est la plaine à l’immense étendue…
Au loin sur l’horizon l’ombre s’est épandue.
Une plainte étouffée, un long gémissement
Lugubre retentit et trouble par moment
Le silence des nuits qui descend sur l’arène.
Les cieux sont constellés et la lune sereine,
Caressant tristement le front blêmi des morts,
Tisse de ses rayons un suaire à leurs corps.
— Car le choc fut terrible et la mêlée affreuse,
Le sang coulait à flots sur la route poudreuse ;
Les bombes, s’élançant des bouches des mortiers,
Fauchaient en un instant des régiments entiers.
Musulmans et chrétiens s’étreignaient avec rage ;
Rien ne pouvait lasser leur sublime courage ;
Exténués, mourants, ils combattaient encor ;
Dans leurs âmes la haine avait pris son essor
Et seule soutenait leurs forces ébranlées,
Tandis que, par-dessus leurs têtes mutilées,
Ils entendaient frémir les ailes du vautour.
– Et cela fut atroce et dura tout un jour ! –
Certe, on a pu savoir, quand la lutte acharnée
Au coucher du soleil fut enfin terminée,
Lequel était vainqueur, du Turc ou du Chrétien ;
Mais on ne saura pas, mais nul historien,
Sans mentir à l’histoire impartiale et grave,
Ne pourra proclamer lequel fut le plus brave.
Et voilà qu’Osmanlis, Moscovites, Roumains,
Dont le sang généreux a trempé les chemins,
Ennemis qu’on a vus transportés de colère,
Sont ici maintenant, dérision amère !
Côte à côte couchés, sans haine ou désaccord,
Dans la fraternité paisible de la mort !
— La Renommée ira par le monde répandre
Le nom d’Abdul-Hamid et le nom d’Alexandre,
Automates vivants, sur un vain trône assis.
Elle dira leur gloire aux peuples indécis ;
Combien ils furent grands, superbes, magnanimes ;
Elle dira combien ils étaient unanimes
À verser leurs bienfaits aux tristes nations !…
Et vingt siècles plus tard les générations,
Du Czar et du Sultan se souviendront encore.
Elles s’en souviendront ! hélas ! et l’on ignore
Le dévoûment obscur des héros inconnus
Dont les noms jusqu’à nous ne sont point parvenus,
Qui dorment oubliés, sans honneurs, dans la plaine.
Leurs yeux ne reverront ni la terre roumaine,
Ni Smyrne, ni Moscou, ni les rives du Kour ;
On ne fêtera pas leur glorieux retour ;
Leurs mères vont rester longtemps à les attendre ;
Fantômes exilés, ils ne pourront entendre
De ceux qui les aimaient les cris désespérés ;
Et leurs restes épars, aux vils corbeaux livrés,
N’auront plus désormais sous l’atmosphère grise
Que les larmes du ciel, les baisers de la brise.
Hélas ! et parmi ceux que la mort enleva
Gît le fils de la veuve et l’amant de Kiva !
(1) Istambol est le nom turc de Constantinople. Il est plus correct que Stamboul. Cette dénomination n’est que la corruption des mots grecs : Εἰς τὴν πόλιν.
III
S’il n’est plus de justice en ce monde où nous sommes,
N’en est-il plus là-haut ? Ainsi, de ces deux hommes,
L’un fut vil et méchant, infâme et criminel ;
Ses moindres actions insultaient l’Éternel…
L’Éternel l’épargna dans sa grâce suprême !
Monstre nuisible à tous, inutile à lui-même,
On le verra, suivant son chemin aplani,
Traîner plus fièrement son orgueil impuni,
Réveiller sans pitié la douleur assoupie,
Et plus haut vers le ciel dresser sa tête impie.
— L’autre était humble et bon ; et quoique ayant veillé,
Et quoique ayant souffert, il n’avait point souillé
Son âme qui gardait la candeur enfantine.
Un noble cœur battait dans sa mâle poitrine ;
Il croyait, il aimait, on l’aimait… et c’est lui
Sur qui le bras de Dieu s’alourdit aujourd’hui !
C’est une étrange loi qui pèse sur le monde !
Et nul ne sondera la sagesse profonde
Des célestes arrêts que les hommes, hélas !
Subissent effrayés, ne les comprenant pas.
Il faut qu’à nos plaisirs, tristes fils de la terre,
S’unisse incessamment quelque infortune austère.
La même main, qui mit la ronce entre les fleurs,
Mêle la larme au rire et la joie aux douleurs.
Comme la nuit au jour, le mal au bien s’enchaîne,
Et du crime de l’un, l’autre porte la peine.
C’est le décret fatal contre nous prononcé,
Et tel qui se plaindrait serait un insensé,
Certes. Mais quand on voit, ainsi qu’une ombre immense,
Passer sur tous les fronts un souffle de démence ;
Quand la guerre homicide enveloppe à la fois
Dans le bruit du canon toutes les autres voix ;
Lorsqu’on verse le sang comme on verserait l’onde ;
Que la parole humaine en sophismes abonde,
Que l’honneur est banni ; que des relations
Des rois, czars ou sultans, avec les nations,
L’antique loyauté disparaît tout entière ;
Quand l’idée est soumise à l’aveugle matière ;
Quand la force brutale a remplacé le droit ;
Quand le vice grandit, quand la vertu décroît ;
Lorsque l’homme, sur qui flottent les maux sans nombre,
Devient, de jour en jour, plus mauvais et plus sombre
Et qu’il est las, voyant son but et son espoir
Qui reculent sans cesse à l’horizon plus noir !…
Quand la réalité, comme une onde mouvante,
Dès qu’on veut la saisir, s’écroule décevante…
Le poète rêveur, dont les accents perdus
En ce siècle d’airain ne sont plus entendus,
Contemple, quand sa Muse aux hommes le ramène,
Le sinistre progrès que fait la race humaine ;
Son esprit étonné, qui s’emplit de terreur,
Demande à l’univers : Où donc est le Seigneur ?…
Marie Nizet, Pierre le Grand à Iassi, Paris, Auguste Ghio, 1878. Gallica • KBR (avec la signature de l’autrice !)
Pierre le Grand à Iassi
Si cu cel Vrancean, mèri, se vorbirà !
(Et dame ! avec celui de Vrantcha ils s’entendirent.)
Vasili Alexandri, Ballades et Chants populaires de la Roumanie.
À la mémoire de Caroline Gravière (Mme Ch. Ruelens)
I
C’était un beau spectacle, un spectacle joyeux
Que la ville d’Iassi montrait à tous les yeux (1)
Un jour du mois de juin en l’an mil sept cent onze.
Un esprit palpitait dans les cloches de bronze ;
Elles n’avaient jamais sonné de meilleur cœur
Quand Étienne le Grand s’en revenait vainqueur (2).
Les églises ouvraient au large leurs portiques ;
On entendait le son nasillard des cantiques
Éperdûment chantés par de vieux popes grecs.
Les cigognes aux tours faisaient claquer leurs becs.
Seule, à l’écart dressant sa haute silhouette,
La cathédrale était solitaire et muette.
Son dôme paraissait un front plein de soucis.
Triste, elle regardait par ses vitraux noircis.
Qui sait ? Elle songeait. Au fondateur peut-être,
À Basile le Loup, un grand prince, un bon maître
Qui mourut de misère à Stamboul. En tout cas
Elle désapprouvait cet étrange fracas
Qu’on faisait autour d’elle. Énigmatique et sombre,
Sur toute cette joie elle jetait une ombre.
Et pourtant Lippovans (3), Cigains estropiés (4)
Traînant encore un bout de chaîne autour des pieds ;
Moldaves qui, malgré le poids des servitudes,
Gardent ce regard fier, ces nobles attitudes
Qui les font reconnaître entre tous, Juifs affreux,
Tout ce peuple dansait, buvait, semblait heureux.
Mais l’allégresse était si rare en la province
Que l’on se demandait si, par hasard, le prince
Avait ordonné d’être ou de paraître ainsi,
Et pourquoi tous ces chants et ces rires ? — Voici :
Brancovan Constantin et Cantimir Démètre (5)
Sont tous deux las d’avoir le Padisha pour maître,
Lequel devient de jour en jour plus exigeant.
Il lui faut de l’argent et toujours de l’argent.
Le tribut est payé comptant au fils des astres ;
Vient le vizir qui veut pour lui cent mille piastres ;
Et puis c’est le pacha, puis ce sera l’émir,
Le capidji-bachi… Que sais-je ! et Cantimir
A pensé qu’on devait à cela mettre un terme.
Oui, mais il lui faudrait l’appui d’une main ferme,
Une main d’empereur ou de roi frappant fort.
Or, Cantimir songeait au Czar Pierre d’abord,
Bon voisin qui serait ennemi redoutable.
Le Czar est franc buveur, gai compagnon de table,
De plus, il a vaincu Charles à Pultava.
Un beau matin d’été l’hospodar se leva,
Assembla ses boyards – qu’il refusa d’entendre, –
Puis écrivit au czar : « Venez, sans plus attendre ! »
Et, comme il n’aurait pu vouloir mieux que ceci,
Pierre fait aujourd’hui son entrée à Jassi.
De là fêtes et chants.
Ah ! vieille métropole,
Savais-tu l’avenir sous ta vaste coupole,
Et tremblais-tu là-haut comme on dansait en bas
De voir le premier czar faire le premier pas
Sur la terre moldave ? — Ô mystère des choses !
Dans les pierres soudain des âmes sont écloses ;
L’esprit se fait matière et la matière esprit,
Et le monument pleure alors que l’homme rit (6).
Le peuple est un enfant qu’on trompe et qu’on amuse,
Sa conscience honnête au soupçon se refuse ;
Comme il ne ment jamais il ne peut concevoir
Qu’on mente, et, tout puissant, ignore son pouvoir.
Le bruit et le clinquant font son bonheur suprême ;
Il est fou dans sa joie, il aime quand on l’aime ;
Hors un peu de bien-être, il ne demande rien ;
Il est plus patient, plus dévoué qu’un chien…
Et moi, je dis qu’il faut, pour qu’un peuple se fâche,
Que le prince ait été bien cruel et bien lâche.
Or, Cantimir ayant aux boyards déclaré
Qu’ils eussent à montrer au czar, bon gré mal gré,
Une mine riante et toute gracieuse ;
Que, l’amitié du czar étant fort précieuse,
Les grands airs n’étaient pas de saison ; qu’il faudrait
Approuver en tout point ce que le czar dirait…
Les boyards furieux avaient fait la grimace,
Sentant qu’on rabaissait en eux toute leur race.
Cantimir n’en vit rien : il leur tournait le dos.
Marchant vers la fenêtre, il tira les rideaux,
Et, s’adressant au peuple assemblé sur la place,
Dit ces mots d’un ton bref : — « Manants et populace,
Le pays, dès ce jour, change de suzerain.
J’ai daigné vous choisir le czar pour souverain ;
Sachez dorénavant que je n’en veux pas d’autre.
Telle est ma volonté – qui doit être la vôtre –
Sur ce, vivez en paix et qu’on soit tous contents. »
C’est ainsi qu’on parlait au peuple dans ce temps.
(1) On écrit indifféremment Jassi ou Iassi ; cette dernière forme est la meilleure se rapprochant davantage du nom roumain qu’on prononce Iachi.
(2) Étienne le Grand, prince de Moldavie, combattit pendant quarante ans les Tartares, les Russes, les Polonais, les Turcs et les Hongrois ; il remporta quarante victoires en commémoration desquelles il fit bâtir quarante églises.
(3) Secte religieuse russe. Les Lippovans ou Philippovans habitent Iassi où ils exercent le métier de cocher ; ils tirent leur nom de leur profession.
(4) Les Cigains sont les bohémiens de la Roumanie ; ils formaient, avec les juifs polonais, les deux tiers de la population d’Iassi.
(5) L’historien Démétrius Cantimir régnait alors en Moldavie. Brancovano occupait le trône de Valachie ; ses ennemis fabriquèrent de fausses preuves à l’aide desquelles ils convainquirent le malheureux hospodar de trahison envers la Porte ; ses biens furent confisqués, il fut lui-même destitué (mazil), amené à Constantinople et assassiné avec ses trois fils. Ce triste événement forme le sujet d’une ballade populaire en Roumanie.
(6) Lors de l’entrée de Pierre le Grand dans la capitale moldave, les cloches de toutes les églises furent mises en branle ; seules celles de l’église des Trois-Saints (la cathédrale) ne se firent pas entendre. La légende dit que les sonneurs eurent beau se pendre à la corde : les cloches ne prétendirent rendre aucun son. Cela fut considéré comme de très-mauvais augure.
II
Le czar avait passé la nuit dans une grange,
À Beltz. Il amenait, par un caprice étrange,
Une suite innombrable, à l’aspect imprévu.
La chaleur était grande. On n’avait jamais vu
Défiler par la ville un semblable cortège.
Les Cosaques du Don et ceux de Voronèje,
Libres encore hier, esclaves aujourd’hui,
Arrivaient les premiers : leur tristesse avait fui,
Ils ne paraissaient pas regretter trop l’Ukraine.
Des Russes d’Arkanghel chaussés de peaux de renne,
À la face idiote, aux yeux à peine ouverts,
Les uns marchant tout droit, les autres de travers ;
Des hetmans, brandissant une arme singulière,
Farouches et pressant les traînards par derrière ;
Des Tatars qui s’étaient gravement affublés
De bonnets suédois à Pultava volés ;
Des seigneurs, imposants bien moins que ridicules,
Plongés dans la fourrure au temps des canicules,
Se succédaient. Un peu moins laids, on les eût pris
Pour des Cigains montés sur des chevaux de prix.
Races du Sud, du Nord, l’une à l’autre mêlée,
Géants, nains, jeunes, vieux, foule bariolée
De hauts seigneurs titrés et d’inconnus sans noms,
C’était toute une armée enfin – moins les canons. –
Ensuite on remarquait les boyards indigènes
Ayant dolmans de soie ornés de point de Gènes,
Et bottes de cuir mou recouvertes d’or fin.
Les plus jeunes avaient des airs de spadassin,
Et les plus vieux portaient barbe de patriarche.
Puis, avec Cantimir, le czar fermait la marche.
Le renard avec l’ours, la ruse et le pouvoir.
Ils marchaient sur la loi, piétinaient le devoir ;
L’un agissait par fougue et l’autre par tactique ;
L’un était grand soldat, l’autre grand politique ;
Pierre avait les dehors d’un Tartare assez laid ;
Cantimir était prince et savant ; il parlait
Le turc comme un émir, le latin comme un prêtre.
Le premier fut un monstre et le second un traître.
III
Le czar a, sans tarder, reçu chaque seigneur,
Et, prodiguant à tous force marques d’honneur,
Il a dit : — Je vous tiens en estime fort haute. —
Les boyards stupéfaits ont pensé que leur hôte
Était bien le meilleur des maîtres. Aussitôt,
Charmés, ils ont quitté leur morgue de tantôt.
— C’est un ami, dit l’un. — C’est un Roumain, dit l’autre (1).
— Cantimir a raison. — Messieurs, sa cause est nôtre.
— Mais il n’a point parlé d’affaires jusqu’ici…
— Ce sera pour demain. — Et l’unique souci
Qui les tourmente encore à cette heure terrible
Est de prendre une part, – la plus large possible, –
Et de goûter les vins un peu mieux qu’à demi,
Au festin que le prince offre au czar, son ami.
La lumière, le bruit, l’or emplissent la salle.
Avides, entourant la table colossale,
Cosaques et Roumains apaisent tour à tour
Et leur soif de soudard et leur faim de vautour.
Toute leur âme est là, dans leurs yeux, dans leur bouche.
Les Russes, se livrant à leur gaîté farouche,
Disent que les palais valent bien les isbas (2),
Et s’étonnent tout haut que l’on puisse ici-bas
Boire de si bon rack et dans de si beau cuivre !
On doute : est-ce le vin ou l’or qui les enivre ?
Ils voudraient toucher tout, – peut-être emporter tout –
Les boyards, surmontant bravement leur dégoût,
Fraternisent avec ces gens abominables.
Et ce sont des éclats de rire interminables ;
Des chants vociférés en l’honneur du repas ;
Et tout ce monde vit, sent et ne pense pas.
À la foule parfois souriant par mégarde,
Démètre Cantimir songe et Pierre regarde.
Calmes dans ce tumulte, ils sentent tous les deux
Qu’ils sont maîtres de tous, étant seuls maîtres d’eux.
Et leur rêve est profond et noir comme leur âme.
Oh ! qui, dans leur cerveau, pourrait lire le drame
Qu’ils méditent, vengeur, se lèverait soudain !…
Mais qu’importe aux boyards ce qui n’est pas le vin ;
Que leur font maintenant devoir, honneur, patrie ;
Et cette conscience importune qui crie,
Qu’elle se taise ! Hier, ils croyaient à cela,
Mais, cette nuit, leur but et leur dieu, le voilà !
C’est le plaisir infâme, à l’allure sinistre ;
Le crime est son parent, la honte est son ministre ;
Et portant de la cendre et des fleurs dans ses bras,
« Ris aujourd’hui, dit-il, demain tu pleureras ! »
Déjà sous l’être humain se révèle la brute,
Car les sens ont vaincu la raison dans la lutte ;
Les instincts les plus vils réveillés à la fois
Font le palais semblable à ces antres des bois
D’où l’on entend sortir le cri des bêtes fauves.
Ce tas de jeunes gens, de vieux à têtes chauves,
Terrassés par l’ivresse et perdant le respect
D’eux-mêmes, offrent à l’œil un repoussant aspect.
Leur abjecte folie atteint son paroxysme,
Ils semblent des démons hurlant sous l’exorcisme,
Sur des dalles, les uns gisent morts à moitié,
Les autres, enjambant les mourants, sans pitié
Précipitent encor l’horrible bacchanale…
Lorsque soudain, brisant cette ronde infernale,
L’immobile Stupeur entre et dit : C’est assez !
Pose sa main de plomb sur tous ces fronts lassés,
Et, faisant un linceul de la nappe rougie,
Les endort du sommeil bestial de l’orgie.
Et, leur couronne au front, sur les débris de tout,
Le prince et l’empereur sont seuls restés debout.
Ô spectres des aïeux, couchés dans votre gloire,
Héros, si, devant vous rouvrant la tombe noire,
La volonté de Dieu vous ramenait ici,
En face de ceux-là qui dorment, de ceux-ci
Qui veillent, sûrement vous ne pourriez pas dire
Lesquels, étant plus vils, il faut le plus maudire !
À l’œuvre, criminels ! Le silence profond
Est seulement troublé du murmure que font
Les respirations bruyantes de ces êtres
Que vous avez faits tels qu’ils sont ; à l’œuvre, maîtres !
Forgez le crime ! allez, vous êtes seuls. — Non pas.
Vingt Cosaques encor sont là qui parlent bas
Et du doigt désignant par terre quelque chose
Ils se consultent : l’un voudrait, et l’autre n’ose.
Que faire ? — S’ils allaient se réveiller, dit l’un ? —
— Le rack est fort, dit l’autre. — Et c’est profit commun.
Cela doit les gêner. — Et, glissant sous la table,
Ils tâtent. Qu’est-ce donc qu’ils font d’épouvantable ?
Ils tirent… Eh quoi donc ?… Les bottes des boyards
Qui depuis le matin fascinaient leurs regards !
Elles étaient vraiment dignes d’être admirées
Ces bottes : cuir doré sur semelles dorées !
Les Cosaques, joyeux comme de vrais enfants,
Emportant leur larcin, s’éloignaient triomphants,
Quand Pierre, se tordant de rire en sa cuirasse,
Dit : — C’est bien, mes amis : je reconnais ma race (3) ! —
— Tes sujets sont adroits, czar, siffla Cantimir ;
Aussi bien mes boyards ont-ils tort de dormir.
Passe encor s’ils n’avaient à perdre que les bottes !
Mais laissons tes filous, laissons mes patriotes :
Causons.
Voici comment un vieil in-folio
Du temps a rapporté leur terrible duo.
(1) Quand un Moldo-Valaque veut exprimer son admiration pour un homme : « Quel Roumain, dit-il, quel fils de Roumain ! »
(2) Les isbas sont les cabanes des paysans russes.
(3) Ce fait, si invraisemblable, est rigoureusement historique.
IV
— Que penses-tu d’Iassi ?
C’est une belle ville,
On y reçoit les czars de façon fort civile.
— Tu savais mon dessein quand je t’y fis venir ?
— Certes, dit l’empereur, si j’ai bon souvenir,
Il faut briser Achmet comme on a brisé Charles.
C’est dit ! Moi qui combats, je viens à toi qui parles,
(Tu parles bien) et nous fondons tous deux sur Mahomet,
Et l’on ne saura plus ce que c’était qu’Achmet.
Moi, je suis Protecteur ; toi, prince héréditaire (1).
Et si ceux qui sont là ne veulent pas se taire…
Mugit Pierre en heurtant un des dormeurs au front,
— Laisse, fit Cantimir, demain ils se vendront.
— S’ils n’obéissent point, hurla le czar féroce,
Ils recevront chacun quarante coups de crosse,
Puis je les enverrai rejoindre les Strélitz !
Aussitôt formulés, je les veux accomplis,
Les ordres que je donne. Eh ! Cantimir Démètre,
Bien qu’il soit ton ami, l’empereur est leur maître ;
Il tient serfs et boyards sous ses pieds, et, tu sais,
Il est grand l’empereur !
— Il ne l’est pas assez !
Certe, il est beau de vaincre et de ne pas comprendre
Que l’on puisse faillir ; certe, il est beau de prendre
Des peuples, des pays, et de marcher dessus,
Et de réaliser tous les rêves conçus.
Mais tu posséderais la Suède et l’Épire,
Ô czar, que tu n’aurais pas encore un empire !
Pierre sur l’hospodar fixa ses yeux de lynx.
— Mon beau savant, dit-il, tu parles comme un sphinx.
Je sais que tu te plais aux subtiles tirades,
Mais je n’ai jamais pu deviner les charades :
C’est un défaut. —
Démètre eut un sourire amer.
On eût dit qu’il allait mentir ; il avait l’air
De l’insecte hideux qui va tendre ses toiles.
— Ne raille pas, dit-il. Des pierres et des voiles,
Des forts et des vaisseaux, des canons et du bruit,
Des soldats ; ce qui tue avec ce qui détruit :
Voilà tout Romanoff. Il est fort dans la guerre
Et faible dans la paix. Il ne s’occupe guère
De l’ordre intérieur, du commerce, des arts ;
Il gouverne un troupeau, s’entoure de hussards,
Méprise la science, et, parce qu’on le nomme
Pierre le Grand, voilà qu’il se croit un grand homme.
S’il trompe un allié, c’est presque par erreur ;
Il n’est que général et se dit empereur ;
Et toutes ses grandeurs s’en iront en fumée,
Parce qu’il n’a souci que de sa renommée,
Parce qu’il ne sait pas faire une bonne loi,
Et qu’il lui manque un homme.
— Et cet homme ?…
— C’est moi !
Moi ! Tu n’as que la force et j’ai l’intelligence.
Toi, tu sers ton orgueil ; moi, je sers ma vengeance ;
Et nous nous appelons, dans la création,
Toi, Barbarie et moi, Civilisation.
Nous inspirons l’horreur, à défaut de l’estime ;
Nous portons fièrement la majesté du crime.
L’Orient, l’Occident appelle notre joug.
Comme tu ne fais pas un sceptre d’un tchibouk,
Que mon âme et mon cœur sont des puits insondables ;
L’un sur l’autre appuyés, nous serions formidables.
Sans toi, je suis toujours le sombre historien (2),
Je reste Cantimir ; mais, sans moi, tu n’es rien
Que le premier soldat d’une armée en déroute.
Qui donc détournera les pierres de ta route ?
Quand tu seras en guerre avec les potentats,
Quel est celui qui doit veiller sur tes états ?
Est-ce Alexis ton fils ? Tu sais combien il t’aime !
À ce nom détesté redevenant lui-même
Le czar, d’un coup de poing, brisa deux coupes d’or,
Se leva, se rassit et se tut.
— Mon trésor
Court grand risque, et tu vas détruire la vaisselle
Qui me vint de Stamboul, parcelle par parcelle.
Nos sujets pourraient bien se réveiller trop tôt,
Si tu fais tant de bruit. Que disais-je tantôt ? —
Poursuivit Cantimir, qui savourait la joie
D’enfoncer largement ses ongles dans sa proie.
— Je disais qu’un seul homme est plus grand qu’Attila,
C’est un moine soldat appelé Loyola ;
Je disais que le maître actuel de l’empire
Est mauvais et cruel – et qu’il le faudrait pire !
Écoute, Romanoff, je n’ai pas oublié
Qu’enfant, dans mon orgueil je fus humilié,
Et qu’homme j’ai servi de jouet à la Porte (3).
Je me suis tu longtemps. Maintenant je t’apporte
Ma colère qui veut se tremper dans le sang.
Entre les plus puissants fais-moi le plus puissant ;
Oh ! donne-moi ma part de ce qui t’environne ;
Mets ton sceptre en mes mains, mon front sous ta couronne
Et ton peuple à mes pieds, et place-moi si haut
Qu’il faille, pour me voir, monter sur l’échafaud ;
Et fais-moi proclamer grand-duc de Moscovie,
Afin qu’on me haïsse, afin que l’on m’envie.
Moi, je te montrerai comme on fait les traités,
Nous entendrons crouler les vieilles royautés,
Et tu verras des rois pris dans leurs propres pièges,
Et nous serons si grands entrepreneurs de sièges,
Si terribles avec ma plume et ton canon
Qu’on n’osera dire « oui ! » quand nous aurons dit « non ! ».
Nous ferons de l’Europe, esclave et tributaire,
Une vaste Russie, et de toute la terre
Tu seras le premier, je serai le second.
Acceptes-tu ?
Le jour bleuissait le plafond.
Pierre dit : Ce n’est pas une mauvaise affaire.
Tu feras… Entre nous, donner vaut mieux que faire.
Si je te reconnais mon unique héritier,
Si je te lègue, avec mon pouvoir tout entier,
Aux dépens d’Alexis, la pourpre souveraine,
Si, moi vivant encor, je te cède l’Ukraine
Avec le droit de vie et de mort sur tes gens,
Si je t’offre, pour prix d’avis intelligents,
La croix de Saint-André, plus l’écu de sinople (5),
Que me donneras-tu ? Parle.
— CONSTANTINOPLE !
(1) L’article 4 du traité intervenu entre Pierre le Grand et Cantimir dit ceci : « Le prince et ses successeurs jouiront à perpétuité de l’hérédité de la Moldavie sous les auspices du czar. » L’article 5 dit en outre que : « Nulle autre maison ne sera admise à la jouissance de la principauté de Moldavie jusqu’à ce que celle des Cantimir soit éteinte. »
(2) Cantimir a laissé des ouvrages très estimés. Les plus remarquables sont : une Histoire de l’empire ottoman, en latin ; et des Chroniques moldaves, en roumain : ces dernières sont restées manuscrites jusqu’en 1830.
(3) Démètre Cantimir se flattait de succéder à son père Constantin selon la promesse faite à ce dernier par le grand vizir ; mais il se vit supplanté par Constantin Duca qui prodigua l’argent à Constantinople ; et même après qu’elle eut été réparée, il consacra tous ses instants à venger cette insulte.
(5) Tous ces détails sont empruntés à l’histoire. Du reste, Pierre n’obligea pas un ingrat. En effet, on peut dire, sans crainte d’exagérer, que Cantimir a créé l’empire de Russie et qu’il a ouvert aux czars le chemin de Constantinople.
—, România (Chants de la Roumanie), Paris, Auguste Ghio, 1878. Poésie Gallica • DONum (avec la signature de l’autrice !) • Google Books
Table des matières
Introduction
I. À la Roumanie
II. Appel aux peuples de l’Europe (mars 1877)
III. Le vent qui vient de Moscovie
IV. Au camp
V. Portrait
VI. À Ioan Héliade Radulesco
VII. À la Dimbovitza
VIII. Georges Maghiero
IX. Exil
X. Chant de guerre des Roumains de Transylvanie (1848)
XI. Manoli et Maritza
XII. Ianco, Roi des Montagnes
XIII. Bucuresci
XIV. Aux filles d’Héliade
XV. L’Hospodar
XVI. Le Phanariote
XVII. Moscou et Bucharest
XVIII. Chair à canon (11 septembre 1877)
XIX. Aux Grandes Duchesses de Russie
XX. La mère d’Étienne le Grand
XXI. Moldo-Valaques et Roumains
XXII. Mikalaki
XXIII. Le Dorobantz
XXIV. Ce que dit l’Oltoù
XXV. Anathème
XXVI. Au Danube
XXVII. Pierre le Grand à Iassi
Introduction
Nous traversons une époque de troubles et de remaniements. La face de l’Europe se renouvelle ; de toutes parts, on fait et on défait des empires. Les chanceliers travaillent à l’accomplissement de leur œuvre, et la splendeur des grands États s’édifie sur les ruines des petits peuples. Ceux-ci ne devraient-ils pas, à leur tour, former une Sainte-Alliance des faibles et se défendre mutuellement, non par les armes, mais par la parole et par la plume de leurs nationaux ?
Droits méconnus, engagements violés, compensations dérisoires : voilà ce que nous offre l’histoire de l’année actuelle qui vient de ratifier, par le traité de Berlin, la trahison la plus insigne, le marché le plus honteux que ce siècle ait à enregistrer dans ses annales : nous parlons de la rétrocession de la Bessarabie.
Le moment nous semble venu de fixer l’attention de tous les gens de cœur sur cette malheureuse
Roumanie qui a tant de titres à nos sympathies et à laquelle il ne manque que le repos et une administration plus sage pour qu’elle puisse tenir dignement son rang à côté de la Suisse et de la Belgique.
Belge, nous nous faisons un devoir de soutenir la cause de ces Roumains dont l’histoire, trop ignorée, présente tant de points de similitude avec la nôtre, et qui, des bords du Danube, aiment à donner le nom de frères aux Wallons.
La poésie nous a paru être la voix qu’on écoute le plus volontiers, celle qui parvient le plus vite à éclairer l’esprit, parce qu’elle s’adresse au cœur. Si les quelques pièces contenues dans ce volume peuvent obtenir le bienveillant assentiment du public roumain, tout en éveillant l’intérêt des lecteurs de toutes nationalités, nous croirons notre but atteint et nos efforts suffisamment récompensés.
I
À la Roumanie
Ô douce Roumanie, ô pays de mes rêves
Qui sembles à l’endroit du monde où tu te lèves
Un songe oriental doré par le couchant,
Sur qui la poésie est à torrents versée,
Permets, en attendant ma dernière pensée,
Que je t’offre mon premier chant !
Ce n’est point en des jours de triomphe et de fête
Qu’éclatent librement les accents du poëte.
La douleur à sa voix semble mieux convenir.
Son plus beau vers se doit au malheur le plus sombre.
C’est ainsi que mon âme, en cette époque d’ombre,
Te rêvait un autre avenir.
De ton astre éclipsé je ranimais le lustre ;
Je te refaisais grande et libre, autant qu’illustre,
Par la pensée et l’art, ou bien par le canon.
Mais le réel détruit l’idéal illusoire,
Et je suis une enfant qui veut, pour toute gloire,
Attacher son nom à ton nom.
Et je n’ai que ma voix, hélas ! pour te défendre.
Bien peu l’écouteront de ceux qui vont l’entendre.
De tes vils détracteurs j’accepte les défis.
Seule, j’ai remonté le cours de ton histoire,
Et ne gardé-je pas au fond de ma mémoire
La langue que parlent tes fils ?
Je ne sais pas flatter ceux qu’on nomme les maîtres.
Qu’ils soient princes ou tzars, je méprise les traîtres ;
Je chante la victime et flétris les bourreaux ;
Pour tous les opprimés j’ai quelque plainte amie ;
Et mon vers, qui replonge au gouffre l’infamie,
Dispute à l’oubli les héros.
Parfois, des jours présents je recule les bornes,
Et je vais contemplant ces immensités mornes :
Le passé disparu, l’avenir hasardeux ;
Puis, je célèbre ceux que tes fastes inspirent,
Et le seul but auquel tous mes efforts aspirent
Est une place au milieu d’eux.
Car je ne te suis point tout à fait étrangère.
Après de longs combats, quelque paix passagère
Mêlait le sang gaulois à celui des vainqueurs,
Et mon pays wallon a ses rudes Ardennes
Qui, comme tes Krapacks et tes forêts, sont pleines
De loups fauves, de nobles cœurs.
Si jamais à mon nom se lève cette foule
Qui fait dieu le mortel qu’elle prend dans sa houle,
Et crée, en moins d’un jour, une immortalité,
Je veux, pour que sur toi la gloire en rejaillisse,
Qu’on dise : Sa devise, en entrant dans la lice,
Fut Roumanie et Liberté !
1/13 mai 1878.
II
Appel aux peuples de l’Europe
(mars 1877)
I
Le chacal moscovite est sorti du repaire.
Le Tzar, qui des Slavons se proclame le père,
Se sent par Dieu même appelé !
Sur les chrétiens souffrants sa pitié va descendre ;
Il s’arme de la croix, il accourt les défendre !…
Hélas ! les chrétiens ont tremblé ! (1)
Il arrive du fond de la steppe enflammée,
Et déjà l’on a vu sa gigantesque armée
Sur les bords du fleuve maudit.
Mais, avant de franchir le célèbre passage,
D’où vient que le tyran, la pâleur au visage,
S’est arrêté comme interdit ?…
Ah ! c’est que là finit le vaste empire slave ;
C’est que sur l’autre rive il n’est pas un esclave,
Malgré le joug des fils d’Omar ;
C’est qu’on y sait le but du sombre philanthrope ;
C’est que, vous l’ignorez, ô peuples de l’Europe,
Les Roumains haïssent le Tzar !
Sans écouter les cris que pousse leur détresse,
Voilà que, les berçant d’une fausse tendresse,
Les Baskirs, maîtres et valets,
Sur leur sol désolé posent leur pied immonde…
Du repos des Roumains vous répondiez au monde,
Ils fléchissent : soutenez-les !
Peuples ! délivrez-les d’une étreinte fatale !
Des soldats de Trajan, vainqueur de Décébale,
Espagne, ils sont les descendants (2).
Le même sang latin coule dans leurs artères,
Gaulois de tous pays, ces hommes sont vos frères.
Italie, ils sont tes enfants !
Et vous, races du Nord, saxonnes ou germaines,
Qui juriez de garder ces ruines romaines
De la serre des potentats,
Écoutez cet appel qui de loin vous arrive,
Et ne permettez pas qu’Alexandre poursuive
L’œuvre infâme de Nicolas !
Songez à la Pologne, à sa longue agonie !
Ne laissez pas glisser la jeune Roumanie
Dans le gouffre noir et profond.
Élevez votre voix ou tirez votre glaive !
Mais de ces nations pas une ne se lève…
Eh quoi !… pas une ne répond !
II
Espagne, qui jadis de flottes couvrais l’onde,
Parmi les grands États se partageant le monde,
Déjà l’on ne te compte plus.
Roumains, qui prendrait garde à votre appel suprême
Lorsqu’au Tzar de Moscou l’Italie elle-même
Adresse un sourire confus !
Et craignant que par toi tous leurs maux ne renaissent,
Ils n’osent t’appeler, Autriche – ils te connaissent !
Tes Hongrois, geôliers inhumains,
Que l’on voit à la fois oppresseurs et victimes,
Font peser lourdement leurs droits illégitimes
Sur trois millions de Roumains.
Allemagne, et toi donc ? — Par-dessus la frontière,
Tu tends ta lâche main à la Russie altière,
Allemagne où l’air se corrompt ;
Empire né d’hier, fait d’une monarchie,
Qui portes en ton sein la brûlante anarchie,
Qui portes des taches au front !
Que t’importent les fils du Romain et du Dace !
Tu traînes après toi la Lorraine, l’Alsace,
Le Schleswig, pris au Danemark ;
Et ta splendeur factice est enfin retombée,
Et ton peuple n’est plus qu’une horde, courbée
Aux genoux de fer de Bismarck !
Et toi donc, Albion ? — Le bruit de tes usines
Qui te font envier des nations voisines
Remplace les chants d’Ossian.
Au-delà du détroit te voilà plus lointaine
Que ne le fut jamais l’Amérique hautaine,
Au-delà du large Océan !
Et que te font, d’ailleurs, Roumanie ou Finlande !
Les larmes et le sang des enfants de l’Irlande
Ont souillé ton manteau royal.
J’entends grincer les fers des rajahs de Mysore,
Et je vois dans ta main, toute rougie encore,
Peser un globe impérial.
Et toi qu’ils appelaient leur seconde patrie,
Reine des nations, de tant de coups meurtrie,
Vers qui leur espoir est tourné,
France ! les entends-tu ?… Mais ton flanc saigne encore,
Et tu combats aussi l’hydre qui te dévore :
Le noir papisme déchaîné !
France, toi qui, marchant de victoire en victoire,
Refoulas pour longtemps dans la nuit de l’histoire
Les Tzars qui tremblaient à tes pas,
France, toi qui rendis Venise à l’Italie,
Si tu ne réponds point à leur plainte affaiblie,
Leurs fils ne t’accuseront pas !
III
À la Roumanie
Meurs donc ! comme autrefois est morte la Pologne !
Cesse de leur montrer tes bras faibles et lourds ;
Laisse le Tzar finir sa lugubre besogne :
Les peuples d’Europe sont sourds !
L’égoïste intérêt les inspire et les mène.
Est-ce pour toi, Terre Roumaine,
Qu’ils lèveraient leurs étendards ?…
Meurs donc ! Et, sans remords, ils verront disparaître,
Avec ton aigle en deuil, qu’ils redoutaient peut-être,
Le dernier de tes hospodars !
8/20 avril 1877.
(1) Les chrétiens, habitant Constantinople, protestèrent solennellement contre l’intervention du Tzar (mars 1877).
(2) On se rappellera que Trajan était Espagnol.
III
Le vent qui vient de Moscovie
Prutule, riŭ blastemat !
(Pruth, rivière maudite !)
Le chant du Pruth.
Qu’est-ce donc qui gronde, là-bas,
Du côté de la Moldavie ?…
Écoutez ! ne dirait-on pas
Que le vent vient de Moscovie ?…
Le pâtre frémit de terreur,
Et presse ses bœufs qu’il rassemble ;
Les forêts se tordent d’horreur ;
Sur sa base la ville tremble.
Le Pruth maudit roule ses flots (1)
Avec un murmure sauvage.
Écoutez ! de rauques sanglots,
Des prières, des cris de rage,
Des gémissements et des pleurs,
Des bruits d’armes entre-croisées,
Des plaintes, de sourdes clameurs
Sortent des vapeurs embrasées.
Le ciel verse du feu. Parfois
Du sein de ce tumulte immense
S’échappent de lugubres voix
Hurlant : À Byzance ! à Byzance !
Ce bruit, hélas ! que l’on entend
Aux frontières de Moldavie,
Ô Roumains, ce n’est que le vent,
Le vent qui vient de Moscovie !
Sur vos têtes il passera !
— Du jour de sang voici l’aurore. —
Il prend son vol vers le Bosphore,
Et son souffle vous brisera !
8/20 mai 1877.
(1) E slut la Prut. Il fait laid du côté du Pruth, dit un proverbe roumain. C’est d’au-delà du Pruth que viennent le choléra, la peste, les légions de sauterelles qui dévorent en quelques heures la récolte de l’année, le crivetzu, qui est le simoun neigeux des plaines danubiennes ; c’est d’au-delà du Pruth, enfin, que viennent les armées russes ! Le Pruth est, pour le Roumain, le fleuve maudit.
IV
Au camp
Voici la nuit. Le camp couvre la plaine immense.
Pour ceux qui sont ici l’égalité commence :
Tout Roumain est soldat.
Sous le même drapeau les éléments contraires
S’unissent, et boyards et paysans sont frères
La veille du combat.
Plus de dissentiment, de haine criminelle.
Tous les cœurs ont senti que l’heure est solennelle,
Et qu’un même danger
Menace, sans souci du nom, de la naissance,
Celui dont les aïeux régnèrent à Byzance,
Et le fils du berger (1).
Dorobantz, Calarash, Zinzares au teint sombre,
Beyzadès couverts d’or qui reluisent dans l’ombre,
Ainsi que des sultans (2),
Lions de Bucharest que partout on admire,
Riverains de l’Oltoù qui craignent le vampire,
Officiers de vingt ans,
Tous ces hommes divers que le bivouac rassemble,
Et qui jamais ailleurs ne se virent ensemble
En des temps plus heureux,
Tandis qu’en lourds faisceaux leurs armes sont dressées,
Alentour du brasier et les jambes croisées,
S’interrogent entre eux,
De joie et de bonheur leurs heures semblaient faites ;
Tant de nobles espoirs reposaient sur leurs têtes ;
De tant d’êtres chéris
S’appuyait à leur bras la vieillesse tremblante !…
Quand, soudain, dans les plis de sa robe sanglante,
La guerre les a pris !
Quelques étudiants, las de leur ignorance,
Demandent à l’un d’eux qui jadis vit la France,
Ce que c’est que Paris,
Paris où l’univers, en masse, vient se rendre ?
Et l’autre s’évertue à leur faire comprendre
Ce qu’il n’a pas compris.
On refuse de croire, on traite d’imposture
Un récit qu’à plaisir le conteur dénature
Afin d’étonner mieux.
Et, perdu dans son rêve, un enseigne fredonne,
D’une voix attendrie, un vieil air monotone
Où l’on parle d’adieux.
Ainsi qu’à son départ le lui firent promettre
Les parents inquiets, l’un écrit une lettre
Sur l’affût d’un canon ;
L’autre a posé sa main dans la main d’un Tzigane
Qui lui dit gravement, et tandis qu’il ricane,
Le sort, propice ou non.
Et chacun, à son tour, au bruyant auditoire,
Expose ses désirs, raconte son histoire,
Triste et gaie à la fois ;
Humble histoire d’amour, presque pour tous la même ;
Et celui qu’on écoute a le visage blême
Et des pleurs dans la voix.
Puis ils parlent aussi des sœurs et des aïeules
Et des mères surtout qui restent, toutes seules,
Les attendre là-bas,
Et qui pourraient mourir, par la douleur brisées,
Si, les rumeurs de guerre étant bien apaisées,
Ils ne revenaient pas !
On fait silence alors. À ce seul nom de mère
S’éveille dans les cœurs quelque pensée amère,
Quelques regrets tardifs ;
Mais, d’un prochain retour tous ces enfants se flattent,
Et la gaîté renaît, et les rires éclatent
Plus vibrants et plus vifs.
— « Ont-ils donc oublié, dans leur joie insolente,
Et l’Osmanli cruel, et la balle sifflante
Qui frappe au nom d’un Dieu ? »
Dites-vous. Ah ! souffrez que pour une heure entière,
Une heure qui peut-être est leur heure dernière,
L’oubli les berce un peu.
Et ne les troublez pas, eux qu’attend la mitraille.
Demain vous pourrez voir, au fort de la bataille,
Sous le fer des bourreaux,
Ces insensés d’un jour, dont le rire vous blesse,
Au poste désigné, sans plainte, sans faiblesse,
Succomber en héros.
13/25 septembre 1877.
(1) Il existe encore en Roumanie des boyards portant le nom de Canta uzène. Cette origine n’est pas incontestée. Deux familles se disputent l’honneur de descendre des anciens empereurs d’Orient et s’accusent mutuellement d’imposture. Il paraîtrait que l’une d’entre elles n’a le droit de s’appeler que Magureanu. Au reste, le port de faux noms empruntés à l’histoire est assez fréquent dans l’aristocrate moldo-valaque.
(2) On nomme calarashi les régiments de cavalerie roumaine. Les Zinzares, qu’il ne faut pas confondre avec les Tziganes, sont les Roumains habitant la Macédoine. Les Roumains du Danube les appellent ainsi parce qu’ils prononcent la lettre c (tch) comme le z français. Par exemple, ils disent : zinze pour tchintche (cinq). Beyzadé (mot turc qui signifie fils de prince) est le titre qu’aiment à prendre les descendants des anciens hospodars. Voir « Le Dorobantz ».
V
Portrait
Or, quant à mon ancêtre, il a tiré sa trace
D’où le glacé Danube est voisin de la Thrace.
Ronsard (1).
Le soleil d’Orient a mis
Des reflets d’or dans son œil sombre.
Il compte, à lui seul, tant d’amis
Qu’il n’en pourrait dire le nombre.
Il est plus changeant que le vent.
Il est riche, et veut qu’on le sache.
Il tourmente du doigt souvent
Une imperceptible moustache.
Il a le cœur pur de soucis,
La bouche rieuse et mutine,
De longs cils et d’épais sourcils,
Le pied petit, la taille fine,
Le sourire malicieux,
Le front bas d’un modèle antique,
Le geste souple et gracieux,
Et la main aristocratique.
On n’approuve pas ce qu’il dit,
Mais quand sa parole étincelle,
En la blâmant, on l’applaudit :
Malgré vous, il vous ensorcelle.
Et le moyen de résister
À sa voix caressante et tendre ?…
Le cœur se plaît à l’écouter,
L’oreille se plaît à l’entendre.
Un cigare à la douce odeur
S’allume entre ses lèvres roses ;
Parfois il fait l’enfant boudeur
Et se donne des airs moroses.
Il lève les yeux au plafond
Avec des poses ennuyées :
Son chagrin n’est jamais profond,
Ses larmes sont vite essuyées.
Un sang vermeil bronze son teint ;
Son amour est un feu de paille
Qui fait grand bruit… et qui s’éteint.
Il s’irrite quand on le raille,
Il veut qu’on prenne au sérieux
Son récit le moins vraisemblable ;
Il est fantasque, impérieux,
Plein d’esprit… mais insupportable !
Mille boucles de cheveux noirs
Sont l’orgueil de sa tête folle ;
Il est en fête tous les soirs ;
Dans les salons on en raffole.
On le voit plus à l’Opéra
Qu’à son cours de philosophie.
Il protège Blanche, Laura…
De boyard il se qualifie.
Il commande à tous bravement ;
Partout, de tout, il se croit maître.
Il s’appelle ordinairement :
Constantin, Ioan ou Démètre.
De progrès et de liberté,
Sans y rien comprendre, il babille ;
Et laisse l’Université
Pour fréquenter le bal Mabille.
Il est indiscret et moqueur.
Ne comptez pas sur sa promesse.
Mauvaise tête et noble cœur,
Son grand défaut est la jeunesse.
Le tapage est son élément.
Il est grand chercheur d’algarades,
Beau valseur, détestable amant ;
Et la perle des camarades.
Il semble fait pour les plaisirs,
Nom pour les peines incommodes.
Le sort se plie à ses désirs ;
Il fait courir et suit les modes.
Et le monde, qui le défend,
Est près de croire à son génie…
Mais, moi, je dis : C’est un enfant,
C’est un enfant… de Roumanie !
9/21 juin 1877.
(1) On ignore généralement que le prince des poëtes était d’origine roumaine. Celui de ses aïeux qui vint se vint se fixer en France changea son nom de Marècine (ronce) en Ronçard. Les domaines des Màràcini étaient situés dans le district de Buzeo, en Valachie.
VI
À Ioan Héliade-Radulesco (1)
Dieu ! le Pruth exécré vomit toute sa rage !
Des nuages humains, de vivants tourbillons,
S’amassent sur ses bords avec un bruit d’orage…
Ils approchent… Quels sont ces larges pavillons ?
Ces canons, dans le sol imprimant leurs sillons ?
Ces farouches soldats qui, volant dans l’espace
Ont des traits inconnus, un langage étranger ?
Qui donc arrêtera leur cohorte rapace ?
Personne, hélas ! Du Tzar qui vient vous protéger,
C’est l’armée horrible qui passe !
Il n’est pas un fils de Roumain
Parmi ceux qui, perdant leurs heures dans les fêtes,
Souillent Tîrguvesci, la ville des poëtes (2).
Quels sont ces hommes-là qui se prennent la main ?…
L’un s’incline bien bas, l’autre de haut lui parle…
C’est un Moscovite, un Germain :
C’est le Tzar Alexandre avec le Prince Charle.
Combien de cadavres glacés
Par les flots de l’Ister bercés !
Combien de corps meurtris aux champs de Bulgarie !…
Ce sont les débris mutilés
De Roumains au Tzar immolés,
Et qui ne sont pas morts pour sauver la patrie !
Dieu n’enverra-t-il point un Vladimiresco (3)
La disputer au Tzar qui veut la rendre libre
Pour lui faire oublier Trajan, Rome et le Tibre ?
Non ! parmi les clameurs qui fatiguent l’écho,
Nul cri de colère ne vibre,
Nul vengeur ne survient… — Debout, Radulesco !
Debout ! Le pays souffre, un devoir te réclame !
Sur les événements répands, comme autrefois,
Toutes les clartés de ton âme,
Toutes les foudres de ta voix !
Armé de tes vertus, sors de la solitude ;
Le peuple se souvient, il te reconnaîtra ;
Sur tes traces il marchera :
Dans le cœur des petits n’est point l’ingratitude.
Tu leur seras sacré ! Lorsqu’ils t’écouteront,
Avec tes cheveux blancs, n’auras-tu pas au front
Ton passé, splendide auréole !
Ranime leur courage avec une parole ;
Montre-leur ces dangers qu’ils ne soupçonnent pas ;
Sois le rayon qui luise en leur ciel de ténèbres,
Et brise les trames funèbres
Où se prennent leurs faibles pas !
Démasque l’étranger qui brigue une couronne,
Et, sur leurs ossements, veut élever son trône
Au niveau du trône des rois.
En eux, des anciens jours grave la forte empreinte ;
Parle-leur des aïeux qui, les voyant sans crainte,
Vont tressaillir d’orgueil dans leurs cercueils étroits.
Marche ! Que ton génie éclaire la tempête !
La Liberté jamais ne descendra du Nord ;
Tu le sais ! Que rien ne t’arrête,
Ni l’exil qui t’attend, mi la haine qui mord,
Ni le glaive du Tzar qui frappera ta tête !
Sois cet Hébreu des temps lointains
Qui tombe, en secouant les piliers des portiques
Sur les immondes Philistins.
Porte jusqu’au tyran tes accents prophétiques.
Et, quand ton sang devrait jaillir,
Va ! Qu’importe le sang ! Tente un effort suprême.
Près d’atteindre le but tu ne dois pas faillir :
Sois Héliade ! sois toi-même !
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ainsi je t’appelais. À mes chants superflus
Ta grande voix restait muette.
J’écoutais ton silence, immobile, inquiète…
Et l’on m’a dit alors : Héliade n’est plus !
Héliade n’est plus ! L’ingrate Roumanie
Verra de bien des jours fuir la ronde infinie
Avant de retrouver et de pouvoir bénir
Au cœur d’un de ses fils un respect plus fidèle,
Un dévoûment plus pur et plus d’amour pour elle !
… Héliade n’est plus : le Tzar peut revenir !
Il faut qu’il soit profond le calme où tout retombe,
Il faut qu’il soit profond le sommeil dont tu dors,
Pour que le dernier cri d’un peuple qui succombe
Ne soit point venu, dans la tombe,
Te réveiller entre les morts !
La main qui te retient doit être bien puissante,
Puisque, quand les Roumains se dirent : Ce sont eux !
Puisque, lorsqu’ils foulaient ta cendre frémissante,
Les Baskirs n’ont point vu, terrible et menaçante,
Ton ombre surgir à leurs yeux !
Mais, dors ! Qu’aurais-tu fait ? Abusée, éperdue,
Ta fière Roumanie aux Russes s’est vendue !
Ô honte ! au Scythe abject le Romain s’est livré !
Ta parole de flamme, ô poëte inspiré,
Dans un tumulte vain aurait été perdue !
Dors ! Tes vieux compagnons reposent comme toi.
Ceux qui restent encore ont méprisé ta loi,
Et tu désavoûrais les tristes vœux qu’ils forment !
Dors ! tandis que le Tzar gouverne par l’effroi,
Heureux sont les Roumains qui dorment !
Défenseur de la liberté,
Ô toi qui, dans Islaz, un jour la fis renaître (4),
Fils du peuple, qui n’as point pris à quelque ancêtre
Ton nom et ta célébrité,
Que j’aurais voulu te connaître !
Mes vers, venant du cœur, t’eussent charmé peut-être…
Disent-ils pas : Honneur, Patrie, Humanité !
Ton noble cœur aurait accueilli l’étrangère
Qui chante ton pays dans l’ombre humilié.
Hélas ! je viens trop tard ! le sépulcre t’enserre !
Ces strophes, faible écho d’une douleur sincère,
Je les offre à ton fils qui n’a pas oublié
Que Radulesco fut son père !
10/22 novembre 1877.
(1) Ioan Héliade Radulesco fut un des hommes les plus remarquables de la Roumanie. Écrivain, il régénéra complètement la langue roumaine, la dota d’excellentes traductions de nos plus célèbres auteurs français et l’enrichit d’une multitude d’œuvres originales qui révèlent un poëte de génie et qui sont justement vantées par ses compatriotes. Plébéien, il défendit énergiquement la cause du peuple et sacrifia sa fortune pour l’organisation d’une centaine d’écoles. Patriote habile et prudent, il opposa toujours la suzeraineté ottomane au protectorat intéressé de la Russie. La Roumanie, disait-il, n’est point assez forte pour conquérir son entière indépendance, encore moins pour la maintenir. Comme tout homme de valeur, Héliade fut en butte aux attaques des envieux auxquels sa popularité portait ombrage. Il est des injures qui, sorties de certaines bouches, honorent plus celui contre lequel elles sont dirigées que les louanges les plus pompeuses. Pour notre part, nous sommes heureuse de pouvoir rendre un humble hommage à la mémoire d’un homme dont l’ouvre suffit à prouver la vitalité d’une race trop longtemps méconnue.
(2) La ville de Tîrguvesci doit ce surnom à ceux de ses nombreux enfants qui se sont illustrés dans les lettrés.
(3) Célèbre révolutionnaire valaque. Vladimiresco n’était qu’un simple paysan du banat de Craïova ; il tenta de délivrer son pays du jour des Phanariotes, et périt, lâchement assassiné, par les ordres du prince Alexandre Hypsilanti, le même qui fonda l’Hétairie.
(4) Islaz fut le berceau de la révolution roumaine de 1848, dont Héliade fut le chef.
VII
À la Dîmbovitza
(Imité du roumain)
Dîmbovitza, je viens à toi :
Ton onde est douce (1).
Tu ne me repousses pas, moi
Que l’on repousse.
Les hommes que j’ai pu juger,
M’ont l’âme aigrie ;
Et je suis comme un étranger
Dans ma patrie.
Maintenant, je n’ai conservé
Nulle espérance.
Par le monde je n’ai trouvé
Qu’indifférence.
Dîmbovitza, de mes amis
Les uns sont traîtres,
Les autres gisent endormis
Près des ancêtres.
Nul de moi ne se souvient plus,
Hélas ! personne !
Et sous mes pas irrésolus
Le sol frissonne.
Dîmbovitza, comme ce soir
Te voilà belle !
Il semble que sous ton flot noir,
La mort m’appelle.
Dîmbovitza, je suis tout seul ;
Ma vie est triste.
Donne-moi tes eaux pour linceul,
Puis… Dieu m’assiste !
J’ai le cœur libre de remords,
L’âme tranquille.
Dîmbovitza, roule mon corps
Loin de la ville.
Jusqu’au Danube bleu, là-bas,
Au Borysthène…
Afin que je n’entende pas
La voix humaine,
Le pas des hommes, les échos
De leur folie,
Et que, dans l’éternel repos,
Je les oublie !
4/16 juillet 1871
(1) Voir la note 3 de « Bucuresci ».
VIII
Georges Maghiero (1)
Oh ! pour la Roumanie il fut des temps prospères !
Lorsque, lassés du joug qu’avaient subi leurs pères,
Les Roumains révoltés chassèrent leur bourreau ;
Lorsque brillait encor cette illustre pléiade :
Les quatre Golesci, le poëte Héliade,
Tell et Georges Maghiero (2).
Héliade, sur tous, régnait par la pensée.
Maghiero régnait par l’effort de son bras.
Rappelant les héros de la Grèce passée,
Héliade semblait vivre dans l’Odyssée,
Maghiero semblait un autre Brasidas.
Son regard pénétrant faisait trembler les traîtres
Qui vendaient leur patrie à d’implacables maîtres ;
Du fond de son palais, le lâche Bibesco (3)
Sentait sur son front pale osciller sa couronne,
Et, sous lui, lentement se dérober son trône
Au seul nom du guerrier répété par l’écho.
Des Roumains délivrés sa gloire était bénie ;
Son audace était leur appui.
Il protégeait le peuple. Ainsi qu’un bon génie
Il planait sur la Roumanie,
Et le peuple croyait en lui !
Des jardins d’Andrinople et des steppes arides
Quand il vit venir à la fois
Les Zaporogues fiers, les Cosaques stupides,
Les pachas orgueilleux, les émirs intrépides,
Montés sur des coursiers qu’ils pressent de la voix,
Alors, il se leva, menaçant et farouche,
Le feu dans les regards, l’anathème à la bouche,
Appela ses soldats répandus par les champs,
Leur montra l’horizon, qui recélait un crime,
Et puis il s’écria, dans un élan sublime :
— Frères ! mon sabre a deux tranchants ! (4)
Oh ! quand il brandissait sa redoutable épée
Qui du sang ennemi fut si souvent trempée,
Dans la mêlée ardente, aux éclats du canon,
Quand il apparaissait calme ; terrible, austère,
Les soldats croyaient voir, descendu sur la terre,
Le céleste vengeur dont il portait le nom.
Héros par la valeur et géant par la taille,
Il dominait dans la bataille,
Comme un phare dans l’ouragan.
Il semblait qu’il fût invincible,
Et sur sa poitrine insensible
Venait s’émousser l’yatagan.
Il allait ; de son cœur la crainte était absente ;
Bravant la mort qui le fuyait,
À lui-même il se confiait,
Et, comète d’airain, la bombe frémissante
À ses pieds rampait impuissante.
Les Osmanlis disaient tout bas :
« Il s’avance, escorté des légions funèbres ;
L’ange noir, Azraël, va glanant sur ses pas,
Et quelque esprit maudit, échappé des ténèbres,
Invisible, guide son bras.
Il porte dans la guerre une armure infernale,
Que forgèrent pour lui les démons de l’enfer,
Et que ne pour percer une vulgaire balle,
Faite de plomb mêlé de fer.
Allah l’a condamné, mais son Christ le protège !
Les croyants sont vaincus par ce giaour obscur
Qui tient d’un talisman sa force sacrilège… »
Et, pour rompre le sortilège,
Les mécréants fondaient des balles d’argent pur (5).
Maghiero riait de leur vaine furie.
Il allait, contre tous défendant sa patrie,
Imprévoyant, hélas ! dans ses nobles écarts.
Un jour qu’à l’avenir il commençait à croire,
Il vit, sur Bucharest, en larges plis de moire,
Flotter la bannière des Tzars.
Il vit, vautours impurs, sur la plaine fertile,
S’abattre les Baskirs en épais tourbillons ;
Il tenta d’arrêter leur multitude hostile…
Et, trop faible, maudit son courage inutile,
Et dispersa ses bataillons.
Et, plutôt que de voir la Roumanie en larmes
Implorer vainement le secours de ses armes,
Et retomber plus bas sous un maître plus vil ;
Plutôt que de servir une force usurpée,
Aux pieds de l’autocrate il brisa son épée,
Et, proscrit volontaire, il partit pour l’exil.
Ô Roumanie, hélas ! la voilà revenue,
Cette aigle détestée, ondulant dans la nue
Au front de tes cités qu’emplissent les bourreaux !
Sans exciter l’horreur, horrible elle se dresse !…
Car les lâches sont nés, ils sont morts les héros,
Et pour veiller sur toi, dans ces jours de détresse,
Il n’est plus de Maghieros !
5/17 novembre 1877.
(1) Célèbre général valaque, Machiero se distingua par les services éminents qu’il rendit à la patrie, par sa double haine qui le faisait craindre également des Russes et des Turcs, et surtout par des exploits militaires et des traits de bravoure dignes des temps antiques. En 1848, il présenta à Kossuth un projet d’alliance hungro-roumaine qui aurait sauvé la Hongrie et qui fut dédaigneusement repoussé.
(2) Principaux chefs du mouvement révolutionnaire valaque. Les lecteurs roumains remarqueront sans doute que nous avons omis les noms d’autres personnages qui ont joué un rôle politique en 1838. Nous leur ferons observer qu’il est des noms qui ne peuvent être accolés les uns aux autres.
(3) Ancien hospodar de Valachie. L’énumération des turpitudes de ce prince tiendrait tout un volume. Bornons-nous à rappeler, avec M. Élias Regnault, que, sous le règne de ce Bibesco, le total des sommes détournées au seul département des travaux publics fut de trente-trois millions de francs.
(4) Ces belles paroles, prononcées par Maghiero, sont devenues célèbres.
(5) Historique.
IX
Exil
À Ioan Héliade Radulesco
Te lasu, patrie, ’n sclavie ;
Si ’n păment si loc străin
Nu m’astéptă de căt chin,
Viată amară, moarte vie.
I. Heliade Radulescu.
Que j’ai vu de pays ! Pourchassé par l’exil,
Oh ! que j’ai parcouru de régions lointaines !
Des confins de l’Asie aux pampas du Brésil,
J’ai longtemps promené le fardeau de mes peines.
Je visitai l’Égypte et l’Irak tant vanté ;
La Grèce, morte, hélas ! et la jeune Allemagne ;
La France, dont le nom parle de liberté ;
L’artistique Italie et la brûlante Espagne…
Que j’ai vu de pays ! Mais je n’en trouvai pas
Un seul qui fût si beau que toi, terre bénie
Que les destins jaloux ont fermé à mes pas,
Que je ne reverrai jamais… ô Roumanie !
Que j’ai vu de cités ! Il n’est pas un endroit
Où mon bras n’ait dressé ma tente vagabonde.
L’exil, qui borne tout d’un horizon étroit,
M’enleva ma patrie et me donna le monde.
Le colosse Paris sut longtemps m’arrêter ;
Je me laissai séduire aux charmes de Lahore ;
Je vis Rome et Milan qu’il me fallut quitter,
Constantinople, assise aux rives du Bosphore ;
Vienne l’impériale et sa rivale Pesth ;
Séville la Moresque aux légères tourelles…
Que j’ai vu de cités ! Mais aucune d’entre elles,
Comme tu me plaisais, ne me plut, Bucharest !
Comme l’Hébreu captif chantait à Babylone
Le long des fleuves purs, sous les saules en pleurs,
Aux bords sacrés du Gange où le lotus foisonne
Aux pieds des dieux hindous, j’ai chanté mes douleurs.
La Theiss, qui du Maros dans son cours s’est accrue ;
Le Volga déchaînant ses flots impétueux ;
Le Tigre qui, pleurant sa gloire disparue,
Roule des vieux palais les débris somptueux ;
L’Amazone, fuyant sous un dais de ramure…
Je les donnerais tous, des Andes à Lassa,
Pour entendre une fois encor ton doux murmure,
Toi qu’on connaît à peine, humble Dîmbovitza ! (1)
13/23 août 1877.
(1) Dîmbovitza. Voir « Bucuresci », note 3.
Х
Chant de guerre des Roumains de Transylvanie (1848)
Des Krapacks à la plaine où la Theiss vient s’étendre,
Voici les Latins révoltés.
Ils se sont levés tous ensemble pour défendre
Et leurs droits et leurs libertés.
Partout le sombre cri des groupes populaires
Qui tiennent l’avenir en mains
Gronde et réveille enfin les haines séculaires
Des Magyars et des Roumains.
Assez longtemps de ceux que le sort fit nos maîtres
Nous avons supporté l’orgueil.
Aux armes ! Nous voulons la liberté des reîtres,
Ou la liberté du cercueil !
Aux armes ! afin que l’ennemi qui nous brave
De ceux qui combattaient jadis
Sous Étienne le Grand et sous Michel le Brave
En nous reconnaisse les fils !
15/27 juin 1877.
XI
Manoli & Maritza
À Mlles Euphrosina & Virgilia Héliade Radulesco
À l’horizon, parmi la brume,
Voyez-vous flotter une plume,
Et courir un cheval qui fume,
Et revenir mon bien-aimé ?…
Victor Hugo.
Encore une fois, hélas ! c’est la guerre ;
Les soldats roumains hier sont partis ;
Bon nombre d’entre eux ne reviendront guère.
La mêlée emporte et grands et petits.
Que d’espoirs perdus ! Que d’amours brisées !
Maritza demeure et Manol s’en va…
Et le cliquetis des lames croisées
Fait fuir le bonheur que leur cœur rêva.
Manoli, pourtant, est plein de courage ;
Il a confiance en son arme, en Dieu…
Mais, pour conjurer un mauvais présage,
Il dit : au revoir ! et non pas : adieu !
— « Le jour est levé, dit celle qui reste,
Sans doute à cette heure il est loin déjà,
Et son régiment poursuit d’un pas leste
La route qui mène à la Dobroudja.
Les vastes forêts couvrent de leur ombre
Son front tout songeur qui rêve de moi…
Si le passé rit, l’avenir est sombre,
Et je porte au cœur comme un vague effroi. »
Hélas ! Maritza, Manol à toi pense,
Mais il a passé le Danube bleu ;
Dans la Dobroudja la troupe s’avance,
Et le sol reluit sous le ciel en feu.
Dans la Dobroudja, désert sans limite,
La course est pénible au pauvre soldat ;
Le regret l’étreint, la force le quitte…
Aujourd’hui la soif, demain le combat.
— « Le soir est venu, dit la fiancée,
Maintenant sans doute, il campe à Tobak,
Et mon souvenir emplit sa pensée
Tandis qu’il s’assied au feu du bivac.
La brise du nord jusques à lui porte
Les parfums connus des fleurs de nos bois…
Si le cœur faiblit, l’âme reste forte ;
De crainte et d’espoir je tremble à la fois. »
Hélas ! Maritza, l’atmosphère est pleine
De l’odeur du sang qui coule à grands flots ;
Sous les escadrons s’ébranle la plaine,
Le bruit du canon répond aux sanglots.
À travers les rangs Manoli s’élance,
Chacun de ses coups donne le trépas.
Un cavalier turc de sa lourde lance
Va frapper Manol qui ne le voit pas…
— « Enfin, c’est la nuit, dit la pauvre fille,
Se bat-on, là-bas ? Non ! l’air est trop doux,
Trop calme est mon cœur, et la lune brille
Là-bas comme ici, pour eux et pour nous.
Manol reviendra. Ma crainte sommeille,
Et je laisse enfin l’effroi puéril.
M’aime-t-il toujours ?… Tandis que je veille,
Il dort sous la tente : à quoi rêve-t-il ? »
Hélas ! Maritza, qui sait à quoi rêvent
Ceux qui, maintenant, là, sont étendus ?…
S’ils rêvaient hier, leurs songes s’achèvent
Là-haut, et Manol ne reviendra plus !
Et si tu l’aimais, ô Maritza, pleure !
D’un profond sommeil pour jamais il dort ;
De son aile noire un corbeau l’effleure,
Et la lune brille… et Manol est mort !
3/15 août 1877.
XII
Ianco, roi des montagnes
(Épisode de la guerre de Hongrie, 1848)
La zece Ungarii un Romăn.
Proverbe transylvain.
I
C’est sur les monts couvrant de frimas à jamais
Leurs éternelles altitudes,
C’est au plus haut des hauts sommets
Que l’aigle, roi des solitudes,
Suspend son gîte impérial,
Son sauvage Kremlin, son fauve Escurial.
C’est aux gorges d’Abrud, sur un roc centenaire,
Qu’Ianco, l’aigle valaque, avait bâti son aire (2).
Et comme les Krapacks, lorsque le soir descend,
Protègent les cités voisines de leur ombre,
Ianco, farouche et bienfaisant,
Sur son Ardialie, à sus pieds reposant,
Étendait sa grande aile sombre ! (3)
L’Ardialie encor des hommes surhumains
Qui jadis soumirent le monde,
Dans les chants des pâtres roumains,
Et dans les pierres des chemins
Conservait l’empreinte profonde.
Ils étaient bien les fils des vieux colons romains,
Ceux dont les traits hardis, les longues chevelures
Rappelaient aux Latins, venus de l’Éridan,
Les merveilleuses ciselures
De la colonne de Trajan (4).
Parmi ces montagnards, vrais héros d’un autre âge,
Qui semblent respirer l’horreur de l’esclavage
Avec l’air parfumé de leurs rudes climats,
Parmi ces laboureurs soldats,
Ianco se reposait dans sa grandeur sauvage.
Les plus fameux des partisans
Étaient les grands de son royaume ;
Dans son palais couvert de chaume
Il n’avait pas de courtisans.
Et ce roi que les rois n’auraient pu reconnaître,
Sacré par ses égaux et régnant sans terreur,
Dans ses rochers était plus maître
Qu’à Pesth ne l’était l’Empereur.
De trône, il n’en possédait guère ;
Pour sceptre ayant sa volonté,
Sa couronne était la fierté
Qui siégeait sur son front sévère ;
Et libre, il déployait, dans la paix et la guerre,
Son étendard : la liberté !
II
Quand les monarques sacrilèges,
Abusant de leurs privilèges,
Sur la Liberté sainte osent porter la main…
Frémissante, et des monts reprenant le chemin,
Elle court exiler son courroux dans les neiges.
Parcourez, de nos jours aux temps des demi-dieux,
L’histoire des peuples victimes,
Vous verrez sur les blanches cimes
Montant plus avant dans les cieux
Les héros plus audacieux
Et les dévoûments plus sublimes.
Léonidas n’est plus ! Hellé meurt avec lui.
Et plus de vingt siècles ont lui
Sur le défilé catacombe.
À l’Orient, qui donc se réveille aujourd’hui ?…
C’est Hellé qui sort de la tombe !
Le Palikare apprend à l’univers surpris
Que le vieux sang des Grecs dans ses veines bouillonne.
Mistra s’élève aux lieux où fut Lacédémone,
Mais, si l’on a changé, si l’on a désappris
Les noms des hommes et des choses,
Brasidas oublié revit dans Botzaris,
Et l’antique Eurotas roule encor ses flots gris
Sous l’ombre de ses lauriers-roses.
Le Russe au langage subtil,
De sang et de vin toujours ivre,
Accourt porter la guerre au pays de Schamyl.
Lesghis et Circassiens aux longs fusils de cuivre
Écrasent l’étranger sous leur bras de Titan,
Car, pour les fils du Daghestan,
Vivre esclave, ce n’est pas vivre.
En vain le Tzar oppose au nouveau Mahomet
Vingt généraux fameux dont parlera l’histoire…
Est-ce Schamyl qui se soumet ?
Il défend, pied à pied, le sacré territoire,
Et les échos d’Afkai célèbrent sa victoire.
Mais le sort a changé. L’empereur canonnier
S’empare du lion que la houte dévore…
L’iman Schamyl est prisonnier :
Le Caucase résiste encore !
Si les sombres desseins des rois devaient mûrir,
Si nos yeux devaient voir la liberté mourir,
Sous les cieux privés de lumière,
Sur la terre livrée aux canons, aux poignards,
C’est dans les monts abrupts où l’ours a sa tanière,
C’est dans le cœur des montagnards
Qu’elle s’éteindrait la dernière !
III
L’Ardialie en feu voit ses champs envahis.
Les pals et les gibets hérissent le pays.
On dirait, à l’horreur de ces engins barbares,
Que les temps sont encor des Huns et des Avares.
Et les drapeaux hongrois, flottant au vent du nord,
Balancent cet arrêt : l’Union ou la Mort ! (5)
Noire duplicité ! sinistre raillerie !
Le Magyar qui montre à l’Europe attendrie
Les fers dont on charge ses mains,
Le Hongrois opprimé qui pleure sa patrie,
Se fait le bourreau des Roumains !
Il ne veut pas de maître, il lui faut des esclaves !
Gaj, Jellajich, Ianco, vous tous, Latins et Slaves (6),
Abaissez votre orgueil, courbez vos fronts meurtris.
Si vous ne cédez pas, on vous nommera traîtres !
Oubliez, vouez au mépris
La douce langue des ancêtres,
Seul trésor des peuples proscrits.
Kossuth le veut ! L’Europe à sa cause est acquise ;
Elle admire les attentats
De Louis Kossuth qui déguise
Sous son masque d’apôtre une âme de Judas.
L’aigle qui dans les cieux vole avec la comète,
Contemple le soleil et brave la tempête,
Peut affronter sans peur l’aspic aux anneaux verts.
« Venez ! a dit Ianco, les Roumains vous attendent !
Abreuvez vos magnats du sang qu’ils vous demandent !
À vous la honte ! à nous les glorieux revers !
Nous mourrons Transylvains pour la Transylvanie !
Hongrois ! nous préférons le cercueil à nos fers,
Le trépas à l’ignominie ! »
IV
Alors des cris de mort de Bude sont partis,
Semblables aux cris de l’hyène
À quelque impur festin appelant ses petits :
Louis Kossuth hurlait, fou de rage et de haine :
« Hatvany, Kémény-Forkos (7),
Traquez, frappez sans nul repos,
Et qu’il ne reste que les os
De ces affreux brigands du Tibre.
Que pas un n’échappe à vos coups !
Ayez du sang jusqu’aux genoux :
Dans les pays voisins, hors nous,
Je ne veux pas de race libre !
Quand il faudrait les empaler,
Puisqu’ils refusent de parler
Notre langue et de s’enrôler
Sous les drapeaux de saint Étienne…
Hourrah ! mes braves compagnons,
Vos mousquets leur diront vos noms.
Hourrah ! que devant nos canons
Il ne soit obstacle qui tienne ! (8)
Puisque Trajan est leur aïeul,
Qu’on les couche dans leur linceul !
Nous sommes le peuple à qui seul
Doivent obéir tous les autres !
Nargue des préjugés étroits !
Nous sommes de vaillants Hongrois
Qui ne reconnaissons de droits
Que pour autant qu’ils sont les nôtres !
Occupez tous les défilés,
Mes nobles honveds, et brûlez
Si ces Valaques endiablés
Opposent trop de résistance.
De leur plainte étouffez l’écho.
Et qu’on me livre cet Ianco
Qui joue au Vladimiresco (9),
Et qu’on lui dresse une potence !
Ils se souviendront de Hôra,
Les Butiano, les Dobra (10) :
Aussitôt pris on les pendra !
Vous aurez leurs biens pour salaire.
Les Transylvains sont condamnés.
Jusqu’à leurs enfants nouveau-nés,
Écrasez tout ! Exterminez !…
C’est trop longtemps qu’on les tolère ! » (11)
V
Près d’Abrud, ce réduit des enfants de Corvin (12),
Des régiments d’élite emplissent le ravin.
Certe, on peut avec eux tenter une conquête.
À l’ordre de Kossuth soumis,
Hatvany galope à leur tête ;
Ils n’ont connu d’autre défaite
Que celle de leurs ennemis.
Des coursiers enlevés aux déserts de Syrie
Traînent leur lourde artillerie ;
Et, parmi les hussards, faits de velours et d’or,
Les yeux admirent plus encor
Ces honveds chamarrés, l’honneur de la Hongrie.
Et là, sur ce plateau, de tant d’exploits témoin,
Sont groupés les Roumains qu’on reconnaît de loin
À leurs habits de toile, à leur noire crinière,
Aux trois couleurs de leur bannière (13).
Ils n’ont ni canons ni chevaux.
Les armes que le peuple aux fauves allégresses
Lève sur les tyrans gros de crimes nouveaux
Sous les murs de leurs forteresses :
Des piques, des fourches, des faux,
Brillent dans leurs mains vengeresses.
Ianco, le soldat justicier,
Avec ses bataillons descend la pente aride.
Et l’ouragan est moins rapide,
Le feu du ciel moins meurtrier
Que cette phalange intrépide
Qui jette des éclairs d’acier.
Sur les Daces, dont on renomme
Les courages désespérés,
Ainsi fondaient en rangs serrés
Les légionnaires de Rome.
Hatvany consterné voit échouer son plan.
Il lance ses honveds, commande, implore, excite.
Vains efforts ! Les Roumains semblent sortir du flanc
De la montagne qui palpite.
Sous leur impétueux élan,
La tourbe des Hongrois s’agite
Avec des vagues d’océan.
Les bandits de la Theiss méritent leurs salaires,
Kossuth ! ils ont du sang plus haut que les genoux,
Et leurs cris vont troubler le sommeil des hiboux,
Dans les cavernes séculaires.
Nul n’est victorieux, nul n’est encor vaincu.
« À nous, s’écrie Ianco, toute cette hécatombe !
Frères, avant que la nuit tombe
Les Magyars auront vécu ;
Un Roumain creusera leur tombe ! »
Quelle force conduit tes pas audacieux ?
Des Hongrois verrais-tu se voiler le grand astre ?
Et, dans l’immensité des cieux,
Lis-tu ta gloire écrite auprès de leur désastre ?
Tu dois être vainqueur, Ianco, voici la nuit !
Dans le mélange affreux des vapeurs et du bruit,
Sur les chairs en lambeaux des masses écrasées,
On ne distingue plus qu’une faux qui reluit,
Un canon sans affût et des hampes brisées.
Quand l’aube se leva sur les champs ravagés,
Les Roumains triomphants, autour d’Ianco rangés,
Virent à l’horizon, encor noir de fumée,
Hatvany fugitif qui pleurait son armée !
VI
Ces Transylvains, pourtant, qui des Impériaux
Jadis avaient suivi la fortune incertaine,
Erraient éperdus dans la plaine (14).
Les vieux manoirs seigneuriaux
Les abritaient de la tempête ;
Chaque soir amenait pour eux
Une lutte inégale, un combat désastreux,
Et chaque aurore une défaite.
Et, contre les Hongrois sans force, sans recours,
Ils allèrent du Tzar implorer le secours…
Tandis que seul debout, au sommet des Carpathes,
Ianco faisait flotter ses aigles écarlates !
Ianco ne croyait pas, dans son âpre équité,
Qu’aux armes de la tyrannie
Les nations à l’agonie
Pussent devoir la liberté.
VII
Quand l’altière Hongrie, épuisée en batailles,
De ses propres splendeurs eut fait les funérailles,
À Vienne un homme vint que l’on n’attendait pas.
Son regard était chargé d’ombre ;
Les portes du palais s’ouvrirent à ses pas,
Et, devant l’empereur, il parut, calme et sombre.
Ils étaient là, tous deux choisis par l’Éternel
Pour l’accomplissement d’une tâche suprême ;
L’un grandi par son rang, l’autre grand par lui-même.
Et ce fut un spectacle étrange et solennel
Quand, parmi ces seigneurs aux paroles hautaines,
Dans ce brillant palais dont les riches parois
Gardaient encor l’écho de ces louanges vaines
Qui corrompent le cœur des rois,
Le Roumain éleva la voix.
« Ô Ferdinand, dit-il, l’Autriche te contemple,
Assis dans ton orgueil comme un dieu dans son temple.
Le ciel dans tes États a ramené la paix ;
Tu foules, dédaigneux, la Hongrie étouffée ;
Ses dépouilles te font un splendide trophée ;
De ses larmes tu te repais.
L’Europe, composant sa nouvelle attitude,
À te plaire aujourd’hui met toute son étude,
Tant les hommes sont faux, tant leur masque est épais !
Du dictateur hongrois elle épousait la haine ;
Oh ! comme elle aurait ri de ta pourpre en lambeau !
Avec quelle allégresse elle eût, dans le tombeau,
Vu descendre, avec toi, la maison de Lorraine !
Mais Kossuth est muet. De Pesth à Kolosvar,
Hormis le cœur du Magyar,
Il n’est rien qui ne t’appartienne.
Car notre force a fait la tienne,
Car nous avons posé sur ton front de César
La couronne de saint Étienne !
Mes sauvages Roumains et leur poignard sanglant
Valaient bien tes hussards dressés à la manœuvre.
Nous avons raffermi ton empire croulant.
Salut ! Roi des Hongrois, ta puissance est notre œuvre !
Par nos armes tu fus vainqueur ;
Sans nous, ta gloire était flétrie ;
Nous avons tout sauvé : ton trône, ton honneur,
Et le seul bras d’Ianco te livre la Hongrie.
Sache-le cependant. Nul de nous n’a pour toi
Cet entier dévoûment sur quoi tu te reposes.
Que ce soit Vienne ou Pesth qui se plie à ta loi,
Qu’importe ! Le hasard unissait nos deux causes.
Kossuth, en nous perdant, a perdu son pays.
Si nos droits les plus saints n’avaient été trahis
Par ses décrets irrévocables,
Si les Hongrois avaient, laissant leur vanité,
En offrant l’Union, offert l’Égalité…
(Les peuples n’ayant point de haines implacables)
Pour eux et contre toi, tous, nous eussions lutté,
Et ce siècle verrait, par un juste équilibre,
L’Autriche humiliée et le Magyar libre !
Dans ton palais je ne viens pas
Mendier le vil prix d’un glorieux ouvrage.
Ianco ne vend ni son courage,
Ni les têtes de ses soldats.
Non ! je viens réveiller la mémoire en ton âme.
Souviens-toi, Ferdinand ! Quand la honte montait
À ton orgueilleuse oriflamme,
Quand la Renommée emportait
Les victoires de Bem sur son aile de flamme :
— Sauvez-moi ! criais-tu, mes fidèles Roumains !
Mêlez vos larges faux à mon canon qui tonne !
De Pesth, de Szégédin, ouvrez-moi les chemins,
Je vous délivrerai de maîtres inhumains,
Et votre liberté, vainqueur, je vous la donne ! —
À ton tour te voilà le maître. Anéantis
Les odieux traités qui nous ont faits ta proie.
Les grands dans ton malheur avaient placé leur joie,
Crains de voir auprès d’eux se dresser les petits.
Fais un pays ami d’une hostile province ;
Par ta justice, enfin, mérite notre amour.
Que le monde sache en ce jour
Ce que peut bien peser la parole d’un prince ! »
La liberté, jamais, n’est un présent des rois.
Au héros transylvain on offrit une croix !
Comme se réveillant soudain d’un rêve étrange,
Du geste il repoussa ce hochet de métal
Que l’homme, trop souvent, va chercher dans la fange,
Et, triste, s’en revint à son hameau natal.
VIII
Dans l’éther obscurci l’aigle a ployé son aile.
Ianco s’est endormi dans la nuit éternelle ;
Et le sol transylvain qu’il avait tant aimé,
Sur tout ce qui fut lui s’est enfin refermé.
Les étrangers, cherchant des palmes de victoire
Sur un marbre géant d’arabesques semé,
Ne savent même pas qu’ils foulent tant de gloire.
Mais l’avide néant qui s’acharne aux autels,
Aux trônes, à cent noms qu’on croyait immortels,
En dévorant le corps respecta la mémoire.
À ces cœurs généreux qui laissent en partant
De nobles actions la trace ineffaçable,
Les vieux refrains naïfs qu’un pâtre va chantant
Forment un monument plus vrai, moins périssable
Que les arcs de granit, les colonnes d’airain
Qu’on élève à grands frais à quelque souverain
Dont le règne inutile est écrit sur le sable.
Et quand les jours, les ans, les siècles auront fui,
Accumulés sur ces campagnes,
Elles conserveront encor, comme aujourd’hui,
Le vivant souvenir d’Ianco, Roi des Montagnes.
18/30 janvier 1878.
(1) Chef des partisans transylvains qui combattirent les armées magyares, en 1848. Voyez le Dictionnaire des contemporains, de G. Vapereau.
(2) Abrud-Banya, lieu de naissance d’Ianco, n’est qu’un petit bourg resserré entre les ramifications des Carpathes.
(3) Ardealul (en hongrois Erdely) est le nom que les Roumains donnent à la Transylvanie.
(4) Le costume national des Roumains est la reproduction exacte des costumes daco-romains représentés sur les bas-reliefs de la colonne trajane.
(5) Historique. Voir les lettres hongro-roumaines de Démètre Bratiano et Daniel Ira’nyi.
(6) Louis Gaj et le Ban Jellajich étaient les chefs de l’insurrection croate.
(7) Les Autrichiens étaient commandés par Püchner ; les majors Hatvany et Kémény-Forkos, qui s’adjoignirent le général polonais Bem, avaient le commandement des troupes hongroises.
(8) Kossuth avait dit, en parlant des Transylvains : Ou nous serons exterminés par eux, ou nous les exterminerons ! Et, répondant à une députation roumaine qui était venue pour traiter avec lui, il s’écria : Quand on veut une nationalité, on la conquiert par le sabre !
(9) Voir « À Ioan Héliade Radulesco », note 3.
(10) Pâtre transylvain. Il aimait à prendre le titre d’empereur de Dacie ; son rêve était, d’ailleurs, de rétablir l’ancienne Dacie telle qu’elle avait été constituée par Trajan. À la tête de 15 000 insurgés, il lutta énergiquement contre les Hongrois qui finirent par s’emparer de lui et de son compagnon Clasca. Tous deux furent amenés à Pesth et périrent sur la roue, le 28 février 1785. Quant à Butiano et à Dobra, lieutenants d’Ianco, ils furent attirés dans un piège et pendus ensuite.
(11) L’Ellenor, publié à Kolosvar, demandait mille têtes de Roumains pour étouffer la rébellion dans son germe. Le Kol hirado(numéro du 29 octobre) disait qu’il fallait porter le fer et la flamme dans les villages roumains et massacrer jusqu’aux enfants au maillot, afin que ne restât pas de traces de la génération actuelle ! Enfin, le gouverneur de Transylvanie engagea les Szeklers à faire la chasse aux Roumains. « Les meubles et immeubles que vous enlèverez aux hommes de cette race vous appartiendront en toute propriété » disait-il.
(12) On sait, ou plutôt on ne sait pas, que Jean Corvin était de race roumaine. Il naquit dans le village de Corvin (petite Valachie). Sa mère était Grecque, son père se nommait Budus. Les Hongrois ne pardonnèrent jamais à Huniade une origine qu’ils considéraient comme ignoble, et les magnats appelaient dédaigneusement le roi Mathias le roitelet roumain. Le nom de Corvin est encore porté par un grand nombre de familles ardialiennes et valaques. Il y a même actuellement à Bucarest un Corvin professeur de danse (!).
(13) Les couleurs du drapeau transylvain étaient le rouge, le bleu et le blanc ; il portait l’inscription suivante : Virtus Romana rediviva. Aujourd’hui, les couleurs de la Roumanie sont le bleu, le jaune et le rouge.
(14) Les Transylvains s’étaient divisés en deux parts : l’une combattait sous les ordres d’Ianco et d’Acenti ; l’autre avait offert ses services à Püchner qui fut, à plusieurs reprises, battu par les troupes de Bem.
XIII
Bucuresci (1)
Plongé dans la solitude
De l’étude,
Je languissais à Paris.
Sous les branches dépouillées,
De feuillées
Soudain mon cœur s’est épris.
Dans le bruit et dans la foule
Qui s’écoule,
Joyeuse, au Quartier Latin,
Aux forêts, aux steppes nues,
Peu connues,
Je songeais soir et matin.
Et j’ai fui la capitale
Qui s’étale
Sous son ciel gris attristant ;
Du pays j’ai pris la route,
Et, sans doute,
À Bucharest on m’attend.
Ce fut par un jour d’automne
Monotone
Que je vis dans le lointain
Se dresser la Métropole,
Sa coupole
Et ses clochetons d’étain ;
Les cent trente autres églises,
Toutes grises,
Avec leurs quatre cents croix (2) ;
Et les bouquets d’arbres sombres,
Dont les ombres
Se projettent sur les toits.
Puis, sur les maisons perchées,
Par nichées,
Les cigognes au long col,
Et, par centaines, les grues
Accourues,
Rayant les airs de leur vol.
Là, j’entendais le tapage
Que propage
La turbulente cité
Qui dans la brume s’élève,
Comme en rêve
Un paradis enchanté.
Voyageur, si dans la vie,
Quelque envie
Vers elle amenait tes pas,
Admire de loin ; ensuite,
Passe vite,
Et plus près n’approche pas.
Car Bucharest la rebelle
Est plus belle
Cent fois de loin que de près ;
Car tu la verrais assise,
Indécise,
Dans la fange et les marais,
Sur les bords d’une rivière,
Sale et fière,
Où la fièvre guette et dort,
Qui coule son eau tranquille
Par la ville,
Et que l’on exalte à tort (3).
Tu verrais, croisant entre elles,
Des ruelles
Et de larges boulevards,
Des palais et des cabanes,
Des Tziganes,
Des moines et des boyards,
Des juifs à la face immonde,
Tout un monde
D’ambassadeurs étrangers,
Un tas de Hongrois sinistres,
Des ministres,
Des moutons et des bergers,
Des haillons frôlant la soie,
Et la joie
Éclatant parmi les pleurs,
Des splendeurs faites de fange,
Un mélange
De vices et de douleurs.
Dans les cris ou les harangues,
De vingt langues
Tu distinguerais les sons.
L’ascultatzi des patrouilles (4),
Des grenouilles
Les agaçantes chansons (5),
Le glas des cloches cassées,
Balancées
Dans leurs tourelles de bois…
À ton oreille étourdie,
Assourdie,
Résonneraient à la fois.
Et, traqué par la fortune
Importune,
Tu marcherais irrité,
Si l’hiver nous fait la moue,
Dans la boue,
Dans la poussière l’été.
Mais ma parole est empreinte
De la crainte
Que tu ne puisses, surtout,
Nous quitter sans nous connaître,
Et, peut-être,
L’âme pleine de dégoût.
Car nous t’aurions pu déplaire ;
De colère
Tu retournerais vers Pesth,
Pour en France l’aller dire,
Et maudire
Les Roumains et Bucharest.
Oh ! sois indulgent pour elle,
Et rappelle,
Rappelle à tes sens surpris
Qu’on offre – chose imprévue –
À ta vue
Bucharest… singeant Paris.
Que, princesse de théâtre,
Idolâtre
De ce qui tinte ou reluit,
Elle répète son rôle,
Et que, folle,
Pas à pas elle vous suit.
Que, dans sa persévérance,
C’est la France
Qu’elle imite en souriant,
Et que, moderne Sodome,
On la nomme :
Le Paris de l’Orient (6) !
6/18 octobre 1877.
(1) Bucuresci (prononcez Boucourechti) est le nom roumain de Bucharest.
(2) Une tradition populaire élève au nombre de 365 (!) les églises de Bucharest, parmi lesquelles on distingue la Métropole, située sur une colline qui domine la ville.
(3) La capitale de la Roumanie est traversée du nord-ouest au sud-est par la Dimbovitza. Un proverbe local, que les Valaques se plaisent à répéter, dit : Dimbovitza,apă dulce, cine o bea nu semai duce ! (Dimbovitza, eau douce, qui la boit ne s’en va plus !)
(4) Écoutez ! Cri de ronde des sentinelles roumaines.(5) Il y a quelque trente ans, les grenouilles étaient extrêmement nombreuses à Bucharest ; elles annonçaient, par les cris, le lever le coucher du soleil. L’assainissement de la ville commence sons le prince Stirbeiù, les a fait disparaître en grande partie.
(6) Le luxe inouï qu’elle étale a valu à Bucharest ce surnom dont elle se montre fière et qu’elle s’efforce chaque jour de justifier davantage.
XIV
Aux filles d’Héliade
Mortea pentru a ta scăpare,
A fost tota tinta mea ;
Fericirca ’mi cea mai mare
E să mor când vei via.
Ion Héliade Radulesco.
I
Vous souvient-il encore, ô filles d’Héliade,
De ces temps où, marqué d’un redoutable sceau,
Votre père veillait, rêvant son Iliade,
Près de votre berceau ?
Quand sa plume magique et de flamme trempée,
D’Étienne et de Michel retraçait les exploits,
Et qu’il reconstruisait, dans sa vaste épopée,
L’édifice écroulé des gloires d’autrefois ?
Les autres, oubliant leur nom, leur origine,
Dans leur abjection se traînaient aux genoux
D’un hospodar venu de Stamboul ou d’Égine,
Et le poëte, seul, se souvenait pour tous.
Ils vivaient, ces boyards, de leur vie insensée,
Sans songer que leur règne était près de finir,
Et se jouaient d’un peuple impuissant à punir,
Tandis que votre père, au fond de sa pensée,
Préparait l’avenir.
Rêveur et comparant, dans ses ardentes veilles,
Les hontes du présent aux splendeurs, aux merveilles
Du grand siècle de Mircéa (1),
Il fit serment, malgré le Kremlin et la Porte,
De rendre sa patrie encore libre et forte,
Telle que Trajan la créa.
Car, plongé dans la nuit, il croyait à l’aurore.
Il savait bien que tout n’était pas mort encore
Dans l’âme indifférente et triste du Roumain ;
Il savait qu’un brasier couvait sous cette cendre,
Et que le feu du ciel n’aurait eu qu’à descendre
Pour qu’il se rallumât soudain.
À tous les aquilons jetant des étincelles,
Son austère génie ouvrait ses larges ailes,
Sans crainte du Phanar et du Russe à l’affût (2).
Et sa voix fut la voix qui parla la première ;
Il dit : « Dans leurs esprits je ferai la lumière »
Et la lumière fut !
Héliade apparut comme un nouveau Messie.
Secouant sa longue inertie
Le peuple en masse se leva,
Et vint, pour écouter sa parole puissante,
Sous la voûte retentissante
Du vieux cloître de Saint-Sava (3).
II
« Ô Roumains, disait-il, le monde nous ignore,
Pauvre peuple déchu, sans force pour agir,
Notre douleur en vain cherche un écho sonore,
Et nul ne s’est senti rougir
À ce joug qui nous déshonore.
Nous errons au hasard, d’ennemis entourés :
Ici le Grec impur, dont la serre s’allonge,
Arrachant les trésors entre nos bras serrés ;
Et là, le vautour russe avec son bec qui plonge
Dans nos flancs déchirés !
L’oubli sombre a touché notre nom, notre gloire ;
L’Europe ne connaît plus rien de notre histoire ;
Nos innombrables maux obsèdent ses regards ;
Et, quand nous invoquons sa parole ou ses armes,
Dédaigneuse, elle dit, sans écouter nos larmes :
— Ce n’est qu’un peuple de boyards ! —
Accablés de mépris et chargés d’anathèmes,
Ô Roumains, nous n’avons d’autre appui que nous-mêmes.
Eh bien ! nous irons, seuls, à notre but sacré.
Du progrès écoutons la lointaine fanfare ;
Nos souvenirs géants allumeront le phare ;
Le chemin… je le tracerai !
Et l’on saura que sous la tourbe méprisable
De boyards étalant leur orgueil éhonté,
Dans les fers et l’obscurité,
S’éveille un peuple véritable,
Avide de lumière, ivre de liberté !
À l’Europe, annonçant l’ennemie éternelle,
Le Roumain sera là, comme une sentinelle
Qui jettera l’alarme avec sa voix d’airain (4) ;
Tel qu’un spectre nocturne à l’approche de l’aube,
L’autocrate fuira, jusqu’aux bornes du globe,
Devant le peuple souverain.
Frères, de quelque nom que l’étranger nous nomme,
Moldaves, Montagnards, nous venons tous de Rome (5).
Déployons ces drapeaux par la cendre ternis ;
Un sort commun nous lie, un ruisseau nous sépare (6) :
Frères, unissons-nous ! Romains, guerre au Barbare !
La patrie est puissante où les cœurs sont unis ! »
III
Lorsque près d’un mortel l’esprit de Dieu se pose,
Conquérant ou poète aux hymnes triomphants,
Du rayon paternel sur le front des enfants
Il reste toujours quelque chose !
La saison du printemps est la saison d’espoir ;
Les heures du matin sont des heures rieuses ;
Mais, près de ce penseur, tout honneur et devoir,
L’ombre, en vos âmes sérieuses,
A dû descendre avant le soir.
Vous l’avez vu montant son pénible calvaire.
Quel autre, plus que lui, trouva le sort sévère,
Quel poëte atteignit à de plus hauts sommets ?
Tout ce qu’il récolta : haine, mépris, outrage,
Tout ce qu’il déploya de sublime courage,
Tout ce qu’il a souffert… qui le dira jamais ?
Il voulut arracher tous ces oripeaux slaves
Qui d’un langage antique altéraient la beauté ;
De l’idée asservie il brisa les entraves,
Proscrivit l’alphabet par Cyrille inventé,
Et rendit aux Roumains, dans sa grandeur romaine
Cette autre fille à lui, cette langue roumaine (7).
Il avançait toujours, détruisant ou créant.
Il tenta d’abolir toutes les servitudes ;
Sa torche illumina les mille turpitudes
Du Tzar, précurseur du néant ;
Et, sous l’infatigable étreinte
De cet athlète exempt de faiblesse et de crainte,
On vit se tordre le géant.
Pour armes, maniant d’une main juste et sûre
Le stylet de la presse à l’ardente morsure,
Le fouet de la satire au sifflement moqueur,
Quarante ans, sous les yeux de la foule éblouie,
Héliade soutint cette lutte inouïe
Dont il sortit presque vainqueur !
Il forgeait, moderne cyclope,
Un glaive de plus à l’Europe
Avec le fer du joug par le peuple brisé.
Comme ces Brancovan dont la race est tarie,
Dans son cœur il avait placé
La famille après la patrie ! (8)
Les plus vastes desseins sous son front sommeillaient.
Dans l’ombre, contre lui, toutes les trois unies,
Vienne, Constantinople et Pétersbourg veillaient
À la garde des tyrannies.
Et, sur l’écueil aride où Stamboul le lia (9),
Cet autre Prométhée, Héliade, expia
Le seul crime d’avoir, en ce siècle où nous sommes,
Ravi le feu céleste et trop aimé les hommes !
IV
Et, sachez-le, boyards, plus vils que des spahis,
Qui de Radulesco fîtes votre victime,
Vous dont l’âme portait le stigmate du crime,
Dont la bouche exhala tant de serments trahis.
Ni les titres, ni l’or n’achetaient son silence,
Il n’avait pas, au prix d’une infâme opulence,
Prostitué sa plume et vendu son pays !
C’est en vain qu’ourdissant vos stériles manœuvres,
Du flot de vos dédains vous couvriez ses œuvres :
Vos cris n’atteignaient pas jusques à sa hauteur ;
Il dédaignait le blâme autant que la louange,
Et riait de vous voir si vains dans votre fange,
Si petits dans votre grandeur !
Insensés qui vouliez mettre une digue au fleuve,
Et dessécher la source où le peuple s’abreuve !
Ne saviez-vous donc pas, boyards efféminés,
Que la force toujours se durcit à l’épreuve,
Que la gloire se fait d’obstacles détournés ?…
Vous pouvez, Archondas, briser toute une vie,
Broyer un être humain sous la dent de l’envie,
Mais vos pleurs de courroux, votre souffle avili
N’éteindront pas l’éclair qui d’une âme a jailli
La pensée a percé la nuit la plus profonde :
Une idée a refait le monde !
Vous redoutiez l’idée et vouliez la bannir.
L’ignorance du peuple était votre cuirasse.
Que reste-t-il de vous ? Une sanglante trace,
Un ridicule souvenir.
Vos forfaits seulement gardent à l’avenir
Vos noms que la honte embarrasse !
Cependant que la main du siècle a réuni
Sur sa plus rayonnante page
Les noms et marqué le passage
D’Héliade et de Mazzini !
D’autres ont, après lui, repris sa tâche sainte.
Ils se sont égarés dans un noir labyrinthe,
Cherchant au même but un chemin différent.
Car aucun n’avait son génie,
Son courage persévérant :
Il est peut-être le plus grand
Des héros de la Roumanie !
La justice des temps vainqueurs du préjugé,
En chants de triomphe a changé
Les murmures diffamatoires ;
On le nomme déjà comme on nomme Stéfan
Qui, huit lustres entiers, combattant l’Ottoman,
Remporta quarante victoires ! (10)
Gloire à lui ! Ses travaux restent pour le venger.
Et quand la pâle mort du doigt toucha sa tête,
Il la vit sans terreur : son œuvre était complète,
Il avait fait si grands ceux qui l’allaient juger !…
D’un seul remords, peut-être, il expirait esclave :
Il regrettait de voir aux mains d’un étranger
Le sceptre de Michel le Brave ! (11)
6/18 janvier 1878.
(1) Mircéa Ier, prince de Valachie, vivait au xive siècle. Ce fut lui qui organisa en Valachie cette armée roumaine qui devint l’avant-garde des Polonais et des Hongrois, et sans le secours de laquelle ces derniers n’auraient pu sauver l’Europe de la domination musulmane.
(2) Le Phanar est ce quartier de Constantinople qui servait de patrie aux hospodars grecs (phanariotes) dont les exactions ruinèrent les principautés. Voyez, pour plus de détails, l’Essai sur les Phanariotes par Zallony.
(3) Le vieil édifice de Saint-Sava a été démoli en 1855 et remplacé par le palais de l’Académie, où sont installés la Bibliothèque, les Musées, l’École des Beaux-Arts, le Sénat et l’Université de Bucharest.
(4) La légende raconte qu’Étienne le Grand avait posté sur la colline de Burcel une sentinelle dont la voix extraordinairement puissante se faisait entendre à six lieues de distance et qui avait pour mission d’avertir le prince de l’arrivée de l’ennemi par ce cri que la tradition a conservé : Alerte ! Étienne, aux frontières ! alerte ! voici l’ennemi !
(5) Voir la note 1 de « Moldo-Valaques et Roumains ».
(6) Avant que l’union des deux principautés roumaines eût été reconnue par l’Europe, un ruisseau, presque toujours à sec, formait la ligne de démarcation qui séparait la Moldavie et la Valachie.
(7) Héliade entreprit de remplacer tous les mots slaves qui s’étaient glissés dans la langue roumaine par leurs anciens équivalents latins ou même par des mots nouveaux qu’il eut la hardiesse de créer. Cette œuvre patriotique fut couronnée d’un succès si complet qu’il ne fallut que quelques années pour que le peuple des campagnes les plus éloignées parlât la langue révisée et épurée par le grand novateur ! Il supprima également les caractères cyrilliques que les Roumains avaient adoptés depuis trois siècles, en haine de l’Église de Rome, et ce fut lui qui, le premier, en Roumanie, recommença à se servir des caractères latins dont l’emploi redevint aussitôt général.
(8) Voir la note 3 de « Pierre le Grand à Iassi ». Constantin Brancovano aima mieux sacrifier ses trois fils que d’abjurer sa religion. La religion et la patrie étaient, dans le vieux temps, deux choses inséparables. Nous avons progressé depuis. Au reste, c’est le seul point de comparaison qu’on puisse établir entre Brancovano et le héros moderne de la Roumanie.
(9) Après la révolution de 1848, Héliade fut exilé dans l’île de Chio.
(10) Voir « Pierre le Grand à Iassi ».
(11) Nous osons rappeler ici qu’Héliade Radulesco fut un des députés qui combattirent, en 1866, la candidature d’un Prince étranger.
XV
L’hospodar (1)
… Plus de grandeur contient plus de néant !
V. Hugo.
À Bucharest, dans la foule sordide
Qui regardait d’un étrange regard,
Passait un jour le cortège splendide
De l’hospodar.
Le prince était grave comme un roi mage.
Son œil errait vaguement au hasard.
Tout s’inclinait et tout rendait hommage
À l’hospodar.
Dignes d’orner le front d’une Tzarine,
Diamant clair, perle au reflet blafard,
Rubis en feu brillaient sur la poitrine
De l’hospodar.
Et, contemplant la majesté du maître,
Qui s’avançait, dédaigneux, sur son char,
Mihou disait : — Oh ! que je voudrais être
Être hospodar !
Zinca, la blonde aux regards séraphiques,
Disait : — Du ciel je donnerais ma part
Pour posséder les joyaux magnifiques
De l’hospodar ! —
Pourquoi vouloir échanger l’assurance
De jours sereins abrités à l’écart
Contre le sort, prospère en apparence,
De l’hospodar ?
Dans ses jardins qu’une onde pure arrose,
Dans ses palais aux divans de brocart,
Si vous saviez combien il est morose,
Cet hospodar !
Dans sa grandeur il reste solitaire.
Et dans sa cour il n’est pas un boyard
Dévoué, tel qu’un ancien feudataire,
À l’hospodar.
Point de sourire à sa bouche muette
Pendant le jour qui lui dure si tard,
Ni de repos sur sa couche inquiète
Pour l’hospodar.
Ayez pitié ! car il marche dans l’ombre,
Sans un flambeau qui perce le brouillard.
Votre amour peut éclaircir le front sombre
De l’hospodar.
Car son pouvoir est fait d’obéissance,
Car Rome était plus grande que César,
Et plus encore à vous est la puissance
Qu’à l’hospodar.
Mais si jamais il vous faisait l’injure
D’abandonner votre patrie au Tzar,
Comme autrefois, à son serment parjure,
Un hospodar…
Lors, vous pourriez reprendre la couronne,
La pourpre, et puis déchirer l’étendard,
Briser le sceptre et renverser le trône
De l’hospodar.
Lors, vous pourriez, peuple de Roumanie,
S’il vous plaisait, exiler sans retard,
Dans son pays, la blonde Germanie,
Cet hospodar !
11/23 juillet 1877.
(1) Le mot « hospodar » n’est ni français ni roumain. Les Roumains ne l’emploient même jamais. Ils donnent au chef de l’État le titre de Domnù ou Domnitor (dominus).
XVI
Le Phanariote
Qu’a-t-il donc, ce pacha que la guerre réclame,
Et qui, triste et rêveur, pleure comme une femme ?…
Son tigre de Nubie est mort ! —
Victor Hugo.
— Las ! ces temps ne sont plus ! disait en soupirant
Un vieux boyard roumain, débris d’un siècle sombre,
En songeant à l’époque où le peuple souffrant
Sous les Grecs du Phanar allait mourant dans l’ombre.
— Las ! ces temps ne sont plus où l’esclave tremblant
Sur ma route inclinait son front dans la poussière,
Où mon œil, tantôt froid, tantôt étincelant,
Jetait dans tous les yeux ou l’ombre ou la lumière.
Selon que s’éteignait ou brillait ma gaîté
Tous les autres boyards étaient joyeux ou mornes.
Je répondais au Tzar de leur fidélité,
Et le Tzar connaissait mon dévoûment sans bornes.
Aidé par mon adresse, aidé par le hasard,
De toutes les grandeurs j’avais atteint le faîte.
Nul autre que le Prince ou l’Envoyé du Tzar
Sous un ordre formel n’eût fait courber ma tête.
L’hospodar m’appelait « son premier serviteur » !
J’étais fier et confus à ce titre suprême,
Car l’Envoyé du Tzar, ainsi qu’un nom flatteur,
Le donnait quelquefois à l’hospodar lui-même (2).
Des trésors de l’État j’augmentais mes trésors.
Le Prince regardait faire avec complaisance :
Il faisait comme moi… Je possédais alors
Un palais à Moscou, des jardins à Byzance,
Des khans à Bucharest, une église à Jassi,
Des villages entiers, des mines et des terres,
Des vêtements dorés, des narghilés aussi,
Des prés à faire envie aux gens des monastères,
Des troupeaux de Cigains, quatre cents paysans,
Des ichliks de haut prix ayant la forme oblongue…
Et c’est moi qui portais, parmi les courtisans,
Le plus vaste calpac, la barbe la plus longue ! (3)
Maintenant, c’est fini ! Du peuple courroucé
Des hommes sont sortis, démons à l’âme noire ;
Ils ont, d’une parole, à la fois renversé
Ce qui faisait leur honte et ce qui fit ma gloire.
Les plébéiens des grands ont perdu le respect,
Et notre déplaisir n’a rien qui les consterne ;
Ils ne sont plus saisis de crainte à mon aspect,
Je passe maintenant… et nul ne se prosterne.
J’ai vu s’évanouir ce cortège d’amis
Qui jadis, nuit et jour, vint assiéger ma porte,
Et, dans la cour du Prince, où d’autres sont admis,
On ne me connaît plus et ma puissance est morte !
Le Trésor de l’État est maintenant gardé.
Mes biens s’en sont allés entre des mains profanes.
De titres et d’honneurs je suis dépossédé.
Il ne m’est plus permis de vendre des Tziganes.
Au poste où je brillais les autres sont élus ;
De moi, de ma grandeur s’efface tout vestige.
Les calpacs, les ichliks… on ne les porte plus !
Le nom de l’Autocrate est veuf de son prestige.
Mes larges vêtements, excitant le dédain,
Sur les lèvres de tous amènent un sourire.
Quand je parle du Tzar, il s’élève soudain
Des voix pour me blâmer, des voix pour le maudire.
Et disant que leur sang est le pur sang romain,
Nos fils ont rené la Grèce, notre mère ;
Ils ont mis en honneur le vil patois roumain,
Et banni pour jamais le langage d’Homère.
Les enfants vont passer leur jeunesse à Paris ;
Leurs sinistres propos me laissent sans réplique.
— Nous sommes tous égaux ! disent-ils. Leurs esprits
Sont pleins de ces deux mots : Liberté ! République !
Mon bonheur eût été parfait à tout égard
En ces jours regrettés qu’ici je vous relate,
Si j’avais pu doubler, ainsi que l’hospodar,
Mes babouches de drap d’Andrinople écarlate ! (4)
9/21 octobre 1877.
(1) Voir « Aux filles d’Héliade », note 2.
(2) Sous le règne des Bibesco et des Stirbeiù, c’était le consul de Russie qui gouvernait les principautés. L’ambassadeur Dashkoff disait publiquement que l’hospodar n’était que son aide de camp !
(3) Les ishliks et les calpacs étaient des bonnets faits de fourrures précieuses. Le calpac avait la forme d’un ballon de cinq à six pieds de circonférence !! La valeur d’un boyard se mesurait à l’ampleur de sa coiffure et à la longueur de sa barbe : plus le calpac était volumineux, plus la barbe était longue, plus le boyard était puissant.
(4) Distinction réservée au seul prince régnant.
XVII
Moscou & Bucharest
Voir supra l’édition de 1877.
XVIII
Chair à canon
11 septembre 1877
Le vent est froid, la terre est dure,
Les soldats sont morts à demi
Et de fatigue et de froidure.
— Mais l’Autocrate a bien dormi. —
Quoique des choses nécessaires
Le manque devienne absolu,
Soyez contents, vils mercenaires :
— L’empereur a le superflu. —
Si l’on vous fit passer le fleuve,
Ce n’est point pour votre plaisir.
Mais, pour vous adoucir l’épreuve,
Sachez que Charle a tout loisir.
Que vous avait-on dit naguère
Que le Tzar était inhumain !
Saluez donc ce jour de guerre :
Il vous eût fait fouetter demain !
Et soyez fiers ! La charge sonne ;
Vous allez mourir pour le Tzar
Qui viendra, ce soir, en personne,
Féliciter votre hospodar.
Vous allez créer un royaume,
Mettre une Majesté debout,
Et couronner un Roi-Fantôme :
—Le Tzar protégera le tout.
Il vous donne l’indépendance.
Peut-être n’y croyez-vous pas ?…
Songez à mourir en cadence :
Le Tzar vous regarde là-bas !
Cessez cet arrogant murmure.
Votre esprit est trop raisonneur.
Vos corps sont leur vivante armure ?…
Les Russes vous font trop d’honneur.
Et, pour retourner à la terre,
Choisissez : ou supplice, ou joug ;
Ou mitrailleuse, ou cimeterre ;
Ou Cosaque, ou Bachi-Bouzouk.
La mort devant, la mort derrière !
Aucun de vous n’échappera.
Mais, lorsqu’il fera sa prière,
Le Tzar de vous se souviendra.
Et quand vous aurez la victoire,
Quand vous aurez pris cent canons,
Les Russes prendront votre gloire,
Et l’oubli couvrira vos noms.
Nul ne plaindra vos destinées,
Vos bataillons anéantis,
Vos illusions condamnées :
Vous êtes faibles et petits.
Le monde flatte, élève, encense
Le tyran cruel, mais adroit.
Les Russes ont force et puissance ;
Les Roumains n’avaient que leur droit !
1/13 septembre 1877.
Voir Moscou et Bucharest.
XIX
Aux grandes duchesses de Russie
I
Blondes filles des Tzars qui mêlez sur vos têtes
L’éclat du diamant au rayon du rubis,
Qui vous croyez si bien à l’abri des tempêtes,
À l’abri des tourments que d’autres ont subis,
Tout semble vous sourire, et rien ne trouble encore
Votre calme profond ;
Vous riez et dansez ; votre jeunesse ignore
Ce que les Tzars ont fait, ce que les peuples font ;
Ne sachant pas que c’est sur un horrible gouffre
Que dansent tous vos pas,
Et qu’il est au dehors un grand peuple qui souffre,
Qu’on fait souffrir, qui pense et qui marche, là-bas !
La voix de vos flatteurs vous empêche d’entendre
Sourdre la liberté, gronder l’horizon noir ;
On vous laisse ignorer ce qu’un Tzar peut attendre
D’un peuple esclave au désespoir.
II
Si je vous demandais, pour vous-même inquiète,
— Parler au roi dormant dans sa gloire muette
Comme à l’humble courbé sous le poids d’un affront,
C’est le droit sacré du poëte —
D’où viennent ces joyaux qui vous font sur le front,
Perçant les longs plis de vos voiles
De leurs reflets sombres et clairs,
Comme une couronne d’étoiles,
Comme un diadème d’éclairs ?
« Ils viennent, diriez-vous, des mines de Golconde,
Ou des flancs entr’ouverts des grands monts escarpés ;
On les ravit pour nous aux profondeurs de l’onde… »
Et moi, je vous dirais : Hélas ! vous vous trompez.
Ils ne sont point éclos dans l’ombre et le mystère
Du gouffre bleu des eaux, du sein noir de la terre.
Pour les former, d’abord, on prend un peuple entier ;
On le jette vivant, sans grâce ni quartier,
Sur une gigantesque enclume,
Près d’un vase immense d’airain ;
Avec un bruit affreux de forge qui s’allume ;
Tandis que, délivrés du frein,
Impôts, charges, supplice, exil, knout, Sibérie,
Tous ces mille marteaux dont disposent les rois,
Déchaînés avec rage, emportés en furie,
Se mettent en branle à la fois,
Frappent incessamment toutes ces chairs hurlantes
Qui brûlent, se tordant en d’atroces douleurs,
Et d’où coulent alors des cascades sanglantes
Et des torrents de pleurs.
III
Princesses, dans le fond de ce vase d’alarmes,
Mêlés à l’argent pâle, à l’or éblouissant,
Sont le rouge rubis qui fut un flot de sang,
Et le diamant clair qui fut un flot de larmes.
18/30 novembre 1877.
XX
La mère d’Étienne le Grand
Voici venir les Turcs et Sultan Bayezid.
Mais Étienne s’en rit : Étienne vaut le Cid.
Il chante tous les jours les psaumes de David,
Il a communié, son armée est chrétienne.
Revêtant son armure, il confie, en partant,
Le fort Némtz à sa mère, et s’en va combattant
Depuis l’aube jusqu’à la nuit close ; et pourtant,
Bayezid est vainqueur ; le vaincu, c’est Étienne !
C’est en vain qu’il fit vœu de bâtir au Seigneur
Une église en granit qui lui ferait honneur ;
Pour obliger les saints à le prendre en faveur.
C’est en vain qu’il joignait la menace à l’antienne.
Ne pouvant rassembler ses bataillons épars,
Il suivit ses soldats, fuyant de toutes parts
Vers la ville de Némtz, et, quand sur les remparts
Il vit sa mère : « Ouvrez, c’est vostre fils Estienne !
— Des pennons ottomans m’apportez les débris.
— Madame, hélas ! ce sont les nostres qui sont pris.
— Me nommez ces gens-là qui s’enquièrent d’abris.
— Madame, cette armée en fuite fust la mienne.
— En quel lieu peut-on voir mes arbalestriers ?
— Madame, ils sont tombés avec leurs destriers
Aux mains des mécréants. — Droit sur ses estriers,
Celuy qui parle ainsi n’est pas mon fils Estienne !
Gentil sire, pour mien ne vous recognois pas.
L’huis demeurera clos : restournez sur vos pas.
Le mien fils est vainqueur ou bien occis ici-bas,
Et morte, avec luy, nostre splendeur ancienne.
C’est grand pitié de voir un prince survivant
À son desfunt honneur ! » Le vaivode, levant
Son front pâle, poussa son cheval en avant
Et dit : — Vous estes bien mère du grand Estienne ! —
« Alerte, mes enfants, et sus aux Osmanlis ! »
À peine a-t-il parlé que, d’audace remplis,
Le suivent ses Roumains à travers les taillis,
Sans qu’il soit de pouvoir humain qui les retienne.
Ils mettent le camp turc à sac, à sang, à feu,
Conduisent les pachas, avec l’aide de Dieu,
Plus loin que Kilia, dedans le fleuve bleu…
Et ce jour mit le comble à la gloire d’Étienne.
2/14 avril 1878
XXI
Moldo-Valaques et Roumains (1)
Juillet ! voici juillet, le mois de la fournaise !
Où l’air de tout son poids sur les poitrines pèse ;
Après le jour brûlant, voici l’ardente nuit ;
Sur son lac préféré Sirius en feu luit (2) ;
La nature s’endort et Bucharest s’éveille !
Joyeuse, reprenant ses grelots de la veille,
Elle a hâte de vivre et d’aimer et de voir ;
Car Bucharest a fait du plaisir un devoir.
Elle veut mériter son nom ; toujours en fête,
Elle a la fange aux pieds et les fleurs sur la tête (3).
Ceux qui s’offrent encor le titre de « boyard »
Vont entendre, à Raschka, les valses de Mozart.
Raschka, c’est le Mabille indigène. — On y fraude
Un peu de Juif à Grec. C’est l’endroit à la mode.
Les boyards vont montrer là ce qu’ils ont appris.
La plupart ont laissé des dettes à Paris.
— J’attends le revenu d’une de mes provinces,
Disaient-ils. Les marchands les prenaient pour des princes :
Comme ils ne payaient pas, ils achetaient fort cher.
Ils ont un certain ton de dire : « Bonjour, cher ! »
Et ces adorateurs des actrices en vogue
S’affublent de grands noms tels que : Paléologue,
Et vont à la Chaussée exhiber des chevaux (4),
Des huit-ressorts de Vienne et des habits nouveaux.
Ils possèdent à fond le grand art de la pose ;
Aux nobles sentiments leur âme reste close,
Et tout l’esprit qu’ils ont ne les fait qu’intrigants.
Ils ont des cruautés, des vices élégants ;
Ils voudraient rattacher le Tzigane à la glèbe,
Perdre le tiers-état, qu’ils appellent la plèbe,
Et vivre au beau milieu d’un conte de Perrault.
Tous ont des droits au trône et les font sonner haut.
Ils ne peuvent souffrir Boliac, Héliade (5) ;
Homère les ennuie avec son Iliade ;
Mais ils ont dévoré Paul de Kock et Zola.
Parle-t-on de Vlad V — Ne connais pas cela ! — (6)
L’histoire du pays et le pays lui-même,
Puisqu’ils ont un palais et presque un diadème,
Qu’est-ce que ça peut faire à ces jolis messieurs ?
Les héros ne sont bons qu’à leur servir d’aïeux ;
L’amour, c’est une affaire ; et Dieu, c’est vieillerie,
C’est superstition, conte bleu, fourberie.
Ils sont leur propre idole et leur propre Seigneur.
Plus de Dieu, plus d’amour, et partant, plus d’honneur !
C’est une table à jeu que leur table de laque,
Et c’est d’eux qu’on a dit : — Menteur comme un Valaque ! —
Leur Éden, c’est Raschka. Les chemins trop étroits
Font qu’on n’y peut danser ; on marche trois par trois,
Deux à deux ; on y boit… et beaucoup ! Pour le reste,
C’est comme chez Bullier, — c’est même un peu plus leste. —
Le beau monde s’amuse ainsi pendant l’été.
Hélas ! elle est charmante à l’œil cette cité
Qui jette chaque soir plus de feux à la ronde
Que n’en allume au ciel la nuit bleue et profonde,
Et qui semble, du nord au midi s’étendant,
Dire : — Je suis pareille aux cités d’Occident —
Mais, si vous m’en croyez, nous quitterons la ville
Que le mal envahit, d’où la vertu s’exile,
Et, de Colentina reprenant le chemin,
Nous irons retrouver le vrai peuple roumain.
Grâce au soleil qui fut clément toute l’année,
— Et grâce à Dieu — voici la moisson terminée.
La journée était rude, et dans tout le pays,
On a rentré les foins et fauché le maïs ;
Et la récolte est bonne, et la joie est complète.
Portant leurs donitze, pleines d’eau, sur la tête (7),
Les filles, qui se font aider par les garçons,
Murmurent en riant des bribes de chansons ;
Elles marchent nu-pieds, et gardent leurs sandales
Pour le dimanche, alors qu’elles vont sur les dalles
De l’église prier le saint des bons maris.
Les grands-pères ont mis sur leurs longs cheveux gris
Le chapeau transylvain ; accroupis à la turque,
À l’endroit où la route immense se bifurque,
Ils fument du tabac nouveau de Focshani.
Les jeunes gens, pour qui le travail est fini,
Gardent la càciulà d’agneau dont la structure (8)
Rappelle le bonnet phrygien ; à leur ceinture
Pend un poignard. Vêtus d’un méchant oripeau,
Les Tziganes qui n’ont que les os sous la peau,
Racontent les cancans de la ville aux matrones.
Leur misère est joyeuse, et les gens à couronnes
Envîraient leur essaim qui va ne sachant où.
Ils savent qu’ils auront un verre de rakiou (9)
Si leur histoire est belle, et mentent tant qu’ils peuvent.
Et, près de la fontaine où les buffles s’abreuvent,
Les chiens, ayant la sainte horreur des étrangers,
Tiennent conseil, ainsi que le font les bergers.
Aux peuples partageant les instincts, les besognes,
Dieu fit les uns marchands et les autres ivrognes :
Il créa les Roumains bavards. Popes, pandours,
Ne sont contents que quand ils ont fait un discours.
Les bœufs forment souvent leur unique auditoire ;
C’est la tradition qui leur apprend l’histoire ;
Ils parlent de Trajan comme s’ils l’avaient vu.
Leur style oriental a ce tour imprévu,
Ce charme qui fleurit aux champs, à la caserne ;
Et plus d’un Paysan du Danube moderne
Pourrait en remontrer à maint grand orateur
Imposant chaque jour sa prose au Moniteur.
L’ironie a chez eux remplacé la colère ;
Éclatant en lazzis, la verve populaire,
Indiscrète, s’attaque au plus fort, au plus grand ;
Et l’étranger surpris s’écrie, en comparant
Leur parole railleuse et leur beauté sévère :
— Ce sont des Marseillais venus du Transtévère ! —
On a dit qu’ils vivaient dans des trous sous le sol,
Qu’ils étaient paresseux, lâches, enclins au vol,
Qu’ils parlaient un jargon, que leur main meurtrière
Frappait trop volontiers le boyard par derrière.
On assurait que pour les mettre à la raison
Il n’était rien de mieux qu’un solide bâton…
En un mot, on a dit qu’ils étaient bons à pendre !
Et, comme ils ne pouvaient eux-mêmes se défendre,
Que l’Europe, d’ailleurs, n’avait pas grand souci
De savoir si, vraiment, tout se passait ainsi,
Nous conclûmes sur l’heure, ignorants que nous sommes,
Que les Roumains étaient des brutes, non des hommes.
Si vous daigniez jamais visiter leur pays,
Quel spectacle offriraient à vos yeux ébahis
Ces Latins méconnus qu’on a pris pour des Slaves,
Ces libres paysans que l’on disait esclaves !
Le Roumain fainéant dès que le jour a lui
Court en hâte à ses champs, et ses bœufs sont à lui,
Cette cabane est sienne et sienne est cette terre ;
Enfin, ce misérable est un propriétaire.
Qu’en dites-vous, bourgeois de Londre et de Berlin,
Chez vous on boit du stout, on s’enivre de gin…
Quand le Roumain a soif, il s’abreuve d’eau pure.
Je vous ai déjà dit comme il venge une injure.
Le sang de ses pareils teint rarement ses doigts ;
Il est doux, patient, et, dame ! si parfois
Quelques ignobles Juifs laissent perdre leur trace,
Ou sautent au Danube avec mauvaise grâce…
C’est qu’ils ont mis la flamme à deux ou trois hameaux,
Empoisonné les puits ou volé des agneaux.
Les Tziganes seront traités de « Seigneuries » ;
Un Ghica se verra, malgré ses armoiries (10),
Tutoyé bel et bien par un simple berger.
— Mais, objectera-t-on, le Roumain est léger,
C’est un fait reconnu. — C’est une vieille histoire ! —
Le Français est léger aussi, s’il faut en croire
Un dicton qu’inventa certain peuple envieux.
Et quand cela serait ! En somme, il vaut bien mieux
Être léger que lourd, n’en déplaise aux Tudesques.
Et quoique le Roumain n’ait pas vos airs grotesques,
Sublimes Bavarois, admirables Prussiens,
Vos coups portaient moins fort et moins loin que les siens ;
Il est plus valeureux que vous n’avez pu l’être.
Si vous pouviez rougir, vous rougiriez peut-être
Devant ce petit peuple héroïque et n’ayant
Que de vrais citoyens et pas un mendiant !
Voyez ces paysans : ils ont pendant quinze heures,
Sous un soleil de flamme et loin de leurs demeures,
Fauché, sarclé, bêché sans trêve. Et vous croyez
Qu’ils vont dormir, ainsi que de vieux caloyers
Fatigués de baiser les mystiques images ?
Tandis que les follets dansent aux marécages,
Le Roumain dormirait ! et, sans être imité,
Le rossignol dirait son hymne aux nuits d’été !
Ah ! vous allez trouver ceci fort ridicule,
Peuples civilisés ; quand vient le crépuscule,
Le Roumain aime à voir monter la lune aux cieux.
Il est songeur ; il a le culte des aïeux ;
Ainsi que Bonaparte il croit en son étoile,
Et maint poëte meurt sous la blouse de toile.
Le sommeil est proscrit ce soir. On dansera
Le chorus des Romains qu’on nomme la hora.
La hora ! Ce seul mot met debout un village.
Ceux qui ne dansent plus, les vieux, courbés par l’âge,
Se rappelant, hélas ! combien ils ont danse,
Regardent, souriants, ces choses du passé.
Celle qui porte au cou des icossars, et celle (11)
Qui dans ses cheveux bruns n’a qu’un bout de ficelle,
Celui qui fut primar sous le prince Couza (12),
Et le pauvre orpailleur de la Dîmbovitza,
Pourvu qu’ils soient joyeux, la hora fraternelle,
Symbole d’unité, les prendra sur son aile.
Les yeux cherchent les yeux, les mains pressent les mains ;
Accordant à grand bruit leur cobza, les cigains (13)
Se placent au milieu de cette ronde immense ;
« Feuille verte ! » dit l’un, et la hora commence (14).
La troupe des danseurs prend son paisible vol ;
Leurs pieds sont si légers qu’ils caressent le sol.
La nuit prête un mystère à leur démarche lente,
Et l’almée a moins qu’eux cette grâce indolente
Que ne peindra jamais un imparfait récit.
Le cercle, tour à tour, s’élargit, s’étrécit,
Et, petit à petit, cette danse timide
S’anime, glisse, fuit, roule sur l’herbe humide,
Et l’ombre des danseurs s’allonge sur leurs pas.
Les musiciens non plus ne se ménagent pas.
L’un d’entre eux, vieux scîndrôme à face de Silène (15),
Fait sentir la mesure et chante à perdre haleine ;
Celui-ci l’accompagne et racle à tour de bras ;
Les autres, sérieux comme des magistrats,
À leur flûte perçante arrachent des fanfares ;
Et ce sont des accords et des rhythmes bizarres,
Tels qu’en a trouvé Liszt, tels qu’en rêvait Chopin.
Les lévriers, qu’on chasse à grands coups d’escarpin,
Veulent dans ce concert faire aussi leur partie.
Et la danse n’est pas un instant ralentie.
Excités par ces chants qu’ils reprennent en chœur,
Les Roumains sont ravis et sautent de tout cœur,
Et la ronde tournoie, et cette hora folle
Dégénère bientôt en une farandole
Qui ferait frémir d’aise un bouvier provençal.
Ce tintamarre n’a plus rien de musical.
Les bonnets d’astrakan s’envolent tous ensemble ;
Et l’orchestre, soudain entrainé par l’exemple,
Se met en branle au bruit de son affreux crin-crin.
Ce n’est plus gracieux, mais, vrai Dieu ! quel entrain,
Quels trépignements fous, quelle ardeur frénétique !
Les torches, répandant leur lueur fantastique,
Donnent à cette scène un faux air de sabbat ;
Les yeux brillent, les pieds bondissent, le cœur bat,
La tête tourne… Allez, qu’importe ! et que l’aurore
Puisse vous retrouver ici dansant encore…
Dansez, peuple roumain, et ne demandez pas
Ce que font Bratian et Rosetti, là-bas !
16/28 février 1878.
(1) Un Roumain en parlant français dira : le peuple roumain et l’aristocratie moldo-valaque. Les mots valaque et Valachien’existent même pas en roumain. Les Valaques refusent de répondre à cette appellation, et quand ils veulent se distinguer des Moldaves et des Transylvains, ils s’appellent : Munténi (montagnards).
(2) Le nom populaire du mois de juillet est luna lui cuptor (le mois de la fournaise). Un des pics des Carpathes porte à son sommet un lac assez étendu dans les eaux duquel l’étoile Sirius se reflète vers cette époque de l’année. L’astre a donné son nom à la montagne.
(3) Bucuresci (Bucharest) n’est que le pluriel de l’adjectif joyeux. Les écrivains roumains qui composent leurs ouvrages en latin ont fait de Bucuresci Hilariopolis.
(4) La longue allée plantée de tilleuls qui fait suite à la rue Mogosoï et qu’on appelle simplement la Chaussée, est la promenade à la mode de Bucharest.
(5) Célèbres poètes roumains que l’Occident perd à ne pas connaître.
(6) Autrement dit : Vlad le Diable ou l’Empaleur. L’historien allemand Engel a donné des détails fort intéressants touchant ce prince qui, comme le connétable de Montmorency, assaisonnait les sentences de mort de plaisanteries lugubres.
(7) Espèce de cruche en bois.
(8) Bonnet de peau d’agneau noire ou blanche qui sert de coiffure nationale aux paysans.
(9) Sorte d’eau-de-vie de prunes ; on dit raki ou rakiou ; cependant raki est plus turc que roumain.
(10) Les Ghica sont une famille d’origine albanaise indigénée depuis plusieurs siècles et dont les membres ont, à différentes reprises, occupé les trônes valaque et moldave. Le pseudonyme de Dora d’Istria cache la princesse Héléna Ghica.
(11) Monnaie d’or ottomane dont les filles se font des parures.
(12) Le titre de primar équivaut à celui de maire.
(13) La cobza est une grande mandoline ayant à peu près le son de la guitare.
(14) Voir la note 3 de « Mikalaki ».
(15) Scîndrôme est un des noms qu’on donne aux Bohémiens. M. Vaillant, dont les écrits touchant les Tziganes sont fort estimés, dit que Scîndrôme signifie Homme de l’Inde.
XXII
Mikalaki
À Mlles Euphrosina & Virgilia Héliade Radulesco
Hélas ! que viens-tu faire en nos plaines désertes,
Oiseau qui, secouant tes deux ailes ouvertes,
Par le printemps joyeux arrives rappelé ?…
La joie est vite éteinte ou la guerre s’allume !
Vers ces pays maudits d’où vient ta folle plume
Mikalaki s’en est allé !
Que la fée, en passant le mardi soir, emporte (1)
Ces soldats qui, sitôt que la lumière est morte,
De leurs cris avinés remplissent la forêt !
Ils sont durs et méchants : ils se sont pris à rire
Comme je demandais s’ils ne pouvaient me dire
Quand Mikalaki reviendrait !
Oh ! les lâches Roumains ! Le cœur rempli de larmes,
Pour le Russe arrogant dont ils craignent les armes
Ils dansent ! Leur terreur réjouit les soldats !
Formez donc vos horas, esclaves, fils d’esclaves (2),
Chantez ! Pour vous punir, vous et vos maîtres slaves,
Mikalaki ne viendra pas !
« Feuille verte de rose. — Ô tourterelle blanche,
Que je puisse du moins t’aimer jusqu’à dimanche !
— Non pas, coucou chéri, tes vœux sont superflus.
Pour toi je dirais « oui », je dis « non » pour ta mère… » (3)
Cesse, douce chanson, ton ironie amère :
Mikalaki ne t’entend plus !
Certes, je donnerais, Vasili le scindrôme,
Eux tous qui sont ici pour mon amant fantôme !
À ma noce, l’été, comme il le souhaitait,
Ni le pope, ni toi ne viendrez d’un air grave :
Nul n’a d’étoile au front, pas un n’est fier et brave (4)
Comme Mikalaki l’était !
À l’heure où du tombeau sortent les pâles stryges,
Sur l’herbe teinte encor de leurs sanglants vestiges,
Quand la lune est en proie au monstre aériens (5),
J’écoute tous les bruits qui me viendront de l’ombre,
Et je vais appelant son nom dans la nuit sombre…
Et Mikalaki n’en sait rien !
Rien ! Ou dorment-ils donc ceux qui furent les nôtres ?…
Je ne sais pas ! Non plus ne le savent les autres ;
Ils disent, en versant aux Russes leur raki :
— Son âme est au démon, son corps est au vampire ! —
Eh ! Vasili, mon corps est las, mon âme aspire
À rejoindre Mikalaki !
16/28 avril 1878.
(1) Le mardi et le vendredi ont la plus mauvaise réputation chez le peuple des campagnes. La fée du mardi soir est redoutée entre toutes ; elle jette du mercure dans les yeux de ceux qui ont le malheur de la rencontrer après le coucher au soleil.
(2) Voir « Moldo-Valaques et Roumains ».
(3) Ces quatre vers sont un fragment d’une ballade populaire intitulée : Cucul si Turturica (Le coucou et la tourterelle). Toutes les chansons roumaines commencent invariablement par ces mots : Frunzà verde (« Feuille verte »), que l’on fait suivre du nom d’une plante emblématique. Une
chanson bachique demandera : Frunzà verde pelin (« Feuille verte d’absinthe ») ; pour un chant d’amour, ce sera : Frunzà verde trandafir (« Feuille verte de rose »). Il y a même des complaintes qui ont pour introduction : Frunzà verde lemn uscat, « Feuille verte de bois sec » (?).
(4) Les Roumains disent d’un homme supérieur qu’il porte une étoile au front.
(5) Est-ce un ver qui te ronge
Quand ton disque noirci
S’allonge
En croissant rétréci ?…
Ce n’est pas un ver, disent les paysans roumains, c’est un dragon.
XXIII
Le Dorobantz (1)
Si fugea, mèri, fugea,
Nici umbra nu’l ajungea !
(Et il fuyait, mon Dieu ! il fuyait !
Pas même l’ombre ne pouvait l’atteindre.)
Vasili Alexandri.
I
La voix de l’ouragan cette nuit parlera !
La plaine est desséchée ainsi qu’un Sahara ;
De sang, hier encore, elle était arrosée…
Mais le soleil a bu la sinistre rosée ;
Le vent et les vautours ont aidé le soleil.
Le vent s’est endormi. Les oiseaux en éveil
Promènent lourdement leur aile solitaire.
Les nuages plombés rasent presque la terre.
On foule de la cendre, on respire du feu.
La forêt se recueille et semble attendre Dieu.
Pas de pied qui chemine ou de feuille qui bouge.
L’air, le sol, tout est noir ; seul, l’horizon est rouge !
Tout se tait ; le canon, seul, murmure là-bas !
Dans l’étrange lueur ne distinguez-vous pas
Un point sombre, parti de la cité lointaine ?…
Il grossit… puis, devient une forme incertaine.
Vers le nord, en suivant le chemin le plus court,
Elle avance… Quelle est cette chose qui court,
Laissant derrière soi ce reflet de Sodome ?…
Et qui donc peut-il être, hélas ! si c’est un homme !
L’onde estivale filtre à travers la forêt,
Goutte à goutte, semblable à des pleurs de regret ;
Un souffle imperceptible entre les branches passe ;
À l’autre coin du ciel s’illumine l’espace :
Un éclair de la nue a déchiré le flanc.
C’est un homme ! un soldat à l’uniforme blanc.
Il court, il vole, ainsi que la flèche à la cible,
Dans la nuit ténébreuse à son but invisible.
Que Dieu soit avec lui ! C’est quelque messager,
Esclave du devoir, courtisan du danger,
Qui, stoïque, remplit sa tâche accoutumée,
Et peut-être d’un mot va sauver une armée.
Le tonnerre mugit et l’écho lui répond.
Puisse le feu du ciel ne pas briser le pont
Qui mène à Sistova ! L’onde à ruisseaux s’épanche ;
Sous les efforts du vent la forêt craque et penche ;
Comme les glaives d’or de géants monstrueux,
Les obliques éclairs semblent jouter entre eux.
L’homme arrive, sans yeux pour l’horrible spectacle.
Ses pieds ensanglantés rencontrent un obstacle,
Il tombe… se relève, et puis, retombe encor.
Comme un oiseau blessé reprenant son essor,
Il repart. Quel qu’il soit, c’est un brave intrépide !
Un cheval eût rendu sa course plus rapide :
Ce n’est pas un courrier. Serait-ce un éclaireur ?
Un de ceux-là qui vont dans la nuit, sans terreur,
Explorer en tous sens un suspect territoire,
Et qui peuvent trahir ou donner la victoire.
Oh ! la nature aveugle et le Tzar sans remord
Travaillent donc ensemble à cet œuvre de mort !
Au loin, de près, partout, dans les airs, dans la poudre,
L’orage et le canon, l’incendie et la foudre
Confondent leurs rumeurs et mêlent leurs clartés.
Les âmes et les nids sont de même emportés :
La balle abat les corps, la foudre abat les chênes.
Les loups sortent hurlants des tanières prochaines.
L’orage croît sans cesse et l’homme va toujours.
De son sein haletant s’échappent des cris sourds ;
La pluie et la sueur sur ses membres ruissellent ;
Le sol va tournoyant sous ses pas qui chancellent ;
Les ronces ont meurtri son visage hagard.
Pour les taillis épais il n’a pas un regard.
Malgré tout, et dans tout, il se fraye une route…
— Cet homme-là n’est point un éclaireur sans doute. —
Entendez-vous là-bas cet effroyable bruit ?
Le pont de Sistova sûrement est détruit !
L’homme entend, lui ! Poussant un hurlement de rage,
Il menace le ciel ; et ce Dieu qu’il outrage
Peut seul, pour le sauver, dompter les éléments.
Sur son corps, en haillons, pendent ses vêtements.
Il tremble, il n’ose plus regarder en arrière ;
Peut-être il se repent et cherche une prière
Dans son cerveau brûlant qui ne se souvient pas.
Il sent, dans ses cheveux, la sueur du trépas ;
Puis, vient la rêverie ardente de la fièvre ;
Il pleure, il a des mots de tendresse à la lèvre ;
Les parents, le pays, la mère, la maison,
Cela roule confus à travers sa raison.
La folie ou la mort ! Qui viendra la première ?
Il disparaît, baigné dans un flot de lumière.
Malheur ! les ans, les jours sont pour lui révolus ;
Il n’entend plus, il ne voit plus, il ne sent plus,
Il est mort !… non… voyez ! il vit, il court encore !
Et du nord au midi, du couchant à l’aurore,
La forêt est en feu !… C’est horrible et c’est beau ç
Ô terre ! entr’ouvre-toi, creuse-lui son tombeau !
Ô foudre ! sur son front hâte-toi de descendre !
Vents, par tout l’univers éparpillez sa cendre !
Pluie, arrose l’endroit que ses pieds ont touché !
Car le sol est maudit où cet être a marché ;
L’air est empoisonné sitôt qu’il le respire ;
Il est plus vil qu’un chien, plus lâche qu’un vampire ;
Frappez ! Qu’il disparaisse et qu’il ne soit plus rien ;
Qu’on ignore quel nom, quel pays fut le sien ;
Que le flot de l’oubli sur sa mémoire monte !…
Il cherchait le salut dans les bras de la honte ;
Il s’est caché le jour, il a marche la nuit ;
C’est pis qu’un traître… C’est un dorobantz qui fuit !
II
Vous ses frères jadis, et maintenant, ses juges,
Valeureux dorobantz, je flétris les transfuges,
À l’égal des flatteurs, à l’égal des tyrans,
Dans vos rangs comme ailleurs, et surtout dans vos rangs.
Qu’un Cosaque, acheté pour un peu plus d’un rouble,
Qu’un Arnaute, vendu peut-être pour le double,
Déserte ses drapeaux par grand’peur du canon :
Ils ne connaissent pas l’honneur, même de nom (2).
C’est fort lâche, sans doute, — et c’est presque excusable.
Mais il est deux fois traître et deux fois méprisable,
Celui qui ne sait pas entendre sur son front
La mitraille siffler, et qui livre à l’affront
Ce nom de dorobantz qu’a suivi la victoire,
Et qui vaut, à lui seul, tous les titres de gloire.
7/19 février 1878.
(1) L’armée roumaine est, en grande partie, composée de dorobantzi, corps spécial d’infanterie d’une valeur militaire que nul ne songe plus à contester et qui a rendu d’immenses services pendant la guerre de 1877-1878.
(2) Le mot « honneur » n’existe pas dans la langue russe. Quand les Russes veulent en exprimer l’idée, ils se servent du vocable français.
XXIV
Ce que dit l’Oltoù (1)
Vieil Oltoù, qui fus l’Aluta,
Sous des arbres que ne planta
Nul bras humain, tes eaux profondes
Vont murmurant ; mais nul ne sait,
Mais nul n’a su ce que disait
Cette voix qui sort de tes ondes.
Redit-elle à leurs descendants
Les cris de guerre discordants
Des Romains qui, sur leur cavale,
Emportaient leur part de butin ?
N’est-elle que l’écho lointain
Du chant de mort de Décébale ?
Gémit-elle encor de douleur
À ce nom de Vlad l’Empaleur (2)
Qui faisait trembler le Bosphore ?
Célèbre-t-elle les exploits
De Michel, grand parmi les rois,
Et du vaivode Théodore ?
L’Oltoù dit : Je suis vieux, hélas !
J’en ai tant vu que je suis las
Des conquérants, de leurs audaces ;
Et je ne chante, sous le ciel,
Ni Vlad le Diable, ni Michel,
Ni Trajan, ni le roi des Daces.
Trajan sur mes rocs anguleux
A fait graver des mots pompeux
Qui le proclament grand et juste,
Je rouille ses glaives pesants,
Et j’ôte, tous les deux cents ans,
Une lettre au nom de l’Auguste.
Le vent, pleurant sous les arceaux,
Ne sait plus même où sont les os
Du dernier des rois de Dacie ;
Et la chair du prince-vautour
Fait maintenant s’ouvrir au jour
Plus de fleurs dans l’herbe épaissie.
Que reste-t-il de Mircéa ?
Pas même les lois qu’il créa.
Radu que le néant dévore,
Fit un peuple d’une tribu ;
Et les oiseaux du ciel ont bu
Dans le crâne de Théodore !
Ceux de mes flots qui purent voir
Michel assouvi de pouvoir
Roulent dans les mers antipodes.
Le pâtre, errant dans mes vallons,
Porte peut-être à ses talons
De la poussière de vaivodes !
Et c’est à peine si l’on voit,
Au fond de l’ombre qui s’accroît,
Se dresser encor leur stature.
Dans leur grandeur ils n’ont été
Que la fragile humanité :
Je suis l’éternelle nature !…
Toutes les choses du passé,
Qui sur ma surface ont glissé,
Ne me sont que choses passées ;
Et je ne me souviens pas plus
De vos grands hommes disparus
Que des fleurs aux vents dispersées !
Les beys sont morts, les tzars s’en vont,
Les peuples arrivent et font
Que je puis, en paix sur la mousse,
Regarder le maïs mûrir,
Et laisser mes ondes courir
Au gré du zéphyr qui les pousse.
Vous demandez ce que ces voix
Qui pleurent dans mes flots parfois
Disent ; eh ! moi-même, qu’en sais-je ?
Loin de ces champs du ciel aimés,
J’ai vu des hommes opprimés
Pour qui penser est sacrilège.
Ils servent des maîtres jaloux ;
Enfants et vieillards, ils sont tous
Dans l’attitude de l’attente.
Le fer hongrois, ni l’or saxon
Ne détournent de l’horizon
Leur vue inquiète et perçante.
Et leurs mystérieux accents
Semblent appeler des absents.
Ils suppliaient mes flots de prendre
Ces mots sans cesse répétés…
Et mes flots les ont emportés
Sans chercher même à les comprendre :
« Quand vous serez un peuple grand,
Que votre bras sera garant
De votre splendeur rétablie
Par les traités ou les combats,
Roumains, vous souviendrez-vous pas
De vos frères d’Ardialie ?… (3) »
2/14 mars 1878.
(1) L’Oltoù (l’Aluta des anciens) prend sa source en Transylvanie, traverse les Carpathes à l’endroit appelé la Tour Rouge, arrose la petite Valachie et se jette dans le Danube à Islaz.
(2) Hospodar valaque célèbre par ses cruautés. Pour ce prince et les suivants, voyez l’Histoire de la Valachie et de la Moldavie, par Mihaïl Cogalniceano, Berlin, 1837, in-8°, ouvrage que nous ne mentionnerions pas s’il n’était, malheureusement, le seul qui fût à la portée des lecteurs français désireux de s’instruire du passé de la Roumanie.
(3) La Transylvanie. Voir « Ianco, Roi des Montagnes ».
XXV
Anathème
L’Europe a bu la coupe pleine
Que lui versait l’ombre de Nicolas ;
Les uns sont morts et les autres sont las !
Le dégoût succède à la haine,
Et le Cosaque dans la gaine
Remet son rouge coutelas.
Les princes, bercés par leur rêve,
Ont béni l’œuvre de ton glaive,
Et les popes ont béni Dieu.
À son tour le peuple se lève,
Ô Tzar, écoute son adieu :
Malheur à toi, Gottorp ! Au loin, dans la campagne,
La malédiction des Roumains t’accompagne !
Fuis ! entre nous et toi, mets l’espace et les jours ;
Au fond des châteaux forts flanqués de hautes tours,
Sur ton coursier à qui l’éperon prête une aile,
Elle va te poursuivre, implacable, éternelle,
Et partout, et toujours !
Inclément pour celui qui n’a pas de clémence,
Puisse Dieu te frapper d’une horrible démence,
Et faire dans ton cœur se heurter les remords,
Et ranger près de toi, dès que la nuit commence,
Un sombre cortège de morts !
On te verra pâlir au cliquetis des armes.
Tu croiras, sur ton front, sentir tomber nos larmes
Lorsque la pluie à flots des nuages descend.
Tu repousseras loin de ta vue égarée
Le vin que l’on présente à ta lèvre altérée,
Et qui te paraîtra du sang !
Non ! Tu n’as pas assez de toutes tes victimes !
Ô Tzar, ne laisse pas ton œuvre inachevé ;
Ajoute un forfait à tes crimes,
Et mords la main qui t’a sauvé !
L’Europe s’accoutume à la honte subie.
Pose ta griffe encor sur la Bessarabie,
Sur son peuple éploré qui, pour te fuir, la fuit (1).
Fais trafic de têtes humaines !
Malheur à toi, Gottorp ! Sa vengeance te suit :
Tu l’entendras gémir en secouant ses chaînes,
Le jour près de ton trône, à ton chevet la nuit !
Fantômes de martyrs et de nations mortes,
D’autres spectres encor presseront leurs cohortes,
T’apportant du passé le menaçant écho.
Trois d’entre eux, plus grands que les autres,
Guerrier, prêtre, poëte, et tous les trois apôtres,
S’écriront : — Sois maudit ! Je suis Kosciusko !
— J’étais Schamyl ! — Et moi, je fus Radulesco ! —
Plus blême que leur foule blême,
Pour braver la terreur essayant un blasphème,
Tu voudras écarter ces squelettes hideux.
Rien ne pourra te sauver d’eux,
Ô Tzar, rien ne pourra te sauver de toi-même !
Ni ton arme immense, inutile troupeau.
Ni ta cour tout entière à tes cris accourue,
Ni ta vaine puissance incessamment accrue,
Ni l’amer repentir allumant son flambeau,
Ni l’ivresse bruyante à la face rougie,
Ni l’oubli que tes sens demandent à l’orgie,
Ô Tzar, ni le tombeau !
Quand tu seras couché sous les dalles funèbres,
Puissent les pas du pope, errant dans les ténèbres,
Réveiller, dans l’horreur, ton âme de bandit !
Puissent toutes les voix de l’immense nature,
Pénétrant sans pitié jusqu’à ta sépulture,
Te répéter sans cesse : Ô Gottorp, sois maudit ! —
Les siècles passeront sans finir ton supplice.
Vlad l’Empaleur, en toi saluant son complice,
S’étonnera de voir son maître en cruauté.
Comme Caïn, sous l’œil de feu qui le regarde,
Devant le jugement de la postérité
Ton âme roulera, misérable et hagarde,
À travers l’infini, durant l’éternité !
C’est la voix du Seigneur qui parle par nos bouches.
C’est son regard qui luit dans nos regards farouches.
Sois maudit ! C’est sa main qui venge notre deuil.
Car nous sommes les fils, les frères et les femmes,
Les mères des soldats que tes complots infâmes
Ont immolés à ton orgueil !
Et nous prierons le Ciel de lever l’anathème
Quand tu pourras, Gottorp, par un pouvoir suprême
Que jamais tu n’auras,
Et retrouver leurs os, et rassembler leur cendre,
Et leur rendre la vie à tous, et nous les rendre,
Vivants, entre nos bras ! »
3/15 février 1878.
(1) Lorsqu’en 1812 la trahison de Démètre Mourouzi eut rendu les Russes maîtres de la Bessarabie, les exigences des gouverneurs moscovites forcèrent la population roumaine à émigrer en masse.
XXVI
Au Danube
I
Toi qui pourrais couler si pur,
Bleu Danube, et bercer sur tes vagues d’azur
Les lourds vaisseaux marchands aux mille ailes de toile,
Qui, d’Europe et d’Asie échangeant les trésors,
Fendent toutes les mers, emplissent tous les ports,
Et qui portent la paix dans les plis de leur voile…
Toi qui pourrais voir s’étaler
La prospérité sur tes rives,
Et qui dans ces climats n’arrives
Que pour voir ton cours se troubler…
Toi qui, plus fameux que le Tibre,
Pourrais rendre à l’Euxin les concerts de tes flots
Avec les chants joyeux de libres matelots
Naviguant sur un fleuve libre…
Les navires, hélas ! du Sultan souverain
Se meuvent sur tes eaux ; mais, revêtu d’airain,
Leur flanc contient toute une armée ;
Du Padisha lui-même ils ont reçu leurs noms,
Et des soldats, toujours, auprès des noirs canons
Tiennent une mèche enflammée.
Ils voguent, ne craignant ni ruse, ni complot,
Et prennent les villes pour cibles.
Le monde les croit invincibles
Jusqu’au jour où, glissant, discrète, sous le flot,
La torpille, que porte un fragile brûlot
S’attache à leur carène, éclate !… — Ou que la bombe
S’élance, aigle de feu, plane et soudain retombe,
Dans son vol foudroyant, sur ces fiers monitors,
Inutiles géants dont il ne reste alors
Qu’une immense clameur, des épaves sans nombre,
Et l’incendie au loin, rouge dans la nuit sombre !
II
Tzar et Sultan ont déchiré
Les traités d’amitié qui les liaient naguère ;
Chrétiens et Turcs ont arboré
Tous les étendards de la guerre.
Les uns disent en chœur quelques psaumes sacrés,
Sur l’armée ennemie appelant la défaite ;
Les autres, de sang altérés,
Hurlent le nom de leur prophète.
Et lances et canons, tout le sombre appareil,
Les ors et les aciers reluisent au soleil
Qui prête son éclat à la lugubre fête.
Du haut de ces remparts qui les protégeront,
Les Osmanlis railleurs, excitant l’adversaire,
Préludent aux combats en lui jetant l’affront
D’un geste de mépris, d’une épithète amère.
La haine imprègne l’atmosphère.
La haine à tous les yeux dérobe le danger.
De la rive roumaine à la rive bulgare
Une aveugle fureur des combattants s’empare ;
Ils brûlent de s’entr’égorger…
Et le fleuve limpide est là qui les sépare !
Mais le fleuve sera franchi !
Aux volontés du Tzar il n’est point de barrières.
Et déjà sous le poids de ces hordes guerrières,
Les ponts fragiles ont fléchi.
Aux Russes le canon chante la bienvenue.
La peur du fouet leur donne une force inconnue ;
Esclaves faits soldats, ils savent obéir.
À chaque pas qu’ils font leur nombre diminue ;
Nul ne reculera : nul n’oserait trahir.
Et sur ces bataillons que le boulet efface,
Sur tous ces hommes morts pour la gloire d’un seul,
Ainsi qu’un immense linceul,
Tu fermes à jamais ta paisible surface !
III
Danube bleu, les conquérants
Ont fait de toi le tombeau sombre
Où dorment, sous les flots errants,
De tant de peuples différents
Les générations sans nombre.
La masse de tes eaux ne pourrait égaler
La masse du sang et des larmes
Que les tyrans ont fait couler
Pour le triomphe de leurs armes.
Pour un rêve de vanité,
Pour décorer un nom d’un reflet de victoire
Qui le fit resplendir au livre de l’histoire,
Pour assouvir aussi la soif de liberté
Qui dévore toujours les nations esclaves,
Daces, Latins, Osmanlis, Slaves
Durant des siècles ont lutté.
Les uns, dans le trépas, ont rencontré la gloire ;
Les autres n’ont trouvé qu’un repos sans mémoire ;
Ils ont vu s’engloutir, avec leurs cavaliers,
L’espoir d’une splendeur future.
Tous, dans tes flots hospitaliers,
Ont, vainqueurs ou vaincus, reçu la sépulture.
Et tant qu’un Gottorp cachera
Son front vil sous un diadème ;
Tant que des monts Krapacks jusques au Sahara,
Un stupide Sultan, qui se croit Dieu lui-même,
Étendra son pouvoir ridicule et suprême ;
Tant que celui qui se soumet
Au dogme impur de Mahomet,
N’aura point au chrétien ouvert ses bras sincères ;
Opposant aux Césars un obstacle puissant,
Tant qu’ils n’auront point dit, saintement téméraires :
— La guerre est sacrilège et les hommes sont frères ! —
Danube, ton flot bleu sera rouge de sang !
IV
Mais un jour surgira, grand entre tous les autres.
Les yeux qui le verront ne seront point les nôtres,
Et le siècle béni qui doit le contenir
Est encore étendu dans le vague avenir.
La Concorde et la Paix régneront sur le monde ;
Les races, s’unissant d’une amitié profonde,
Ne se prêteront plus aux lâches attentats
De ces criminels potentats
Sur qui déjà l’orage gronde.
Délivré de ses rois bannis,
L’Orient lèvera son front mélancolique,
Danube, et l’on verra, sur tes bords rajeunis,
Des peuples libres réunis
La gigantesque République !
13/25 décembre 1877.
XXVII
Pierre le Grand à Iassi
Voir supra l’édition de 1878.
Marie Nizet, « Le Bonheur. Vers lus au banquet de l’Union littéraire, le 1er mars 1879 », in Revue de Belgique, 11e année, t. 31, 15 mars 1879, p. 333-335. Google Books
Le Bonheur
Oh ! ne cherchez pas trop loin
À travers l’espace
La chimère, le besoin :
Le Bonheur qui passe !
Il n’a dans nul lieu secret
Demeure ni règle,
Et son aile lasserait
Jusqu’au vol de l’aigle.
Il craint le désir jaloux,
Le vœu romanesque ;
Il faut, pour qu’il songe à vous,
N’y plus songer presque !
Vous dont les pleurs ont voilé
La sombre prunelle,
Peut-être il vous a frôlé
Du bout de son aile !
Quand vous quittiez l’âtre en deuil
Qui vous a vu naître,
Le Bonheur, à votre seuil,
Vous guettait peut-être !
Au bord de votre chemin,
Souriant et tendre
Il s’offrait, et votre main
N’avait qu’à le prendre.
Peut-être qu’il vous a dit,
Ce jour ou la veille,
Sans que nul ne l’entendît,
Un mot à l’oreille.
Mais vous, qui suiviez des yeux
Quelque ombre lointaine,
À son appel gracieux
Prîtes garde à peine.
Vous n’avez pas reconnu
Son être impalpable !…
Et le Plaisir est venu,
Ce Bonheur coupable !
Le Bonheur, ce n’est pourtant
Qu’un sourire, un songe,
Une parole, un instant
Qu’un instant prolonge.
Un espoir qui dure peu,
Qui trompe et caresse,
Et puis le contact de feu
D’une main qu’on presse !
Quand le Bonheur disparaît,
Chassé par un charme,
Il laisse au cœur un regret,
À l’œil une larme.
Il emporte de nos jours
La part la meilleure :
Mieux vaut l’ignorer toujours
Que l’étreindre une heure !
S’il prenait jamais souci
D’être enfin votre hôte,
Oh ! cachez-le bien, ainsi
Qu’on cache une faute.
Il aime l’ombre, le bruit
Toujours l’effarouche,
Il vit de mystère, il fuit
Sitôt qu’on le touche !
L’homme le plus pris aux nœuds
Du destin aride
Peut sentir dans ses cheveux
Son souffle timide.
Souvent il vient en sournois
À ce qui succombe ;
On l’a rencontré parfois
Au bord de la tombe.
Il est là dans quelque coin,
Prêt à vous surprendre…
Le Bonheur n’est jamais loin,
Pour qui sait l’attendre !

